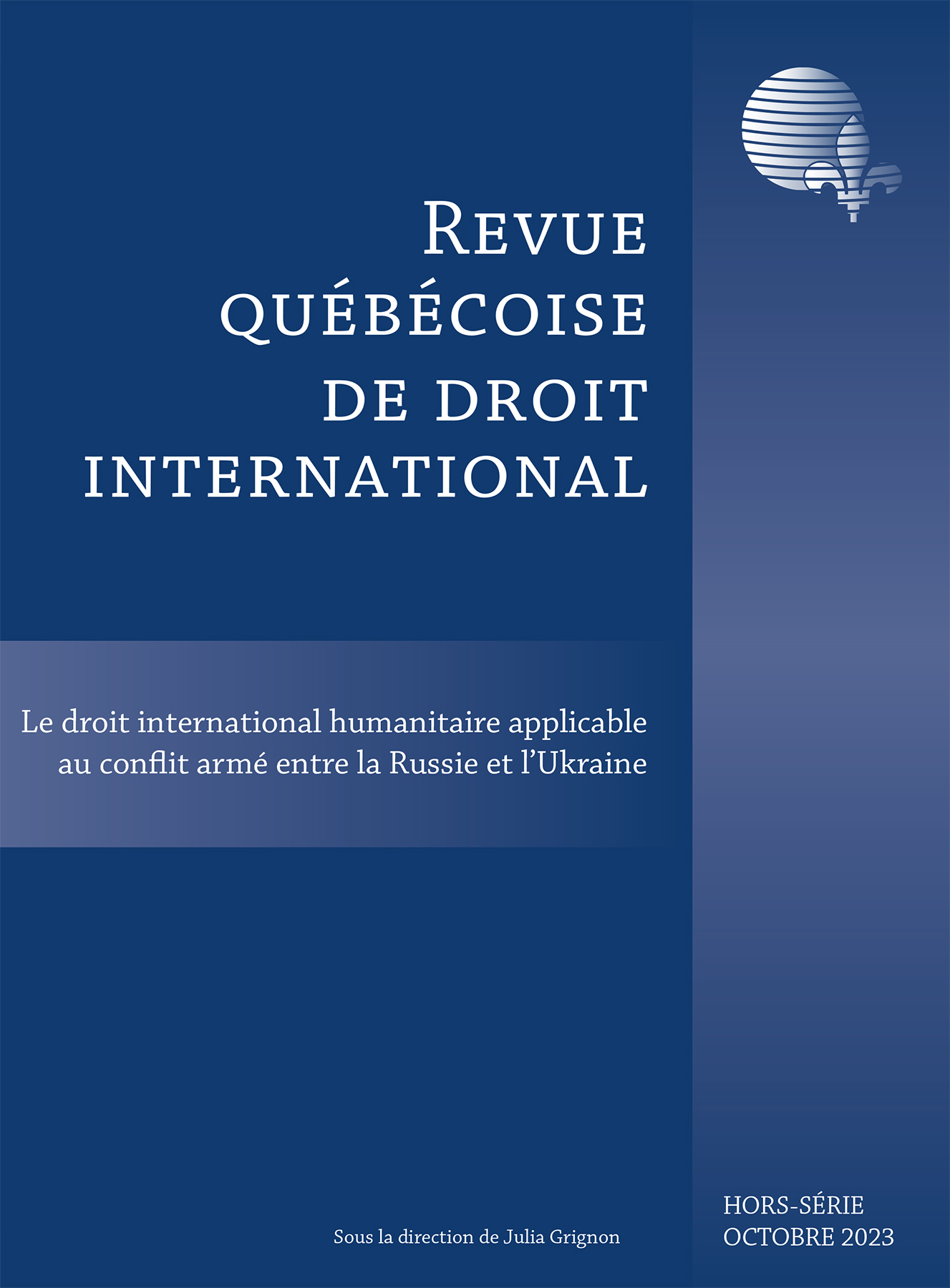Résumés
Résumé
La neutralité perpétuelle fait partie de l’identité suisse et permet au pays de préserver son indépendance et de garantir sa prospérité économique. La neutralité repose sur deux éléments fondamentaux : le droit de la neutralité et la politique de neutralité. Le premier définit les droits et devoirs d’un État neutre pendant un conflit armé international et, de ce fait, il est souvent associé au droit de la guerre. Le second possède un caractère discrétionnaire. L’État neutre, en tant que Puissance protectrice, peut proposer, dans le cadre de sa politique de neutralité, ses « bons offices » à des belligérants. Les autorités suisses interprètent régulièrement la pratique de neutralité adoptée par la Confédération suisse. Cela a été également le cas lors de l’invasion russe de l’Ukraine, fermement condamnée par la Suisse. Le rapport du Conseil fédéral du 11 avril 2022 sur la clarté et l’orientation de la politique de neutralité définit comment le pays envisage sa neutralité dans ce cas concret et quelles décisions ont été prises en lien avec son statut de neutralité, notamment en matière de transfert et d’exportation de matériel de guerre, de survol du territoire suisse par les parties belligérantes, d’accueil des blessés ou de cyberattaques.
Abstract
Perpetual neutrality is part of Switzerland’s identity, allowing the country to preserve its independence and guarantee its economic prosperity. Neutrality is based on two fundamental elements: the law of neutrality and the policy of neutrality. The first defines the rights and duties of a neutral state during an international armed conflict and is therefore often associated with the law of war. The second has a discretionary character. The neutral state, as a Protecting Power, may offer to belligerents its “good offices”, as part of its neutrality policy. The Swiss authorities regularly interpret the Swiss Confederation’s practice of neutrality. This was also the case during the Russian invasion of Ukraine, which was strongly condemned by Switzerland. The Federal Council’s Report of 11 April 2022 on the Clarity and Orientation of Neutrality Policy defines how the country intends to interpret its neutrality in this specific case and what decisions have been taken in relation to its neutrality status, particularly regarding the transfer and export of war material, the overflight of Swiss territory by belligerent parties, the reception of wounded persons or cyber-attacks.
Resumen
La neutralidad perpetua forma parte de la identidad de Suiza, permitiendo que el país preserve su independencia y garantice su prosperidad económica. La neutralidad se basa en dos elementos fundamentales: el derecho de neutralidad y la política de neutralidad. El primero define los derechos y deberes de un Estado neutral durante un conflicto armado internacional, por lo que a menudo se relaciona con el derecho de la guerra. El segundo tiene carácter discrecional. El Estado neutral, como Potencia protectora, puede ofrecer a los beligerantes sus “buenos oficios” como parte de su política de neutralidad. Las autoridades suizas interpretan regularmente la práctica de neutralidad de la Confederación Suiza. Lo mismo ocurrió durante la invasión rusa de Ucrania, que fue condenada enérgicamente por Suiza. El Informe del Consejo Federal del 11 de abril de 2022 sobre la claridad y orientación de la política de neutralidad define cómo el país pretende interpretar su neutralidad en este caso concreto y qué decisiones se han tomado en relación con su estatuto de neutralidad, especialmente en lo que respecta a la transferencia y exportación de material bélico, sobrevuelo del territorio suizo por las partes beligerantes, acogida de heridos y ciberataques.
Corps de l’article
La neutralité, qui vient du mot latin neuter signifiant « aucun des deux, ni l’un ni l’autre »[1], est étroitement liée à la Suisse, et pourtant, ni le droit international ni le droit interne helvétique ne définissent cette notion. La neutralité constitue un gage de prospérité de ce petit pays très actif sur la scène internationale et fait partie de son identité. Elle est souvent mise en avant par les autorités suisses « à l’instar d’autres éléments tels que l’absence de passé colonial, le fédéralisme ou la multiculturalité »[2]. À cela s’ajoutent la démocratie semi-directe et l’approche helvétique de gestion des conflits internes, fondée sur le compromis : « Les problèmes sont abordés et résolus par le dialogue. Cela exige certes du temps, mais permet de réunir un large consensus, pour un résultat final accepté et pérenne »[3]. Ces caractéristiques vont de pair avec la neutralité qui repose sur deux éléments constitutifs, le droit de la neutralité ainsi que la politique de neutralité.
La période suivant la Seconde Guerre mondiale est caractérisée par de multiples formes de belligérance et l’apparition d’autres phénomènes tels que
[l]e non-alignement, l’isolationnisme, le devoir d’ingérence, la participation aux opérations militaires internationales, la raréfaction des déclarations de guerre et les conflits avec des acteurs non étatiques ayant fait entrer l’Europe et le monde dans une époque de post-neutralité[4],
d’où la difficulté d’interpréter et d’appliquer le droit de la neutralité. Lors de la première décennie après la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a décidé de maintenir la neutralité intégrale. La doctrine dite de Bindschedler, devenue une doctrine d’État à cette époque, prônait l’interprétation stricte de la neutralité helvétique[5]. Par conséquent, la Suisse était liée par « des devoirs de neutralité d’un pays durablement neutre »[6], notamment le devoir de s’abstenir d’adhérer à une organisation politique non universelle comme l’Organisation des Nations unies (ONU)[7], de ne s’associer à aucune sanction de l’ONU ni de participer à une union à caractère économique[8].
Un tournant majeur sur le plan de la conception de la neutralité s’est opéré au début des années quatre-vingt-dix, marquées par la chute du communisme et la guerre du Golfe. C’est à cette époque que le Conseil fédéral a décidé que la Suisse prendrait part, pour la première fois dans son histoire, à des sanctions non militaires adoptées par l’ONU contre un État impliqué dans un conflit international, en l’occurrence l’Irak[9]. Cette position exigeait néanmoins une clarification; ainsi le Conseil fédéral a rédigé en 1993 le Rapport sur la neutralité (Rapport 93)[10] considéré depuis comme un texte de référence sur la conception de la neutralité de la Suisse[11]. Par la suite, il s’est régulièrement référé à ce texte, notamment lorsque la neutralité helvétique a été confrontée à de nouvelles situations relevant du droit international humanitaire[12]. C’était également le cas lors de l’agression russe sur le territoire de l’Ukraine le 24 février 2022, qui a suscité de nombreuses interrogations au sein de la population et de la classe politique suisses. Bien que la Suisse ait généreusement ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiens[13], un besoin de débat mettant à l’épreuve la neutralité est apparu, notamment pour savoir quelle position devrait adopter le pays par rapport à cet événement. Devrait-il se tenir à l’écart du conflit en se limitant à proposer ses « bons offices » aux parties belligérantes? N’outrepasserait-il pas son statut d’État neutre en s’alignant sur les sanctions à l’encontre de la Russie, adoptées par d’autres pays ainsi que par l’Union européenne (UE)?
Notre réflexion portera sur la conception de la neutralité que la Suisse a appliquée depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. L’interprétation de la neutralité est capitale, car la Suisse dispose d’une large marge de manoeuvre en la matière et peut adapter sa neutralité au contexte international du moment. De plus, les droits et obligations d’un État neutre appliqués en vertu du droit de la neutralité sont peu connus[14] (I). Nous analyserons également les positions concrètes prises par la Suisse par rapport à cette agression et déterminées par son statut de neutralité (II).
I. Le statut juridique de neutralité de la Confédération suisse
Notons que la neutralité ne figure pas directement parmi les buts de la Confédération définis à l’article 2[15] de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999[16]. Comme le souligne la doctrine constitutionnelle suisse, l’absence de la neutralité dans cet article est justifiée par le fait qu’elle ne constitue pas un but en tant que tel. Il s’agit d’un instrument, l’un parmi d’autres, qui permet à la Suisse d’atteindre ses objectifs et particulièrement de préserver son indépendance. Bien que la crainte de marginalisation de la Suisse sur la scène internationale soit souvent évoquée et considérée comme un danger pour ce pays[17], l’indépendance du pays neutre n’exclut en aucun cas son adhésion à une organisation supranationale ou de sécurité collective[18].
La neutralité est mentionnée expressément par les articles 173, alinéa 1a) et 185, alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération en vertu desquels l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral « prennent les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse »[19]. Depuis la création de l’État fédéral en 1848, la neutralité constitue une composante des politiques de sécurité et extérieure. Cette neutralité est permanente, dans le sens que la Suisse reste à l’écart de tous les conflits, y compris les conflits futurs, ceci indépendamment de l’identité des belligérants comme du lieu et du moment de l’affrontement[20].
La neutralité suisse découle d’un acte du droit international public, en l’occurrence l’Acte final du Congrès de Vienne du 20 mars 1815, et du Traité de Paris du 20 novembre 1815 qui « font entrer la neutralité suisse dans le droit positif »[21]. Même si sa neutralité est reconnue à l’échelle internationale, la Suisse peut librement et unilatéralement renoncer à son statut d’État neutre. Notons que seules la Suisse et l’Autriche[22] sont reconnues au niveau du droit international en tant qu’États neutres permanents qui se sont volontairement engagés à respecter le droit de la neutralité[23].
La neutralité permanente doit être distinguée d’autres statuts de neutralité ou d’attitudes adoptées par les États en cas de conflit armé international. C’est le cas notamment de la neutralité occasionnelle adoptée uniquement lors d’un conflit déterminé. Un État peut ainsi opter pour une position neutre au cas par cas. En outre, la neutralité permanente en tant que statut juridique se distingue de la neutralité permanente de fait, cette dernière n’imposant pas à l’État concerné d’obligations juridiques[24]. Par ailleurs, les États neutres sont toujours non-alignés sur le plan militaire. En revanche, les États non-alignés ne sont pas tous neutres. L’adoption de statut de non-alignement permet à un État d’indiquer qu’il ne fait pas partie d’une alliance militaire.
La Suisse a également pratiqué, au cours de son histoire, la neutralité différentielle. Cette notion est apparue au moment de son accession comme membre de la Société des Nations (SdN). C’est dans ce contexte que le pays a dû faire des concessions, notamment sur le plan de son statut d’État neutre[25]. La neutralité différentielle a été énoncée par le Conseil de la SdN dans sa Déclaration de Londres de 1920 sur l’adhésion de la Suisse à cette organisation[26]. Le pays pouvait conserver sa neutralité militaire, étant donc dispensé de participer à des sanctions à caractère militaire. En revanche, il était tenu d’appliquer des sanctions économiques et financières dans les mêmes conditions que d’autres États membres de la SdN[27]. Finalement, le pays a retrouvé sa neutralité intégrale le 14 mai 1938[28].
Enfin, la neutralité suisse est armée[29] et repose sur l’obligation constitutionnelle de service militaire pour tout homme de nationalité suisse[30]. Néanmoins, les Suisses ont la possibilité de recourir au service de remplacement[31]. L’obligation de servir signifie que la Suisse a le droit d’assurer l’inviolabilité de son territoire et de se défendre militairement compte tenu du fait qu’elle ne peut pas s’appuyer sur une alliance militaire[32]. Par conséquent, il revient à la Suisse l’obligation de défendre son territoire. Par ailleurs, le droit de la neutralité admet le recours à la force par la Puissance neutre lorsqu’elle repousse des atteintes à sa neutralité. Dans ce cas, ses agissements ne seront pas qualifiés d’actes hostiles[33]. De l’avis des autorités suisses, le fait de disposer d’une armée constitue une sorte de gage qui renforce la crédibilité ainsi que l’efficacité de sa neutralité[34]. C’est parce qu’elle est armée que la Suisse peut demeurer neutre.
De ce fait, cette neutralité doit être interprétée comme « une attitude de réserve » en lien avec le devoir d’abstention de toute participation aux hostilités et de soutien militaire à des parties au conflit[35]. La Suisse, en tant qu’État neutre, est liée par le droit de la neutralité (A). Néanmoins, elle a défini les principes en lien avec la neutralité qu’elle a décidé d’appliquer à l’égard de la Russie et de l’Ukraine (B). Par ailleurs, elle offre, sur le plan diplomatique, ses « bons offices » dans le cadre de sa politique de neutralité (C).
A. Les droits et devoirs d’État neutre en vertu du droit de la neutralité
L’ensemble des règles que les États neutres et les États belligérants sont tenus de respecter en cas de conflit armé international constitue le droit de la neutralité. Ce droit est codifié par deux conventions de La Haye – la Convention V concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (Convention V)[36] et la Convention XIII concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime[37]–, adoptées lors de la seconde conférence de la paix qui s’est tenue à La Haye le 18 octobre 1907. La coutume internationale complète ces conventions; ainsi, les règles qu’elles prévoient en cas de guerre sur terre et de guerre maritime s’appliquent par analogie à la guerre aérienne. Le droit coutumier impose à l’État neutre une seule obligation en période de paix, celle de ne pas participer à des alliances militaires. Les conventions de La Haye ont été adoptées « à une époque où le principe d’interdiction du recours à la force armée n’était pas encore bien établi, ce qui complique son application aux circonstances actuelles »[38], et de ce fait, la neutralité apparaît comme une des notions les plus indéterminées en droit international public. Quant à la doctrine, elle souligne « l’état chaotique du droit de la neutralité »[39].
La neutralité, décrite comme « la fille de guerre »[40], s’applique uniquement pendant un conflit armé entre États et non lors d’un conflit armé interne. De ce fait, elle est souvent associée au droit international humanitaire, bien qu’elle entraîne, pour l’État neutre, des conséquences par rapport au droit de recourir à la guerre :
Le développement du jus in bello s’attache par exemple à identifier le statut de la neutralité qui comporte pour les belligérants comme pour les neutres des droits et des obligations, fondés sur la non-participation au conflit et la non-intervention. En même temps, la neutralité permanente entraîne une limitation substantielle du droit de recourir à la guerre – jus in bellum – sauf en cas de légitime défense ou de renonciation régulière au statut[41].
Conformément aux conventions de La Haye, l’État neutre a le devoir de s’abstenir de prendre part à des hostilités (article 2), de fournir et d’apporter un soutien aux parties belligérantes sous la forme de troupes ou en leur offrant du matériel de guerre. Il lui est également interdit de mettre son propre territoire à la disposition des belligérants (articles 1 et 5). Le statut de neutralité impose à l’État neutre un devoir d’impartialité, et, en conséquence, les mesures qu’il adopte en cas de conflit armé international doivent être les mêmes pour les deux parties au conflit (article 9). Ce droit garantit l’inviolabilité du territoire d’un État neutre par les belligérants, ces derniers étant tenus de ne pas faire circuler leurs troupes, convois de munitions ou de vivres par voie terrestre, maritime et aérienne (articles 2 à 4).
B. Les principes en matière de neutralité adoptés par la Suisse à l’égard de la Russie et de l’Ukraine
Dans son rapport du 7 septembre 2022, le Conseil fédéral[42] a analysé en détail les conséquences de la guerre en Ukraine et a mis l’accent sur l’interprétation qu’il entend donner à la neutralité[43]. Il a décidé d’adopter trois principes en lien avec la neutralité à l’égard de la Russie et de l’Ukraine, à savoir : l’application du droit de la neutralité par la Suisse aux deux États belligérants (1); la neutralité ne signifie pas l’indifférence de la Suisse face aux violations du droit international (2); la reprise des sanctions adoptées par l’UE n’est pas contraire à la neutralité (3).
1. L’application du droit de la neutralité aux États belligérants
La délimitation temporelle du conflit est d’une importance particulière, car c’est en fonction de celle-ci qu’il incombe à l’État neutre de déterminer à partir de quel moment il est tenu d’appliquer le droit de la neutralité et quand cette application prend fin. Ainsi, aux termes de la Convention III relative à l’ouverture des hostilités :
L’état de guerre devrait être notifié sans retard aux Puissances neutres. […] Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l’absence de notification, s’il était établi d’une manière non douteuse qu’en fait elles connaissaient l’état de guerre[44].
En pratique, la notification de l’état de guerre auprès des États neutres ne va pas de soi puisque, très souvent, les États participant à des hostilités ne qualifient pas la situation en question comme une guerre. L’opération militaire lancée contre l’Irak en mars 2003 par les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni peut illustrer cette situation. Les autorités suisses ont dû déterminer si cette opération était expressément légitimée par le Conseil de sécurité de l’ONU, puisque la neutralité ne s’applique pas si une action de nature militaire s’appuie sur une résolution de cet organe votée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression)[45]. En revanche, le droit de la neutralité s’applique lorsqu’une action militaire effectuée par un État ou un groupe d’États sur un territoire d’un autre État est menée sans le consentement de ce dernier et sans mandat du Conseil de sécurité[46]. Dans ce cas, cette action constitue un conflit armé international. Finalement, en tant qu’État neutre, la Suisse « n’avait pas d’autre choix que d’appliquer le droit de la neutralité »[47] au conflit irakien. Ce constat a eu pour conséquence l’application scrupuleuse des devoirs d’une Puissance neutre. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que la Suisse devait observer les droits et les devoirs qui incombent aux États neutres et que la neutralité s’appliquait à l’égard des deux États belligérants[48].
Concernant la constatation de la fin des hostilités, notons que le droit international public ne prévoit pas de dispositions spécifiques en la matière. Il revient aussi à l’État neutre de déterminer si, compte tenu des circonstances, le conflit peut être considéré comme terminé. La fin effective des opérations militaires[49] constitue l’élément clé permettant de formuler ce constat. Cette situation peut se produire à la suite d’un accord de capitulation, avec un cessez-le-feu ou lorsqu’une partie ne peut plus se défendre militairement (debellatio). À partir de ce moment, les devoirs de l’État neutre prennent fin en vertu du droit de la neutralité.
À titre d’exemple, le Conseil fédéral a constaté que le conflit en Irak a pris fin le 16 avril 2003 en raison de « la défaite de l’armée irakienne et la cessation de facto des actes de guerre »[50]. Par conséquent, le droit de la neutralité n’était plus applicable et le Conseil fédéral a décidé de lever les mesures prises avant et au cours du conflit. Quant à la fin de la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral sera de nouveau confronté à l’épineuse question du constat de cessation des actes de guerre pour décider si le conflit peut être considéré comme terminé en vertu du droit de la neutralité[51].
2. La condamnation ferme de l’agression russe
Le 23 février 2022, le Conseil fédéral a condamné la reconnaissance des régions ukrainiennes de Lougansk et de Donetsk par la Russie, considérant qu’elle a enfreint les accords de Minsk de 2014[52]. Postérieurement, la Suisse a condamné l’attaque russe en Ukraine du 24 février, la jugeant contraire au droit international et la qualifiant d’« agression ». Le terme « guerre » est ensuite apparu dans le discours officiel[53]. Le rapport du 7 septembre 2022 souligne que la Suisse a fermement condamné l’agression russe et s’est associée aux sanctions de l’UE[54]. La neutralité ne signifie en aucun cas que la Suisse reste neutre en termes de valeurs. Claude Wild, ambassadeur de Suisse en Ukraine, a exprimé la position helvétique dans les termes suivants : « nous sommes clairement derrière la position de l’Ukraine », en désignant la Russie comme un « agresseur » déclenchant « la guerre d’agression »[55].
La neutralité suisse n’est pas figée, elle s’adapte aux enjeux politiques mondiaux. Comme le souligne Micheline Calmy-Rey, ancienne présidente de la Confédération helvétique : « La Suisse est passée d’une neutralité de nécessité fondée d’abord sur un besoin de sécurité à une neutralité active assise sur le droit international »[56] qu’elle pratique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
3. L’alignement sur les sanctions de l’Union européenne conforme au droit de la neutralité
Selon la doctrine et la pratique adoptée par les États neutres, le droit de la neutralité n’interdit pas l’application de sanctions à caractère économique. En tant qu’État membre de l’ONU, la Suisse est juridiquement tenue d’appliquer les sanctions décidées par le Conseil de sécurité. Elle peut également participer à des sanctions économiques prises par l’UE ou un groupe d’États, mais n’a aucunement l’obligation de le faire.
Étant donné que l’UE a adopté des sanctions économiques à l’encontre de la Russie en réaction à la violation du droit international par ce pays, de l’avis du Conseil fédéral « on peut leur attribuer une fonction de maintien de l’ordre international »[57]. La Suisse a donc décidé de reprendre intégralement ces sanctions le 28 février 2022[58], en vertu des dispositions de la Loi fédérale sur l’application des sanctions internationales du 22 mars 2002 (dite Loi sur les embargos)[59]. Les dispositions de l’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine et prévoyant les sanctions et leur mise en oeuvre ont un caractère contraignant[60]. Parmi les mesures adoptées, nous pouvons noter celles visant l’interdiction de la vente, de la livraison, de l’exportation et du transit, entre autres, des biens d’équipement militaires[61], des biens à double usage (civil et militaire)[62], des biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité militaires[63]. De l’avis du Conseil fédéral, lors de la reprise des sanctions de l’UE, la Suisse a « entièrement respecté les obligations découlant du droit de la neutralité »[64].
Il convient de souligner que cet alignement sur les sanctions européennes diverge de la position adoptée après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. À l’époque, la Suisse avait condamné l’annexion de la Crimée par la Russie, mais elle ne s’était pas associée aux sanctions de l’UE[65]. Néanmoins, elle s’était engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que son territoire soit utilisé comme plateforme pour contourner les sanctions internationales. Le Conseil fédéral a pris cette position dans un contexte particulier, celui de la présidence suisse de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe[66]. Il était d’avis que la Suisse devait être perçue par les deux parties comme un partenaire crédible; c’est pour cette raison qu’il a décidé qu’il était dans son intérêt de ne pas reprendre l’ensemble des sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie.
Le changement de position en 2022 a été justifié par le fait que « les dimensions de la guerre d’agression et l’intensité des violations du droit international étaient différentes »[67] même si, dans les deux cas de figure, il s’agissait d’une violation du droit international. Ainsi, avant de prendre une décision sur la reprise totale ou partielle, voire la modification, des sanctions économiques internationales, le Conseil fédéral analyse chaque situation et prend en compte les intérêts de la Suisse.
C. La politique de neutralité réalisée par l’intermédiaire des « bons offices »
Contrairement au droit de la neutralité, la politique de neutralité ne relève d’aucune règle de droit[68]. Ainsi, elle est menée et façonnée par l’État neutre en dehors des obligations liées au droit de la neutralité. Le Conseil fédéral met l’accent sur le fait que tant le contenu de la politique de neutralité que sa mission ne sont pas immuables et « subissent des changements au fil du temps »[69]. L’application de la politique de neutralité est toujours liée au contexte international du moment et permet à la Suisse de renforcer son image de crédibilité au sein de la communauté internationale, notamment en période de guerre, dans le sens qu’elle sert à convaincre les autres États que la Suisse se comportera de manière neutre en cas de conflit armé et qu’elle se conformera au droit de la neutralité[70].
Les « bons offices », proposés dans le cadre de mandats de puissance protectrice[71], représentent un outil très efficace dans la promotion de la paix et font partie intégrante de la politique extérieure, telle qu’elle est définie par la Constitution fédérale[72]. C’est le cas notamment lorsque deux États interrompent leurs relations diplomatiques. Dans ce contexte, un État tiers peut accepter de représenter, en tant que Puissance protectrice, les intérêts d’une des parties auprès de l’autre, notamment en période la guerre, ces services étant rémunérés par l’État mandant.
La Loi fédérale sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme du 19 novembre 2003 dispose que la Confédération contribue à « prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés »[73]. La Suisse « applique la notion de “bons offices” aux domaines que sont les mandats de puissance protectrice (représentation d’intérêts étrangers), la politique d’État hôte ainsi que la facilitation de dialogue et la médiation »[74]. Les débuts de cette expérience datent de la guerre franco-prussienne (1870-1871) pour atteindre son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque la Suisse représentait les intérêts réciproques de trente-cinq pays dans le cadre de deux cents mandats[75]. Actuellement, elle exerce les mandats de puissance protectrice pour : l’Iran en Égypte (depuis 1979); les États-Unis en Iran (depuis 1980); la Russie en Géorgie et la Géorgie en Russie (depuis 2009)[76]; l’Arabie saoudite en Iran et réciproquement (depuis 2017); et depuis 2019, elle représente les intérêts iraniens au Canada.
La Suisse a dû adapter sa politique de neutralité au contexte de la guerre en Ukraine. Depuis l’agression russe, les relations entre la Suisse et la Russie ont considérablement changé. La Russie a qualifié la Suisse de « pays inamical » au moment de la reprise des sanctions de l’UE. Pourtant, la Suisse n’a pas refusé d’accorder des visas aux ressortissants russes participant à des discussions internationales se déroulant dans le cadre des Nations unies ou d’autres organisations internationales basées à Genève, bien que cette position ne soit pas unanime sur le continent européen[77]. Contrairement aux États membres de l’UE, elle n’a pas expulsé de son territoire les diplomates russes même si elle s’attend à un accroissement de l’activité d’espionnage sur son territoire, particulièrement à Genève. Les autorités suisses soulignent que ces activités visent tant la Suisse que les États tiers qui possèdent des représentations auprès des organisations internationales situées à Genève[78]. Cette position a permis à la Suisse d’assurer le bon fonctionnement de son ambassade à Moscou, au sein de laquelle se trouve une section chargée de représenter les intérêts de la Géorgie auprès de la Russie dans le cadre du mandat de la puissance protectrice exercé par la Suisse[79].
En outre, en tant qu’allié de la Syrie, la Russie a demandé que son gouvernement boycotte les pourparlers sur la nouvelle constitution syrienne qui devaient se tenir en juillet 2022 à Genève sous l’égide des Nations unies[80]. D’après la mission permanente de la Fédération de Russie à Genève, « la Suisse a malheureusement abandonné son statut de neutralité »[81]. À la demande de l’Ukraine, la Suisse a préparé le mandat de puissance protectrice visant à représenter ses intérêts auprès de la Russie. Ce mandat a été fermement refusé par la Russie car la Suisse, selon elle, s’est associée à « des sanctions illégales » de l’UE. Ainsi, « il est tout à fait incompréhensible de proposer une médiation, une représentation ou d’autres services de bonne volonté alors que l’on se comporte de cette manière »[82]. Il semble difficile d’envisager dans le contexte actuel que la Suisse puisse agir en tant qu’intermédiaire entre les deux belligérants.
II. L’application des droits et devoirs d’État neutre aux situations en lien avec la guerre en Ukraine
L’étude du Stockholm International Peace Research Institute, se référant à la période de 2017 à 2021, place la Suisse au quinzième rang des exportateurs de matériel de guerre à l’échelle internationale[83]. En 2021, l’industrie de l’armement représentait 0,21 % des exportations dans l’ensemble des marchandises suisses[84]. Cependant, il s’agit d’un sujet très sensible qui revient régulièrement dans le débat public suisse. Des interrogations portent sur la question de savoir si le pays neutre, qui abrite d’ailleurs le siège du Comité international de la Croix-Rouge et qui est dépositaire des conventions de Genève[85], peut se permettre, à des fins mercantiles, d’exporter du matériel de guerre dans des zones de conflits, et ceci d’autant plus qu’il jouit d’une très grande crédibilité en matière de droit international humanitaire.
Comme le souligne Hans Urlich Jost, « lors des moments délicats, la “neutralité helvétique” servira aussi d’obus fumigène pour camoufler l’engagement douteux de la Suisse dans des affaires commerciales ou politiques avec des pays étrangers »[86].
La neutralité est aussi interprétée comme un « modèle d’affaires » indispensable pour la survie de la Suisse[87]. L’exportation de matériel de guerre est certainement le domaine où la relation entre le droit de la neutralité et la politique de neutralité entre en ligne de mire[88], comme en témoigne le positionnement suisse notamment en matière de livraison et d’exportation de matériel de guerre (A), de transit par son territoire et d’accueil des blessés (B) et de l’application de neutralité à l’espace numérique (C).
A. La distinction entre le transfert et l’exportation de matériel de guerre pendant le conflit armé international
Du point de vue juridique, il convient de distinguer deux cas de figure : les transferts de matériel de guerre appartenant à la Suisse en tant qu’État neutre et les exportations réalisées par les entreprises privées suisses. Le droit de la neutralité impose à un État neutre le devoir de ne pas mettre à la disposition d’un État belligérant du matériel de guerre. Ainsi, en vertu de ce droit, la Suisse ne peut pas transférer directement ce matériel en provenance des stocks de son armée ni vers l’Ukraine ni vers la Russie. Même si la Suisse reste solidaire avec l’Ukraine, elle ne peut aucunement lui fournir une aide militaire. Cependant, le droit de la neutralité ne restreint pas la liberté de commerce avec les belligérants, y compris en ce qui concerne les exportations de matériel de guerre[89].
1. La liberté de commerce de matériel de guerre prévue par le droit de la neutralité et sa règlementation en droit suisse
La Suisse n’est pas tenue « juridiquement, d’observer une neutralité économique »[90] et de limiter le commerce privé de matériel de guerre effectué par les entreprises suisses. Conformément à l’article 7 de la Convention V, « une Puissance neutre n’est pas tenue d’empêcher l’exportation ou le transit, pour le compte de l’un ou de l’autre des belligérants, d’armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte »[91]. Néanmoins, si l’État neutre décide d’appliquer des restrictions par rapport aux exportations dans ce domaine, il est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement (devoir d’appliquer les mêmes restrictions à l’égard des deux parties au conflit)[92].
La réalité est pourtant bien différente, puisque pratiquement tous les États possèdent une législation nationale visant à contrôler l’exportation de matériel de guerre par des entreprises privées en établissant un système d’autorisation d’exporter. C’est également le cas de la Suisse, qui contrôle la fabrication et le transfert de matériel de guerre ainsi que la technologie qui lui est relative, en vertu des dispositions de la Loi fédérale sur le matériel de guerre[93] (LFMG) et de l’Ordonnance sur le matériel de guerre[94].
Conformément à la LFMG :
La fabrication, le courtage, l’exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l’étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales[95].
Par ailleurs, cette autorisation sera refusée lorsque le pays destinataire des exportations est impliqué dans un conflit armé interne ou international[96]. En outre, l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 mars 2022 prévoit que :
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits[97].
De ce fait, la législation interne suisse va plus loin que le droit de la neutralité et interdit les exportations privées de matériel de guerre directement vers la Russie et l’Ukraine, pays impliqués dans un conflit armé international.
2. Les requêtes concernant le transfert de matériel de guerre et de matériel de protection adressées aux autorités suisses
Les autorités suisses ont reçu de nombreuses requêtes de la part d’autres États européens portant directement sur la livraison de matériel de guerre suisse[98]. L’objet de ces requêtes représente un très large et intéressant spectre de situations, notamment du point de vue du droit de la neutralité. Faisant référence à sa neutralité et à la LFMG, le Conseil fédéral a pris la position selon laquelle la Suisse « ne pouvait pas autoriser et n’autorisera pas de livraison d’armes à une partie belligérante dans un conflit armé international »[99]. Néanmoins, chaque demande relative au matériel de guerre formulée par d’autres États sera examinée au cas par cas.
L’Allemagne et le Danemark, les plus grands importateurs de matériel de guerre suisse en 2021[100], ont demandé son accord en vue de la réexportation de ce matériel en Ukraine. Il s’avère nécessaire, puisque ces États ont signé, au moment de l’acquisition du matériel de guerre, une déclaration de non-réexportation[101] conformément à laquelle ils se sont engagés à ne pas transférer le matériel acquis sans accord préalable de la Suisse[102]. En évoquant le principe d’égalité de traitement et les dispositions de la LFMG, la Suisse a pris la position selon laquelle la remise de matériel de guerre suisse par des États européens à l’Ukraine doit être refusée.
Un autre type de requêtes concerne le matériel de guerre provenant des anciens stocks et stocks actuels de l’armée suisse. De nombreux États européens ont mis une partie de leur matériel de guerre à la disposition de l’Ukraine et ont souhaité reconstituer leurs propres stocks. Ces requêtes ont été déposées notamment par l’Allemagne, la Pologne et la Grande-Bretagne. Elles concernent « l’aliénation de matériel excédentaire de l’armée »[103].
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), destinataire de ces requêtes, a autorisé l’Allemagne à disposer librement des chars de combat de type Leopard 2A4. Il s’agit en effet des chars revendus, il y a douze ans, à une entreprise allemande[104] par l’Office fédéral d’armement armasuisse[105]. De ce fait, les autorités suisses confirment que l’Allemagne peut décider librement de la manière selon laquelle elle souhaite ultérieurement utiliser ces chars « car il n’y a pas de contraintes dans ce domaine »[106]. En outre, c’est la législation allemande relative à l’exportation de matériel de guerre qui s’applique dans ce cas.
En revanche, la demande polonaise, motivée par le fait que le pays « a livré des armes en quantité substantielle à l’Ukraine » et qu’il souhaitait urgemment reconstituer ses stocks, a été refusée[107]. La Pologne était également intéressée par l’acquisition de chars de combat de type Leopard 2A4, à une différence près, à savoir qu’elle a souhaité acquérir des chars désaffectés. Dans ce cas, l’aliénation de ce type de chars par la Suisse à un autre État exige leur mise hors service, donc engendre des coûts, ce qui nécessite l’approbation du Parlement dans le cadre du Message annuel sur l’armée établi par le Conseil fédéral. Pour cette raison, l’aliénation de chars désaffectés ne pouvait pas être réalisée dans un délai utile[108]. Cependant, le DDPS n’a pas précisé comment il interprète le terme « délai utile » ni s’il serait possible à la Pologne de renouveler sa demande.
Un autre exemple concerne la requête venant de la Grande-Bretagne sur la cession d’armes polyvalentes à épauler, Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW)[109], que la Suisse a commandées auprès de la société suédoise Saab. Dans ce cas concret, la demande portait sur des armes commandées, ne se trouvant pas encore en possession de la Suisse. La livraison de NLAW à la Suisse devait être échelonnée. La Grande-Bretagne a demandé si la Suisse pouvait céder la première livraison de ce matériel en sa faveur et la recevoir plus tard. Le Conseil fédéral a accepté cette demande en cédant les deux premiers lots de NLAW, qui correspondent à 30 % de la commande suisse. Par conséquent, les lots retardés devraient être livrés à la Suisse jusqu’à la fin de 2024. Du point de vue des intérêts militaires de la Suisse, ce retard ne constitue pas un problème puisque l’armée suisse dispose d’autres systèmes d’armes de défense antichars.
L’armée ukrainienne a demandé à la Suisse de lui fournir des biens et du matériel de protection[110]. Cette demande a été refusée car elle concerne les équipements relevant de la catégorie des biens utilisables à des fins militaires[111] tels que les casques et les gilets pare-balles, classés en tant que biens militaires spécifiques[112]. Inversement, sont acceptées les demandes concernant les biens humanitaires comme les médicaments, les matelas, les sacs de couchage ou les biens en provenance de la pharmacie de l’armée suisse.
B. Les demandes de transit par le territoire suisse et d’accueil des blessés ukrainiens
Le statut de neutralité impose à la Suisse l’obligation de ne pas mettre son territoire à la disposition des États belligérants, et cette interdiction s’applique également aux survols de son territoire aérien. Ainsi, les transits par la Suisse tels
le survol à des fins militaires d’avions militaires des parties en conflit ainsi que le survol d’avions militaires d’autres États dans le but d’apporter un soutien militaire aux parties en conflit, notamment par la livraison de matériel de guerre[113][,]
sont interdits pendant la guerre en Ukraine. En revanche, les survols à caractère humanitaire, tels que le transport aérien des blessés, restent autorisés. Toute autre demande relative à des survols en lien avec le conflit en Ukraine doit être préalablement soumise à l’examen du Conseil fédéral qui se réserve « la décision d’autoriser ou de refuser les survols de nature militaire au vu de l’ensemble des circonstances »[114].
Le Conseil fédéral avait adopté la même position pendant la guerre en Irak. À l’époque, l’interdiction de survols visait des avions américains. D’après son appréciation, ces survols « avaient pour objectif évident »[115] de préparer une opération militaire en Irak. Cette interdiction s’appliquait aussi aux survols de reconnaissance et de surveillance[116].
Le Département fédéral des affaires étrangères a également avancé l’argument de neutralité et n’a pas donné de suite favorable à l’appel de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), datant de mai 2022, d’accueillir des personnes blessées lors de la guerre en Ukraine. Bien que la Suisse ne soit pas membre de l’OTAN, elle participe au Partenariat pour la paix, l’instrument de coopération entre l’OTAN et ses partenaires, lancé en 1994.
L’appel de l’OTAN n’a pas précisé de quelle sorte de blessés il s’agissait, civils ou militaires. De plus, l’organisation a mentionné que les personnes soignées dans les États partenaires devraient retourner en Ukraine. L’ambiguïté de cet appel a été à l’origine du refus puisque les autorités helvétiques n’étaient pas en mesure d’établir avec certitude s’il s’agissait de blessés civils ou militaires. Cette position était fondée sur les dispositions de la Convention I de Genève[117] et de la Convention V, qui prévoient l’internement par l’État neutre des troupes appartenant aux armées belligérantes pour éviter qu’elles prennent part aux opérations de guerre.
Par conséquent, en acceptant la demande de l’OTAN, la Suisse risquerait d’accueillir sur son territoire les militaires blessés et, dans ce cas, elle serait tenue de les interner, car les militaires soignés dans un État neutre ne peuvent retourner sur les champs de bataille[118]. Une attitude contraire aurait signifié un soutien militaire en faveur de l’Ukraine. La Suisse ne s’oppose pas en revanche à l’accueil des civils blessés. Elle a accepté les demandes de l’Ukraine des 19 et 20 juillet 2022 visant expressément la prise en charge des civils ukrainiens blessés[119].
C. Le droit de la neutralité et l’espace numérique
Bien que les autorités suisses considèrent comme improbable « une agression armée directe de la Russie contre la Suisse, notamment avec les troupes au sol »[120], elles sont conscientes que la Suisse peut être directement atteinte par les effets de la guerre en Ukraine, notamment par le biais de cyberattaques de la part de la Russie. Le Conseil fédéral, dans son rapport du 7 septembre 2022, fait le constat suivant :
Avec la guerre, les activités russes d’influence et les opérations de désinformation vis-à-vis de la Suisse ont elles aussi augmenté, du fait notamment que notre pays abrite le siège de nombreuses organisations internationales[121].
L’interconnexion internationale croissante signifie que les cyberattaques ont des effets au-delà des frontières et qu’elles peuvent également toucher des équipements en Suisse. En cas d’escalade du conflit, il faut aussi s’attendre à des cyberattaques visant directement des cibles en Suisse[122].
Trois conditions doivent être réunies pour que le droit de la neutralité puisse être appliqué dans l’espace numérique, à savoir : l’existence d’un conflit armé, le fait que la cyber-opération corresponde à un acte militaire direct et le fait que la cyberattaque puisse être attribuée à un État au sens du droit international. La problématique des cyberattaques s’avère donc très complexe. L’espace numérique possède une dimension transfrontalière lorsque les données sont transmises par des câbles terrestres ou maritimes, ou par des satellites situés dans l’espace. En cas de cyber-opération le visant, l’État neutre est légitime pour repousser les atteintes à sa neutralité, conformément à l’article 10 de la Convention V, en vertu duquel : « Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité. »
L’État neutre se voit aussi garantir l’inviolabilité de son territoire, et par conséquent, les parties au conflit ont des obligations à son égard. Elles ne peuvent pas mener des cyber-opérations à partir d’installations situées sur le territoire d’un État neutre ou placées sous son contrôle exclusif. Il leur est aussi interdit de prendre le contrôle de systèmes informatiques d’un État neutre pour conduire de telles opérations. Enfin, elles sont tenues de ne pas endommager les réseaux de données d’un État neutre par leurs opérations de combat menées sur les réseaux informatiques[123].
***
La neutralité est un instrument efficace et utile uniquement lorsqu’elle est reconnue à l’échelle internationale. Pour cela, il faut d’abord qu’elle soit comprise, d’où l’importance que la Suisse accorde à la promotion de sa contribution à l’ordre international. La guerre en Ukraine a eu pour conséquence de mettre en lumière la neutralité suisse sur la scène internationale avec une nouvelle intensité. Les autorités suisses ont été prises de court par la rapidité et l’ampleur de ce tragique événement, comme en témoignent les propos prononcés par Ignazio Cassis, président du Conseil fédéral lors de l’invasion russe en Ukraine : « nous nous étions tous bercés de l’illusion que nous n’aurions plus jamais à nous soucier de la guerre en Europe. Nous avons dû apprendre à avoir tort »[124].
Le constat que nous pouvons formuler est que la guerre en Ukraine n’a pas contraint le Conseil fédéral à modifier sa pratique de la neutralité. Il reste constant, considérant qu’il est dans l’intérêt de la Suisse de se tenir à la pratique de neutralité telle qu’elle est définie dans le rapport de 1993 sur la neutralité[125]. Cette attitude peut se justifier par le fait que le Conseil fédéral dispose d’une marge de manoeuvre suffisante pour pouvoir réagir au fur et à mesure aux événements en lien avec la guerre en Ukraine.
À travers sa position, le Conseil fédéral donne également un signal à ses partenaires occidentaux, souvent critiques et méfiants quant à l’attitude de la Suisse pendant la guerre, notamment en ce qui a trait à l’exportation de matériel militaire. Il appartient aux autorités suisses, et à elles seules, de décider comment sera interprétée la neutralité suisse pendant ce conflit. Cependant, reste la question de savoir si cette stratégie pourra être maintenue sur le long terme, et surtout si elle permettra à la Suisse de préserver son image de crédibilité auprès de la communauté internationale.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Alfred Ernout et Antoine Meille, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, retirage de la 4e éd augmentée d’additions et de corrections par Jacques André, Paris, Klincksieck, 2001 à la p 439, sub verbo « neuteur ».
-
[2]
Conseil fédéral suisse, Neutralité, Annexe I du Rapport de politique étrangère, 14 juin 2007, FF 2007 5283 à la p 5283 [Rapport 2007].
-
[3]
Ignazio Cassis, « Discours du président de la Confédération et chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) », Assemblée générale des Nations unies, présentée à New York, 20 septembre 2022 à la p 6, en ligne : UN Journal : <estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20220920/fmM7ArKgKRs0/xcC8wN75agcH_fr.pdf>.
-
[4]
Éric Schnakenbourg, « Neutralité : l’espoir de vivre en paix au milieu de la guerre » dans Olivier Dard, dir, Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, 2020, en ligne : EHNE <ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/l%E2%80%99europe-et-le-monde/l%E2%80%99europe-et-la-r%C3%A9gulation-juridique-des-relations-internationales/neutralit%C3%A9%C2%A0-l%E2%80%99espoir-de-vivre-en-paix-au-milieu-de-la-guerre>.
-
[5]
Cependant, en tant qu’« État neutre occidental », la Suisse a participé, en 1953, notamment à la demande des États-Unis d’Amérique, à la Commission de surveillance des nations neutres pour l’armistice en Corée. Elle a néanmoins exigé à ce que la mission de contrôle prévue par le projet de Convention d’armistice lui soit confiée en tant qu’État neutre par les deux parties belligérantes : « Troisième version de l’aide-mémoire concernant la neutralité et l’impartialité suisse lors de la participation à la Commission des nations neutres pour la surveillance de l’armistice en Corée, remise au Département d’État américain le 14.4.1953 » (dernière consultation le 14 août 2023), en ligne : Dodis <dodis.ch/60855>.
-
[6]
Daniel Möckli, « Neutralité et capacité d’action extérieure de la Suisse » (2007) Center for Security Studies ETH Zurich Politique de sécurité : analyses du CSS 20 à la p 2.
-
[7]
Le climat post-Seconde Guerre mondiale s’avérait peu propice aux États neutres qui se sont vu reprocher par les alliés le manque d’action dans la lutte contre les États de l’Axe. De ce fait, ils n’ont été ni consultés pendant les négociations ayant précédé la fondation de l’ONU ni invités à la Conférence de San Francisco lors de l’adoption de la Charte des Nations Unies le 16 juin 1946. C’est dans ce contexte tendu que le Conseil fédéral a décidé de renoncer à l’adhésion, « Message concernant l’adhésion de la Suisse à l’ONU du 21 décembre 1981 » 21 décembre 1981, FF 1982 I 505 à la p 547; Christian Favre, La Suisse avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, Lyon, Baudelaire, 2011.
-
[8]
L’interprétation stricte de la neutralité a subi des modifications dans les années soixante dans le contexte de l’adhésion de la Suisse au Conseil de l’Europe : Conseil fédéral suisse, Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’adhésion de la Suisse au statut du Conseil de l’Europe (du 15 janvier 1963), 31 janvier 1963, FF 1963 I 109. La décennie suivante a été marquée par l’engagement de la Suisse au sein de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Par ailleurs, l’Acte final d’Helsinki de 1975 a énoncé la neutralité comme un élément légitime de sécurité européenne. Désormais, les États neutres pouvaient se prévaloir d’un droit à neutralité. Notons que ce droit figure parmi les principes régissant les relations mutuelles des États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 1er août 1975 à la p 942, en ligne : Dodis <dodis.ch/58821>.
-
[9]
Conseil fédéral suisse, Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d’Irak, 7 août 1990, RS 946.206; Conseil fédéral suisse, Rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90 Annexe : Rapport sur la neutralité du 29 novembre 1993, 24 janvier 1994, FF 1994 I 150 [Rapport sur la neutralité 93]; fédéral suisse, « Clarté et orientation de la politique de neutralité : Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 22.3385 de la Commission de politique extérieure du Conseil des États du 11 avril 2022 » (26 octobre 2022) à la p 13, en ligne (pdf) : Conseil fédéral <www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73616.pdf> [« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 »].
-
[10]
Rapport sur la neutralité 93, supra note 9 à la p 221.
-
[11]
Lors de la préparation du Rapport sur la neutralité de 1993, la Suisse n’était pas membre de l’ONU. Elle est devenue le 190e État membre de l’Organisation le 10 septembre 2002. Par ailleurs, sa demande d’adhésion incluait une déclaration concernant la neutralité : « La Suisse est un État neutre dont le statut est consacré par le droit international. Pour les Nations Unies, la neutralité d’un État membre est compatible avec les obligations découlant de la Charte et contribue à la réalisation des buts des Nations Unies. En tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, la Suisse restera neutre. » Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RO 2003 866 à la p 898 (accession de la Suisse : 10 septembre 2002).
-
[12]
À titre d’exemple, l’intervention humanitaire sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU en réaction aux violations des droits de la personne commises à l’encontre des Kosovars en 1998-1999. La Suisse, pour la première fois, a décidé d’appliquer des sanctions de l’Union européenne (UE), dans ce cas concret à l’encontre de la Yougoslavie. « Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 16. Le droit de légitime défense préventive lors de la guerre en Irak en 2003 constitue un autre exemple. Conseil fédéral suisse, La neutralité à l’épreuve du conflit en Irak. Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak en réponse au postulat Reimann (03.3066) et à la motion du groupe UDC (03.3050), 2 décembre 2005, FF 2005 6535 [Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak 2005].
-
[13]
Jusqu’en novembre 2022, 67 000 Ukrainiens ont été accueillis en Suisse. Ils ont obtenu un statut spécial de protection.
-
[14]
Les représentants de la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations unies sont sollicités, depuis le début de l’invasion russe, pour expliquer en quoi consiste la neutralité, Sibilla Bondolfi, « Pascale Baeriswyl : “La Suisse continuera à être perçue comme un bâtisseur de ponts crédible et neutre” », Swiss Info (16 mars 2022), en ligne : <www.swissinfo.ch/fre/pascale-baeriswyl---la-suisse-continuera-à-être-perçue-comme-un-bâtisseur-de-ponts-crédible-et-neutre-/47434978>.
-
[15]
En vertu duquel :
« 1º La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
2º Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3º Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4º Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique ». Constitution fédérale de la Confédération suisse, 18 avril 1999, RS 101 art 2, RO 1999 2556 (entrée en vigueur : 1er janvier 2000) [Constitution fédérale].
-
[16]
Ibid.
-
[17]
Conseil fédéral suisse, Rapport sur la politique de paix et de sécurité (Postulats 84.348 du conseiller aux États F. Muheim, [du 8 mars 1984] et 88.384 du conseiller national M. Pini, [du 16 mars 1988]) du 29 juin 1988, 13 mars 1989, FF 1989 I 642 à la p 646.
-
[18]
Ce constat relève du texte constitutionnel, conformément à l’article 140(1)b) consacré au référendum obligatoire : l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est soumise au vote du peuple et des cantons. Voir à ce sujet Luc Gonin, « Art.173 » et « Art.185 » dans Vincent Martenet et Jacques Dubey, dir, Constitution fédérale, Commentaire Romand, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2021, à la p 3187.
-
[19]
Constitution fédérale, supra note 15, arts 172, alinéa 1a), 185, alinéa 1.
-
[20]
Rapport sur la neutralité 93, supra note 9 à la p 204.
-
[21]
François Bugnion, déclaration, « La neutralité suisse dans l’optique du Comité international de la Croix Rouge » (26 mai 2004), en ligne : Comité International de la Croix Rouge <www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5zla49.htm>.
-
[22]
Le pays a déclaré sa neutralité en 1955 en s’inspirant du modèle suisse. La neutralité autrichienne est énoncée à l’article 9a)(1) de la Loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920, 1er octobre 1920, version française en ligne : Digithèque MJP <mjp.univ-perp.fr/constit/aut1920a.htm>. Contrairement à la Suisse, l’Autriche est un pays membre de l’UE. À ce titre et conformément au traité d’adhésion à l’UE, elle s’est engagée à participer activement à la prise de décision dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Cependant, elle a exercé son droit à « une abstention constructive » lorsque le Conseil a adopté, le 28 février 2022, deux décisions PESC, respectivement 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (CE, Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, [2022] JO, L 60) et 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (CE, Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes, [2022] JO, L 61). Conformément à la Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, chaque État membre de l’UE peut s’abstenir lors de décisions ponctuelles et ne pas participer au financement de la fourniture d’armes létales (CE, Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528, [2021] JO, L 102/14, art 5(3)).
-
[23]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 9.
-
[24]
Samantha Besson, Droit international public. Précis de droit et résumé de jurisprudence, Berne, Stämpfli Editions, 2019 à la p 664.
-
[25]
Conseil fédéral suisse, Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la neutralité de la Suisse au sein de la Société des Nations (du 3 juin 1938), mémorandum sur la neutralité de la Suisse au sein de la Société des Nations du 29 avril 1938 en annexe, 7 juin 1938, FF 1938 I 845 aux pp 850-53.
-
[26]
Déclaration de Londres du 13 février 1920, dans ibid aux pp 849-50.
-
[27]
C’était le cas notamment des sanctions économiques prises par la SdN à l’encontre de l’Italie en raison de l’agression contre l’Abyssinie : « Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 12.
-
[28]
Bien que le Conseil de la SdN ait approuvé le retour vers la neutralité intégrale, le contexte de l’époque jouait un rôle important avec notamment des retraits successifs de la SdN des futures Puissances de l’Axe (de l’Allemagne et du Japon en 1933 et de l’Italie en 1937). Aloïs Riklin, « Neutralité » (9 octobre 2010), en ligne : Dictionnaire historique de la Suisse <hls-dhs-dss.ch/fr/articles/016572/2010-11-09>.
-
[29]
D’après le recensement de l’armée 2022, l’effectif réel de l’armée est de 151 299 militaires : Groupement de défense, communiqué, « Recensement de l’armée 2022 : l’effectif réel sera encore atteint » (13 octobre 2022), en ligne : Conseil fédéral <www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation.html>.
-
[30]
Conformément à l’article 59(1) de la Constitution fédérale, supra note 15 : « Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. » Concernant les Suissesses, elles « peuvent servir dans l’armée à titre volontaire » (ibid, art 59(2)). Depuis 1995, elles ont accédé au statut de militaire à l’égalité des hommes.
-
[31]
Ce service est prévu par la Loi fédérale sur le service civil (LSC) du 6 octobre 1995 : Conseil fédéral suisse, Loi fédérale sur le service civil (LSC) du 6 octobre 1995, 16 octobre 1995, FF 1995 IV 488. Cependant, un Suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement est tenu de s’acquitter d’une taxe. Celle-ci est fixée et levée par les cantons, mais perçue par la Confédération.
-
[32]
Les Suisses sont très attachés au service militaire. En 2013, ils ont rejeté l’initiative populaire « Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire » à 73 % : Conseil fédéral suisse, Arrêté du Conseil fédéral constatant le résultat de la votation populaire du 22 septembre 2013 (Initiative populaire « Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire »; loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme [Loi sur les épidémies, LEp]; modification de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce [Loi sur le travail, LTr]), 26 novembre 2013, FF 2013 7879. Voir aussi Pierre Streit, Histoire militaire suisse. Des origines à nos jours, Gollion, Infolio éditions, 2016 à la p 189.
-
[33]
Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, 18 octobre 1907, RS 0.515.22 art 10 (entrée en vigueur pour la Suisse : 11 juillet 1910) [CGV concernant les droits et les devoirs des Puissances].
-
[34]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 aux pp 2-3.
-
[35]
Bugnion, supra note 21.
-
[36]
CGV concernant les droits et les devoirs des Puissances, supra note 33.
-
[37]
Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime, 17 octobre 1907, RO 26 530 (entrée en vigueur : 10 juillet 1910). D’autres sources sur la neutralité existent en droit international, cependant, il s’agit de sources secondaires, notamment la Déclaration de Paris concernant le droit maritime européen en temps de guerre, 16 avril 1856, RS 0.515.121 ou les Règles concernant l’action des sous-marins à l’égard des navires de commerce, 6 novembre 1936, RS 0.515.127.
-
[38]
Besson, supra note 24 à la p 666.
-
[39]
Christian Dominicé, « La neutralité de la Suisse au carrefour de l’Europe » dans Christian Dominicé, dir, L’ordre juridique international entre tradition et innovation, Graduate Institute Publications, Genève, 1997, 471 au para 84.
-
[40]
Ibid.
-
[41]
Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, 12e éd, Collection Précis Domat, Issy-les-Moulineaux, LGDI, 2016 à la p 624.
-
[42]
Conformément à l’article 174 de la Constitution fédérale, supra note 15 : « Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération », ainsi il gouverne la Suisse, dirige l’administration fédérale, propose des lois et les met en oeuvre. Cet organe est composé de sept membres, élus par l’Assemblée fédérale.
-
[43]
Conseil fédéral suisse, Rapport complémentaire au rapport sur la politique de sécurité 2021, sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Rapport du Conseil fédéral du 7 septembre 2022, 3 octobre 2022, FF 2022 2357 à la p 3 [Rapport sur les conséquences de la guerre en Ukraine 2022]. Ce rapport a le caractère complémentaire et s’appuie sur : Conseil fédéral suisse, La politique de sécurité de la Suisse. Rapport du Conseil fédéral, 23 novembre 2021, FF 2021 2895.
-
[44]
Convention relative à l’ouverture des hostilités, 18 octobre 1907, RS 0.515.10 art 2 (entrée en vigueur pour la Suisse : 11 juillet 1910).
-
[45]
Charte des Nations Unies, supra note 11.
-
[46]
Voir à ce sujet Paul Seger, « The Law of Neutrality » dans Andrew Clapham et Paola Gaeta, dir, The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford, Oxford University Press, 2014, 248.
-
[47]
Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak 2005, supra note 12 à la p 6546.
-
[48]
Rapport sur les conséquences de la guerre en Ukraine 2022, supra note 43 à la p 19.
-
[49]
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 287 art 6 alinéa 2 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950, accession de la Suisse : 21 octobre 1950) [CGIV relative à la protection des personnes civiles].
-
[50]
Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak 2005, supra note 12 aux pp 6552-53.
-
[51]
La constatation de la fin des hostilités n’entraîne pas la cessation de l’applicabilité du droit international humanitaire. Conformément à l’article 6 de la CGIV relative à la protection des personnes civiles, supra note 49, celle-ci reste entièrement applicable en territoire occupé pendant un an suivant la fin des opérations militaires. Après cette période, la Puissance occupante ne serait liée que dans la mesure où elle continue d’exercer des fonctions gouvernementales.
-
[52]
Conseil fédéral suisse, communiqué, « Est de l’Ukraine : le Conseil fédéral condamne les agissements de la Russie contraires au droit international » (23 février 2022), en ligne : Conseil fédéral <www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87316.html>.
-
[53]
À titre d’exemple, dans son communiqué portant sur la réexportation de matériel de guerre par des États tiers datant du 10 mars 2022, le Conseil fédéral évoque l’« agression militaire » de l’Ukraine par la Russie : Conseil fédéral suisse, communiqué, « Ukraine : le Conseil fédéral confirme sa position concernant la réexportation de matériel de guerre par des États tiers » (10 mars 2022), en ligne : Conseil fédéral <admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-93641.html>. Par la suite, le postulat 22.3385 de la Commission de politique extérieure du Conseil des États du 11 avril 2022 évoque l’« attaque » de la Russie contre l’Ukraine. En revanche, dans le « Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9, le terme « guerre » est employé et devient désormais dominant dans le discours officiel.
-
[54]
Rapport sur les conséquences de la guerre en Ukraine 2022, supra note 43 à la p 8.
-
[55]
« L’invité de La Matinale - Claude Wild, Ambassadeur de Suisse en Ukraine » (23 novembre 2022), en ligne (balado) : RTS <www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-invite-de-la-matinale-claude-wild-ambassadeur-de-suisse-en-ukraine-25878473.html>.
-
[56]
Micheline Calmy-Rey, Pour une neutralité active. De la Suisse à l’Europe, Lausanne, Savoir suisse, 2021 aux pp 18-19.
-
[57]
Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022, supra note 9 à la p 19.
-
[58]
Ultérieurement, la majorité des sanctions de l’UE ont été reprises, en procédant à l’analyse au cas par cas. Cependant, la Suisse ne s’est pas alignée quant à l’interdiction de diffuser pour certains médias russes. Cette sanction a été considérée comme incompatible avec la conception suisse de la liberté d’expression, ibid à la p 20.
-
[59]
Loi fédérale sur l’application de sanctions internationales, 22 mars 2002, RS 946.231 (entrée en vigueur : 31 décembre 2002).
-
[60]
Conseil fédéral suisse, Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine du 4 mars 2022 (modifié le 22 novembre 2022), RS 946.231.176.72, en ligne : Fedlex <fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/fr>.
-
[61]
Ibid, art 2a.
-
[62]
Ibid, art 4.
-
[63]
Ibid, art 5.
-
[64]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 20.
-
[65]
Conseil fédéral suisse, Rapport sur la politique extérieure 2014, 13 janvier 2015, FF 2015 987 à la p 1011.
-
[66]
À partir du 1er janvier 2014.
-
[67]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 20.
-
[68]
Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak 2005, supra note 12 à la p 6544.
-
[69]
L’interprétation accordée à la politique de neutralité a subi une évolution, assimilée à la politique extérieure de la Suisse pendant la guerre froide. Actuellement, cette politique englobe toutes les mesures permettant de garantir l’efficacité et la crédibilité de la neutralité suisse : « Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 aux pp 6-7.
-
[70]
Ibid à la p 7.
-
[71]
Afin d’assurer la protection des populations en période de conflit, le droit humanitaire prévoit un mécanisme de puissance protectrice chargé de sauvegarder les intérêts des personnes protégées par les conventions de Genève : Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 135 arts 8-11 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950, accession de la Suisse : 21 octobre 1950); CGIV relative à la protection des personnes civiles, supra note 49, arts 9-12; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 RTNU 3, art 5 (entrée en vigueur : 7 décembre 1978, accession de la Suisse : 17 août 1982).
-
[72]
La Constitution fédérale de la Confédération suisse, supra note 16, art 54(2), énonce que « la Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles ».
-
[73]
Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme, 18 décembre 2003, RS 193.9 art 2a), RO 2004 2157 (entrée en vigueur : 30 avril 2004).
-
[74]
Confédération suisse, Conseil fédéral, « Bons offices : bilan des démarches de facilitation et de médiation de la Suisse au niveau international. Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Béglé 16.3929 du 1er décembre 2016 » (14 décembre 2018) à la p 4, en ligne (pdf) : DFAE <eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-securite-humaine/paix/bons-offices-suisse.html>.
-
[75]
Raymond Probst et Walter Weideli, « Bons offices » (1er juillet 2014) aux pp 1-2, en ligne (pdf) : Dictionnaire historique de la Suisse <hls-dhs-dss.ch/fr/export/articles/026461/2014-07-01/WebHome?format=pdf&pdftemplate=HLSCode.ArticlePdfExport>.
-
[76]
Lorsque la Russie a reconnu en 2008 les provinces séparatistes géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, la Géorgie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec la Russie : Michel Guénec, « La Russie et les “sécessionnismes” géorgiens » (2010) 138:3 Hérodote 27 aux pp 42-43.
-
[77]
La Pologne illustre parfaitement un autre point de vue. Elle a notamment refusé l’entrée sur son territoire de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qui souhaitait se rendre à la réunion ministérielle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, organisée à Lodz les 1er et 2 décembre 2022 : « Lavrov persona non grata : Moscou dénonce une provocation » Swissinfo (19 novembre 2022), en ligne : <swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/lavrov-persona-non-grata--moscou-dénonce-une-provocation/48070964>.
-
[78]
Rapport les conséquences de la guerre en Ukraine 2022, supra note 43 à la p 16.
-
[79]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 22.
-
[80]
Il s’agit de cycles de négociations inter-syriennes entamées sur la base de la Résolution 2254 (2015), Rés CS 2254, Doc off CS NU, 2015, Doc NU S/RES/2254 (2015).
-
[81]
Benjamin Luis, « La Russie veut-elle en finir avec la Genève internationale ? » Swissinfo (4 août 2022), en ligne : <www.swissinfo.ch/fre/economie/la-russie-veut-elle-en-finir-avec-la-genève-internationale-/47803424>.
-
[82]
« Moscou refuse que l’Ukraine soit représentée en Russie par la Suisse » RTS info (11 août 2022), en ligne : <rts.ch/info/monde/13300549-moscou-refuse-que-lukraine-soit-representee-en-russie-par-la-suisse.html>.
-
[83]
Les exportations dans ce domaine sont dominées par les États-Unis d’Amérique, la Russie, la France, la Chine et l’Allemagne. Concernant les importations : « The five largest arms importers were India, Saudi Arabia, Egypt, Australia and China. Between 2012–16 and 2017–21 there were increases in arms transfers to Europe (19 per cent) and to the Middle East (2.8 per cent), while there were decreases in the transfers to the Americas (–36 per cent), Africa (–34 per cent), and Asia and Oceania (–4.7 per cent) » : Alexandra Kuimova, Siemon T Wezeman et Pieter D Wezeman, « Trends in International Arms Transfers » (2022) à la p 1, en ligne (pdf) : SIPRI <www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf>.
-
[84]
« En 2021, les entreprises suisses ont exporté pour 742,8 millions de francs de matériel de guerre vers 67 pays sur la base des autorisations du Secrétariat d’État à l’économie » : Secrétariat d’État à l’économie SECO, communiqué, « Exportation de matériel de guerre en 2021 » (23 mars 2022), en ligne : Secrétariat d’État à l’économie (SECO) <www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.html> [« Exportation de matériel de guerre SECO 2021 »].
-
[85]
Claude Schenker, « Dépositaire : une impartialité sous surveillance. L’exemple de la Suisse » (2018) 28:1 RSDIE 25.
-
[86]
Hans Ulrich Jost, « Origines, interprétations et usages de la neutralité helvétique » (2009) 93:1 Matériaux pour l’histoire de notre temps 5.
-
[87]
Christophe Blocher, ancien conseiller fédéral et farouche opposant aux sanctions contre la Russie, fait le constat suivant : « Nous sommes pauvres et nous n’avons pas de ressources naturelles. Alors nous ne devons priver nos entreprises d’aucun marché » : Xavier Lambiel, « Christophe Blocher : “Je ne suis pas avec Vladimir Poutine, je suis pour la paix en Suisse” », Le Nouvelliste (22 août 2022), en ligne : <lenouvelliste.ch/monde/ukraine/christoph-blocher-je-ne-suis-pas-avec-vladimir-poutine-je-suis-pour-la-paix-en-suisse-1210371>.
-
[88]
Rapport 2007, supra note 2 à l’annexe 1.
-
[89]
Conformément à l’article 5 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, sont considérés comme du matériel de guerre « les armes, les systèmes d’arme, les munitions et les explosifs militaires; les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles » : Loi fédérale sur le matériel de guerre, 13 décembre 1996, RS 514.51 art 5, RO 1998 794 (entrée en vigueur : 31 mars 1998) [LFMG].
-
[90]
Besson, supra note 24 à la p 672.
-
[91]
CGV concernant les droits et les devoirs des Puissances, supra note 33, art 7.
-
[92]
Ibid.
-
[93]
LFMG, supra note 89.
-
[94]
Conseil fédéral suisse, Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG), 24 février 1998, RS 514.511 (entrée en vigueur : 31 mars 1998) [OMG].
-
[95]
LFMG, supra note 89, art 22.
-
[96]
Ibid, art 22a), alinéa 2a).
-
[97]
Ibid, note 60, art 2a), alinéa 1.
-
[98]
LFMG, supra note 89, art 5, qui définit le matériel de guerre en tant que les armes, les systèmes d’arme, les munitions et les explosifs militaires, les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles. De plus, sont considérés comme matériel de guerre les pièces détachées et les éléments d’assemblage, même partiellement usinés, lorsqu’il est reconnaissable qu’on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
-
[99]
Rapport sur les conséquences de la guerre en Ukraine 2022, supra note 43 à la p 9.
-
[100]
« Exportation de matériel de guerre SECO 2021 », supra note 84.
-
[101]
LFMG, supra note 89, art 18.
-
[102]
La déclaration de non-réexportation est déposée auprès du Secrétariat d’État à l’économie par les États suivants, considérés comme États partenaires de la Confédération helvétique : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxemburg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque et la Suède (OMG, supra note 94 à l’annexe 2). Concernant les autres États, à part la déclaration de non-réexportation, ils déposent en plus une note diplomatique du pays de destination.
-
[103]
« Décisions concernant le matériel de guerre provenant d’anciens et d’actuels stocks de l’armée » (3 juin 2022), en ligne : Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports <www.vbs.admin.ch/fr/home.detail.nsb.html/89131.html> [« Décisions matériel de guerre 2022 »].
-
[104]
Il s’agit de l’entreprise Rheinmetall Landsysteme GmbH, située à Kiel.
-
[105]
L’Office fédéral d’armement armasuisse est le centre de compétences pour les acquisitions, les technologies ainsi que l’immobilier. C’est une entité du DDPS.
-
[106]
« Décisions matériel de guerre 2022 », supra note 103.
-
[107]
La Pologne a livré à l’Ukraine, entre autres, environ 250 chars T-72 de fabrication soviétique, appartenant à l’armée polonaise : Zbigniew Parafianowicz et Maciej Miłosz, « Niecelne uderzenie w polskie T-72 », Dziennik Gazeta Prawna (7 juin 2022), en ligne : <gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8439872,wojna-w-ukrainie-uderzenie-w-polskie-t-72.html>.
-
[108]
« Décisions matériel de guerre 2022 », supra note 103.
-
[109]
Conformément au Message relatif au plafond des dépenses de l’armée pour la période de 2017 à 2020, au Programme d’armement 2016 et au Programme immobilier du DDPS 2016 (Message sur l’armée 2016), il s’agit d’armes antichars légères de nouvelle génération (engagement jusqu’à 800 m, poids : environ 13 kg). « Ces armes servent à lutter contre des blindés ou des chars de grenadiers et, en terrain bâti, contre des adversaires retranchés dans des bâtiments ou des positions fortifiées. Elles sont emportées dans des véhicules et des hélicoptères, épaulées par le militaire, et engagées de jour comme de nuit et par mauvaise visibilité » : Conseil fédéral suisse, Arrêté fédéral relatif au programme d’armement 2016, 23 février 2016, FF 2016 1469 à la p 1436.
-
[110]
« Les biens destinés uniquement à la protection de la vie et de l’intégrité corporelle des personnes et ne pouvant pas être utilisés à des fins offensives » : « Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 27.
-
[111]
Ibid.
-
[112]
« Les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d’autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d’entraînement avec point d’emport. Le commerce de tels biens est soumis à la loi sur le contrôle des biens » : Ibid.
-
[113]
Ibid à la p 20.
-
[114]
Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak 2005, supra note 12 à la p 6549.
-
[115]
Rapport 2007, supra note 2.
-
[116]
Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, communiqué, « Droit de la neutralité et opérations militaires contre l’Irak » (20 mars 2003), en ligne : Conseil fédéral <admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-20502.html>.
-
[117]
Quant à l’article 37 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, 75 RTNU 970 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950, accession de la Suisse : 21 octobre 1950) : « Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades ».
-
[118]
Au sujet des internements des prisonniers de guerre, voir Hazuki Tate, « Hospitaliser, interner et rapatrier : la Suisse et les prisonniers de guerre » (2014) 3:159 Relations Intl 35.
-
[119]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 22.
-
[120]
Rapport sur les conséquences de la guerre en Ukraine 2022, supra note 43 à la p 15.
-
[121]
Ibid à la p 16.
-
[122]
Ibid.
-
[123]
« Rapport clarté et orientation de la politique de neutralité 2022 », supra note 9 à la p 25.
-
[124]
Sermîn Faki et Sophie Reinhardt, « Ignazio Cassis fait son bilan : “Nous avons dû apprendre à avoir tort” », Blick (17 décembre 2022), en ligne : <blick.ch/fr/news/suisse/ignazio-cassis-fait-son-bilan-nous-avons-d-apprendre-a-avoir-tort-id18151944.html>.
-
[125]
Rapport sur la neutralité 93, supra note 9.