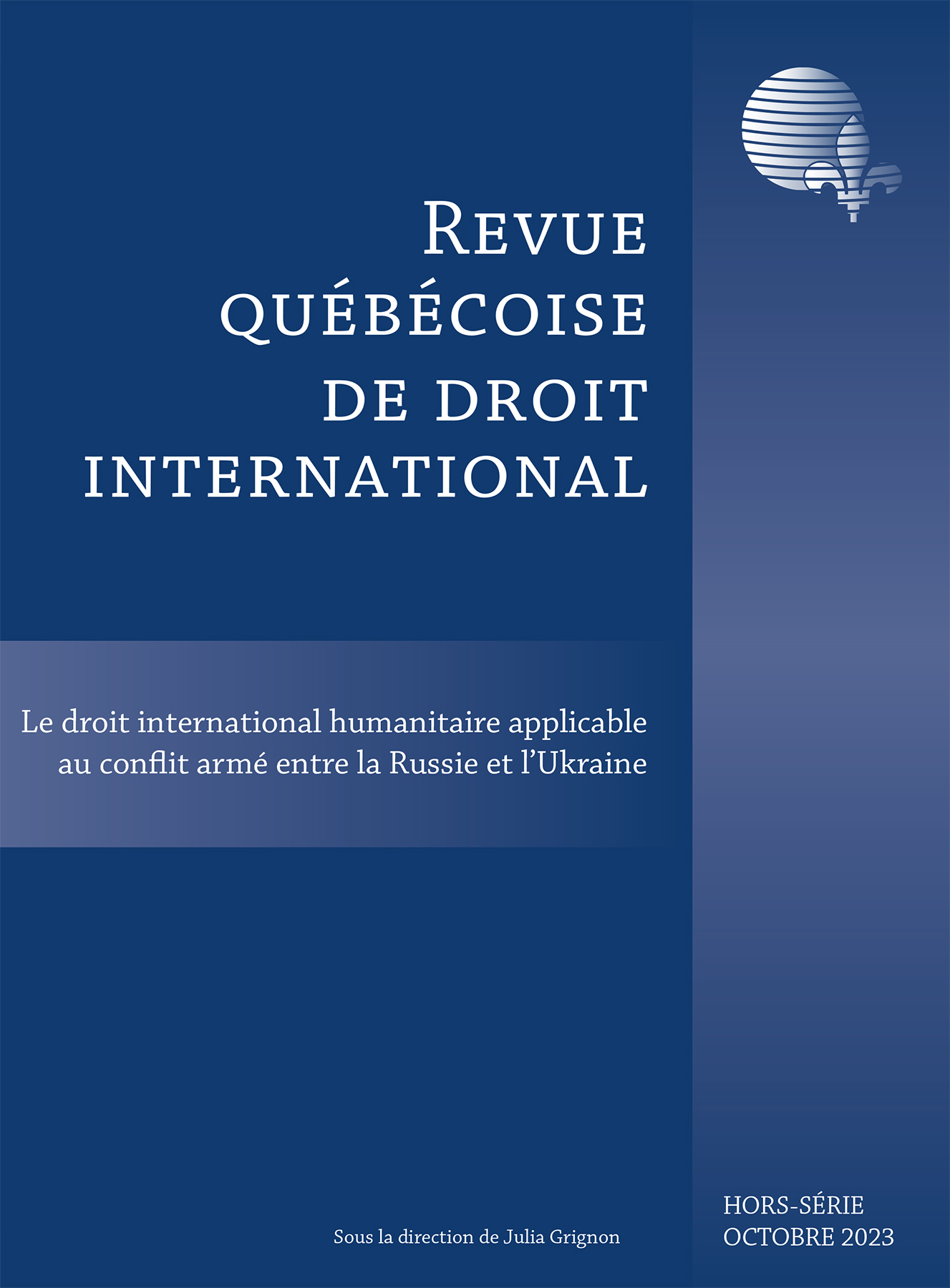Je suis très honoré d’avoir l’occasion d’écrire cette courte note d’ouverture pour le numéro spécial de la Revue québécoise de droit international consacré à la guerre qui se déroule présentement entre la Russie et l’Ukraine, la plus grande guerre continentale en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les divers articles inclus dans ce numéro se concentrent principalement sur le droit international humanitaire (DIH), un sujet qui a occupé une partie importante de ma vie académique, ainsi que sur quelques sujets qui lui sont étroitement liés. Pourtant, ma tâche n’a pas du tout été facile. Que puis-je dire exactement sur le DIH et sa pertinence aujourd’hui, au milieu de la terrible guerre qui détruit ma patrie et qui coûte la vie à mes compatriotes tous les jours, presque comme une routine ? Devrais-je me contenter de reproduire un ensemble de vérités bien connues ou, peut-être, de dire ce que je pense au risque de paraître légèrement déséquilibré, voire émotif ? De toute manière, ce texte ne peut être que très personnel. Ayant enseigné le droit international public — et plus particulièrement le DIH et les disciplines connexes, en Ukraine et ailleurs pendant une vingtaine d’années — et ayant bénéficié de nombreuses opportunités de coopération académique avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), notamment en résumant la pratique de mon pays pour deux mises à jour de l’étude du CICR sur le DIH coutumier, en révisant en tant que pair son nouveau commentaire des Conventions de Genève ou en siégeant au comité de rédaction de la Revue internationale de la Croix-Rouge, est-ce que je crois encore au potentiel du DIH pour remplir sa mission ? Ou, plus généralement, que vaut le droit international face à la tragédie qui se manifeste par de nombreuses violations de ses règles les plus importantes ? Mes études sur le droit des conflits armés, qui étaient considérées par mes collègues ukrainiens comme purement théoriques pour notre pays pacifique, sont devenues plus que d’actualité depuis 2014. Tout comme ces collègues, j’avais l’habitude de considérer comme acquis le fait que je resterais à l’abri de la guerre, théorisant sur la fragmentation du droit international et sur l’autonomie du DIH en tant que régime juridique (autonome ?) (Quelle discussion inutile, dirais-je maintenant !), sur divers modèles d’interaction entre le DIH et le droit international des droits humains ou sur la (re) conceptualisation de la relation entre la responsabilité de l’État et celle de l’individu pour les violations des lois et des coutumes de la guerre. On aurait vraiment préféré que les choses restent exactement comme cela. Évidemment, la guerre qui a frappé l’Ukraine a radicalement changé la donne. Le traumatisme qui accompagne inévitablement la guerre n’a cessé de croître et de s’approfondir dans la société ukrainienne, ne laissant personne indifférent, aujourd’hui et pour de nombreuses générations à venir. Personnellement, la chance tragique de pouvoir mettre en pratique mes connaissances en matière de droit international humanitaire s’est révélée être un moyen de rester sain d’esprit et pertinent au beau milieu de la guerre. Mes préoccupations, voire mes frustrations, à l’égard de la discipline et de son application pratique n’ont cessé d’augmenter depuis le début du conflit armé international entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, c’est-à-dire depuis la fin février 2014, lorsque la première a commencé son opération de prise de contrôle de la République autonome de Crimée, en Ukraine. À chaque nouveau développement, des révélations ont été faites. La simple logique selon laquelle l’annexion d’un territoire étranger équivaut à un acte d’agression et que le territoire en question ne peut être considéré que comme occupé …
Préface[Notice]
Juge à la Cour européenne des droits de l’homme élu au titre de l’Ukraine, professeur associé de droit international à l’Université nationale Taras Shevchenko de Kiyv (2002-2022), président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (2015-2021).