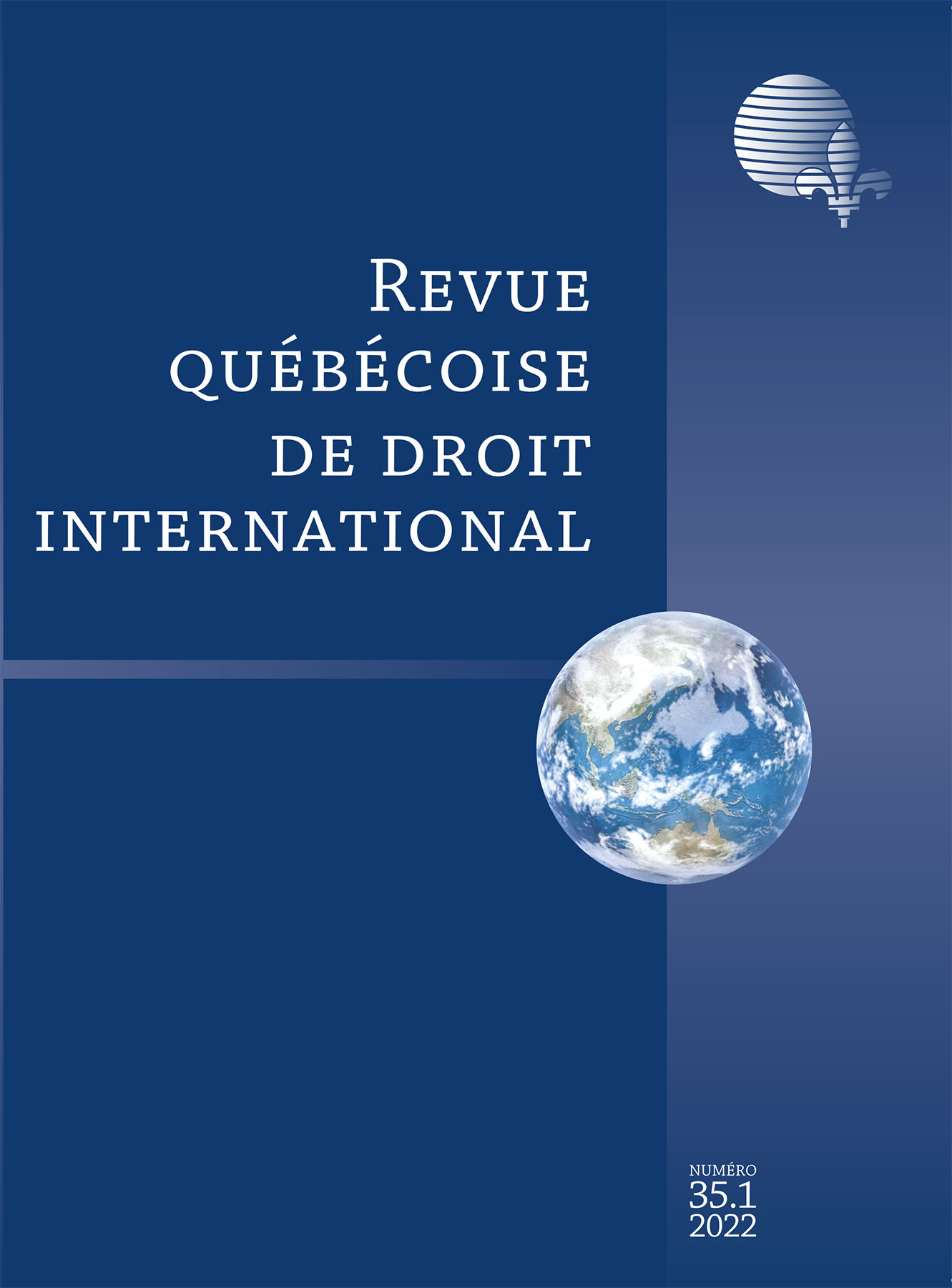Corps de l’article
En 2021, le paysage du droit international privé du Québec a connu des changements importants à la suite de plusieurs affaires qui ont soulevé de nouveaux problèmes et défis juridiques, façonnant ainsi l’approche de la province en matière de litiges transfrontaliers. Naviguant dans un cadre juridique de plus en plus complexe, les tribunaux ont démontré une capacité remarquable à s’adapter en développant des solutions novatrices pour aborder les problèmes juridiques rencontrés dans ces affaires. Ils ont affiné leur approche des défis en matière de compétence, en mettant l’accent sur la nécessité d’équilibrer l’équité et la commodité pour toutes les parties concernées. En outre, ils ont manifesté une volonté accrue de reconnaître et d’appliquer les décisions rendues à l’étranger, témoignant ainsi d’une prise de conscience croissante de la nécessité de coopération et de courtoisie internationales dans ce domaine.
Néanmoins, le système de droit civil du Québec pose des défis uniques lors de la résolution de litiges transfrontaliers. Les tribunaux doivent prendre en compte non seulement les principes du droit civil, mais également les lois internationales et nationales et les précédents juridiques d’autres juridictions. Cette chronique présente plusieurs décisions impliquant des défis de compétence, des litiges contractuels, des actions collectives, du droit de la famille et de la reconnaissance des jugements étrangers. En explorant ces décisions, nous cherchons à offrir des perspectives sur les principes juridiques qui guident l’approche des tribunaux québécois en matière de litiges transfrontaliers et à contribuer à la discussion en cours sur le droit international privé au Québec.
I. La compétence internationale des autorités québécoises : les facteurs de rattachement et la doctrine du forum non conveniens
Les règles de compétence internationale des tribunaux québécois en matière de droit international privé sont codifiées dans le Livre X du Code civil du Québec[1] (CcQ). L’article 3148 CcQ énumère les cinq facteurs de rattachement qui servent de base à la détermination de la compétence des tribunaux québécois dans les affaires portant sur des actions personnelles de nature patrimoniale. Ces critères sont les suivants :
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :
1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec ;
2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec ;
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée ;
4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé ;
5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises.
Chacun des cas prévus dans cet article est suffisant pour établir la compétence des tribunaux québécois, car ils établissent une connexion réelle et substantielle entre l’action juridique et le Québec[2]. Afin de promouvoir la compétence des tribunaux québécois en matière de droit international privé, il est essentiel d’interpréter cette disposition de manière large[3].
Toutefois, le principe juridique du forum non conveniens permet au tribunal de se dessaisir d’une affaire relevant de sa compétence si un autre tribunal est jugé plus approprié. Bien que ce pouvoir ne soit pas couramment utilisé[4], il est considéré comme étant exceptionnel dans les contextes juridiques. Il est important de noter que le tribunal ne peut exercer ce pouvoir qu’à la demande d’une des parties et ne peut prendre une telle décision de manière autonome. L’application de ce principe nécessite une évaluation de divers facteurs variables. Les tribunaux québécois retiennent généralement les critères suivants pour appliquer le principe du forum non conveniens :
le lieu de résidence des parties et leur domicile ;
l’emplacement du forum naturel ;
l’emplacement des éléments de preuve ;
le lieu de résidence des témoins ;
le lieu où seraient survenus l’acte et l’opération allégués, y compris le lieu de formation et d’exécution du contrat ;
l’existence d’une action à laquelle les mêmes personnes sont parties dans un autre ressort (dans un cas de litispendance imparfaite) et les étapes franchies dans cette instance ;
le droit applicable au litige ;
la possibilité de réunir toutes les actions ;
la nécessité d’une procédure en exemplification dans l’autre ressort ;
les avantages pour le demandeur sur le plan juridique ; et l’intérêt de la justice[5].
La Cour suprême du Canada souligne que la détermination du for compétent pour statuer sur une affaire ne peut être fondée sur un critère unique concluant en soi[6]. En effet, la liste des critères établis n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent s’appliquer en fonction des circonstances particulières de chaque cas[7]. De plus, la signification globale de chaque critère doit être évaluée dans le contexte spécifique de l’affaire. Ainsi, il est essentiel d’aborder l’analyse de ces critères d’un point de vue procédural, car l’objectif premier consiste à déterminer le tribunal le mieux à même de statuer sur l’affaire en question[8].
Cette année, plusieurs décisions ont mis l’accent sur ces règles régissant la compétence des tribunaux québécois, en mettant particulièrement l’accent sur les affaires impliquant une responsabilité extracontractuelle (A), des obligations contractuelles (B), des actions collectives (C) et des affaires familiales (D).
A. Responsabilité extracontractuelle
1. Arrangement relatif à Bloom Lake[9]
Twin Falls Power Corporation (Twinco), appuyée par Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited (CFLCo), cherche à faire rejeter la requête de liquidation et dissolution, de répartition des actifs, de remboursement des sommes et d’un allègement supplémentaire (requête LCSA) des requérants et des mises en cause (requérants) conformément à l’article 11 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[10] (LACC) ainsi qu’aux articles 214 et 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[11]. Elle conteste la compétence des tribunaux québécois, arguant que les deux sociétés, domiciliées à Terre-Neuve, n’ont ni lieu d’activité ni actifs au Québec. Par conséquent, Twinco soulève un argument subsidiaire selon lequel les tribunaux de Terre-Neuve-et-Labrador sont « mieux à même de trancher le litige »[12].
Toutefois, les requérants estiment que la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec (Cour LACC) est compétente en la matière. Ils soulignent que la Cour LACC a supervisé la vente coordonnée de leurs actifs ainsi que la liquidation des activités pendant une période excédant cinq ans, et que la Cour LACC a déjà fait prévaloir sa compétence sur celle de Terre-Neuve dans le cadre des procédures en cours, en vertu de la LACC, depuis 2015.
Malgré cela, la Cour LACC rejette les arguments avancés par Twinco et CFLCo et refuse de décliner sa compétence. Elle relève que Twinco avait déposé une preuve de réclamation dans le cadre des procédures de la LACC, acceptant ainsi la compétence de la Cour LACC[13]. La Cour LACC examine également les facteurs de la doctrine du forum non conveniens et conclut que, bien que certains facteurs aient favorisé les tribunaux de Terre-Neuve-et-Labrador, comme l’emplacement des parties et des témoins, ces facteurs géographiques ne sont pas pertinents dans le contexte d’une audience virtuelle en raison de la pandémie mondiale.
En outre, la requête LCSA porte sur un actif matériel des requérants et a une incidence sur les procédures relevant de la LACC, et elle est liée à l’administration de la succession des requérants et à la mise en oeuvre du plan sanctionné par la Cour LACC. Le transfert de la requête LCSA violerait le principe de « contrôle unique »[14], entraînant ainsi des procédures multiples et des dépenses supplémentaires pour les parties[15].
Enfin, bien que Twinco et CFLCo présentent des faits pertinents, ces derniers ne permettent pas d’affirmer de manière « clairement plus appropriée »[16] que la Cour LACC devrait décliner sa compétence et que la requête LCSA devrait être transférée aux tribunaux de Terre-Neuve-et-Labrador. En tant que tribunal national, la Cour LACC estime qu’elle dispose de la compétence nécessaire pour entendre et trancher la question ainsi que les problèmes soulevés dans la requête des requérants.
2. GF Urecon Ltd c M Holland Canada Company[17]
GF Urecon (Urecon) réclame des dommages à M Holland Canada Company (Holland) et Equistar Chemicals, LP (Equistar) conformément au régime de garantie de qualité de l’article 1726 CcQ. La demande fait suite à la détérioration prématurée de gaines fabriquées avec la résine Alathon d’Equistar, achetée aux Pays-Bas et distribuée par Holland. Urecon demande 1 088 093 $CAN en dommages-intérêts, représentant le coût de la réparation des gaines fissurées et détériorées. Bien que Holland ne conteste pas la compétence des tribunaux québécois, Equistar demande le rejet de la demande introductive d’instance modifiée d’Urecon, alléguant que les tribunaux québécois n’ont pas compétence en vertu de l’article 3148 CcQ, et demande subsidiairement au tribunal de décliner sa compétence en vertu de l’exception de forum non conveniens à l’article 3135 CcQ.
Malgré les allégations d’Equistar selon lesquelles aucun dommage n’a été subi au Québec, la Cour ne partage pas cette opinion. En effet, la résine utilisée pour les gaines a été employée dans seize projets à travers le Canada, y compris au Québec. De plus, le paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ n’exige pas que la totalité du préjudice ait été subie au Québec pour que le tribunal ait compétence ; une partie du préjudice[18] survenu au Québec suffit[19]. Par conséquent, la Cour conclut qu’elle est compétente pour statuer sur le litige.
Néanmoins, Equistar fait valoir que l’Alberta constitue le forum le plus approprié pour la résolution du différend, en raison du lien substantiel entre l’Alberta et le litige, notamment la livraison de résine, l’implication des employés d’Urecon dans le processus de fabrication et l’enquête. Lorsque le tribunal décide de décliner sa compétence, il doit prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la résidence des parties, l’emplacement des preuves, la loi applicable et l’intérêt de la justice[20]. Cependant, d’autres facteurs, tels que le domicile d’Urecon, les emplacements des témoins et des employés, ainsi que les réparations effectuées au Québec, suggèrent que le Québec constitue un forum approprié. Les actifs d’Equistar au Texas et la fabrication de la résine sur place indiquent également que le Texas pourrait être un forum possible.
En somme, Equistar démontre qu’il existe d’autres forums potentiels, mais ne parvient pas à prouver qu’un autre forum est « clairement plus approprié »[21]. La Cour conclut que le rejet de l’action contre Equistar entraînerait une multiplication des procédures, ce qui ne constitue pas une utilisation efficace des ressources judiciaires et ne sert ni l’intérêt de la justice ni celui des parties. Ainsi, la demande de dessaisissement fondée sur le principe du forum non conveniens est rejetée.
3. Quévillon c Fondation des maladies du coeur et de l’AVC[22]
Quévillon dépose une demande d’injonction provisoire visant à rétablir son accréditation en tant que maître enseignante, son droit d’utiliser le portail, les outils et le matériel de la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC (Fondation), ainsi qu’une ordonnance empêchant la Fondation de discréditer sa réputation. En réponse, la Fondation dépose une requête en rejet fondée sur une clause d’élection de for incluse dans ses modalités d’utilisation de son portail de formation, exigeant qu’une action en justice soit introduite devant un tribunal ontarien.
Quévillon soutient que l’article 3138 CcQ confère au tribunal la compétence de prononcer une injonction provisoire, tandis que la Fondation se réfère à l’article 3148 CcQ in fine pour soutenir l’effet contraire. En se basant sur l’arrêt Dimter[23] de la Cour suprême, la Cour donne priorité à la clause d’élection de for pour les litiges visés par ladite clause, tout en limitant l’application de l’article 3138 CcQ aux cas où des mesures provisoires ou conservatoires appuient un litige déjà né ailleurs.
La Cour convient avec la Fondation sur le fait que le processus d’accréditation constitue un service fourni par la Fondation elle-même et doit être inclus dans les litiges couverts par la clause. Cependant, la Cour ne se reconnaît pas compétente pour traiter des questions relatives aux conditions d’utilisation des outils et services de la Fondation. Le droit d’utiliser le portail, les outils, les logos et les matériaux de la Fondation est inclus dans les litiges couverts par la clause, mais la question de l’accréditation doit être traitée de manière équivalente. L’exclusion de la question de l’accréditation obligerait les parties à comparaître devant deux tribunaux distincts, ce qui pourrait entraîner des jugements contradictoires.
En ce qui concerne la diffamation alléguée de Quévillon, la Cour conclut que la clause d’élection de for ne s’applique pas à une telle réclamation. Quévillon allègue que la lettre de la Fondation concernant la révocation de son statut d’enseignante et la résiliation de sa licence d’utilisation du logo de la Fondation constitue une diffamation. La Cour observe que la lettre n’a pas été largement diffusée et ne visait pas à discréditer ou à nuire à la réputation de Quévillon.
4. Vie Urbaine Média c 9632301 Canada Inc (Réseau Outgo)[24]
Vie Urbaine Média (VUM) et Steve Mailhot (Mailhot) demandent une ordonnance du tribunal obligeant Facebook de fournir des factures détaillées pour trente-six frais, pour un montant total de près de 37 000 $CAN, portés sur deux cartes de crédit Visa détenues par Mailhot. Facebook conteste cette demande, affirmant que ses conditions commerciales exigent que tout litige lié à la divulgation de documents soit soumis à un tribunal californien, où la société est domiciliée. Néanmoins, VUM et Mailhot font valoir que les tribunaux québécois sont compétents, étant donné que le préjudice allégué s’est produit au Québec. Ils soutiennent également qu’ils ne sont pas liés par les règles commerciales de Facebook, car ils n’ont pas transigé avec l’institution.
La Cour rejette l’argument de Facebook et ordonne à l’entreprise de fournir les documents demandés et, s’ils n’existent pas, de fournir une liste des services associés à ces transactions. Les parties ne sont pas engagées dans un litige avec Facebook, mais recherchent plutôt des informations auprès de l’institution sans avoir transigé avec elle. En conséquence, la Cour détermine que les conditions commerciales ne s’appliquent pas dans la présente affaire. La demande a un lien suffisant avec le Québec en vertu de l’article 3136 CcQ, et le préjudice allégué s’est produit au Québec, ce qui appuie davantage la compétence des tribunaux québécois en vertu du paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ.
B. Obligations contractuelles
1. 9253-8180 Québec Inc (Fabrik) c 9134-9928 Québec Inc (Dynas)[25]
Fabrik poursuit Dynas et Dynas Construction pour rupture de contrat à prix fixe concernant la construction d’un hôtel à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Dynas conteste la recevabilité de la réclamation, tandis que Dynas Construction conteste la compétence des tribunaux québécois pour entendre l’affaire. Fabrik est une entreprise spécialisée dans la promotion et la construction d’unités résidentielles, opérant à partir du Québec, tout comme la société de portefeuille Dynas. Cependant, la société de construction Dynas Construction est basée au Nouveau-Brunswick.
Dans un premier temps, Dynas dépose une demande de rejet de la demande de Fabrik, invoquant les alinéas 2 et 3 de l’article 168 du Code de procédure civile[26] (Cpc). Pour déterminer l’irrecevabilité d’une demande, la Cour se réfère aux principes établis dans l’arrêt Bohémier[27], qui impliquent notamment de considérer comme véridiques les allégations présentées dans la déclaration, et de décider si les faits allégués pourraient donner lieu à une demande plutôt que d’évaluer la légitimité de la cause du demandeur. La tâche principale de la Cour consiste à déterminer si les faits présentés appuient l’existence d’un lien juridique entre Fabrik et Dynas. Alors que Dynas nie toute implication ou relation juridique avec Fabrik, Fabrik remet en question l’utilisation par Dynas de certains documents à titre de preuve. Toutefois, la Cour autorise l’examen de ces documents dans le cadre de la procédure préliminaire. En dépit de l’absence d’allégations établissant un lien juridique entre Fabrik et Dynas, la Cour examine le contrat, les factures et les certificats d’assurance relatifs au projet et confirme que le litige demeure entre Fabrik et Dynas Construction. La Cour accède alors à la requête en rejet de la demande contre Dynas, soulignant l’importance de ne pas mettre fin à un procès prématurément et de préserver les droits du demandeur.
Dans un deuxième temps, la Cour procède à l’évaluation de sa propre compétence pour juger du litige. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 3148 CcQ, si les parties ont convenu de résoudre leurs différends juridiques devant une autorité étrangère ou un arbitre, les autorités québécoises n’auront pas compétence. En l’espèce, les parties ont clairement exprimé leur volonté d’exclure la compétence des tribunaux québécois en se basant sur la clause de règlement des différends du contrat. Cette dernière dispose que tout différend découlant du projet fera l’objet d’une médiation ou d’un arbitrage dans le district de Rivière-du-Loup et que tout différend non résolu par ces moyens sera porté devant un tribunal du Nouveau-Brunswick. De plus, le projet de construction s’est déroulé au Nouveau-Brunswick et Dynas Construction avait son siège social dans cette province, ce qui renforce la pertinence de ce forum pour le règlement des différends. Étant donné que Dynas Construction n’avait pas reconnu la compétence des tribunaux québécois, la Cour décline compétence en faveur des tribunaux du Nouveau-Brunswick et accueille la demande en moyen déclinatoire.
2. 9259-5057-Québec Inc c Edible Arrangements International[28]
Edible Arrangements International (Edible), le franchiseur défendeur, introduit une demande en exception déclinatoire en réponse à une poursuite engagée par trois de ses franchisés québécois. Les franchisés cherchent à résilier leurs contrats de franchise et à obtenir des dommages-intérêts pour des manquements présumés aux obligations contractuelles. Ils font valoir que les accords sont des contrats d’adhésion et sont abusifs au sens des articles 1379 et 1437 CcQ, demandant que la loi applicable et les clauses de consentement à la juridiction soient déclarées nulles et non avenues. En revanche, Edible soutient que le différend doit être résolu par arbitrage, conformément à la clause d’arbitrage figurant dans les contrats.
La Cour décide que la clause compromissoire est contraignante, définitive et exécutoire, constituant une obligation complète d’arbitrage conformément à l’arrêt Zodiak[29] de la Cour suprême et à la convention d’arbitrage valide en vertu de l’article 2638 CcQ. La Cour souligne que l’arbitre doit trancher les contestations portant sur sa compétence et que seules les questions de droit peuvent être résolues par le tribunal.
Les franchisés soutiennent que la clause compromissoire est excessive, déraisonnable et abusive. Pour trancher ce litige, la Cour exige des preuves permettant de déterminer si la convention d’arbitrage conclue avec chaque demandeur constitue un contrat d’adhésion et si ladite clause leur a causé un préjudice excessif et déraisonnable. La Cour opère une distinction entre la présente affaire et l’arrêt Uber c Heller[30], où la clause compromissoire était abusive, en soulignant la clarté des clauses des présents accords et l’absence de preuve indiquant que les franchisés n’ont pas compris ou apprécié leur portée au moment de la conclusion desdits accords. De plus, la Cour estime qu’une exception limitée à la règle générale de renvoi à l’arbitrage n’est pas nécessaire pour préserver la légitimité publique[31].
En outre, la Cour procède à l’examen de la clause de « consentement à la juridiction » dans les contrats de franchise, laquelle ne s’applique que si la clause compromissoire est invalide. Pour être opposable, une clause d’élection de for doit être obligatoire pour au moins une partie[32], et claire et précise, conférant une compétence exclusive à l’autorité étrangère[33]. Bien que certaines conventions présentent une clause d’élection de for imprécise et ambiguë, la clause d’arbitrage est suffisante pour résoudre la problématique, rendant ainsi inutile un examen plus approfondi de la clause de consentement à la juridiction. Conformément aux précédents de la Cour suprême[34] et de la Cour d’appel[35], la Cour reconnaît l’autonomie des parties[36], permettant à l’arbitre de se prononcer sur la validité des conventions d’arbitrage. Donc, la Cour se dessaisit et rejette la demande des franchisés.
3. Argyle Medical Distributors Inc c Salts Healthcare Limited[37]
Argyle Medical Distributors Inc (Argyle) et Salts Healthcare Limited (Salts) ont conclu un contrat de distribution de cinq ans pour le Canada, avec une option de renouvellement. À la fin de la période initiale, Salts choisit de ne pas renouveler le contrat. En conséquence, Argyle réclame de Salts la somme de 2 285 000 $CAN pour perte de bénéfices présumée résultant du non-renouvellement.
Salts tente de rejeter cette réclamation en se prévalant de la clause d’élection de for contenue dans le contrat de distribution, qui stipule que les parties sont soumises à la compétence exclusive des tribunaux anglais. Néanmoins, Argyle soutient que la clause n’a pas un caractère exclusif et que les tribunaux québécois sont compétents. À cet égard, il souligne plusieurs éléments, notamment le fait que la clause mentionne la « compétence exclusive des lois des tribunaux anglais » au lieu de la seule « compétence exclusive des tribunaux anglais », ainsi que l’article 24 des conditions générales de vente qui prévoit la « compétence non exclusive des tribunaux anglais »[38].
Cependant, la Cour exprime son désaccord et déclare que lorsqu’on lit l’ensemble de l’entente de distribution, l’article 13.10[39] ne peut être interprété que comme un choix de juridiction, en vertu duquel Argyle est tenue de déposer toute poursuite contre Salts devant les tribunaux anglais exclusivement. En effet, la référence à la « compétence exclusive des lois des tribunaux anglais » à l’article 13.10 ne contredit pas l’objectif d’attribuer une compétence exclusive et toute autre conclusion priverait la disposition de tout sens.
En outre, la Cour aborde également la question de la notification dans la seconde phrase de l’article 13.10, laquelle s’applique aux situations où des poursuites sont engagées dans une autre juridiction conformément à l’article 13.11[40]. Elle reconnaît la validité des clauses d’élection de for asymétriques[41] et conclut que l’asymétrie en l’espèce ne modifie en rien l’obligation d’Argyle d’intenter une action devant les tribunaux anglais.
Enfin, la Cour souligne que la coexistence de deux clauses d’élection de for est possible. L’article 13.10 du contrat de distribution fait référence à la « compétence exclusive des lois des tribunaux anglais », tandis que l’article 24 des conditions générales de vente se réfère à la « compétence non exclusive des tribunaux anglais ». Cependant, il s’agit de deux accords distincts, énonçant chacune des obligations différentes. Dans le contexte des litiges liés à l’accord de distribution, les parties ont convenu de la compétence exclusive des tribunaux anglais.
En résumé, l’article 13.10 constitue une clause d’élection de for impérative, claire et précise, en vertu de laquelle des parties avisées ont déclaré leur intention. La Cour est tenue de respecter la clause d’élection de for, et Argyle doit soumettre sa demande devant les tribunaux anglais.
4. Belley c Facebook Inc (Meta Platforms Inc)[42]
En 2015, Belley crée une page Facebook intitulée « Help Dogs Center » et investit plus de 6 000 $CAN auprès de Meta au cours des six années suivantes pour accroître la visibilité de ladite page. Par la suite, Belley perd momentanément le contrôle de la page Facebook susmentionnée, dont elle impute en partie la responsabilité à Facebook Inc (Meta). Par conséquent, Belley intente une action en justice contre Meta en vue d’obtenir une injonction et des dommages-intérêts.
Meta milite en faveur du rejet de la demande, en affirmant que la compétence relève exclusivement des tribunaux de Californie, étant donné que les litiges commerciaux avec Facebook sont soumis à une clause d’élection de for appliquant la loi californienne. En effet, une telle clause dans un contrat commercial est généralement valide et obligatoire, garantissant la prévisibilité et la sécurité des transactions juridiques internationales[43]. Les tribunaux locaux perdent leur compétence lorsque les parties conviennent de soumettre les différends à une autorité ou à un arbitre étranger, sauf si le défendeur reconnaît la compétence des tribunaux locaux[44].
Toutefois, en matière de contrats de consommation, les tribunaux peuvent protéger les intérêts des consommateurs, de sorte que la dérogation à la clause d’élection de for peut ne pas être applicable[45]. En présence d’une clause d’élection de for claire et non équivoque, le rôle du tribunal se limite à faire respecter le contrat des parties, sauf si une règle spécifique prévaut sur l’application de ladite clause[46].
Belley reconnaît avoir conclu un contrat commercial et avoir accepté les termes du contrat en cliquant simplement sur un bouton de la souris, y compris la clause exigeant que les litiges commerciaux soient réglés par les tribunaux californiens. La clause d’élection de for est claire et concise, et par conséquent, le choix du forum de Facebook doit être respecté. Par conséquent, la Cour accueille la requête en irrecevabilité de Meta.
5. Bergeron c 2528-1023 Québec Inc[47]
Bergeron acquiert un véhicule récréatif auprès de l’entreprise 2528-1023 Québec Inc (Québec Inc), qui a été modifié par Thor Industries. Lors de la livraison, un voyant jaune relatif au système de réduction des émissions DEF s’allume, ce qui provoque des problèmes. Fraser Ford Sales (Coburg) (Fraser) résout le problème dès le diagnostic. Toutefois, lors du premier voyage de Bergeron, le voyant lumineux de niveau bas de DEF s’allume à nouveau, entraînant d’autres complications. Bergeron intente alors une action en annulation de la vente et en remboursement des frais et des dommages à l’encontre de Québec Inc, Fraser et Thor.
Fraser avance que les tribunaux québécois n’ont pas compétence territoriale et que l’action en garantie devrait être séparée de la demande principale. Toutefois, Fraser s’est soumis à l’autorité des tribunaux québécois en présentant des arguments et des défenses de fond dans le cadre de leur protocole de la cause. Conformément au paragraphe 5 de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ, les tribunaux québécois sont compétents en matière patrimoniale lorsque le défendeur s’est soumis ou reconnait leur compétence. Fraser a élaboré, négocié et approuvé un protocole de procédure[48], et a présenté une demande pour étendre le délai de préparation et de mise en état du procès[49], démontrant ainsi qu’il acceptait manifestement la compétence des autorités québécoises. En outre, en cochant la case « NON » sur le protocole de procédure, Fraser a renoncé à son droit de soulever des exceptions préliminaires futures.
En outre, l’action principale et l’action en garantie doivent être réunies et instruites dans la même procédure, sauf en cas de motifs justifiés pour agir autrement[50]. Étant donné le lien évident entre l’action principale et l’action en garantie intentée par Québec Inc contre Fraser, la disjonction des procédures pourrait entraîner des jugements contradictoires, une complexité accrue, des délais et des frais de justice. La Cour permet que l’action en garantie se poursuive au Québec en se fondant sur le fait que Bergeron a subi des dommages au Québec[51]. Il convient également de rappeler que si un tribunal québécois a la compétence territoriale pour entendre la demande principale d’une affaire, il a également compétence pour entendre toutes les demandes incidentes ou reconventionnelles liées à cette affaire[52].
Fraser soutient que les tribunaux de l’Ontario sont mieux qualifiés pour statuer sur l’action de garantie de Québec Inc, étant donné que leur relation était régie par les lois de l’Ontario. Toutefois, le juge estime que, pour des motifs d’efficacité judiciaire, il convient que les tribunaux québécois entendent l’action de garantie. La demande principale ayant déjà été entendue par les tribunaux du Québec, toute preuve relative au droit ontarien pourra être produite devant la Cour supérieure du Québec sur des questions précises, si nécessaire. La Cour rejette donc la demande d’irrecevabilité de Fraser, ainsi que la demande de disjonction de l’action principale, en ordonnant à Fraser de payer les dépens.
6. Boustany c Crédit Libanais[53]
Boustany, résidant au Québec, intente une action en justice contre le Crédit Libanais. Il allègue que le Crédit Libanais refuse de lui permettre de retirer ses fonds déposés en raison de la détérioration de la situation économique et géopolitique au Liban. Il affirme que la Cour supérieure du Québec a compétence sur le litige en vertu de diverses dispositions du Code civil du Québec. Cependant, tous ses arguments sont rejetés par le tribunal.
La Cour statue que l’alinéa 2 de l’article 3148 CcQ, qui exige que le défendeur ait un établissement au Québec, ne trouve pas application en l’espèce. En effet, le Crédit Libanais a fermé son bureau de représentation de Montréal avant que Boustany n’entame l’action en justice, et le litige ne porte pas sur ses activités au Québec. Bien que l’article 3148 CcQ puisse établir un fondement juridictionnel large[54] qui requiert une interprétation raisonnable[55], sa portée ne peut être étendue à des litiges sans lien avec les activités du défendeur au Québec[56]. En l’espèce, le recours à une banque canadienne pour traiter des crédits documentaires ne constitue pas des activités au Québec non plus.
La Cour rejette également la demande de Boustany en vertu de l’alinéa 3 de l’article 3148 CcQ, qui requiert que le préjudice économique soit en grande partie subi au Québec, étant donné que les fonds sont déposés au Liban et que le préjudice y est survenu. La demande de Boustany est ainsi comparée à celle d’une personne volée au Liban qui poursuit le voleur étranger au Québec, en alléguant que le préjudice s’est produit au Québec parce que les fonds volés sont inaccessibles.
De plus, la Cour rejette l’argument avancé par Boustany selon lequel le contrat qu’il a conclu avec le Crédit Libanais est un contrat de consommation qui confère compétence aux tribunaux québécois en vertu de l’article 3149 CcQ. La Cour souligne que, même s’il s’agit effectivement d’un contrat de consommation, celui-ci ne peut être interprété de manière suffisamment large pour conférer aux tribunaux québécois une compétence générale sur tous les contrats de consommation conclus par des résidents du Québec, indépendamment du lieu de signature et de la loi applicable. En outre, le contrat a été signé au Liban et est régi par le droit libanais, ce qui renforce la décision de la Cour selon laquelle les tribunaux québécois n’ont pas compétence.
Enfin, la Cour rejette la demande de Boustany en vertu de l’article 3136 CcQ, qui exige un lien suffisant avec le Québec pour justifier la compétence des tribunaux québécois. La Cour détermine que la seule résidence de Boustany au Québec est insuffisante pour établir un lien suffisant avec le Québec, et que tous les autres facteurs pointent vers le Liban. En conséquence, la Cour déclare qu’elle n’a pas compétence pour se saisir de la demande de Boustany, ce qui est conforme aux décisions récentes rendues en Angleterre[57] et aux États-Unis[58] traitant de cas similaires.
7. Consult Overseas Ltd c Bora Capital Partners SPC[59]
Consult Overseas Ltd (Consult), une société établie aux îles Caïmans, intente une action en justice contre quatre défendeurs, dont Bora Capital Partners SPC (SPC) et Ralph Massoud (Massoud), en lien avec un investissement infructueux. Consult accuse SPC et Massoud d’avoir fait des déclarations frauduleuses et manqué à leurs obligations en vertu d’une lettre incorporée à un accord. Toutefois, les défendeurs affirment que la demande devrait être rejetée en raison d’un manque de lien juridique et contestent également la compétence de la Cour supérieure du Québec.
L’investissement de Consult consistait en l’acquisition d’une participation de 15 % dans une société québécoise par le biais de Bora M Investments II LP (LP), une société en commandite, dans le but d’obtenir une franchise de restauration au Qatar. SPC, représentée par Massoud, a proposé les modalités relatives aux frais de franchise, aux redevances et aux frais annuels dans une lettre, s’engageant à combler tout écart entre les conditions proposées et celles requises par la société tierce. Cette lettre est incorporée dans une entente signée par le demandeur et le commandité de LP, Bora M Investments GP Inc (GP).
D’abord, la Cour examine l’argument des défendeurs concernant l’irrecevabilité de la demande. SPC et Massoud soutiennent que l’affaire doit être rejetée en raison de l’absence de relation juridique, affirmant qu’ils ne sont pas parties à l’accord et que SPC opère de manière indépendante de LP et GP. Ils soutiennent également que les allégations de fausses déclarations manquent de preuves factuelles et ne sont que des qualifications juridiques, ce qui rend l’affaire susceptible d’échouer. La Cour ne peut rejeter une demande que s’il existe « une absence claire et manifeste de fondement juridique »[60]. La lettre de SPC suggère la possibilité de leur responsabilité, mais la base de la responsabilité personnelle de Massoud semble faible à ce stade de la procédure. Toutefois, la Cour ne peut pas encore se prononcer sur le fond du litige[61], et il incombe à Consult de prouver au procès que Massoud a commis une faute extracontractuelle ou engagé sa responsabilité personnelle d’une autre manière. La Cour rejette donc la demande d’irrecevabilité de la demande.
Par la suite, la Cour prend en considération l’objection soulevée par les défendeurs au sujet de la compétence des tribunaux québécois. SPC et Massoud soutiennent que la poursuite intentée par Consult à leur encontre est irrecevable, car elle ne relève d’aucun des cinq paragraphes de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ. Toutefois, la Cour constate que la condition prévue au paragraphe 3 est remplie, étant donné qu’une des obligations du contrat devait être exécutée au Québec[62]. En outre, la clause d’élection de for incluse dans l’accord s’applique à SPC et Massoud, étant donné que la lettre de SPC a été incorporée dans l’entente et que Massoud a signé à la fois la lettre de SPC et l’entente.
Enfin, la Cour rejette l’argument de SPC et de Massoud selon lequel les tribunaux québécois devraient décliner leur compétence en vertu du principe du forum non conveniens. Elle souligne que les défendeurs n’ont pas avancé cet argument dans leur demande écrite et n’ont pas démontré que les tribunaux libanais, où Massoud est citoyen, seraient un forum « nettement plus approprié » [63] pour le litige. Par conséquent, la Cour rejette la demande en rejet et en exception déclinatoire de SPC et de Massoud.
8. De Varennes c Research Capital Corporation[64]
Research Capital Corporation (RCC) soulève une exception déclinatoire visant à faire rejeter l’action intentée par Danielle De Varennes (De Varennes) en se fondant sur la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 3148 CcQ, tel qu’énoncé dans une clause d’élection de for incluse dans un contrat, RCC soutient que l’entente est une convention unanime des actionnaires et qu’elle lie De Varennes. De son côté, De Varennes conteste la position de RCC, affirmant qu’elle n’est pas liée par l’entente, puisqu’elle ne l’a jamais signée. Cependant, Vaugeois, le conjoint de De Varennes, apparaît dans les registres de RCC en tant que détenteur des actions en litige et des actions émises en relation avec son emploi. Ainsi, cela confirme que la convention unanime des actionnaires lui donne une position opposable à celle de De Varennes.
Après avoir procédé à l’interprétation des intentions des parties et à la mise en oeuvre de leur volonté, la Cour estime que la demande présentée par RCC manque de fondement et doit être rejetée. Pour qu’une autorité étrangère dispose d’une compétence exclusive, la clause en question doit être claire, précise et impérative[65]. Dans la présente affaire, la simple clause d’engagement ou de reconnaissance de compétence ne suffit pas à établir une clause d’élection de for[66], et n’exclut pas la compétence des tribunaux situés à l’extérieur de l’Ontario. En outre, le contexte global de l’affaire, comprenant notamment la présence de RCC au Québec, la détention d’actions par De Varennes découlant de l’emploi de son époux à Montréal, ainsi que plusieurs événements déclencheurs de la situation survenus au Québec et ayant causé un préjudice, appuie la position de De Varennes. Par conséquent, la Cour rejette l’exception déclinatoire de compétence présentée par RCC.
9. Ernst & Young c Ormuco Inc[67]
Un litige oppose Ernst & Young et Ormuco en raison de factures impayées. Le contrat conclu entre les parties prévoit des clauses de compétence exclusive en faveur des tribunaux ontariens. Malgré cela, Ormuco soulève une exception déclinatoire en affirmant que les tribunaux ontariens ne devraient pas avoir compétence juridictionnelle. Ernst & Young affirme que l’exception déclinatoire est tardive et qu’Ormuco avait reconnu la juridiction de la Cour supérieure du Québec lors de la négociation du protocole. Ormuco soutient que les règles relatives aux délais pour présenter une exception déclinatoire ne s’appliquent pas dans ce cas, car la clause d’élection de for confère une juridiction exclusive à une autorité étrangère, et non à un tribunal québécois.
La Cour constate que l’exception déclinatoire d’Ormuco est tardive, contrairement à l’exigence du Code de procédure civile, qui précise que de tels défis soient soulevés en tant que question préliminaire et présentés dans le protocole ou, à défaut, au plus tard à la date limite pour la production du protocole[68]. De plus, Ormuco ne fournit aucun motif valable[69] pour justifier son retard. Le simple fait qu’Ormuco ait changé d’avocat pendant la période pertinente n’excuse pas son incapacité à relever le défi en temps utile. La Cour rejette l’exception déclinatoire.
En outre, la Cour maintient que la conduite d’Ormuco dans l’affaire démontre la reconnaissance de la compétence de la Cour supérieure du Québec. Elle explique que même si un défendeur a une clause d’élection de for conférant une compétence exclusive à un tribunal étranger, il peut quand même relever de la compétence des autorités québécoises s’il y consent. La Cour souligne que cette reconnaissance, bien que tacite, doit être claire et évidente[70], nécessitant une évaluation du contexte et de toutes les circonstances[71].
Par conséquent, la Cour considère qu’Ormuco reconnaît expressément la compétence de la Cour supérieure du Québec par sa conduite, notamment en négociant et en déposant un protocole, en discutant de dates précises pour un interrogatoire, une demande reconventionnelle et même des demandes substantielles, bien qu’elles fussent préliminaires. De plus, la défenderesse n’a jamais invoqué son moyen déclinatoire ni dans le protocole ni dans les délais impartis à cet effet.
De surcroît, la Cour rejette la requête d’Ernst & Young tendant à obtenir une déclaration d’abus qui aurait éventuellement permis une action en réclamation ultérieure. Elle radie en outre la demande d’inscription pour instruction et jugement produite de manière prématurée, faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée eu égard au plan initial des parties.
10. Fasano c Servier Canada Inc[72]
En mars 2021, Servier Canada Inc (Canada Inc) dépose une requête en suspension des procédures en réponse aux poursuites intentées par Fréderic Fasano (Fasano) contre la société. Fasano, un ancien employé de Servier International (International), est muté pour travailler pour Canada Inc avant d’être licencié par les deux sociétés. Il intente une action en dommages-intérêts contre chacune d’elles, tout d’abord en novembre 2020 contre International devant le Tribunal du travail de Nanterre, puis en décembre 2021 contre Canada Inc.
Canada Inc reconnait la compétence des tribunaux québécois[73], mais soutient que les affaires françaises et québécoises impliquent les mêmes parties, faits et objets. Pour cette raison, Canada Inc insiste pour que les procédures soient suspendues jusqu’à ce que le tribunal français rende une décision en raison de la litispendance internationale[74]. Toutefois, Fasano conteste cette position en faisant valoir son droit de saisir les tribunaux québécois, comme stipulé dans son contrat. Il soutient également que le tribunal français ne peut pas rendre une décision qui serait reconnue au Québec et que la litispendance internationale ne devrait pas s’appliquer en l’espèce.
La Cour constate l’absence d’identité de parties entre les deux affaires et confirme la compétence des tribunaux québécois. Bien que la détermination de l’identité des parties dans des litiges internationaux puisse être souple, la Cour remarque que la présente affaire diffère de celle de Ticketmaster[75]. Canada Inc, ayant des craintes quant à une double indemnisation, sollicite la suspension de l’affaire québécoise jusqu’à ce que le tribunal français rende sa décision. Cependant, la Cour rejette cette requête et, comme les dossiers de contrats de travail sont prioritaires devant la Cour supérieure du Québec, prévoit que la cause de Fasano sera traitée et jugée avant l’audience prévue par l’autorité française en mars 2024. Même si la Cour avait reconnu l’identité des parties, elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de suspendre l’affaire québécoise en faveur du tribunal français, conformément à l’arrêt PR[76] de la Cour suprême.
11. Gagnon c Gagnon[77]
Geneviève Gagnon (Geneviève), ancienne présidente de XTL, intente une action en justice contre son père, Serge Gagnon (Serge) et XTL, en rapport avec une convention unanime des actionnaires qui désigne les tribunaux ontariens comme le seul forum pour tout désaccord connexe. Geneviève cherche à invalider la clause d’élection de for et à intenter un recours en oppression visant à obtenir le rachat de la valeur des intérêts détenus par la Fiducie Familiale Geneviève Gagnon dans Gestion Serga Inc, le seul actionnaire de contrôle de XTL, pour soixante-dix millions de dollars canadiens. De leur côté, Serge et XTL cherchent à faire rejeter l’affaire en se basant sur la clause d’élection de for.
La Cour confirme la validité et l’opposabilité de la clause d’élection de for, en se référant à la troisième exception à l’autonomie des parties, laquelle exige une formulation claire et impérative de la clause[78], ainsi qu’une rencontre des volontés de part et d’autre[79]. L’inclusion de termes tels que « irrévocablement », « inconditionnellement » et « compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario » répond aux critères les plus stricts établis par les tribunaux au fil du temps. De plus, la Cour rejette l’allégation de Geneviève selon laquelle le recours en oppression est subordonné à celui pour congédiement déguisé et qu’il pourrait se poursuivre devant le tribunal en vertu d’une exception législative prévue à l’article 3149 CcQ.
La Cour rappelle que la convention unanime des actionnaires est régie par les lois ontariennes et que tout rachat des droits de Geneviève dans l’entreprise est assujetti à ladite convention. Par conséquent, Geneviève ne peut contourner les effets de la clause d’élection de for en intentant une action en justice au Québec pour contester la validité de la clause ou pour réclamer une indemnisation. Donc, la Cour accueille la demande d’exception déclinatoire de Serge et suspend le recours en oppression jusqu’à ce que Geneviève entame une procédure judiciaire similaire devant la Cour supérieure de l’Ontario.
12. Gruppo Piccini c Magil Construction Corp[80]
Gruppo Piccini (Piccini) intente une action en justice de soixante-treize millions de dollars canadiens contre Magil Construction Corporation (Magil), alléguant une ingérence dans ses contrats commerciaux et gouvernementaux au Cameroun. Le conflit découle d’un contrat pour un complexe sportif qui avait été initialement attribué à Piccini, mais qui a ensuite été annulé et attribué à Magil. Dans ce contexte, Magil dépose une demande d’exception déclinatoire, faisant valoir que les tribunaux camerounais seraient mieux placés pour traiter de l’affaire. Cependant, la Cour supérieure du Québec décide de ne pas décliner sa compétence conformément à l’article 3135 CcQ.
La décision de la Cour est motivée par l’intérêt de la justice ainsi que les préoccupations relatives à la capacité des tribunaux camerounais à traiter une affaire de plusieurs millions de dollars portant sur l’attribution de contrats gouvernementaux au Cameroun. En outre, l’expert en droit constitutionnel comparé et en systèmes judiciaires africains mandaté par Piccini a fourni des preuves convaincantes qui soulèvent des doutes quant à l’indépendance[81], l’impartialité[82] et la capacité des tribunaux camerounais à rendre une justice équitable à tous les justiciables. Ce constat s’explique notamment par le contrôle exercé par le président sur le pouvoir judiciaire et par le manque d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature.
En outre, il est à souligner que d’importants problèmes de corruption sévissent au Cameroun, tels que l’indice de l’état de droit 2020 du World Justice Project[83]. Les experts de Magil ont échoué à résoudre les problèmes soulevés par l’expert de Piccini, et n’ont pas été en mesure de démontrer la capacité du système juridique camerounais à gérer une affaire longue et complexe telle que le procès de Piccini. Par conséquent, le traitement du procès de Piccini au Cameroun ne sert pas l’intérêt de la justice, ce qui conduit la Cour à rejeter la demande déclinatoire de Magil.
13. Huang c Yan[84]
Jiahe Immigration Service Inc (Jiahe) fait face à deux appels contre un jugement rejetant les actions de deux citoyens étrangers pour manquements contractuels et fraude. Le jugement de la Cour supérieure accorde les exceptions déclinatoires des intimées et rejette chacune des actions des appelants en se fondant sur la clause « Droit applicable et règlement des différends » contenue dans deux ententes de services en immigration. La clause précise que la loi applicable est celle de la République populaire de Chine et que chaque partie a le droit d’intenter une action en justice devant le tribunal compétent.
Huang et Li sont des citoyens étrangers ayant fait appel aux services de Jiahe, une entreprise québécoise spécialisée en immigration, afin de faciliter leur processus d’immigration. Cependant, suite à l’échec de cette procédure, ils ont chacun intenté une action en justice alléguant des manquements contractuels ainsi que des fraudes contre Jiahe et les autres intimés, Yan et Zhang, en leur qualité respective d’actionnaire, président et administrateur de Jiahe.
Huang et Li soutiennent que les tribunaux québécois ont compétence en raison de la nature contractuelle et extracontractuelle de leurs réclamations. À l’inverse, Yan et Zhang affirment que la clause opère comme une clause obligatoire d’élection de for, accordant une compétence exclusive aux tribunaux chinois pour toutes les questions litigieuses. Cependant, la Cour d’appel découvre que les deux parties interprètent mal le véritable problème, car la clause litigieuse représente une clause de choix de la loi applicable et non une clause d’élection de for.
Les parties à un contrat peuvent désigner la loi qui régira le contenu de cet acte juridique, soit de manière explicite, soit de manière implicite[85]. Cependant, la simple désignation d’une loi étrangère dans un contrat ne prive pas les tribunaux québécois de leur compétence[86]. Les tribunaux québécois peuvent appliquer des lois étrangères, à condition que ces lois soient invoquées et prouvées[87]. La Cour d’appel établit ainsi une distinction entre une clause de choix de la loi applicable et une clause d’élection de for, en soulignant leurs effets juridiques distincts et qu’elles ne doivent pas être confondues.
Une clause d’élection de for doit être obligatoire et conférer sans équivoque une compétence exclusive à une autorité étrangère[88]. La Cour d’appel constate que la clause litigieuse ne possède pas ces caractéristiques essentielles, car elle ne contient aucune disposition impérative pouvant être interprétée comme une obligation pour l’une ou l’autre des parties d’engager une action en justice exclusivement devant une juridiction déterminée. Par conséquent, le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant la clause litigieuse de clause d’élection de for, et les tribunaux québécois conservent leur compétence sur l’objet de ces affaires.
Enfin, la Cour d’appel rejette l’argument de Yan et Zhang selon lequel le mémorandum de Huang et Li démontre un accord clair pour qualifier la clause litigieuse de clause d’élection de for exclusive. Elle souligne que même si les deux parties perçoivent la clause comme une clause d’élection de for, cette interprétation n’obligerait pas le tribunal[89] et qu’il devrait encore remplir les conditions juridiques préalables à une clause d’élection de for valide. Étant donné l’absence d’une clause d’élection de for valide et que les intimés sont tous domiciliés au Québec, la Cour d’appel détermine que les tribunaux québécois ont compétence sur l’objet des présentes affaires.
14. John Scotti Automotive Inc c Davis[90]
Davis vend deux voitures classiques Chevrolet Biscayne de 1964 à John Scotti (Scotti), un expert en voitures classiques, pour 50 000 et 60 000 $CAN, sur la base des affirmations de Davis selon lesquelles les voitures sont de qualité supérieure, originale et sans rouille. Cependant, Scotti découvre plus tard que les voitures ne sont pas telles qu’elles sont représentées et qu’elles présentent de la rouille. L’entreprise John Scotti Automotive Ltd (Société) demande une réduction du prix d’achat égale au coût de réparation évalué à 40 552,72 $CAN, ainsi que 3 000 $CAN en dommages-intérêts pour les frais extrajudiciaires encourus en raison des déclarations frauduleuses de Davis.
Davis fait une défense orale dans le protocole de l’instance, mais ne fournit aucun document et est absent de l’audience. La Cour estime qu’elle a compétence pour entendre le litige conformément au paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ, étant donné que le contrat exigeait l’exécution, notamment la livraison des voitures, au Québec[91].
Ensuite, la Cour examine si la Société, en tant que demandeur, a qualité pour intenter la réclamation. Elle conclut que la Société n’avait pas d’intérêt suffisant pour poursuivre la réclamation, car c’était Scotti, et non la Société, qui avait signé les contrats. La validité de la signification de la procédure a également été évaluée par la Cour, et bien que Davis ait fait valoir une signification inappropriée, la Cour détermine qu’aucun préjudice n’avait eu lieu et rejette l’argument.
De plus, la Cour rejette les deux évaluations soumises par la Société afin de déterminer les coûts de réparation des voitures, car elles ne sont pas fiables et ne sont pas signées, et aucune documentation prouvant les qualifications des experts n’est fournie. Enfin, la Cour évalue le droit de la Société aux sommes réclamées et détermine que la Société ne peut réclamer de dommages-intérêts pour les pertes subies par Scotti. Les réclamations liées aux représentations frauduleuses sont également rejetées.
15. Langford Sharp c Autorité des marchés financiers[92]
Langford Sharp est soupçonné d’avoir participé à un stratagème de « pump and dump » transnational en manipulant le cours des actions. Le Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF) a confirmé sa compétence en la matière et l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec a intenté une action contre lui pour manipulation illégale du cours des actions en violation des articles 195.2 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[93]. Résidant en Colombie-Britannique, Langford Sharp effectue des transactions financières par l’intermédiaire de sociétés étrangères constituées dans plusieurs pays et détient des comptes bancaires en Europe. Il aurait collaboré à l’achat d’actions de Solo International Inc (Solo), à la création d’une image crédible pour cette dernière, à la stimulation de ses activités (avec l’intention de gonfler frauduleusement la valeur de ses actions), puis à la vente de ces actions pour un gain financier.
Langford Sharp soutient que le TAMF n’a pas compétence à son égard et que sa décision de se déclarer compétent est déraisonnable. Il prétend également que le TAMF a omis de tenir compte des règles de droit international privé du Code civil du Québec dans sa décision. Langford Sharp affirme également que la norme de la décision correcte, plutôt que la norme de la décision raisonnable, devrait s’appliquer lors de l’examen du choix du TAMF entre les règles de common law et celles du Code civil du Québec, car il s’agit d’une question de droit générale au coeur du système juridique.
La Cour supérieure rejette la demande en révision judiciaire de la décision du TAMF, confirmant ainsi sa compétence pour entendre l’action intentée par l’AMF contre Langford Sharp en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Le TAMF affirme justement sa compétence sur la base du critère du lien réel et substantiel, comme indiqué par la Cour suprême dans l’arrêt Van Breda[94]. La Cour supérieure conclut que les principales allégations de l’AMF contiennent suffisamment de facteurs objectifs de rattachement au Québec et juge raisonnable l’inférence du TAMF selon laquelle Langford Sharp avait conspiré pour manipuler le cours des actions de Solo.
La Cour d’appel statue que les règles de droit international privé du Code civil du Québec ne s’appliquent pas en l’espèce, et que la compétence du TAMF repose principalement sur des considérations de droit public liées à la territorialité. L’autorité du TAMF doit être déterminée en utilisant le critère du lien réel et substantiel, qui exige la démonstration d’un lien suffisant entre l’affaire et le Québec, ainsi que la preuve de l’impossibilité ou du caractère déraisonnable d’intenter une poursuite à l’étranger. La Cour d’appel conclut que le TAMF s’est appuyé à juste titre sur le critère du lien réel et substantiel, plutôt que sur les règles de droit international privé du Code civil du Québec, pour revendiquer sa compétence en la matière. Par conséquent, la Cour d’appel rejette l’appel et accorde les dépens. En avril 2022, la Cour suprême du Canada autorise l’appel de la décision de la Cour d’appel du Québec.
16. Liquid Capital Exchange Corporation c American Atelier Inc[95]
Liquid Capital Exchange Corporation (LCEC) intente une action en justice contre American Atelier Inc (Atelier) pour refus de paiement de marchandises commandées auprès de Metcan Inc, une société dont les dettes ont été acquises par LCEC. Bien qu’Atelier soit une société américaine basée en Pennsylvanie, LCEC est domiciliée au Québec. Toutefois, Atelier prétend que les tribunaux québécois ne sont pas compétents en vertu de l’article 3148 CcQ. En réponse, LCEC soutient que les articles 41 et 42 Cpc s’appliquent, étant donné que les contrats étaient conclus à Montréal, au siège social de Metcan, où LCEC subit le préjudice.
La Cour fait droit à la demande d’exception déclinatoire présentée par Atelier. Elle souligne que le lieu de la conclusion du contrat ne permet pas d’établir la compétence en vertu du paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ. Afin d’établir la compétence des tribunaux québécois, LCEC devait alléguer qu’une obligation contractuelle devait être exécutée au Québec[96], ce qu’elle a omis de faire.
Par ailleurs, la Cour rejette l’affirmation de LCEC selon laquelle le préjudice découlant du défaut de paiement est subi au Québec. En l’absence de preuve démontrant qu’Atelier est tenu d’effectuer des paiements au Québec, la Cour applique les dispositions de l’article 1566 CcQ, concluant que les paiements sont dus au domicile d’Atelier en Pennsylvanie, ou encore celles de l’article 1734 CcQ, concluant que les paiements sont dus aux lieux de livraison américains spécifiés dans les bons de commande. Par conséquent, la Cour insiste sur l’importance d’allégations précises[97] et sur le fait que les dommages doivent être subis au Québec, et non pas simplement comptabilisés dans cette province[98]. En conséquence, le litige de LCEC contre Atelier ne peut être intenté au Québec.
17. Media Graph Dépôt Inc c MTEX Solutions[99]
Media Graph Dépôt Inc (Media Graph), une entreprise québécoise de design, achète une imprimante industrielle de MTEX Solutions SA (MTEX), une entreprise portugaise. Cependant, Media Graph allègue que l’imprimante contient des vices cachés qui la rendent inutilisable pour la production. Par conséquent, elle demande des garanties légales et conventionnelles en vertu du Code civil du Québec, ainsi que la résolution de la vente, le remboursement de la somme de 120 000 €, et les frais de justice. En réponse, MTEX nie tout défaut et accuse Media Graph d’avoir mal utilisé et modifié l’imprimante, rendant la restitution impossible. De plus, MTEX affirme qu’elle n’a pas l’obligation de fournir une garantie, car aucune dénonciation ni mise en demeure concernant les défauts allégués et les réparations entreprises ne lui a été faite.
Le contrat en question ne comporte aucune clause de droit applicable. Ainsi, dans les affaires de vente internationale de marchandises, il revient au tribunal de déterminer si la Convention de Vienne[100] s’applique, sauf si les parties l’ont expressément exclue par une clause contractuelle. La Convention de Vienne s’applique aux contrats de vente de marchandises entre parties établies dans des États différents, à condition que ces États soient contractants de la Convention. Toutefois, au moment de la signature du contrat en 2014, les deux parties n’étaient pas des États contractants[101], de sorte que le contrat est régi par le droit québécois.
La Cour classe les vices cachés en trois catégories principales : matériels, fonctionnels et contractuels. Media Graph affirme que l’imprimante a des vices cachés, mais la plupart des problèmes proviennent du manque de connaissances et d’expérience de l’acheteur. Les seuls vices cachés potentiels incluent les fuites d’encre, un tuyau d’aspiration défectueux et des problèmes avec le système d’alimentation et d’alignement. Cependant, lors d’une visite dans les locaux de Media Graph, MTEX découvre que Media Graph avait abusé et modifié l’imprimante, repoussant toute présomption de responsabilité de la part de MTEX en vertu de l’article 1729 CcQ.
Par ailleurs, l’acheteur doit notifier par écrit au vendeur tout vice dans un délai raisonnable[102]. La Cour d’appel rappelle que le défaut de préavis est généralement considéré comme fatal à la demande de l’acheteur, même si le vendeur connaissait ou était présumé connaître le vice, car la notification constitue une condition de fond[103]. En l’espèce, Media Graph ne dénonce formellement aucun des vices allégués, ne met pas MTEX en demeure et continue d’utiliser l’imprimante. La Cour rejette ainsi la demande de Media Graph.
18. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances c Quevillon[104]
Quevillon, un résident de l’Ontario, fait face à une poursuite de Royal & Sun Alliance Assurances (RSA) suite à un incident survenu au Québec où il est présumé responsable de dommages. Au moment des faits, Quevillon louait un condo dans l’immeuble touché par l’incendie. Les parents de Quevillon avaient souscrit une assurance responsabilité civile auprès de Pembridge en Ontario. En réponse à la poursuite, Quevillon dépose une demande de type Wellington contre Pembridge, afin de le contraindre à le représenter et à le défendre contre la réclamation de RSA. Cependant, Pembridge demande la suspension des procédures, arguant qu’une poursuite distincte avait déjà été intentée en Ontario, avec les mêmes parties, faits et objets.
Selon l’article 3137 CcQ, l’autorité québécoise peut suspendre une procédure judiciaire si une autre action impliquant les mêmes parties, les mêmes faits et ayant le même objet est déjà en cours dans une autorité étrangère, à condition que la décision étrangère puisse être reconnue au Québec, ou si une autorité étrangère a déjà rendu une décision. La Cour constate que les trois conditions de cet article sont remplies. Cependant, la décision de surseoir à statuer est discrétionnaire et doit être appréciée en fonction des facteurs identifiés par la Cour suprême dans l’arrêt PR[105].
Malgré cela, la Cour refuse d’ordonner la suspension des procédures en raison des intérêts de la justice, de la proportionnalité et des intérêts de Quévillon. Si la suspension avait été accordée, Quevillon perdrait son droit d’être défendu par Pembridge, tandis que la poursuite de RSA se poursuivrait. Cette suspension aurait potentiellement créé un déséquilibre entre les parties et aurait eu un impact négatif sur Quévillon. Par conséquent, la Cour rejette la demande de suspension des procédures relative à la demande de type Wellington.
19. Specter Aviation c Laprade[106]
Spectre Aviation interjette appel d’une décision de la Cour supérieure du Québec qui a rejeté leur demande d’arbitrage dans un différend concernant la propriété d’un avion Beechcraft 300. La société soutient que la clause compromissoire inclut la demande reconventionnelle et doit être résolue par un tribunal arbitral. Les intimés, parmi lesquels World Aircraft Leasing Inc, affirment être les propriétaires de l’aéronef et soutiennent que les appelants n’avaient pas le droit de le saisir.
En 2012, une coentreprise entre Jean Laprade et United Mining Supply s’est constituée pour développer des services de transport aérien en Afrique, signant un contrat avec une clause compromissoire. Bien que la coentreprise se soit dissoute en 2019, un accord en avril 2019 stipulait que les différends non résolus seraient soumis à la Chambre arbitrale internationale de Paris. Le Code civil du Québec prévoit des exceptions pour les litiges qui ne sont pas éligibles à l’arbitrage[107], mais exige une interprétation libérale des clauses d’arbitrage pour reconnaitre leur importance dans les opérations commerciales internationales[108].
Les tribunaux doivent ordonner aux parties de recourir à l’arbitrage, sauf lorsque la convention d’arbitrage est manifestement invalide ou inapplicable[109]. En vertu du principe de compétence-compétence, les tribunaux judiciaires doivent donner la priorité au processus arbitral et envoyer les parties à l’arbitrage. Toutefois, si les parties renoncent à la convention d’arbitrage de manière implicite par des actions judiciaires, le tribunal peut refuser de les renvoyer à l’arbitrage[110].
La Cour d’appel détermine ainsi que la Cour supérieure du Québec a conclu à tort que les appelants avaient consenti à la compétence des tribunaux du Québec. Les appelants n’ont participé qu’aux procédures en justice concernant la saisie de l’aéronef et n’ont soulevé la question de l’arbitrage qu’après avoir déposé leur demande de renvoi. De plus, la demande de renvoi était déposée dans les délais appropriés, notamment en moins de 90 jours après la première procédure judiciaire de fond liée au litige[111]. En conséquence, la Cour d’appel accueille l’appel et renvoie la question en suspens concernant la saisie de l’aéronef à la Cour supérieure du Québec, en attendant une décision finale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris.
C. Actions collectives
1. Hakim c Pfizer Inc[112]
Hakim demande la suspension temporaire d’une demande d’autorisation d’intenter une action collective contre Pfizer, alléguant que l’entreprise a conçu, fabriqué, testé, emballé, étiqueté, commercialisé et vendu des pilules contraceptives Alesse 21® et Alesse 28® défectueuses. Hakim soutient que l’audience d’autorisation du Québec devrait être reportée en faveur de la certification de la Colombie-Britannique en raison de similitudes entre les parties, les faits et l’objet des deux procédures. Pfizer, de son côté, s’oppose à la suspension, alléguant que l’affaire du Québec implique un groupe plus important de parties et se limite à un défaut d’emballage, alors que l’affaire de la Colombie-Britannique se concentre sur une insuffisance de dosage.
En vertu de l’article 3137 CcQ, les procédures devant les tribunaux québécois peuvent être suspendues en présence de procédures parallèles dans une juridiction étrangère. Cependant, dans le cadre d’une action collective, l’article 3137 CcQ ne peut être invoqué si l’une de ses conditions, telles que l’antériorité, n’est pas remplie[113]. Ainsi, l’analyse d’une suspension des procédures dans le cadre d’une action collective oblige le juge à évaluer si les conditions d’une suspension des procédures fondée sur la litispendance internationale sont remplies[114]. Si une condition n’est pas satisfaite, le juge ne peut faire droit à la demande de sursis[115].
En l’espèce, les procédures judiciaires au Québec ont été engagées plusieurs mois avant les procédures judiciaires en Colombie-Britannique et la description du groupe québécois diffère aussi. De plus, les comprimés encapsulés et cassés, d’une part, et l’insuffisance de concentration des ingrédients actifs, d’autre part, constituent des causes d’action distinctes et nettement différentes. Ainsi, la Cour en conclut qu’il n’y a pas de litispendance entre les deux demandes en raison de cette différence significative dans les faits sous-jacents.
La Cour examine ensuite si une suspension servirait la bonne administration de la justice, compte tenu des intérêts des résidents du Québec en vertu de l’article 577 Cpc. Cet article guide et inspire l’approche du tribunal dans de tels cas, stipulant que le tribunal ne peut refuser d’autoriser une action collective uniquement parce que les membres du groupe font partie d’une action collective multijuridictionnelle hors Québec. Toutefois, si une telle action existe à l’extérieur du Québec, le tribunal peut refuser le désistement d’une demande ou permettre à un autre demandeur d’intenter une action collective s’il estime que cela servira mieux les intérêts des membres du groupe.
La Cour conclut que la suspension demandée n’est pas justifiée, car les procédures judiciaires au Québec sont au moins aussi avancées que celles en Colombie-Britannique et que le processus d’autorisation est plus rapide et plus simple au Québec. De plus, la procédure québécoise est réputée pour être plus souple que celle en vigueur dans le reste du Canada, avec un seuil bas pour autoriser une action collective au Québec[116]. La Cour observe également que les avocats et la législation du Québec ne sont pas impliqués de manière significative dans les procédures en Colombie-Britannique et que les résidents du Québec manifestent peu d’intérêt à leur égard. Par conséquent, la Cour conclut que les intérêts de la justice sont mieux servis en permettant la poursuite des procédures au Québec, car les procédures en Colombie-Britannique ne protègent pas suffisamment les intérêts des résidents du Québec et ne répondent pas aux impératifs de proportionnalité, d’équité et de bon déroulement des procédures[117].
2. Patterson c Ticketmaster Canada Holdings[118]
Ticketmaster demande la suspension d’une action collective au Québec réclamant des remboursements pour les annulations d’événements liées à la COVID-19, au profit d’une action similaire en Ontario. Cette démarche s’appuie sur les dispositions de ses conditions d’utilisation, lesquelles comportent une renonciation aux actions collectives, à l’arbitrage obligatoire et à la compétence des tribunaux québécois pour régler les différends.
La Cour procède à l’examen de l’article 3137 CcQ, qui exige l’identité tripartite entre les parties, la cause et l’objet du recours afin de suspendre une action collective au Québec en raison d’une procédure similaire entreprise ailleurs. Toutefois, en raison des différences entre les systèmes juridiques, la règle de l’identité tripartite est plus flexible dans les litiges internationaux. La Cour détermine que les faits et les objets des actions collectives au Québec et en Ontario sont identiques, et que l’identité entre les demandeurs et les défendeurs n’a pas besoin d’être parfaite[119] ; il suffit que certains défendeurs soient communs aux deux actions[120].
La Cour souligne que l’article 577 Cpc, plutôt que l’article 3137 CcQ, constitue l’enjeu principal de la présente affaire. En effet, l’article 577 Cpc prévoit qu’une action collective au Québec peut être suspendue s’il existe une procédure parallèle dans une autre juridiction offrant une meilleure protection des droits et intérêts des résidents du Québec. Pour évaluer la protection ainsi offerte, divers facteurs sont pris en considération, notamment l’état d’avancement des procédures dans l’autre juridiction, la participation et l’intérêt des membres dans les procédures québécoises, ainsi que les différences entre les lois applicables dans les différentes juridictions[121].
StubHub, en tant que co-défendeur dans l’action québécoise, s’oppose à la demande de suspension de Ticketmaster. Il fait valoir que le demandeur, Patterson, n’a établi de relation contractuelle qu’avec Ticketmaster et non avec StubHub. La suspension du recours collectif québécois contre Ticketmaster entraînerait donc des difficultés à vérifier le droit de Patterson d’intenter une action contre d’autres défendeurs dans le recours collectif québécois.
Toutefois, Ticketmaster n’a pas réussi à démontrer que la priorisation du recours collectif en Ontario protégerait mieux les droits et intérêts des résidents du Québec. La Cour ne disposait pas d’informations fiables sur les procédures ontariennes, et les critères de certification sont plus stricts en Ontario qu’au Québec. Néanmoins, un refus de certification en Ontario n’entraîne pas automatiquement un refus d’autorisation au Québec. Par conséquent, la Cour rejette la demande de suspension de Ticketmaster, car sa préférence pour une seule instance de défense n’est pas un critère applicable en vertu de l’article 577 Cpc.
3. Pohoresky c Otsuka Pharmaceutical Company Limited[122]
Harold et Michael Pohoresky (Pohoresky), père et fils, demandent l’autorisation d’exercer une action collective contre les défendeurs étrangers Otsuka et Lundbeck USA (défendeurs étrangers), alléguant le manquement à l’obligation de divulguer les risques d’effets secondaires nocifs associés au médicament REXULTI® et les recherches et tests inadéquats concernant ces prétendus effets secondaires. Ils ont pour objectif d’établir une action collective nationale pour toutes les personnes ayant résidé au Canada et ayant été prescrites et ayant ingéré REXULTI® à partir du 16 février 2017.
Les défendeurs étrangers font valoir que les tribunaux québécois ne sont pas compétents pour entendre les actions personnelles de Pohoresky et les demandes des non-résidents du Québec contre eux. En réponse, Pohoresky soutient que les effets secondaires de REXULTI® se sont en partie manifestés au Québec. En effet, Michael prétend avoir subi des effets secondaires nocifs non divulgués, notamment une compulsion au jeu, entraînant des conséquences psychologiques et financières, tandis qu’Harold affirme avoir subi des préjudices en raison de la compulsion au jeu de son fils.
La Cour juge que ce critère unique et vague est insuffisant pour établir la compétence des tribunaux québécois, au sens de l’article 3148 CcQ, pour la réclamation de Pohoresky et des autres membres non-résidents. Cependant, la Cour affirme sa compétence sur les réclamations contre les défendeurs étrangers en vertu de l’article 3136 CcQ[123]. Cette décision repose sur un lien suffisant entre les réclamations des membres et la province de Québec, ainsi que sur la règle de proportionnalité.
La Cour établit que les allégations d’inconduite et de manquements des défendeurs étrangers sont liées aux fautes présumées commises par les défendeurs canadiens concernant REXULTI®, établissant ainsi un lien suffisant entre les réclamations des membres et la province de Québec. Par conséquent, les tribunaux québécois ont compétence sur les réclamations contre les défendeurs canadiens et étrangers, et ces réclamations sont étroitement liées. La Cour rejette l’exception déclinatoire des défendeurs étrangers, car « il serait disproportionné et déraisonnable [de demander aux parties de] plaider les revendications des membres dans différentes instances à travers le Canada »[124].
4. Ranger c Aphria Inc[125]
Ranger demande l’autorisation d’une action collective au Québec. L’action concerne les individus ou les entités qui ont acquis des titres d’Aphria Inc (Aphria) entre le 20 janvier 2018 et le 4 décembre 2018, à l’exclusion de certaines parties. Les allégations portent sur de fausses déclarations importantes faites par Aphria concernant ses activités, ayant eu un impact négatif sur le cours de son action et causant un préjudice aux membres du groupe.
Cependant, Aphria demande au tribunal de rejeter l’action collective, affirmant que les tribunaux québécois n’ont pas compétence pour entendre le recours. Selon la société, Aphria n’était pas un émetteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec pendant la période visée par l’action collective, et toute faute commise aurait été commise à l’extérieur du Québec.
La Cour se penche sur la question de sa compétence pour entendre l’action collective et conclut qu’Aphria n’était pas un émetteur assujetti pendant la période couverte par la demande et que les tribunaux québécois n’ont donc pas compétence pour entendre l’affaire. De plus, Ranger n’était pas domicilié au Québec, la faute alléguée ne s’est pas produite au Québec et le lien entre Aphria et le Québec était insuffisant.
La Cour constate en outre que les dommages subis par Ranger n’ont été comptabilisés qu’au Québec, alors que le lieu substantiel du dommage se situe en Ontario. Par conséquent, Ranger ne peut pas fonder la compétence du tribunal sur le paragraphe 3 de l’alinéa 1 de l’article 3148 CcQ.
Ensuite, la Cour aborde la doctrine du forum non conveniens, expliquant qu’elle doit être considérée lors de l’analyse de la réclamation individuelle de Ranger et de sa demande d’autorisation d’exercer une action collective[126]. Elle doit tenir compte de divers critères, notamment la résidence et le domicile des parties, le lieu du for naturel, le lieu de la preuve, le lieu de résidence des témoins, et le lieu de la conduite et de la transaction alléguées[127]. La Cour note que bien que les tribunaux québécois reconnaissent l’importance de conserver les ressources judiciaires lorsqu’une action multijuridictionnelle avec les mêmes enjeux est en cours ailleurs, la solution la plus probable est de suspendre les procédures au Québec et de surveiller les intérêts des membres du groupe québécois dans les litiges à l’extérieur de la province.
La Cour en conclut que bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher la question du forum non conveniens puisque les tribunaux québécois n’ont pas compétence, dans l’hypothèse où les tribunaux auraient compétence, un débat sur l’opportunité de suspendre les procédures au Québec aurait peut-être été approprié. Par conséquent, la demande en autorisation d’une action collective est rejetée.
D. Affaires familiales
1. Droit de la famille – 211290[128]
PA intente une action au Québec pour établir sa paternité à l’égard de l’enfant X, né au Québec, alors que la mère, BC, a déménagé en Ontario. En 2017, la Cour supérieure du Québec ordonne une analyse ADN pour vérifier si PA est le père biologique de X, mais l’exécution de cette ordonnance n’a lieu qu’en avril 2020, lorsque BC cherche à révoquer le jugement. Malgré le rejet de la demande de BC, la Cour supérieure du Québec accueille la demande de son mari, GP, pour révoquer le jugement[129]. PA interjette alors appel de cette décision et dépose un avis d’appel contre un jugement ultérieur, alléguant que la Cour supérieure n’a pas compétence pour statuer sur la demande de filiation de l’enfant.
En appel, PA soutient qu’il est l’un des « parents » de X et que le juge a erronément décliné la compétence de la Cour supérieure du Québec. Me Prud’homme, la tutrice ad hoc de l’enfant X, est d’accord, affirmant que le déclin de cette juridiction ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour d’appel détermine que l’expression « l’un de ses parents » de l’article 3147 CcQ doit être interprétée de manière large, en s’alignant sur les articles 532 et 3091 CcQ, pour appuyer l’établissement de la filiation d’un enfant et qu’une personne revendiquant la filiation d’un enfant entre dans son champ d’application. Par conséquent, la Cour supérieure est compétente pour connaître de l’action de PA en recherche de filiation et reconnaissance de paternité de l’enfant X. Cependant, la Cour d’appel reconnaît que permettre à une personne d’établir sa filiation peut parfois nuire à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, l’enfant ou les autres parties peuvent demander au tribunal de se dessaisir au profit d’un autre for « mieux à même de trancher le litige »[130].
La Cour d’appel examine ensuite si le jugement révoquant l’ordonnance antérieure est susceptible d’appel de plein droit ou avec permission. La Cour décide que l’appel requiert une autorisation et que GP n’a pas l’intérêt nécessaire pour s’opposer à la preuve ADN dans l’affaire. La Cour limite la révocation du jugement aux seules conclusions relatives à la déclaration de limites de PA, soulignant qu’elle inflige un préjudice irréparable tant à PA qu’à X. La Cour renvoie le dossier à la Cour supérieure du Québec pour décision et recommande à chaque partie d’assumer ses propres frais juridiques.
2. Droit de la famille – 211947[131]
Le litige opposant la demanderesse D (Madame) et le défendeur A (Monsieur), porte sur une bataille pour la garde de leurs deux enfants mineurs, nés au Québec. Les parties avaient convenu d’une garde partagée par un consentement à jugement, qui est resté en vigueur jusqu’en avril 2019, date à laquelle la Cour a homologué une entente modifiée. Toutefois, le différend est survenu après que Madame a déménagé avec les enfants en Belgique en juin 2019, où ils détiennent la citoyenneté belge par leur mère. En mars 2021, Monsieur a déposé une demande de modification de garde, de pension alimentaire et de rapatriement des enfants au Canada, ce qui a conduit Madame à déposer une demande d’exception déclinatoire. La demande de Madame vise à obtenir une déclaration de la Cour supérieure selon laquelle elle n’a pas compétence pour entendre et décider de la demande de Monsieur.
Madame soutient que la résidence habituelle de ses enfants et d’elle-même, qu’elle considère comme leur domicile, est en Belgique, et que la Cour supérieure du Québec devrait décliner sa compétence au profit d’un tribunal belge compétent. Monsieur, pour sa part, affirme que le domicile des enfants se situe toujours au Québec et que la Cour supérieure du Québec conserve sa compétence sur cette affaire.
Au Québec, la « garde de l’enfant est régie par la loi de son domicile »[132]. Par conséquent, les tribunaux sont compétents en matière de garde lorsque le domicile de l’enfant est situé au Québec[133]. Cette règle est en conformité avec l’article 5 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants[134], qui confère aux autorités de la résidence habituelle d’un enfant la compétence pour prendre des mesures visant à protéger son bien-être.
Sauf décision contraire du tribunal, le domicile du mineur est présumé être celui du parent avec lequel il réside habituellement[135]. Toutefois, l’intention d’une personne peut déterminer un changement de domicile[136], et le domicile d’origine persiste jusqu’à ce qu’un nouveau domicile soit établi[137]. Si la Cour supérieure autorise un parent gardien à déménager avec un enfant dans un nouveau domicile hors du Québec, les tribunaux québécois perdent compétence sur l’enfant, et le parent non-gardien doit se tourner vers le droit international privé pour exécuter ou modifier l’ordonnance de droit de visite[138].
En l’espèce, la Cour conclut que Madame n’a pas fourni de preuve suffisante pour établir que la résidence des enfants a été transférée du Québec vers la Belgique depuis juin 2019. En effet, l’entente entre les parties a permis aux enfants de déménager temporairement en Belgique avec Madame pour une période d’essai d’un an, avec une révision prévue. La Cour rappelle qu’elle avait autorisé le déménagement des enfants, mais pas un changement de domicile. En conséquence, la Cour supérieure du Québec conserve sa compétence et rejette la demande de Madame.
II. La reconnaissance des jugements étrangers
Le Canada est un État fédéral dans laquelle les provinces disposent de pouvoirs législatifs distincts. En droit québécois, chaque autre province est considérée comme un État et ses tribunaux sont considérés comme des « autorités étrangères »[139]. Lorsqu’un tribunal québécois est saisi d’une demande de reconnaissance d’une décision d’une autorité étrangère, son rôle se limite à vérifier si la décision étrangère satisfait aux conditions prévues par le Code civil du Québec pour la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères et à apprécier la compétence des autorités étrangères. Les tribunaux québécois ne sont pas tenus d’examiner le fond de la décision étrangère[140].
Toute décision rendue en dehors du Québec est reconnue et, le cas échéant, considérée comme exécutoire par les autorités québécoises, sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 3155 CcQ s’applique :
1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre ;
2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire ;
3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure ;
4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec ;
5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ;
6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger.
L’article 3164 CcQ énonce que la compétence d’une autorité étrangère pour résoudre un différend dépend des règles régissant la compétence internationale des tribunaux québécois[141], tant que « le litige se rattache d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie ».
De plus, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, l’article 3168 CcQ reconnait la compétence des autorités étrangères dans quatre cas précis :
1° Le défendeur était domicilié dans l’État où la décision a été rendue ;
2° Le défendeur avait un établissement dans l’État où la décision a été rendue et la contestation est relative à son activité dans cet État ;
3° Un préjudice a été subi dans l’État où la décision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit ;
4° Les obligations découlant d’un contrat devaient y être exécutées ;
Plusieurs de ces critères sont abordés dans les décisions rendues cette année concernant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Ces décisions soulignent l’importance pour les parties engagées dans des litiges transfrontaliers de maîtriser les règles de reconnaissance et d’application des décisions étrangères au Québec, afin d’assurer l’efficacité de leurs droits et obligations.
A. Jugements rendus par défaut
1. Helicopter Transport Services (Canada) Inc c Vaugeois[142]
Helicopter Transport Services (Canada) (HTSC) demande la reconnaissance d’un jugement par défaut de la Cour des petites créances de l’Ontario. Ce jugement ordonne à Vaugeois, résident du Québec, de payer pour suivre une formation afin d’obtenir une accréditation pour piloter un hélicoptère Bell 407. Toutefois, Vaugeois conteste la reconnaissance du jugement.
Le litige découle d’un accord entre les parties, selon lequel HTSC s’engageait à fournir à Vaugeois la formation nécessaire pour obtenir l’accréditation pour piloter des hélicoptères Bell 407. Vaugeois a signé un billet promissoire, s’engageant à payer au demandeur 7 321,60 $CAN pour cette formation. La somme serait considérée comme payée une fois que Vaugeois avait effectué deux années de service pour HTSC ou l’une de ses filiales.
Vaugeois invoque la première exception prévue à l’article 3155 CcQ, soutenant que le tribunal ontarien n’était pas compétent pour entendre la demande de recouvrement du montant dû en vertu du billet promissoire présenté par HTSC. Il affirme que seuls les tribunaux québécois ont compétence sur le fond du litige. Il souligne qu’il est domicilié au Québec et que son contrat de travail n’a pas été conclu avec HTSC, mais plutôt avec sa filiale Héli-Transport Inc.
Néanmoins, la Cour rejette l’argument de Vaugeois. La source de l’obligation donnant lieu à cette réclamation n’était pas le contrat de travail, mais le billet promissoire que Vaugeois a signé avec HTSC en Ontario, où le siège social de HTSC est situé. La Cour constate également que c’est en Ontario que les parties ont signé le billet promissoire et que Vaugeois a reçu la formation nécessaire pour obtenir l’accréditation de piloter des hélicoptères de type Bell 407. Par conséquent, elle détermine que le litige présente des liens importants avec l’Ontario, l’État dont l’autorité a été saisie[143], et que la Cour des petites créances de l’Ontario avait compétence pour entendre la demande de HTSC[144]. La Cour du Québec accède à la demande de HTSC en reconnaissance du jugement ontarien et condamne Vaugeois au paiement de la somme due.
2. Ram Mechanical Inc c Cacao 70 Inc[145]
Ram Mechanical Inc (Ram) dépose une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de justice albertaine fondée sur une violation de contrat et d’enrichissement injustifié. Après avoir obtenu un jugement par défaut, Ram cherche à le faire exécuter au Québec, où Cacao 70 possède des actifs. Bien que Cacao 70 soit présent à l’audience, il ne conteste pas la demande de reconnaissance et d’exécution.
Au Québec, les décisions étrangères sont présumées valides[146], sous réserve de certaines exceptions[147]. La partie cherchant à faire valoir un droit doit démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de ses prétentions[148]. Donc, pour vérifier la connexion substantielle de l’autorité étrangère avec le litige[149] et les conditions substantielles du jugement étranger[150], la Cour procède à une analyse en deux étapes.
En premier lieu, il est démontré de manière prépondérante que la Cour provinciale de l’Alberta est compétente pour entendre le litige, en raison d’un lien substantiel avec cette juridiction. Le litige concerne une action personnelle de nature patrimoniale[151], en l’occurrence un défaut contractuel dans un contrat de construction pour des services de plomberie et de chauffage, qui ne relève pas de la compétence exclusive du Québec[152]. De plus, Cacao 70 a un établissement en Alberta, et le contrat de construction est à la fois conclu et exécuté en Alberta, ce qui cause un préjudice pour Ram en Alberta à la suite du défaut contractuel de Cacao 70. En outre, Cacao 70 reconnaît la compétence de l’Alberta et ne fait défaut qu’après l’octroi de la demande de retrait de son avocat.
En second lieu, la Cour constate que le jugement est définitif et exécutoire en Alberta[153], ne viole pas les principes fondamentaux de procédure, n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public en matière de relations internationales et ne contrevient pas aux obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger. Aucun litige similaire n’est en cours entre les mêmes parties, n’a donné lieu à une décision au Québec, n’est pendant devant une autorité québécoise ou n’a été décidé dans un troisième État. Par conséquent, la Cour reconnaît et exécute le jugement albertain, ordonnant à Cacao 70 de payer à Ram la somme de 59 030 $CAN, ainsi que les frais, y compris les frais extrajudiciaires et les débours encourus.
B. Jugements rendus en présence du défendeur
1. AMBC Ventures Inc c Awanda[154]
AMBC Ventures Inc (AMBC), une entité ad hoc établie dans les îles Vierges britanniques, accorde un prêt à Thel Advisory Corporation Limited (Thel), une société basée à Hong Kong, afin de financer des contrats commerciaux de matières premières. Bien que le contrat de prêt prévoie un taux d’intérêt annuel de 438 % et un taux d’intérêt moratoire correspondant de 73 %, la transaction visant à fournir de l’or brut de Tanzanie aux Émirats arabes unis échoue, et Thel et son garant, Daniel Awanda, un résident de Laval, au Québec, ne remboursent pas l’emprunt. Par conséquent, AMBC poursuit les deux parties devant les tribunaux anglais et remporte un jugement les condamnant à payer 536 500 $US et 37 000 £ pour frais de justice. Suite à cela, AMBC cherche à faire exécuter le jugement anglais au Québec.
Cependant, en vertu de l’article 347 du Code criminel[155], la loi canadienne, y compris au Québec, considère tout taux d’intérêt supérieur à 60 % par année comme criminel. De plus, le paragraphe 5 de l’alinéa 1 de l’article 3155 CcQ interdit la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers contraires à l’ordre public québécois en matière de relations internationales. Tout jugement étranger doit s’intégrer harmonieusement dans l’ordre juridique québécois et tout jugement qui viole des lois impératives ne peut être exécuté[156].
La Cour supérieure conclut que le taux d’intérêt annuel de 438 % stipulé dans la convention de prêt est excessif et criminel selon les normes canadiennes, en violation de l’ordre public international du Québec. Conformément à l’article 3159 CcQ, la Cour peut dissocier les dispositions d’un jugement étranger. Ainsi, afin de déterminer la réparation appropriée, elle applique les critères énoncés dans l’arrêt Transport Express[157], rompt la clause d’intérêt et fixe le taux à 60 %. Cette décision respecte la liberté contractuelle et l’autonomie des parties tout en préservant l’ordre public[158]. La Cour révise le jugement anglais et ordonne à Thel et au garant de payer à AMBC la somme de 423 810,32 $CAN. Elle déclare également que l’ordre public est un concept dynamique qui équilibre la sécurité contractuelle avec les restrictions aux droits contractuels[159].
2. Corporatek Inc c Éditions Francis Lefebvre[160]
Le Tribunal de Commerce de Nanterre en France prononce une condamnation contre les Éditions Francis Lefebvre (EFL), les obligeant à payer à l’appelant une somme de 3 821 927,05 €. Cependant, cette décision est infirmée par la Cour d’appel de Versailles, qui condamne l’intimé à payer une somme de 6 971 695,40 €. Malgré cela, la Cour de cassation française annule la décision de la Cour d’appel de Versailles en raison d’un vice de procédure et renvoie l’affaire devant cette même cour pour une nouvelle décision.
Avant que la Cour d’appel de Versailles ne puisse prononcer une nouvelle décision dans l’affaire, EFL dépose une demande devant la Cour supérieure du Québec, afin de faire reconnaître et d’exécuter l’arrêt de la Cour de cassation française. Cette décision a pour effet de contraindre Corporatek à rembourser le paiement effectué conformément à la décision de la Cour d’appel de Versailles. La Cour supérieure du Québec reconnaît et exécute cette décision de la Cour de cassation française. Toutefois, Corporatek interjette appel de cette décision, faisant valoir qu’elle n’est ni définitive ni exécutoire en vertu du droit québécois.
La Cour d’appel du Québec accueille l’appel en précisant que, conformément à l’article 3155 CcQ, une décision étrangère n’est considérée comme « définitive » que si elle résout de manière concluante une question en litige entre les parties. Dans cette affaire, l’arrêt de la Cour de cassation française ne remplit pas cette condition, car elle ne règle définitivement aucun aspect du litige entre les parties. Il convient de souligner que, pour être considérée comme définitive, une décision n’a pas nécessairement pour objectif de mettre fin à la procédure principale : elle peut également trancher de manière définitive une question incidente ou accessoire de la procédure, pour autant qu’elle règle définitivement cet aspect du litige.
La Cour d’appel du Québec observe que la reconnaissance de l’arrêt de la Cour de cassation française engendre de nouveaux litiges entre les parties quant au calcul des intérêts à payer conformément au droit québécois[161]. Cela crée une interférence indirecte avec les procédures en cours devant les tribunaux français. En vue de la reconnaissance de la décision étrangère est conforme aux principes de courtoisie, d’ordre et d’équité internationaux, ainsi qu’à des considérations d’économie judiciaire et à l’intérêt de décourager la multiplication des procédures dans un procès en cours, la Cour milite en faveur du rejet de la demande de reconnaissance de l’arrêt de la Cour de cassation.
La Cour d’appel du Québec estime ainsi que la décision de la Cour supérieure du Québec reconnaissant et exécutant l’arrêt de la Cour de cassation française est erronée, et rejette la demande introductive d’instance en reconnaissance et exécution présentée par EFL. La question de la responsabilité d’EFL vis-à-vis Corporatek reste en suspens jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles rende une nouvelle décision. Dès lors, « la reconnaissance et l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation […] ne peuv[ent] être source de stabilité juridique entre les parties »[162].
III. Droit applicable
Les litiges impliquant des parties étrangères ou de faits survenus dans un autre pays peuvent se révéler complexes, étant donné que des interrogations peuvent surgir quant au droit applicable. Il est donc primordial que les tribunaux abordent avec attention la problématique du droit dans les affaires présentant un élément d’extranéité afin de garantir un résultat juste et équitable.
A. Fotso c Brice[163]
Bertrand Fotso (Fotso) et Roger Wabo (Wabo) prétendent que Serge Bobbé (Bobbé) et Garba Well (Well) leur doivent 15 000 $CAN pour l’achat et l’importation d’un véhicule au Cameroun. De plus, ils demandent l’annulation de la vente, car le véhicule n’a pas été livré malgré le paiement effectué. Cependant, Bobbé et Well contestent cette demande en faisant valoir qu’ils ont traité avec les demandeurs indirectement par l’intermédiaire du Groupe B WON Inc (WON), qui est également impliqué dans cette affaire. Bien que la majorité des parties résident au Québec et que la transaction a eu lieu au Québec, aucune d’entre elles ne demande l’application de la loi camerounaise en vertu du paragraphe 2 de l’alinéa 1 de l’article 3114 CcQ ou de l’article 3117 CcQ. Toutefois, Wabo, un résident du Cameroun, consent à résoudre le différend au Québec en utilisant les procédures judiciaires. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2809 CcQ, la Cour applique donc le droit québécois.
Malgré le transport de la voiture jusqu’à destination, celle-ci n’a pas été livrée à l’acheteur au Cameroun. WON admet devoir aux demandeurs une somme de 7 000 $CAN pour le prix d’achat convenu et s’engage à rembourser les demandeurs.
En sus du prix d’achat, Fotso et Wabo réclament le remboursement des frais encourus par Wabo au Cameroun, car ce dernier a versé 3,7 millions de francs CFA à Ngassa MBadi, qui prétendait représenter WON. Conformément à l’article 2160 CcQ, WON est responsable des actes de son mandataire, en l’occurrence MBadi, qui a agi en son nom en recevant le paiement de Wabo. Par conséquent, le tribunal ordonne à WON de rembourser à Wabo la somme versée à son représentant, limitée à 8 000 $CAN.
Fotso et Wabo cherchent également à engager la responsabilité de Bobbé et Well pour les actions de WON. Ils affirment que le voile de la personnalité morale doit être levé afin d’établir leur responsabilité personnelle en tant que victimes de fraude. Toutefois, la Cour maintient l’application de la doctrine de la personnalité juridique distincte, selon laquelle les actes d’une société ne peuvent en principe être imputés à ses actionnaires ou dirigeants. Bien que les demandeurs n’aient pas réussi à prouver que Bobbé et Well avaient commis une fraude ou adopté un comportement justifiant la levée du voile corporatif, la demande contre les défendeurs individuels est rejetée.
B. St-Jacques c Gaudreau-Duchesne[164]
St-Jacques est propriétaire d’un condominium situé en Floride aux États-Unis. Un contrat de vente est signé avec Julie Gaudreau-Duchesne et Alain Aubé Limited Partnership (JGDAA) pour 145 000 $US, avec une date de transfert de propriété fixée au 29 juin 2018. Le même jour, St-Jacques signe un deuxième contrat personnellement, indiquant un prix de vente réel de 162 500 $US et des modalités supplémentaires. St-Jacques réclame désormais un solde restant de 18 170 $CAN et un supplément de 19 390 $CAN pour des jours de vacances perdus. Gaudreau-Duchesne et Aubé soutiennent qu’ils ont signé les contrats en tant que représentants de JGDAA et non personnellement, et qu’ils ne sont donc pas parties aux contrats. Ils nient également tout abus de droit dans leur contestation.
La Cour du Québec se déclare compétente en vertu du premier paragraphe de l’article 3148 CcQ afin de trancher le litige qui oppose St-Jacques et les défendeurs domiciliés au Québec, malgré l’emplacement du condominium en Floride et la possible application de la loi de la Floride. Faute d’allégation ou d’établissement de la loi de la Floride, la loi québécoise prévaut[165].
La Cour considère le deuxième contrat entre les parties comme une contrelettre et une simulation, révélant la véritable intention des parties en ce qui concerne le prix de vente du condominium, les modalités de paiement, les droits de séjour et les frais de nettoyage. Les représentants de JGDAA, agissant dans leur propre intérêt, sont tenus responsables du solde restant du prix de vente et des droits de séjour inutilisés dus à St-Jacques.
JGDAA doit ainsi à St-Jacques 18 170 $CAN pour le solde restant du prix de vente, 5 170,76 $CAN pour les droits de séjour inutilisés et doit honorer ses obligations contractuelles pour onze semaines de vacances à venir. Puisque JGDAA n’est pas enregistrée au Québec comme l’exige le troisième paragraphe de l’article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises[166], elle est considérée comme une société en participation[167]. Gaudreau-Duchesne, en tant que commanditaire de JGDAA et partenaire de la société, peut être tenue personnellement responsable des dettes et obligations de la société[168]. En sa qualité de débitrice solidaire[169], elle doit assumer la responsabilité de payer le solde restant du prix de vente et les dommages-intérêts dus à St-Jacques.
La Cour ne trouve aucune preuve que les défendeurs abusent de leurs droits ou agissent de manière malveillante ou imprudente.
IV. La notification internationale
La notification internationale vise à s’assurer que les parties concernées sont correctement informées des procédures judiciaires, leur offrant ainsi la possibilité d’y participer et de protéger leurs droits. La procédure de notification internationale comprend une série d’étapes multiples et complexes, telles que la traduction, la certification et le respect des réglementations du pays de destination pour la bonne exécution de la notification.
Lorsqu’un État ratifie la Convention de La Haye sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale[170] (Convention de La Haye), la notification doit être effectuée en vertu de cette convention[171] et les tribunaux ne peuvent y déroger[172]. Dans de tels cas, toute autorisation d’un mode alternatif de notification est invalide[173]. La Convention de La Haye, qui a force de loi au Québec, a préséance sur les dispositions régissant la notification des procédures à l’intérieur de la province[174].
Les règles suivantes s’appliquent au Québec en matière de notification internationale des procédures. L’alinéa 3 de l’article 107 Cpc énonce les exigences relatives au dépôt d’une demande initiale en vue d’un procès ou d’un jugement :
107. […] Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification ; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée.
L’article 363 Cpc concerne les délais de dépôt d’un appel au Québec :
363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel.
Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels ; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension.
L’article 494 Cpc décrit les procédures de notification internationale des actes de procédure en matière civile ou commerciale :
494. La notification internationale s’effectue, dans les États qui y sont parties, conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec.
La notification, dans un État qui n’est pas partie à cette convention, s’effectue suivant les modes prévus au livre I ou conformément au droit en vigueur au lieu où elle doit être effectuée. Le tribunal peut, sur demande, si les circonstances l’exigent, autoriser un autre mode de notification.
Le procès-verbal de la notification est transmis à celui qui l’a requise par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande de notification a été acheminée.
Enfin, l’article 495 Cpc traite des situations dans lesquelles un tribunal peut rendre un jugement par défaut contre un défendeur dans un État étranger :
495. Lorsqu’une demande introductive d’instance a été transmise dans un État étranger pour y être notifiée conformément à l’un des modes admis par le droit de cet État pour la notification sur son territoire des actes venant de l’étranger et qu’il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l’obtenir, aucun procès-verbal de notification n’a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le tribunal peut néanmoins rendre jugement contre le défendeur.
La partie ainsi condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation ou de contester au fond, peut, dans l’année de la date du jugement, en demander la rétractation si elle démontre que, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à l’encontre de la décision et que ses moyens de défense n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
Les décisions qui suivent portent sur des questions relatives à la notification internationale de documents juridiques et à la conformité aux exigences légales et conventions pertinentes. Elles soulignent l’importance de respecter les exigences légales applicables aux parties dans les procédures de notification en droit international privé.
A. 9343-4678 Québec Inc (Restaurant Déli Boyz) c Uber Canada Inc[175]
Le Restaurant Déli Boyz dépose une requête pour notifier des documents juridiques à Uber BV et Uber Portier BV aux Pays-Bas par courrier électronique ou par FedEx. Toutefois, selon l’article 494 Cpc, la signification internationale doit respecter les normes énoncées dans la Convention de La Haye. Cela s’applique aux États parties de cette convention, dont font partie le Canada et les Pays-Bas. Malheureusement, la Convention de La Haye ne précise pas clairement si le courrier électronique ou les coursiers privés tels que FedEx sont des méthodes de notification acceptables. Face à cette incertitude, la Cour décide de prendre des précautions et autorise la notification par l’intermédiaire de Postes Canada, une entité postale exploitée par l’État[176]. Le Restaurant Déli Boyz est donc autorisé à signifier sa demande et toute procédure supplémentaire par l’intermédiaire de Postes Canada, à l’adresse des défendeurs aux Pays-Bas, jusqu’à ce qu’ils obtiennent une représentation juridique. De plus, il est nécessaire que le demandeur dépose une preuve de confirmation de livraison pour prouver la signification.
B. Hazan c Micron Technology Inc[177]
Hazan éprouve des difficultés pour signifier l’avis d’appel à tous les intimés dans le cadre d’une action collective internationale. Cependant, les méthodes de notification varient en fonction de la nationalité des intimés. Pour les intimés canadiens, Hazan utilise le courrier électronique, tandis que pour les intimés américains, il utilise le service de messagerie. En ce qui concerne les intimés coréens, Hazan collabore avec l’Autorité centrale pour les notifier. En prévision d’un délai de signification de trois à cinq mois, Hazan demande à la Cour de déclarer que l’appel a été dûment introduit, de le relever du défaut de signification dans les trente jours prescrits, ou d’ordonner au greffier de la cour d’ouvrir le dossier d’appel pour les intimés coréens.
La Cour reconnaît l’intention de Hazan.de faire appel dans les trente jours ainsi que les démarches entreprises. Cependant, la difficulté de signifier les intimés coréens risque de ne pas permettre de respecter le délai de six mois prévu à l’article 363 Cpc. Par conséquent, la Cour renvoie la demande à un collège de trois juges.
Malgré cela, la Cour accueille la demande de Hazan au titre de bene esse, le relevant du défaut de déposer l’avis d’appel et proroge le délai de dépôt du mémoire. Ainsi, Hazan dispose désormais de trois mois et dix jours à compter de la notification au dernier intimé pour déposer son mémoire concernant tous les intimés.
La Cour constate que l’Arrêté n° 4267[178], qui autorise la notification par courrier électronique, a été promulgué en réponse à l’état d’urgence pandémique de la COVID-19. Cependant, elle se demande si un décret lié à une urgence au Québec peut prévaloir sur un traité international appliqué en République de Corée. Encore, la Cour soumet la question du droit de Hazan à notifier les intimés coréens par courrier électronique à un collège de trois juges.
Lors d’une audience ultérieure, la Cour autorise Hazan à notifier Samsung de ses procédures d’appel par l’intermédiaire de ses avocats au Québec, tout en fournissant une traduction en coréen. Cette décision a été prise en considération du fait que les avocats de Samsung en première instance avaient déposé un acte de représentation dans la présente instance d’appel. D’autres éléments d’analyse ont également penché en faveur de Hazan, notamment le temps écoulé depuis le jugement de première instance et la modification de la pratique du greffe de la Cour. Toutefois, la Cour souligne que chaque cas doit demeurer un cas d’espèce et que l’ordonnance recherchée devra être justifiée en fonction des circonstances propres au dossier et de l’objectif de notification.
Au cours d’une audience ultérieure[179], la Cour autorise Hazan de notifier Samsung de ses procédures d’appel par l’entremise des avocats de Samsung au Québec, tout en fournissant une traduction en coréen. Les éléments d’analyse qui penchaient en faveur de Hazan comprenaient notamment le temps écoulé depuis le jugement de première instance et la modification de la pratique du greffe de la Cour. De plus, les avocats qui représentaient Samsung en première instance ont déposé un acte de représentation dans la présente instance d’appel. Cependant, la Cour souligne que chaque cas doit être considéré individuellement et que l’ordonnance demandée doit être justifiée en fonction des circonstances particulières du dossier et de l’objectif de la notification.
C. Letarte c Bayer Inc[180]
Letarte dépose une demande d’autorisation pour exercer une action collective contre Bayer Inc, Bayer Healthcare et Bayer Corporation en relation avec les problèmes de santé causés par un implant contraceptif permanent. Toutefois, la notification de l’assignation n’a été effectuée qu’à l’égard de deux des trois défendeurs. La demanderesse cherche maintenant à obtenir une réparation pour défaut de signification à l’égard de la troisième défenderesse, Bayer Corporation, dans le délai de trois mois prévu à l’alinéa 3 de l’article 107 Cpc.
Letarte soutient que ledit délai ne s’applique pas à la notification internationale en vertu des articles 494 et 495 du Cpc. En outre, elle ajoute que si le délai s’applique, il doit être prolongé, car elle a agi avec diligence et que Bayer Corporation n’a subi aucun préjudice. Toutefois, Bayer Corporation s’oppose à la demande et demande la prescription du recours intenté contre elle.
D’après la Cour, l’alinéa 3 de l’article 107 Cpc s’applique dans le cas d’une notification internationale. Cependant, la prise en compte des règles internationales ou étrangères relatives à la notification est un élément important pour déterminer si une partie doit être déchargée de sa défaillance. Néanmoins, la Cour souligne que les parties étrangères ne doivent pas être confrontées à une incertitude permanente en raison du retard excessif d’une autre partie dans le respect des dispositions d’une convention internationale.
Il convient également de souligner que le délai de trois mois prévu à l’alinéa 3 de l’article 107 Cpc n’est pas un délai de rigueur[181]. En effet, une partie peut bénéficier d’une dispense de non-conformité si elle est en mesure de prouver qu’elle avait des raisons légitimes et impérieuses pour ne pas respecter le délai imparti. Toutefois, la Cour rejette l’argument de Letarte selon lequel elle devrait être relevée de son défaut, car le retard dans la notification de la procédure était dû à une erreur, n’avait causé aucun préjudice à Bayer Corporation, et cette dernière aurait prétendument renoncé à son droit à être valablement signifiée. La Cour affirme que l’existence du procès depuis 2016 n’excuse pas les exigences de notification. En effet, la défaillance dans la notification correcte de Bayer Corporation était due à la négligence des avocats de la demanderesse et à leur manque de transparence, et non à une erreur. En outre, la Cour estime que Letarte n’avait pas démontré de motifs sérieux ou raisonnables pour ne pas respecter les exigences de notification dans le délai imparti. L’absence de préjudice ne suffisait pas à exonérer la demanderesse de son défaut. En conséquence, la Cour rejette la demande de Letarte et déclare l’action périmée.
D. Surin c Apple Inc[182]
Surin intente une action en contrefaçon de marque contre Apple Inc (Apple), demandant à la fois une injonction et des dommages-intérêts. Toutefois, Apple demande au tribunal de rejeter cette demande en arguant qu’elle n’a pas été correctement notifiée. Bien que Surin ait tenté de notifier sa demande au siège social d’Apple au Canada sans succès, il envoie actuellement une notification par courrier électronique. Surin soutient que l’Arrêté n° 4267[183] autorise la notification par courrier électronique et que, par conséquent, la notification de la demande introductive d’instance doit être considérée comme valide. Apple rétorque actuellement que la demande n’est pas notifiée conformément à la Convention de La Haye[184] et que, même si la méthode était appropriée, la demande a été notifiée à la mauvaise entité.
La Cour décide que la notification adressée à CanadaLegal@apple.com n’est pas conforme à la Convention de La Haye. Un principe juridique bien établi énonce que le demandeur ne peut notifier une personne morale en utilisant l’adresse probable d’une autre[185]. La Cour ne trouve aucun élément de preuve permettant d’établir une relation entre l’adresse électronique utilisée et Apple. En outre, le tribunal a la faculté discrétionnaire de proroger le délai de trois mois[186] pour signifier une demande introductive d’instance s’il existe des motifs légitimes justifiant le retard, si la demande est sérieuse, si la partie fait preuve de diligence et si la preuve présentée est à la fois probante et suffisante pour justifier le défaut ou le retard[187]. Aucune prorogation de délai ne doit être automatique[188]. En l’espèce, bien que les avocats de Surin adoptent une position intenable quant à l’applicabilité de l’Arrêté n° 4267, ils participent activement aux discussions avec les avocats d’Apple. Apple ne subira pas de préjudice substantiel si la Cour autorise Surin à notifier sa demande introductive d’instance par voie postale aux États-Unis. En conséquence, la Cour conclut que la notification par voie postale doit être autorisée et l’affirmation selon laquelle Surin n’avait pas déposé la déclaration de mise en état au procès dans le délai approprié est dénuée de fondement.
V. Les règles relatives au transport aérien international
La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international[189], connue sous le nom de Convention de Montréal (Convention), est incorporée dans le droit canadien par l’article 2(2.1) de la Loi sur le transport aérien[190]. En énonçant les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens peuvent être tenus responsables et en limitant leur responsabilité[191], la Convention assure la protection des intérêts du secteur du transport aérien international tout en maintenant un équilibre avec les passagers cherchant à obtenir réparation[192]. De plus, elle établit des présomptions de responsabilité ou de faute, simplifiant ainsi le processus pour les passagers de déposer des réclamations contre les transporteurs aériens[193]. En tant qu’accord international, la Convention remplace tout autre recours prévu par le droit interne d’un État membre[194]. Par conséquent, elle s’applique à l’exclusion du régime de responsabilité civile extracontractuelle du Code civil du Québec.
L’article 17 de la Convention traite la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de blessure, de décès ou de dommages causés aux bagages :
Article 17 – Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Les paragraphes 2 et 5 de l’article 22 de la Convention prévoient les limites du montant d’indemnisation qu’un passager peut recevoir à l’égard de ses bagages :
Article 22 – Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
[…]
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
[…]
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
Cependant, l’article 29 de la Convention[195] précise que les seuls recours disponibles contre les transporteurs aériens pour les dommages subis lors de voyages aériens internationaux sont ceux décrits dans la Convention elle-même :
Article 29 – Principe des recours
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.
Cette année, la Cour des petites créances continue de recevoir de nombreuses réclamations contre les compagnies aériennes[196]. Étant donné que les dispositions de la Convention de Montréal sont reconnues comme applicables en droit québécois, ces décisions n’offrent pas une analyse approfondie du droit international privé. Néanmoins, les questions soulevées dans les causes suivantes ont retenu notre attention.
A. Hilaire c Air Canada / Air Canada Rouge[197]
Lors d’un vol de Fort-de-France, Martinique à Montréal, Air Canada refuse l’embarquement au fiancé américain d’Hilaire. Cette dernière dépose alors une réclamation en dommages-intérêts contre la compagnie aérienne, reprochant à celle-ci de ne pas lui fournir des informations précises et une assistance adéquate. Air Canada nie toute responsabilité de paiement et invoque diverses raisons, telles que les restrictions de voyage liées à la COVID-19 imposées par le gouvernement canadien, l’application de la Convention et le remboursement partiel reçu par Hilaire pour le vol inutilisé.
La Cour estime qu’Hilaire fournit une preuve claire et convaincante selon laquelle elle a informé le représentant d’Air Canada à Fort-de-France de l’exemption de son fiancé des restrictions de voyage. En revanche, la compagnie aérienne ne fournit aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle elle était obligée de refuser l’embarquement au fiancé d’Hilaire.
De plus, le tribunal détermine qu’Air Canada a manqué à son devoir[198] de fournir des renseignements exacts et une aide adéquate[199] à Hilaire. En conséquence, la Cour accorde à Hilaire 945,09 $CAN pour le vol alternatif de son fiancé et 500 $CAN pour les inconvénients et le stress causés par les actions de la compagnie aérienne[200]. Cependant, la Cour rejette la demande d’Hilaire de dommages-intérêts punitifs[201], interdits par l’article 29 de la Convention.
B. Kake c Société Air France[202]
Abdoulaye Kake, une personne à mobilité réduite, achète des billets d’Air France pour un voyage de Montréal à Conakry, avec une escale à Paris. Bien qu’il enregistre son fauteuil roulant en tant que bagage enregistré pour le vol, celui-ci disparaît à son arrivée à Conakry. Malgré sa demande, Air France ne fournit aucun fauteuil de remplacement pendant son séjour. À son retour à Montréal, Kake se procure un fauteuil roulant temporaire. Cinq mois plus tard, Air France lui a fourni un fauteuil de remplacement, similaire à celui qui avait été perdu.
Kake demande une compensation de 15 000 $CAN pour la perte de son fauteuil roulant, ainsi que les frais de billet, la location de voiture à Conakry, les frais de physiothérapie pour les chutes subies pendant son séjour à Conakry et la détresse émotionnelle qu’il subit. Cependant, Air France soutient qu’elle a respecté la Convention, qui limite l’indemnisation pour les bagages perdus à environ 2 100 $CAN.
La Cour rejette la demande de Kake puisque la Convention limite la responsabilité des compagnies aériennes pour les dommages subis lors des voyages aériens internationaux. Elle détermine que le seul recours disponible pour Kake est le remboursement de la valeur du fauteuil roulant perdu, étant donné que la Convention ne couvre pas les dommages subis par les passagers après l’embarquement ou le débarquement de l’avion[203], tels que les accidents ou les blessures survenant pendant le séjour à destination. Ainsi, la demande de Kake pour des dommages résultant de chutes à Conakry et de douleurs et souffrances est rejetée, car elle dépasse le champ d’application de la Convention[204].
C. Nguyen c Société Air France[205]
Don Nguyen (Nguyen) réclame une indemnisation de 8 048,23 $CAN à la Société Air France (Air France) pour la perte d’espèces et d’une montre de valeur dans ses bagages à main lors d’un vol Paris-Florence. Toutefois, Air France conteste cette demande en affirmant que Nguyen n’a pas respecté les conditions de transport pertinentes, et que la Convention exclut sa réclamation. Certes, la Convention régit la responsabilité des compagnies aériennes en matière de bagages. Toutefois, elle opère une distinction entre les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés, et exige que les passagers prouvent la faute de la compagnie pour les dommages causés aux bagages non enregistrés.
En l’espèce, l’agente de bord refuse à Nguyen de conserver ses bagages à main avec lui, affirmant qu’il n’y a pas suffisamment de place dans la zone des passagers. Elle insiste pour les stocker ailleurs et pendant le vol, la valise est ouverte et des objets de valeur sont volés. Air France avance l’argument selon lequel Nguyen aurait dû retirer les objets de valeur avant de remettre sa valise, mais la Cour n’est pas convaincue. En effet, le choix de l’agente de bord de prendre en charge les bagages de Nguyen était arbitraire et, en tant que telle, elle était responsable de la conservation de leur contenu. De plus, elle a manqué à son devoir de conseiller le passager de retirer tous les objets de valeur. En conséquence, la Cour a statué que le passager avait droit à une indemnisation complète pour ses pertes[206], plutôt qu’à l’indemnisation limitée prévue par la Convention[207].
VI. En matière de faillite
Le cadre juridique québécois en matière de faillite et de cautionnement pour frais intègre les lois fédérales et provinciales, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Loi) constituant la base principale des procédures de faillite. Le Code civil du Québec régit les questions de droit civil, tandis que le Code de procédure civile détaille les procédures pour l’obtention d’ordonnances de cautionnement. Toutefois, l’application de ces lois et règlements s’avère complexe, comme le souligne l’article 3 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité[208] (Règles) :
Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.
Une question controversée émerge fréquemment, à savoir si un syndic est habilité à requérir un cautionnement pour frais de justice auprès d’un créancier non-résident dans le cadre d’une procédure de faillite. La décision suivante apporte des éclaircissements à cette problématique.
A. Syndic de Pâtisserie de Gascogne Inc[209]
Pâtisserie de Gascogne Inc (Débitrice) déclare de manière volontaire sa faillite en conformité avec la Loi. Par conséquent, MNP LTD (Syndic) est désigné comme séquestre officiel de la succession de la Débitrice. Dans le but d’acquérir les biens de la Débitrice, Arnaud Chailloux (Chailloux) verse un dépôt de 75 000 $CAN au Syndic. Cependant, ce dernier demande un cautionnement pour frais de justice en vertu des articles 192(1)(k) et 197(1) de la Loi ainsi que de l’article 492 Cpc.
Chailloux, résidant à Fort-de-France, en Martinique, conteste la requête, arguant que la Loi ne prévoit aucun cautionnement pour frais dans ce cas et que, si le droit commun provincial s’applique par le biais de l’article 3 des Règles, la disposition d’exclusion prévue par la Loi assurant l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec[210] (Loi de l’Entente France–Québec) doit être invoquée. De plus, Chailloux affirme que le montant demandé est excessif, car plusieurs réclamations demeurent hypothétiques.
Le Syndic, de son côté, soutient que le Code de procédure civile, qui régit le droit commun du Québec, permet l’utilisation du cautionnement pour frais dans les procédures intentées au Québec en vertu de l’article 3 des Règles. La Cour adhère à ce raisonnement et considère que le droit commun de la province s’applique également aux cautionnements dans les procédures de faillite intentées au Québec en vertu de l’article 3 des Règles[211], en dépit du fait que l’article 43(12) de la Loi ne traite que les cautionnements dans les procédures de faillite.
En outre, la Loi de l’Entente France–Québec confère une protection particulière aux résidents français en vertu de laquelle ces derniers ne sont pas tenus de fournir des cautionnements lors de poursuites intentées au Québec, étant donné qu’ils ne sont pas domiciliés dans cette province. Toutefois, il convient de souligner que la Loi de l’Entente France–Québec n’entre pas en contradiction directe avec l’article 3 des Règles, lequel constitue le fondement de la demande de cautionnement en l’espèce. En conséquence, la Cour estime que l’octroi d’un cautionnement relève de la discrétion du tribunal[212], lequel doit appliquer conjointement l’article 492 Cpc et la Loi de l’Entente France–Québec. Par conséquent, la Cour rejette la demande du Syndic visant à obtenir un cautionnement pour frais de la part de Chailloux, domicilié en France, en raison de l’incapacité du Syndic à démontrer l’existence de difficultés ou de risques pour récupérer ses frais de justice si Chailloux remportait le procès.
***
Les décisions présentées dans cette chronique soulignent l’importance de la législation en droit international privé et de la capacité des tribunaux à appliquer ces lois pour résoudre les litiges complexes. Les tribunaux québécois ont montré leur engagement envers l’équité, l’impartialité et le respect de l’état de droit. Leur examen attentif des faits, des arguments et des lois dans chaque cause en témoigne. En outre, les tribunaux ont souligné l’importance d’une clause contractuelle claire et précise pour déterminer le for compétent. Les arrêts Dimter, Infineon, PR, Spar et STMicroelectronics de la Cour suprême ont également eu un impact significatif sur la prise de décision des juges et leur interprétation et application de la loi. De plus, les tribunaux ont veillé à protéger les droits et les intérêts de toutes les parties impliquées, y compris les populations vulnérables. Dans les affaires impliquant des actions collectives, ils ont été particulièrement vigilants pour éviter toute injustice envers les résidents du Québec. En somme, ces éléments montrent à quel point l’expertise et l’engagement des tribunaux québécois envers la justice et le droit international privé sont essentiels pour garantir un système juridique équitable et efficace.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 [CcQ].
-
[2]
Infineon Technologies AG c Option consommateurs, 2013 CSC 59 au para 45 [Infineon]; Spar Aerospace Ltée c American Mobile Satellite Corp, 2002 CSC 78 aux para 55–56 [Spar].
-
[3]
Infineon, supra note 2 au para 47; Spar, supra note 2 aux para 31, 58; Partner Reinsurance Company Ltd c Optimum Réassurance Inc, 2020 QCCA 490 au para 47.
-
[4]
Spar, supra note 2 aux para 77, 81; GreCon Dimter Inc c JR Normand Inc, 2005 CSC 46 au para 33 [Dimter].
-
[5]
RS c PR, 2019 CSC 49 au para 74 [PR].
-
[6]
Ibid au para 75.
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Ibid.
-
[9]
Arrangement relatif à Bloom Lake, 2021 QCCS 3402.
-
[10]
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC 1985, c C-36.
-
[11]
Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44.
-
[12]
Art 3135 CcQ.
-
[13]
Club Resorts Ltd c Van Breda, 2012 CSC 17 au para 79 [Van Breda].
-
[14]
Le modèle de « contrôle unique » s’applique aux procédures d’insolvabilité au Canada, favorisant le règlement des litiges impliquant une société insolvable dans une seule juridiction. Le paragraphe 1 de l’article 188 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3, garantit que les ordonnances rendues par un tribunal de la faillite siégeant dans une province peuvent être et seront exécutées dans tout le pays.
-
[15]
Sam Lévy & Associés c Azco Mining Inc, 2001 CSC 92 au para 64.
-
[16]
Van Breda, supra note 13 aux para 108–9.
-
[17]
GF Urecon Ltd c M Holland Canada Company, 2021 QCCS 4353.
-
[18]
Les dommages pour les réparations effectuées au Québec représentaient 16,4 % des dommages réclamés.
-
[19]
Bombardier Inc c Honeywell International Inc, 2019 QCCS 481 au para 78.
-
[20]
Spar, supra note 2 au para 71; Newfoundland and Labrador (Attorney General) c Uashaunnuat, 2020 CSC 4 au para 68.
-
[21]
Van Breda, supra note 13 au para 108.
-
[22]
Quévillon c Fondation des maladies du coeur et de l’AVC, 2021 QCCS 1818.
-
[23]
Dimter, supra note 4 aux para 35, 47.
-
[24]
Vie Urbaine Média c 9632301 Canada inc (Réseau Outgo), 2021 QCCS 3328.
-
[25]
9253-8180 Québec inc (Fabrik) c 9134-9928 Québec inc (Dynas), 2021 QCCS 1631.
-
[26]
Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01 [Cpc].
-
[27]
Bohémier c Barreau du Québec, 2012 QCCA 308 au para 12.
-
[28]
9259-5057-Québec Inc c Edible Arrangements International, 2021 QCCS 1870.
-
[29]
Zodiak International c The Polish People’s Republic, [1983] 1 RCS 529.
-
[30]
Uber Technologies Inc c Heller, 2020 CSC 16 [Uber].
-
[31]
Dell c Union des consommateurs, 2007 CSC 34 au para 126 [Dell].
-
[32]
United European Bank and Trust Nassau Ltd c Duchesneau, 2006 QCCA 652 aux para 75–78 [Duchesneau]; STMicroelectronics Inc c Matrox Graphics Inc, 2007 QCCA 1784 au para 84 [STMicroelectronics]; General Motors du Canada Ltée c 178018 Canada inc (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac Hummer Ltée), 2011 QCCA 1461 au para 29 [GM].
-
[33]
Dimter, supra note 4 au para 27.
-
[34]
Ibid aux para 21-22, 24, 35, 38; Dell, supra note 31 aux para 142, 144; Uber, supra note 30 au para 86.
-
[35]
Duchesneau, supra note 32 aux para 38-39, 51; Achilles (USA) c Plastics Dura Plastics (1977) Ltée/Ltd, 2006 QCCA 1523 au para 26; Holiday Hospitality Franchising c Hôtels Côte de Liesse Inc, 2018 QCCA 1998 aux para 7, 24.
-
[36]
Art 3148 al 2 CcQ.
-
[37]
Argyle Medical Distributors Inc c Salts Healthcare Limited, 2021 QCCS 4156.
-
[38]
L’article 24 des Conditions générales de vente stipule que « Le contrat est et sera réputé avoir été conclu en Angleterre et sera à tous égards régi par le droit anglais et sera soumis à la juridiction non exclusive des tribunaux anglais » [notre traduction].
-
[39]
L’article 13.10 de l’Accord de distribution stipule que « les parties se soumettent à la compétence exclusive des lois des tribunaux anglais et conviennent qu’en ce qui concerne les procédures en Angleterre ou dans toute autre juridiction, une procédure peut être notifiée à l’une d’elles de la manière spécifiée pour avis à la clause 13.8 » [notre traduction].
-
[40]
L’article 13.11 de l’Accord de distribution stipule « Rien dans la présente clause 13 ne limite le droit du fournisseur d’engager des poursuites contre le distributeur devant tout autre tribunal compétent, et l’engagement d’une procédure dans une ou plusieurs juridictions n’empêche pas l’engagement de procédure dans toute autre juridiction, simultanément ou non, dans la mesure permise par la loi de cette autre juridiction » [notre traduction].
-
[41]
Duchesneau, supra note 32 aux para 74-78; Dimter, supra note 4 au para 84.
-
[42]
Belley c Facebook inc (Meta Platforms inc), 2021 QCCS 5475.
-
[43]
Duchesneau, supra note 32 au para 48.
-
[44]
Ibid au para 49.
-
[45]
Demers c Yahoo! Inc, 2017 QCCS 4154 au para 32.
-
[46]
Arts 3111 et 3148 al 2 CcQ.
-
[47]
Bergeron c 2528-1023 Québec Inc, 2021 QCCS 539.
-
[48]
Art 148 Cpc.
-
[49]
Art 173 Cpc.
-
[50]
Art 190 Cpc.
-
[51]
Art 3148(3) CcQ; Infineon, supra note 2 au para 43.
-
[52]
Art 3139 CcQ.
-
[53]
Boustany c Crédit Libanais, 2021 QCCS 5175.
-
[54]
Spar, supra note 2 au para 58.
-
[55]
Quebecor Printing Memphis Inc c Regenair Inc, 2001 CanLII 27960 (QC CA) au para 11.
-
[56]
Interinvest (Bermuda) Ltd c Herzog, 2009 QCCA 1428 aux para 34, 41.
-
[57]
Bitar v Banque Libano-Francaise SAL, [2021] EWHC 2787 (QB); Khalifeh v BlomBank, [2020] EWHC 2427 (QB).
-
[58]
Daou v BLC Bank, 20cv4438 (DLC) (SDNY 2021).
-
[59]
Consult Overseas Ltd c Bora Capital Partners SPC, 2021 QCCS 920.
-
[60]
Canada (Procureur général) c Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49 au para 17.
-
[61]
Spar, supra note 2 aux para 31-32; Transax Technologies Inc c Red Baron Corp Ltd, 2017 QCCA 626 aux para 15-16.
-
[62]
Transax Technologies Inc c Red Baron Corp Ltd, 2017 QCCA 626 aux para 34-35.
-
[63]
Haaretz.com c Goldhar, 2018 CSC 28 au para 46; Spar, supra note 2 au para 77.
-
[64]
De Varennes c Research Capital Corporation, 2021 QCCQ 13264.
-
[65]
Dimter, supra note 4 au para 27.
-
[66]
STMicroelectronics, supra note 32 au para 77.
-
[67]
Ernst & Young c Ormuco Inc, 2021 QCCS 2543.
-
[68]
Arts 148, 150, 152, 166 et 491 Cpc.
-
[69]
Art 166 al 3 Cpc.
-
[70]
Groupe SNC-Lavalin Inc c Siegrist, 2020 QCCA 1004 au para 113.
-
[71]
Ibid; Richter et Associés c Coopers et Lybrand, 2013 QCCS 1945 au para 57.
-
[72]
Fasano c Servier Canada Inc, 2021 QCCS 4187.
-
[73]
En vertu de l’article 3149 CcQ, les tribunaux québécois ont juridiction en matière de contrat de travail.
-
[74]
Art 3137 CcQ.
-
[75]
Patterson c Ticketmaster Canada Holdings, 2021 QCCS 378 [Ticketmaster].
-
[76]
PR, supra note 5 aux para 68-69.
-
[77]
Gagnon c Gagnon, 2021 QCCS 44.
-
[78]
STMicroelectronics, supra note 32 au para 84; Dimter, supra note 4 au para 27.
-
[79]
Dimter, supra note 4 au para 27. Les deux autres exceptions sont l’origine législative de la limite (au para 25) et la reconnaissance antérieure de la juridiction des autorités québécoises (au para 26).
-
[80]
Gruppo Piccini c Magil Construction Corp, 2021 QCCS 5270.
-
[81]
Mgwanga Gunme v Cameroon, Communication No 266/2003, [2009] ACHPR 99 aux para 209-13.
-
[82]
Michel Thierry Atangana Abega v Cameroon, Doc off CDH NU, 68e sess, Doc NU A/HRC/WGAD/2013/38 (2014) aux para 14-15.
-
[83]
« Rule of Law Index » (2020) à la p 57, en ligne (pdf) : The World Justice Project <worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Index-2020-English.pdf>.
-
[84]
Huang c Yan, 2021 QCCA 1473.
-
[85]
Art 3111 CcQ.
-
[86]
STMicroelectronics, supra note 32 au para 88.
-
[87]
Art 2809 CcQ.
-
[88]
Dimter, supra note 4 au para 27; STMicroelectronics, supra note 32 aux para 84-85; GM, supra note 32 au para 29.
-
[89]
Uniprix Inc c Gestion Gosselin et Bérubé Inc, 2017 CSC 43 au para 129.
-
[90]
John Scotti Automotive Inc c Davis, 2021 QCCQ 1857.
-
[91]
Poppy Industries Canada Inc c Diva Delights Ltd, 2018 QCCA 163.
-
[92]
Langford Sharp c Autorité des marchés financiers, 2021 QCCA 1364.
-
[93]
Loi sur les valeurs mobilières, LRQ c V-1.1.
-
[94]
Van Breda, supra note 13 au para 23.
-
[95]
Liquid Capital Exchange Corporation c American Atelier Inc, 2021 QCCS 153.
-
[96]
Partner Reinsurance Company Ltd c Optimum Réassurance Inc, 2020 QCCA 490 au para 48.
-
[97]
Nakisa Inc c Mullen, 2020 QCCA 1808 au para 10.
-
[98]
Infineon, supra note 2 au para 46.
-
[99]
Media Graph Dépôt Inc c Mtex Solutions, 2021 QCCS 5206.
-
[100]
Loi concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, RLRQ c C-67.01.
-
[101]
Le Canada a adhéré à la Convention de Vienne en 1992 et le Québec l’a incorporée dans son droit interne la même année. Le Portugal a cependant ratifié la Convention en septembre 2020, celle-ci prenant effet en octobre 2021.
-
[102]
Art 1739 CcQ.
-
[103]
Immeubles de l’Estuaire phase III Inc c Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III, 2006 QCCA 781 aux para 153-59.
-
[104]
Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances c Quevillon, 2021 QCCS 4178.
-
[105]
PR, supra note 5 au para 74.
-
[106]
Specter Aviation c Laprade, 2021 QCCA 1811.
-
[107]
Par ex, arts 2639, 3149 et 3151 CcQ; Dimter, supra note 4 aux para 25, 32, 36.
-
[108]
Dimter, supra note 4 au para 22.
-
[109]
Dell Computer Corp c Union des consommateurs, 2007 CSC 34 au para 75.
-
[110]
Dimter, supra note 4 au para 26.
-
[111]
Art 626 Cpc.
-
[112]
Hakim c Pfizer Inc, 2021 QCCS 160.
-
[113]
Garage Poirier & Poirier Inc c FCA Canada Inc, 2019 QCCA 2213 au para 71.
-
[114]
PR, supra note 5 au para 36.
-
[115]
Ibid.
-
[116]
Desjardins Financial Services Firm Inc c Asselin, 2020 CSC 30 aux para 22, 27.
-
[117]
Lebel c Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd/Ltée, 2021 QCCS 6.
-
[118]
Ticketmaster, supra note 75.
-
[119]
Li c Equifax, 2018 QCCS 1892 au para 34; Conseil pour la protection des malades c Biomet Canada Inc, 2016 QCCS 4574 au para 27.
-
[120]
Ticketmaster, supra note 75 au para 40.
-
[121]
FCA Canada Inc c Garage Poirier & Poirier Inc, 2018 QCCS 107 au para 70.
-
[122]
Pohoresky c Otsuka Pharmaceutical Company Limited, 2021 QCCS 5064 [Pohoresky].
-
[123]
La Cour d’appel a statué que dans des circonstances exceptionnelles, si une autorité québécoise n’a pas compétence pour entendre un litige, elle ne peut assumer sa compétence qu’en vertu de l’article 3136 CcQ (Anvil Mining Ltd c Association canadienne contre l’impunité, 2012 QCCA 117 au para 97). Cette décision a été prise avant la promulgation de l’article 491 Cpc, qui ajoute la règle de la proportionnalité comme facteur à considérer dans l’analyse, reflétant les objectifs des actions collectives pour rendre la justice plus accessible, changer les comportements préjudiciables et conserver les ressources judiciaires (L’oratoire Saint-Joseph du Mont‑Royal c JJ, 2019 CSC 35 au para 6).
-
[124]
Pohoresky, supra note 122 au para 115.
-
[125]
Ranger c Aphria Inc, 2021 QCCS 534.
-
[126]
Zuckerman c Target Corporation, 2017 QCCS 110 aux para 31-34.
-
[127]
Boucher c Stelco Inc, 2005 CSC 64 au para 37.
-
[128]
Droit de la famille – 211290, 2021 QCCA 1123.
-
[129]
Droit de la famille – 20716, 2020 QCCS 1653.
-
[130]
Art 3135 CcQ.
-
[131]
Droit de la famille – 211947, 2021 QCCS 4338.
-
[132]
Art 3093 CcQ. Toutefois, en vertu l’article 3140 CcQ, l’autorité judiciaire compétente au Québec peut prendre les mesures nécessaires pour protéger une personne résidant sur son territoire, peu importe son lieu de domicile.
-
[133]
Art 3142 CcQ.
-
[134]
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 19 octobre 1996, [2008] JO, L 151/39.
-
[135]
Art 80 CcQ.
-
[136]
Art76 CcQ.
-
[137]
Trottier c Rajotte, [1940] SCR 203 à la p 207; Droit de la famille – 081848, 2008 QCCS 3565 au para 14.
-
[138]
Droit de la famille – 18126, 2018 QCCA 116 au para 45.
-
[139]
Art 3164 CcQ.
-
[140]
Art 3158 CcQ.
-
[141]
Arts 3134-54 CcQ.
-
[142]
Helicopter Transport Services (Canada) Inc c Vaugeois, 2021 QCCQ 4136.
-
[143]
Art 3164 CcQ.
-
[144]
L’article 3168(4) CcQ reconnait la compétence des autorités étrangères dans les actions personnelles à caractère patrimonial lorsque les obligations résultant d’un contrat doivent y être exécutées.
-
[145]
Ram Mechanical Inc c Cacao 70 Inc, 2021 QCCQ 12338.
-
[146]
Arts 3155 et 3164 CcQ; Barer c Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13 aux para 23-24 [Barer]; Société canadienne des postes c Lépine, 2009 CSC 16 aux para 22-26 et 36; Iraq (State of) c Heerema Zwijndrecht, bv, 2013 QCCA 1112 aux para 11-15; SNC-Lavalin Group Inc c Ben Aïssa, 2019 QCCS 465 aux para 110-11; Chevron Corp c Yaiguaje, 2015 CSC 42 au para 72; Jules Jordan Video Inc c 144942 Canada Inc, 2014 QCCS 3343 au para 25.
-
[147]
Arts 3155-68 CcQ.
-
[148]
Arts 2803-04 CcQ; Barer, supra note 146 aux para 28-29, 33.
-
[149]
Arts 3155 et 3164 CcQ.
-
[150]
Art 3155 aux para 2-6 et 3156 CcQ.
-
[151]
Art 3168 CcQ.
-
[152]
Art 3165 CcQ.
-
[153]
Art 508 Cpc.
-
[154]
AMBC Ventures Inc c Awanda, 2021 QCCS 543.
-
[155]
Code criminel, LRC 1985, c C-46 [Ccr].
-
[156]
PR, supra note 5 au para 52.
-
[157]
Les quatre considérations pertinentes pour déterminer si l’ordre public devrait permettre l’exécution partielle d’un accord par ailleurs illégal plutôt que de le déclarer nul ab initio en raison de l’illégalité du contrat sont les suivantes : 1. la question de savoir si l’application de la divisibilité compromettrait l’objectif ou la politique générale visé par l’article 347 Ccr; 2. la question de savoir si les parties ont conclu la convention dans un but illégal ou dans une intention malveillante; 3. le pouvoir de négociation relatif des parties et leur conduite au cours des négociations; et 4. la possibilité que le débiteur tire un profit injustifié de la solution choisie (Transport North American Express Inc c New Solutions Financial Corp, 2004 CSC 7 au para 42).
-
[158]
Art 3155(5) CcQ.
-
[159]
Jan Paulsson, The Idea of Arbitration, Oxford, University Press, 2013 à la p 132.
-
[160]
Corporatek Inc c Éditions Francis Lefebvre, 2021 QCCA 1241 [Corporatek].
-
[161]
Art 1631 CcQ.
-
[162]
Corporatek, supra note 160 au para 47.
-
[163]
Fotso c Brice, 2021 QCCQ 3839.
-
[164]
St-Jacques c Gaudreau-Duchesne, 2021 QCCQ 6398.
-
[165]
Art 2809 al 2 CcQ.
-
[166]
Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1.
-
[167]
Art 2189 al 2 CcQ.
-
[168]
Art 2253 al 1 CcQ.
-
[169]
Art 2254 CcQ.
-
[170]
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 15 novembre 1965, 658 RTNU 163 (entrée en vigueur : 10 février 1969) (reproduite à l’annexe I du Cpc).
-
[171]
Bountounis c Volkswagen Group Canada Inc, 2017 QCCS 5572 au para 36 [Bountounis].
-
[172]
Gagnon c Audi Canada Inc, 2018 QCCA 202 au para 21.
-
[173]
Bountounis, supra note 171 au para 37.
-
[174]
Droit de la famille – 192513, 2019 QCCA 2139 aux para 46-47; Surin c Apple Inc, 2021 QCCS 2217 au para 11 [Surin]; Syndic de Liquid Nutrition Franchising Corporation, 2018 QCCS 5014 au para 9; Bountounis, supra note 171 au para 62.
-
[175]
9343-4678 Québec inc (Restaurant Déli Boyz) c Uber Canada Inc, 2021 QCCS 1418.
-
[176]
Basal c Allergan PLC & Others, 2019 QCCS 469 au para 5.
-
[177]
Hazan c Micron Technology Inc, 2021 QCCA 1425.
-
[178]
Arrêté n° 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 27 mars 2020, (2020) 152 Gaz II, 1170A [Arrêté n° 4267].
-
[179]
Hazan c Micron Technology Inc, 2022 QCCA 117.
-
[180]
Letarte c Bayer Inc, 2021 QCCS 4947.
-
[181]
Art 84 Cpc.
-
[182]
Surin, supra note 174.
-
[183]
Arrêté n° 4267, supra note 178.
-
[184]
Les dispositions de la Convention de La Haye sur la notification internationale doivent être suivies lors de la signification d’actes juridiques à des personnes résidant dans des pays signataires de la Convention (art 494 al 1 Cpc). Le Canada et les États-Unis sont tous deux signataires de la Convention.
-
[185]
Surin, supra note 174 au para 20.
-
[186]
En vertu de l’article 84 Cpc, le délai de trois mois de l’article 107(3) Cpc n’est pas un délai de rigueur.
-
[187]
CSX Transportation Inc c Price, 2017 QCCQ 8163 au para 45.
-
[188]
Vasilevich c Anna, 2013 QCCS 5599 au para 22.
-
[189]
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 28 mai 1999, 2242 RTNU 309 (entrée en vigueur : 4 novembre 2003) [Convention de Montréal].
-
[190]
Loi sur le transport aérien, LRC 1985, c C-26.
-
[191]
Thibodeau c Air Canada, 2014 CSC 67 aux para 31-57 [Thibodeau].
-
[192]
Ibid au para 41.
-
[193]
Ibid au para 33; Raymond Lefebvre c United Airlines, 2021 QCCQ 160 au para 16; Ouanes c Royal Air Maroc, 2016 QCCQ 10 au para 19.
-
[194]
Thibodeau, supra note 191 au para 145.
-
[195]
Bien que le débat jurisprudentiel concernant l’étendue de cet article soit toujours en cours, certains juges ont choisi d’adopter une interprétation plus large et équitable pour les voyageurs, en octroyant des dommages moraux conformément aux critères établis par la Convention de Montréal, supra note 189. Voir Côté c Vacances Sunwing, 2019 QCCQ 1795 au para 53; Todorova c Sunwing Vacations, 2019 QCCQ 2455 au para 70.
-
[196]
Bournias Petros c Air Canada, 2021 QCCQ 13604; Layachi c Entreprise publique économique Air Algérie, 2021 QCCQ 11143; Sternstein c Air Canada, 2021 QCCQ 11056; Dion c Sunwing, 2021 QCCQ 8611; Zhao c Air Canada, 2021 QCCQ 8264; Zouheir c Turkish Airlines, 2021 QCCQ 8263; Bastien c Air Canada, 2021 QCCQ 7580; Rubio c Air Canada Inc, 2021 QCCQ 6876; Gnefia c Air Algérie, 2021 QCCQ 5008; Llobat c Air Canada, 2021 QCCQ 3838; Hénault c Air Transat AT Inc, 2021 QCCQ 3239; Brouty c Air Canada, 2021 QCCQ 1897; Thibodeau c Transat Tours Canada Inc, 2021 QCCQ 736; Lefebvre c United Airlines Inc, 2021 QCCQ 160.
-
[197]
Hilaire c Air Canada/Air Canada Rouge, 2021 QCCQ 12609.
-
[198]
Art 2100 CcQ.
-
[199]
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art 219.
-
[200]
Ibid, art 272; Tremblay c Air Canada, 2018 QCCQ 4823 aux para 13, 29.
-
[201]
Mercier c Vacances Sunwing, 2019 QCCQ 1795.
-
[202]
Kake c Société Air France, 2021 QCCQ 171.
-
[203]
Convention de Montréal, supra note 189, art 17(1).
-
[204]
Thibodeau, supra note 191 aux para 144-45.
-
[205]
Nguyen c Société Air France, 2021 QCCQ 10467.
-
[206]
Les paragraphes 2 et 5 de l’article 22 de la Convention de Montréal, supra note 189, fixent des limites au montant de l’indemnisation qu’un passager peut recevoir pour ses bagages. Les tribunaux appliquent une norme souple à la conduite qui détermine les circonstances dans lesquelles la limite pécuniaire du montant des dommages dus par le transporteur peut être ignorée en vertu du paragraphe 5 de cette disposition (Neudorfer c Swiss International Air Lines, sa, 2011 QCCQ 8664 au para 86; Armstrong c Voyages Bernard Gendron Inc, 2007 QCCQ 4834 au para 49; Lorange c Compagnie d’aviation Cubana, 2004 CanLII 48392 (QC CQ) au para 8).
-
[207]
Air France a présenté des éléments de preuve démontrant que le montant maximal que Nguyen pourrait réclamer en vertu de la Convention de Montréal, supra note 189, est de 2 021,76 $CAN.
-
[208]
Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, CRC c 368.
-
[209]
Syndic de Pâtisserie de Gascogne Inc, 2021 QCCS 4237 [Gascogne].
-
[210]
Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec, RLRQ c A-20.1. Elle est « incluse » dans le Code de procédure civile, « qui est d’ordre public, par le biais de l’article 493 Cpc » : Gascogne, supra note 209 au para 29.
-
[211]
Services hypothécaires La Patrimoniale Inc (Syndic des), 2013 QCCS 6337 au para 10.
-
[212]
Ibid au para 12.