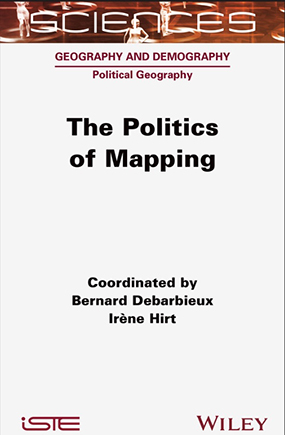Corps de l’article
L’ouvrage collectif The Politics of Mapping rassemble une variété d’analyses conceptuelles et méthodologiques du rapport entre la cartographie et la politique. Longtemps considéré comme une science « objective » visant à brosser un portrait neutre de la surface de la Terre, le champ de la cartographie s’est considérablement transformé dans le monde universitaire occidental à partir de la fin du xxe siècle avec le mouvement de la cartographie critique. Ayant comme figure de proue les travaux de Brian Harley, la cartographie critique a introduit l’idée que les cartes sont au service du pouvoir politique (Gautreau et Noucher 2022 : 48). L’objectif principal de l’ouvrage The Politics of Mapping est de démontrer que les contextes sociaux, économiques, technologiques et politiques contemporains obligent les cartographes à refonder les paramètres de rapports de pouvoir et de domination établis par la cartographie critique. L’avènement du Web, la multiplication exponentielle des données géographiques et l’accessibilité aux logiciels cartographiques ont profondément transformé les rapports historiques de pouvoir et de domination, ce qui doit être mieux reflété dans la discipline.
Les perspectives autochtones ont été essentielles dans l’émergence de la cartographie critique. Portées par les mouvements sociaux, les organisations autochtones ont été dans les premières à s’approprier les techniques de cartographie occidentales dans le but de renverser le pouvoir colonial exercé sur elles par l’État, jusqu’alors maître de la représentation géographique du territoire. C’est à partir de ces mouvements que s’est manifesté ce que Peluso (1995) nomme la « contre-cartographie » et qui a permis d’approfondir considérablement les réflexions entourant la cartographie critique. Bien que The Politics of Mapping ne soit pas un ouvrage entièrement dédié aux questions autochtones, il offre des pistes pertinentes pour réfléchir à la cartographie à partir d’une perspective décoloniale.
Les quatre premiers chapitres de l’ouvrage consistent en des essais qui incitent les cartographes à réfléchir aux principes de leur discipline pour mieux traiter les réalités politiques contemporaines. Selon Farinelli (chap. 2), l’arrivée de l’imprimerie en Europe a permis la rapide propagation d’un certain type de représentation du territoire alimentée par les courants de pensée émergents du xviie siècle, qui ont donné une importance toute particulière au savoir « universel » écrit et intemporel. Pendant longtemps, les cartographes ont contribué à véhiculer cette représentation « objective » de la réalité, qui a permis à l’État de maintenir un contrôle sur la gestion du territoire et de sa population. Lévy (chap. 1) propose que les cartographes doivent aujourd’hui rejeter cette idée faussement admise de l’objectivité de la carte et plutôt épauler leurs concitoyens et concitoyennes dans leur volonté à prendre part à la vie politique. Dans le même ordre d’idée, Burini (chap. 4) déplore que bien souvent, les systèmes de collecte de données mobilisés par l’État se fondent exclusivement sur des approches topographiques et statiques de la population comme les recensements. Ces approches ne prennent en compte qu’une dimension physique et absolue du territoire (topos) et omettent l’ensemble des relations culturelles et sociales qui le forment (chora). Il faut donc repenser les projets cartographiques pour considérer le chora, ce qui offrira à la population une meilleure compréhension des dynamiques socioculturelles au sein du territoire et, du même coup, une meilleure gouvernance territoriale. Quant à eux, Gautreau et Noucher (chap. 3) déploient la thèse centrale de l’ouvrage. Ils soutiennent que les méthodes, les concepts et les objets développés par la cartographie critique doivent évoluer pour réussir à prendre en compte les changements majeurs causés par les avancées de la technologie numérique.
Debarbieux (chap. 5) et Dao (chap. 6) présentent l’évolution du rôle de la cartographie dans les structures politiques occidentales. Selon Debarbieux, la promotion d’une cartographie se voulant neutre et objective à partir du xviie siècle était une condition nécessaire à l’apparition de l’État moderne parce qu’elle lui a permis de projeter l’idée d’une réalité commune pour étendre son pouvoir et cimenter une identité nationale. Ces conditions ont ouvert la voie à la naissance de l’État-nation, qui a appliqué cette logique territoriale dans ses politiques publiques. Par la suite, Dao soutient que les structures politiques internationales telles que l’ONU ont pu régulariser et uniformiser l’information géospatiale, qui était jusqu’alors concentrée dans les mains des États. Or, l’explosion de la quantité de données géographiques due aux avancées technologiques pose des défis importants pour leur gestion par les organisations politiques internationales, notamment avec les géants privés comme Google qui produisent et qui gèrent un volume substantiel de données géographiques en marge des structures institutionnelles nationales et internationales.
Le chapitre 7 (Hirt) est une synthèse de ce que signifie « cartographies autochtones » dans la littérature universitaire occidentale. D’une part, les cartographies autochtones peuvent se référer à la réappropriation par les peuples autochtones des méthodes et outils cartographiques coloniaux afin de rendre visible leur occupation du territoire face à l’État colonial. Selon Hirt, cette stratégie politique a permis à de nombreux groupes autochtones partout dans le monde d’accroître la reconnaissance de leurs droits territoriaux. Toutefois, cette stratégie nécessite de traduire les savoirs territoriaux autochtones dans les termes de l’État, ce qui peut affecter négativement les structures politiques et sociales des communautés, par exemple en figeant une certaine représentation incomplète de leur occupation territoriale. De plus, il est aujourd’hui difficile d’évaluer l’impact des géants du Web dans la mobilisation politique de la cartographie chez les nations autochtones. L’accessibilité et la multiplication des données géographiques peuvent contribuer positivement à leur autonomisation, mais peuvent également promouvoir de nouvelles formes de colonialisme. Par exemple, McGurk et Caquard (2020) soutiennent que même si de plus en plus de projets de cartographie digitale sont initiés par des communautés autochtones, ils reposent généralement sur des systèmes informatiques développés à partir d’une perspective occidentale et nécessitent une expertise externe pour opérer. Cette tendance se manifeste notamment par la marginalisation des perspectives des femmes au sein de cartes digitales produites. L’une des raisons est qu’elles mettent plus facilement en valeur les activités occupant de vastes territoires comme la chasse, qui sont traditionnellement masculines (McGurk et Caquard 2020 : 60-62).
D’autre part, les « cartographies autochtones » peuvent se référer aux méthodes de valorisation des savoirs territoriaux et des conceptions du monde propres aux nations autochtones. Toujours selon Hirt, en s’engageant avec ces savoirs, il est possible de décoloniser le domaine de la cartographie occidentale en valorisant d’autres formes de savoirs qui ne sont pas hégémoniques. Cependant, il est encore une fois difficile de déterminer si la transformation technologique de la cartographie encourage véritablement la mise en valeur de ces formes de savoirs ou contribue plutôt à leur marginalisation, dans une ère « d’universalisation des contenus et des contraintes liées à l’interopérabilité des données » (Hirt 2022 : 178).
Les chapitres de Gautreau et Noucher (chap. 3) ainsi que de Hirt (chap. 7) sont les plus pertinents pour réfléchir aux enjeux de cartographies contemporains auxquels font nécessairement face les peuples autochtones. Les auteurs du chapitre 3, dont les propos sont soutenus par ceux des auteurs et autrices des chapitres précédents, parviennent à bien démontrer que les États occidentaux ne détiennent plus le monopole de la production cartographique en raison des avancées technologiques, ce qui devrait pousser les cartographes à réfléchir aux changements dans les relations de pouvoir. On comprend bien que le rapport de pouvoir historique unidirectionnel de l’État vers ses sujets est désormais étendu à ceux et celles qui sont en mesure de s’engager dans la production cartographique de leur territoire. Or, à l’instar des propos de Gautreau et Noucher au sujet de leur chapitre, cette réflexion « soulève beaucoup plus de questions qu’[elle] n’apporte de réponses sur les défis posés par l’ère numérique à la cartographie critique » (Gautreau et Noucher 2022 : 65). Comme l’aborde Hirt, il est encore trop tôt pour véritablement comprendre les impacts des avancées technologiques en cartographie dans les différents rapports de pouvoir qu’entretiennent les peuples autochtones avec l’État.
Si l’ouvrage The Politics of Mapping suppose que la fin du monopole de production cartographique de l’État face à ses citoyens et ses citoyennes transforme les relations de pouvoir, on n’aborde que très brièvement la possibilité que les avancées technologiques les accroissent. Pourtant, dans un contexte colonial, il semble y avoir un risque réel que le pouvoir de l’État sur les peuples colonisés soit accentué par les technologies. Briggs et al. (2020 : 3-4) attestent que les savoirs traditionnels autochtones sont effectivement à risque d’être manipulés par les logiciels de données numériques mobilisés par l’État. Trois mécanismes y contribuent : la tendance à extraire uniquement des savoirs traditionnels autochtones les données perçues comme « utiles » par les logiciels ; la tendance à ne conserver que les données s’alignant facilement avec le cadre scientifique dominant ; la tendance à omettre la spécificité géographique des savoirs traditionnels autochtones. Ainsi, selon Briggs et al., « la littérature s’accorde à reconnaître que la distorsion, la dilution, la dévaluation et la fragmentation des savoirs autochtones sont des effets inhérents à la saisie et au stockage des données numériques » (Briggs et al. 2020 : 4).
La lecture de The Politics of Mapping est tout de même pertinente puisqu’elle laisse entrevoir la possibilité pour la cartographie occidentale de se doter de nouvelles perspectives exposant les impacts de l’avancée des technologies numériques sur les rapports de pouvoirs coloniaux. L’idée défendue par les textes qu’il faille réfléchir à de nouveaux concepts et méthodologies en cartographie corrobore le constat de Rose-Redwood et al. (2020 : 159) que « les fissures dans la façade de l’imagination géographique coloniale deviennent de plus en plus évidentes » et qu’en ce sens, une véritable prise de conscience décoloniale au sein du monde universitaire occidental est envisageable. La réflexion est particulièrement intéressante pour les peuples autochtones du Canada, qui sont quotidiennement confrontés aux réalités de l’avancement technologique en cartographie et auxquelles les jeunes générations sont éminemment exposées (Syme 2020 : 1111-1112).
Parties annexes
Ouvrages cités
- Briggs, Carolyn et al. 2020. « Bridging the Geospatial Gap: Data about Space and Indigenous Knowledge of Place ». Geography Compass 14(11) : e12542.
- McGurk, Thomas. J. et Sébastien Caquard. 2020. « To what extent can online mapping be decolonial? A journey throughout Indigenous cartography in Canada ». The Canadian Geographer / Le Géographe canadien 64(1) : 49-64.
- Peluso, Nancy L. 1995. « Whose Woods Are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia ». Antipode 27(4) : 383‑406.
- Rose-Redwood, Reuben et al. 2020. « Decolonizing the Map: Recentering Indigenous Mappings ». Cartographica 55(3) : 151-162.
- Syme, Tony. 2020. « Localizing landscapes: a call for respectful design in Indigenous counter mapping ». Information, Communication & Society 23(8) : 1106‑1122.