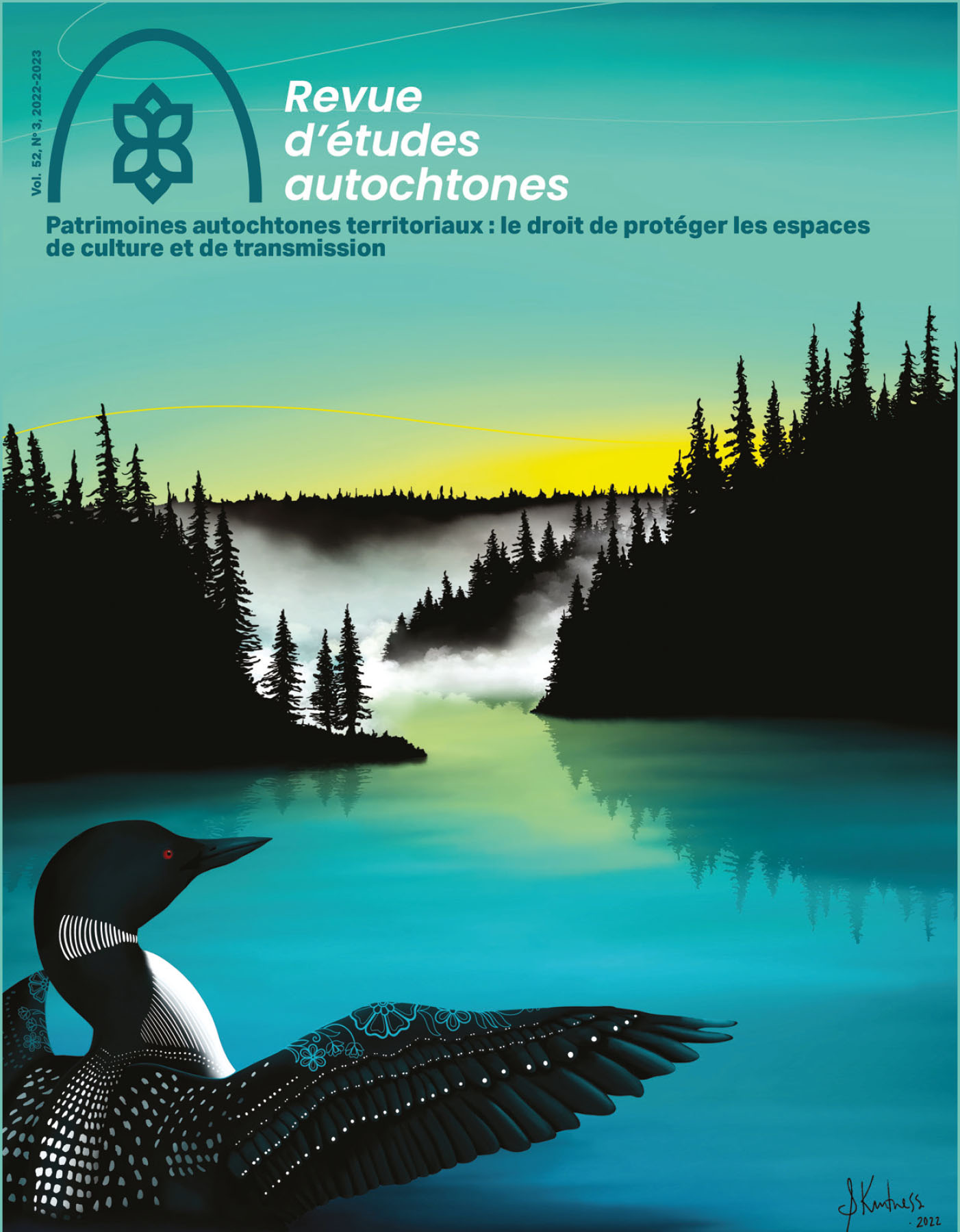Depuis les années 2000, nous pouvons observer un accroissement important de l’identification à l’autochtonie au Québec. Ceci s’est surtout accentué après l’arrêt Powley de 2003, qui a contribué à définir les critères nécessaires pour que les droits ancestraux métis soient reconnus. L’arrêt Powley a aussi augmenté la portée géographique de l’identité métisse reconnue jusqu’alors. Selon Darryl Leroux, cet arrêt a eu pour conséquence une hausse d’« auto-autochtonification » métisse venant de personnes blanches, soit des personnes québécoises francodescendantes. Cette problématique est au centre de son livre Ascendance détournée (2022). Paru en 2019 en anglais, le livre a été traduit en français par Aurélie Lacassagne. Comme le suggère le titre, Leroux y fait l’analyse de ce phénomène à travers l’hypothèse selon laquelle ces autoreconnaissances sont le produit d’un détournement ou d’une construction d’une identité autochtone par l’établissement d’un lien généalogique avec une personne autochtone. Dès l’introduction, il place ce phénomène dans un contexte colonial plus large en se basant sur la théorisation du race shifting de Circe Sturm. Dans son livre Becoming Indian, Sturm conceptualise le processus par lequel le lien entre autochtones s’est fait coopter afin de permettre la blanchisation de l’identité autochtone (2011). Leroux, pour sa part, se donne comme objectif de chercher à comprendre ce qui a poussé des personnes allochtones à revendiquer une nouvelle identité autochtone. Cette analyse se fait en deux temps : une première partie du livre cherche à faire la typologie des ascendances détournées ; une deuxième partie, en mobilisant cette typologie, cherche à analyser la dimension politique de ce détournement identitaire en observant de quelle manière il est mobilisé dans le cadre des mouvements sociaux pour la consolidation des droits des Blancs. Ces droits visent le maintien des privilèges des populations blanches mises en péril par la reconnaissance des droits ancestraux autochtones. Pour ce faire, paradoxalement, les Blancs revendiquent une identité autochtone et mobilisent des droits ancestraux autochtones. Ce processus de revendication identitaire passe avant tout par une réévaluation de leur généalogie. En effet, Leroux observe trois types de mécanismes d’ascendance de réévaluation à l’oeuvre : une ascendance linéaire affirmée sur l’existence d’un lien ancestral autochtone lointain, mais direct ; une ascendance ambitieuse qui se base sur l’hypothèse qu’un ancêtre était autochtone ; et finalement, une ascendance latérale, produit de la supposition de l’existence de liens familiaux autochtones par une proximité géographique historique avec des personnalités métis (ex. Louis Riel). Or, ce qui caractérise ces liens est leur nature spéculative et imaginée, reposant notamment sur le détournement des liens fondés sur la parenté autochtone pour en faire une identité basée sur le sang. Cette biologisation de liens autochtones de nature affinitaire a pour conséquence d’individualiser des relations autochtones qui, au contraire, se caractérisent par leur nature réciproque, par leur capacité de démontrer une continuité historique et par leur pratique régulière dans un cadre contemporain. Selon cette biologisation, n’importe qui peut désormais se dire Métis, tant qu’un lien familial avec des Autochtones peut être construit en mobilisant ces stratégies. Leroux soutient cette typologie par l’analyse d’échanges en ligne sur des forums de généalogie. Cette approche méthodologique part du postulat de Sturm selon lequel Ces espaces d’échanges permettent donc d’observer l’effort qu’exige la création de nouvelles relations familiales par la pratique de la généalogie. En effet, l’auteur reprend les travaux d’Alondra Nelson (2008) en conceptualisant la mobilisation de la généalogie comme une « technologie de l’appartenance ». Ceci révèle donc la dimension stratégique de cette création de soi. La deuxième partie reprend cette typologie afin de soutenir la thèse selon laquelle l’auto-autochtonification est un moyen employé afin de consolider et protéger les privilèges territoriaux …
Parties annexes
Bibliographie
- Deloria, Philip J. 1998. Playing Indian. New Haven : Yale University Press.
- Nelson, Alondra. 2008. « Bio Science: Genetic genealogy testing and the pursuit of African ancestry ». Social Studies of Science 38(5) : 759-783.
- Sturm, Circe. 2011. Becoming Indian: The Struggle over Cherokee Identity in the Twenty-First Century. Albuquerque : SAR Press.