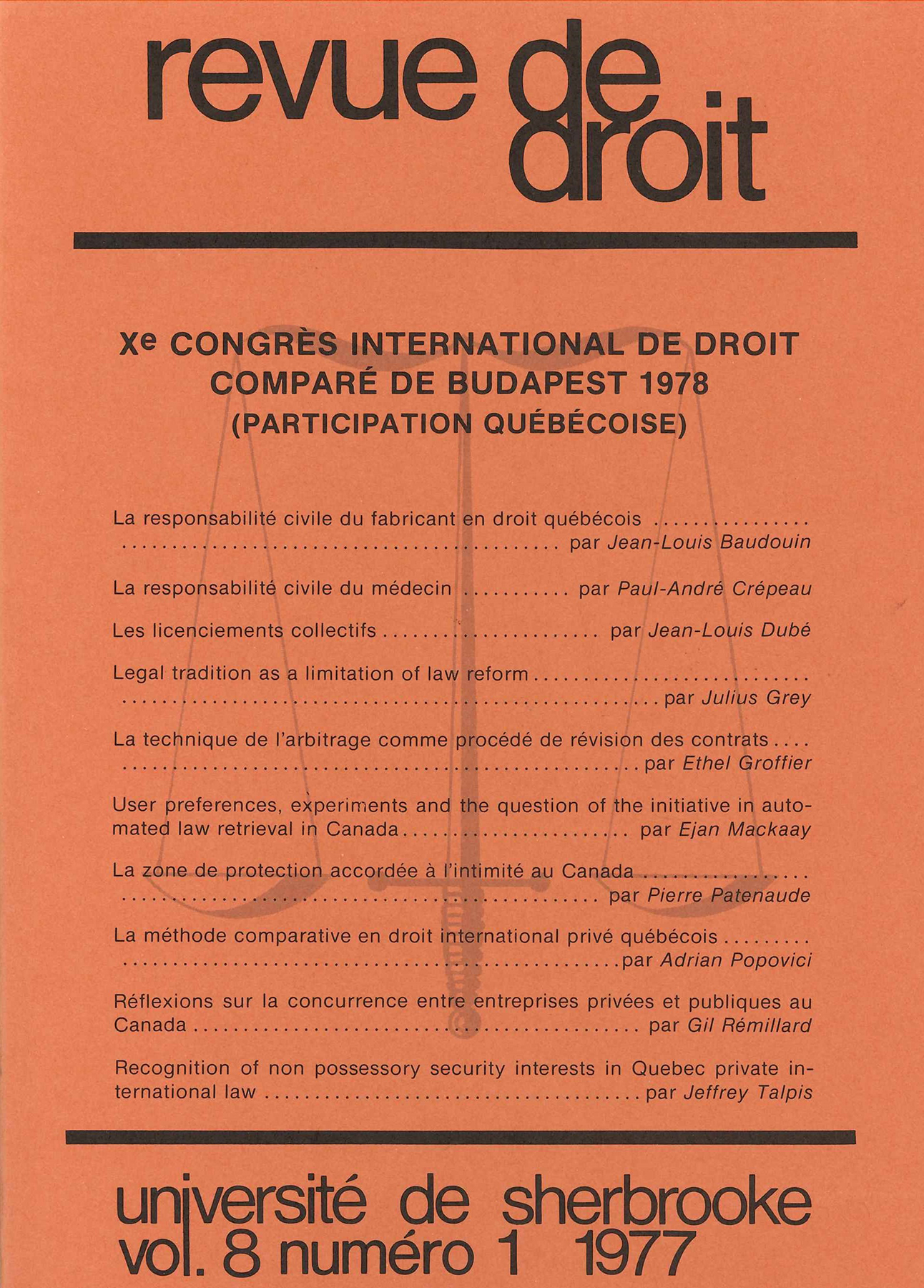Résumés
Résumé
La documentation automatique en droit a été lancée au Canada en 1968 afin d’améliorer l’état généralement déplorable des sources documentaires dont pouvaient se servir les juristes de l’époque. En effet, des sondages indiquaient que le juriste canadien dépensait moins pour la documentation que son confrère dans des pays comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande dont la situation sur ce point semble pourtant moins favorable. La bibliothèque de la plupart des juristes s’avérait dans ces sondages comme étant sérieusement incomplète, surtout pour ceux qui travaillent en pratique privée, en petits cabinets, en dehors des grandes villes. Sans doute, l’éventail de livres disponibles sur le marché canadien du droit n’était pas de nature à encourager de grands achats, mais entre ce que les créditeurs publient et ce que leurs clients sont prêts à acheter il y a une causalité circulaire. Il semblait donc à la suite de ces sondages que la documentation juridique était stagnante.
Pour sortir de cet état déplorable, on ne pouvait se fier à l’initiative privée. Il n’était pas non plus question de subventions massives directes à cette industrie. Il nous apparaît maintenant que le moyen choisi pour débloquer la documentation juridique, pour convaincre les juristes à réévaluer leurs véritables besoins documentaires, était d’encourager le développement de systèmes de repérage automatique. Ce secteur, développé à l’origine par les universités, s’annonçait comme une possibilité pour court-circuiter les moyens documentaires traditionnels. Deux projets furent mis en marché, DATUM au Québec, Quic/Law dans certaines provinces anglaises.
DATUM est des deux projets celui dont la mise en marché a été poursuivie le plus systématiquement : formule du centre de service n’exigeant pas d’importants sacrifices en temps ou in argent de la part du juriste, banque de données couvrant au moins le minimum vital. L’effet de DATUM au Québec a été non pas un succès éclatant pour la documentation automatique, mais bien davantage une vague d’innovations dans les sources documentaires traditionnelles. La création de la Société québécoise d’information juridique a servi à consolider ces efforts. On peut déceler un mouvement analogue au Canada anglais, sous l’impulsion de QL Systems Ltd., exploitant du système Quic/Law, et notamment du Conseil canadien de la documentation juridique.
Si l’informatique juridique a ainsi servi, malgré soi, à l’amélioration des moyens plus traditionnels de documentation, a-t-elle néanmoins un rôle propre à jouer ? Il nous semble que la réponse est affirmative. Les systèmes de repérage automatique peuvent donner accès à une banque intégrée plus large que ce qui reste maniable sous forme de livre. Ils permettent en principe une mise à jour plus rapide et des recherches plus riches étant donné qu’elles peuvent porter sur des concepts traditionnels aussi bien que sur d’autres et que la qualité des résultats peut être améliorée de façon semi-automatique au fur et à mesure que l’expérience avec le système s’accumule. Enfin, on peut croire qu’au cours des années 80 le coût des moyens traditionnels dépassera celui des systèmes informatisés.
Veuillez télécharger l’article en PDF pour le lire.
Télécharger