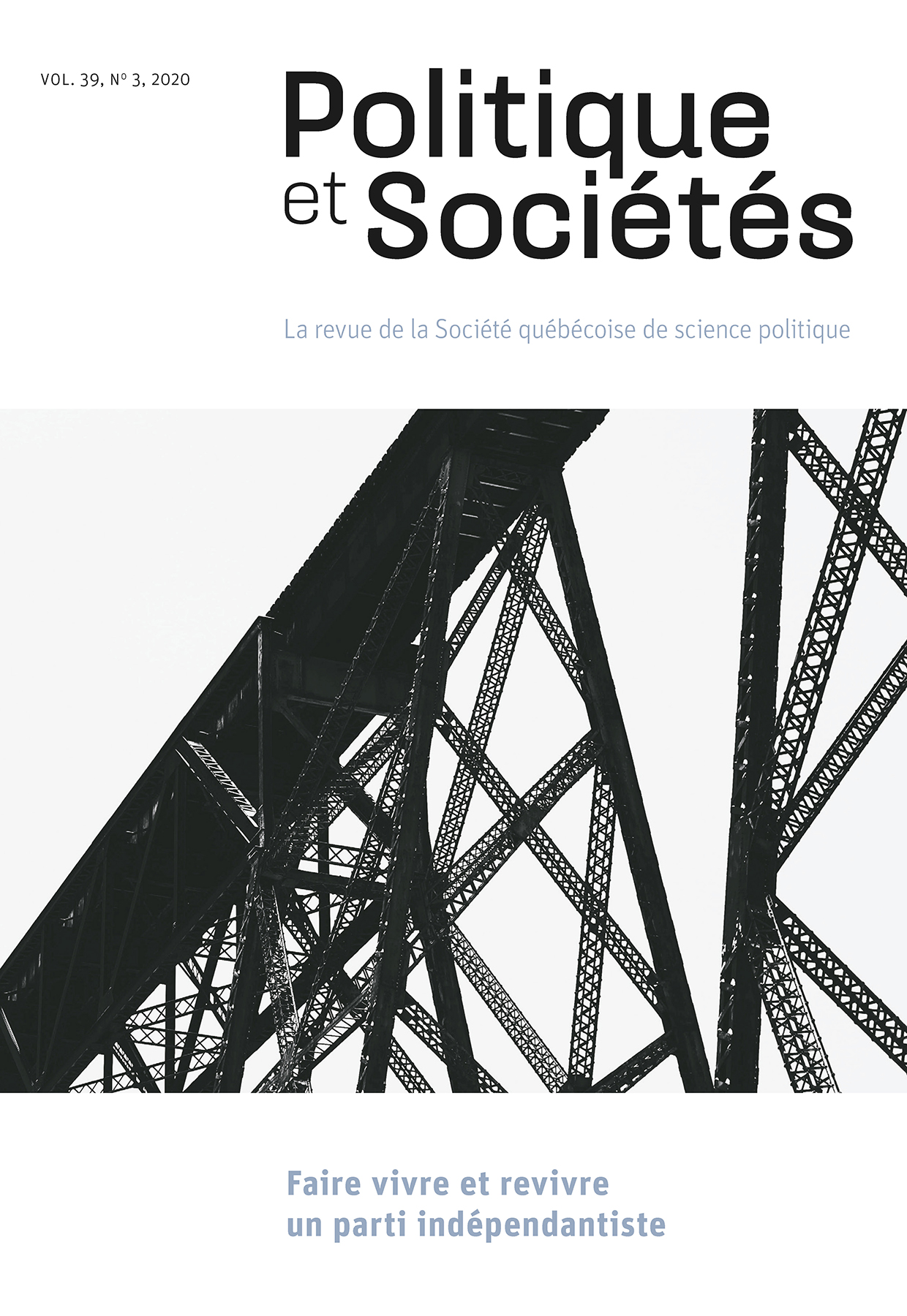Dans cet essai, Gérard Bouchard continue de se pencher sur ses préoccupations de recherche de prédilection, à savoir les imaginaires nationaux, les récits collectifs et les mythes nationaux. Dans Les nations savent-elles encore rêver ? Les mythes nationaux à l’ère de la mondialisation, Bouchard émet la thèse que les nations en sont à une conjoncture historique importante, un peu à une croisée de chemins en ce qui a trait aux mythes qui les façonnent. Si, selon lui, le fondement symbolique de la nation, les mythes nationaux vont survivre, du moins pour une période indéterminée, il n’est pas clair par quoi ils seront remplacés. Cet état des faits découle de plusieurs défis auxquels la nation fait face : mondialisation, immigration, crise environnementale et autres. Dans leur fondement symbolique, certaines nations sont plus ébranlées que d’autres, c’est ce que l’analyse approfondie des cas des États-Unis, de l’Acadie, du Canada (hors Québec, et surtout connu comme le Canada anglais) et du Québec révèlent. D’abord, aux deux premiers chapitres, Bouchard met les balises théoriques sur lesquelles son analyse est basée. Il importe de souligner d’entrée de jeu que celui-ci s’inscrit dans une démarche sociologique néodurkheimienne, que les mythes sont pour lui porteurs d’une valeur sacralisée et institutionnalisée. De plus, son approche de la nation, pour les études sur les nationalismes, s’inscrit dans une démarche moderniste, mettant la naissance de la nation avec la modernité. Bouchard est également grandement influencé par les écrits d’Anthony D. Smith et de l’ethno-symbolisme. Au premier chapitre, il dégage donc de son approche les définitions clés qui sous-tendent son essai ; on notera l’importance des mythes, au coeur du fondement symbolique d’une nation. Il faut faire une précision importante : « le fondement symbolique n’est pas synonyme d’homogénéité ou d’unanimité » (p. 16). L’auteur nous initie également au concept d’archémythes, une situation qui se présente rarement dans les nations mais où les mythes sont présentés de manière presque symbiotique, dégageant ainsi une grande convergence dans la nation. Une fois les définitions établies, Bouchard établit au chapitre 2 une nomenclature des mythes nationaux et construit une typologie en trois temps : 1) la célébration de la nation ; 2) la protection de la nation (parce qu’elle est « fragile » ; cette « fragilité » provient de diverses sources et perceptions, selon la nation) ; 3) la mobilisation de la nation autour de grands projets, valeurs ou idéaux. Ces deux chapitres sont, à mon avis, les plus intéressants et suscitent de nombreuses questions et pistes de recherche pour les chercheurs qui s’intéressent au sujet. Bouchard étale plusieurs failles de la recherche sur les mythes nationaux ; mentionnons par exemple la question du genre qui est trop peu souvent abordée. Les chapitres 3 à 6 sont des analyses de cas approfondies offertes par Bouchard. Il commence d’abord par la nation américaine, dont le mythe du rêve américain est en péril, puisqu’au lieu d’efforts et du mérite, comme le veut ce mythe, les gens s’enrichissent sans travailler, par le biais d’héritages, et, pendant ce temps, l’écart entre riches et pauvres s’accroît considérablement, si bien que les gens de la classe moyenne semblent peu optimistes que l’avenir sera plus luisant pour leurs enfants. Malgré ce portrait, le mythe persiste, bien qu’il soit fragilisé. Au chapitre 4, Bouchard aborde l’Acadie, dont l’analyse fait le portrait d’une nation fractionnée à la recherche d’un (nouveau ?) fondement symbolique. La conclusion qu’il en tire mérite ici d’être citée : Pour lui, il importe que les élites adoptent une voie de compromis pour que l’avenir ne soit pas tout noir. Au chapitre 5, Bouchard ne manque pas de …
Les nations savent-elles encore rêver ? Les mythes nationaux à l’ère de la mondialisation, de Gérard Bouchard, Monréal, Boréal, 2019, 438 p.[Notice]
…plus d’informations
Valérie Vézina
Kwantlen Polytechnic University
valerie.vezina@kpu.ca