Que ce soit en Espagne, en Écosse, en Irlande, au Québec ou en Belgique, le développement des sociétés fut marqué par l’expression d’une question nationale et par un rapport complexe entre différentes identités. La présence de forces politiques portant cette question nationale ou s’organisant vis-à-vis d’elle a eu et continue d’avoir des répercussions sur les dynamiques politiques qui les animent. Contrairement à d’autres démocraties libérales, ce qui est d’abord en jeu, ce sont les frontières du « nous », qui sont non stabilisées. Cela a un impact sur les débats et les dynamiques politiques : la finalité de la prise de pouvoir (réaliser l’indépendance ou non), la nature des revendications qui sont mises de l’avant au détriment d’autres, la construction de l’ennemi politique, le type de divisions au sein de la population, etc. Souvent, ce sont aussi des forces politiques qui ne sont pas uniformes sur l’axe droite–gauche, réunissant sous une même bannière des nationalistes progressistes et des nationalistes conservateurs, dont la prégnance dépend bien sûr du rapport de force entre les tendances. Si le nationalisme peut se révéler un outil de division, il est aussi un outil de développement social, qui conduit les unités (fédérées ou dévolues) à faire des choix politiques distincts et, souvent, à accorder une place centrale à leur État comme outil de transformation sociale. Bref, avoir ou ne pas avoir de parti politique nationaliste/indépendantiste change quelque chose dans le devenir des sociétés. C’est cette question générale que nous nous sommes posée dans ce numéro thématique. Il traite largement de la situation au Québec, mais comporte aussi des incursions dans d’autres sociétés, en comparaison ou non avec le cas du Québec. Avant de présenter les textes de ce numéro, nous revenons dans cette introduction sur ce qui a constitué le prétexte au colloque « Le PQ 50 ans plus tard », que nous avons organisé dans le cadre du congrès 2018 de la Société québécoise de science politique (SQSP), et l’état des lieux qui l’accompagnait. L’objet politique partisan nommé « Parti Québécois » s’est historiquement distingué par deux particularités, qui ont très bien été documentées dans la littérature spécialisée (Pinard et al., 1997 ; Lemieux, 2011 ; Montigny, 2012) : il s’agit d’une coalition hétéroclite sur le plan des idées, qui a réussi à imposer un clivage politique concernant le statut politique du Québec, de 1973 à 2007, dans la société québécoise ; le Parti québécois (PQ) est un parti antisystème qui a réussi par cinq fois à devenir un parti de gouvernement. Cette position particulière du PQ sur l’échiquier politique québécois a conduit à des développements politiques spécifiques en termes de politiques publiques, d’intervention de l’État et d’arrangements institutionnels plus ou moins formalisés avec la société civile. Cela a contribué à forger un régime de citoyenneté québécois qui se distingue du régime de citoyenneté observé dans le reste du Canada. Ainsi, les travaux de Jane Jenson (1998) ont clairement montré pourquoi, au-delà de la question normative de la spécificité nationale du Québec et de son existence comme communauté politique distincte, il était nécessaire de séparer analytiquement le Québec du reste du Canada. Évidemment, le PQ n’est pas seul à l’origine de cette distinction de l’unique juridiction majoritairement francophone en Amérique du Nord. Néanmoins, sa présence dans le jeu politique a joué un rôle central dans la configuration/reconfiguration des dynamiques politiques, que ce soit avec les autres partis ou avec d’autres acteurs sociaux (Dufour et Traisnel, 2009). Aujourd’hui, le PQ comme véhicule politique de la question du statut politique du Québec est dans la tourmente. Aux dernières élections québécoises du 1er octobre 2018, il …
Parties annexes
Bibliographie
- Bilge, Sirma, 2010, « “…Alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous, et nous les aimons ainsi” : La patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans une “nation” en quête de souveraineté », Sociologie et Sociétés, vol. 42, no 1, p. 197- 226.
- Castonguay, Alec, 2016, « CAQ : le pari de la fleur de lys », L’Actualité, mars.
- Depelteau Julie, Francis Fortier et Guillaume Hébert, 2013, Les organismes communautaires au Québec : financement et évolution des pratiques, Montréal, Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), consulté sur Internet (https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Communautaire-WEB-02.pdf), le 10 février 2019.
- Dufour, Pascale et Geneviève Pagé, 2020, « Gender and Feminists Mobilization in and Beyond Quebec », dans Alexandra Dobrowolsky et Fiona MacDonald, Turbulent Times, Transformational Possibilities ? Gender and Politics Today and Tomorrow, Toronto, University of Toronto Press, p. 221-239.
- Dufour, Pascale et Christophe Traisnel, 2009, « Aux frontières mouvantes des mouvements sociaux, ou quand les partis politiques s’en mêlent. Le cas du souverainisme au Québec », Politique et Sociétés, vol. 28, no 1, p. 37-62.
- Dufresne, Yannick, Charles Tessier et Eric Montigny, 2019, « Generational and Life-cycle Effects on Support for Quebec Independence », French Politics, vol. 17, no 1, p. 50-63.
- Fortier, Isabelle, 2010, « La modernisation de l’État québécois : la gouvernance démocratique à l’épreuve des enjeux du managérialisme », Nouvelles pratiques sociales, vol. 22, no 2, p. 35-50.
- Graefe, Peter, 2001, « Whose Social Economy ? Debating New State Practices in Québec », Critical Social Policy, vol. 21, no 25, p. 34-58.
- Grégoire, Marie, Eric Montigny et Youri Rivest, 2016, Le coeur des Québécois. De 1976 à aujourd’hui, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Jenson, Jane, 1998, « Les réformes des services de garde pour jeunes enfants en France et au Québec : une analyse historico-institutionnaliste », Politique et Sociétés, vol. 17, nos 1-2, p. 183-216.
- Jetté, Christian, 2008, Les organismes communautaires et la transformation de l’État-providence, Québec, Presses de l’Université du Québec.
- Lamoureux, Jocelyne, 1994, Le partenariat à l’épreuve, Montréal, Éditions Saint-Martin.
- Lamoureux, Diane, 2001, L’amère patrie. Féminisme et nationalisme dans le Québec contemporain, Montréal, Remue-ménage.
- Langlois, Simon, 2018, « Évolution de l’appui à l’indépendance du Québec de 1995 à 2015 », dans Amélie Binette et Patrick Taillon (sous la dir. de), La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 55-84.
- Lemieux, Vincent, 2011, Les partis générationnels au Québec. Passé, présent, avenir, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Mahéo, Valérie-Anne et Éric Bélanger, 2018, « Is the Parti Québécois Bound to Disappear ? A Study of the Current Generational Dynamics of Electoral Behaviour in Quebec », Revue canadienne de science politique, vol. 51, no 2, p. 335-356.
- Masson, Dominique, 2012, « Changing State Forms, Competing State Projects : Funding Women’s Organizations in Québec », Studies in Political Economy, vol. 89, p. 79-103.
- Mills, Sean, 2004, « Québécoises deboutte ! Le Front de libération des femmes du Québec, le Centre des femmes et le nationalisme », Mens, vol. 4, no 2, p. 183-210.
- Montigny, Eric, 2012, Leadership et militantisme au Parti québécois, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Montigny, Eric, 2016, « La fin des Oui et des Non au Québec ? Un clivage en déclin », L’Idée fédérale, Bulletin, vol. 7, no 1, n.p., consulté sur Internet (http://ideefederale.ca/documents/Janvier_2016_fr.pdf), le 6 juin 2020.
- Montigny, Eric, 2018, « Un bilan de l’expérience référendaire québécoise », dans Amélie Binette et Patrick Taillon (sous la dir. de), La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 55-84.
- Montigny, Eric, 2019, « A Realignment Election ? », Inroads, vol. 44, n.p., consultable sur Internet, (https://inroadsjournal.ca/?issues=issue-44-winter-spring-2019).
- Pagé, Geneviève, 2012, Feminism à la Quebec : Ideological Travelings of American and French Thought (1960-2010), thèse de doctorat en études féministes, University of Maryland, College Park.
- Pagé, Geneviève, 2015, « “Est-ce qu’on peut être racisées, nous aussi ?” : Les féministes blanches et le paradoxe du désir de racisation », dans Naïma Hamrouni et Chantal Maillé (sous la dir. de), Le sujet du féminisme est-il blanc ? Femmes racisées et recherche féministe, Montréal, Remue-ménage, p. 133-154.
- Pinard, Maurice, Robert Bernier et Vincent Lemieux, 1997, Un combat inachevé, Québec, Presses de l’Université du Québec.
- White, Deena, 2012, « Interest Representation and Organisation in Civil Society : Ontario and Quebec Compared », British Journal of Canadian Studies, vol. 25, no 2, p. 199-229.
- White, Deena, Céline Mercier, Henri Dorvil et Lili Jureau, 1992, « Les pratiques de concertation en santé mentale : trois modèles », Nouvelles pratiques sociales, vol. 5, no 1, p. 77-93.

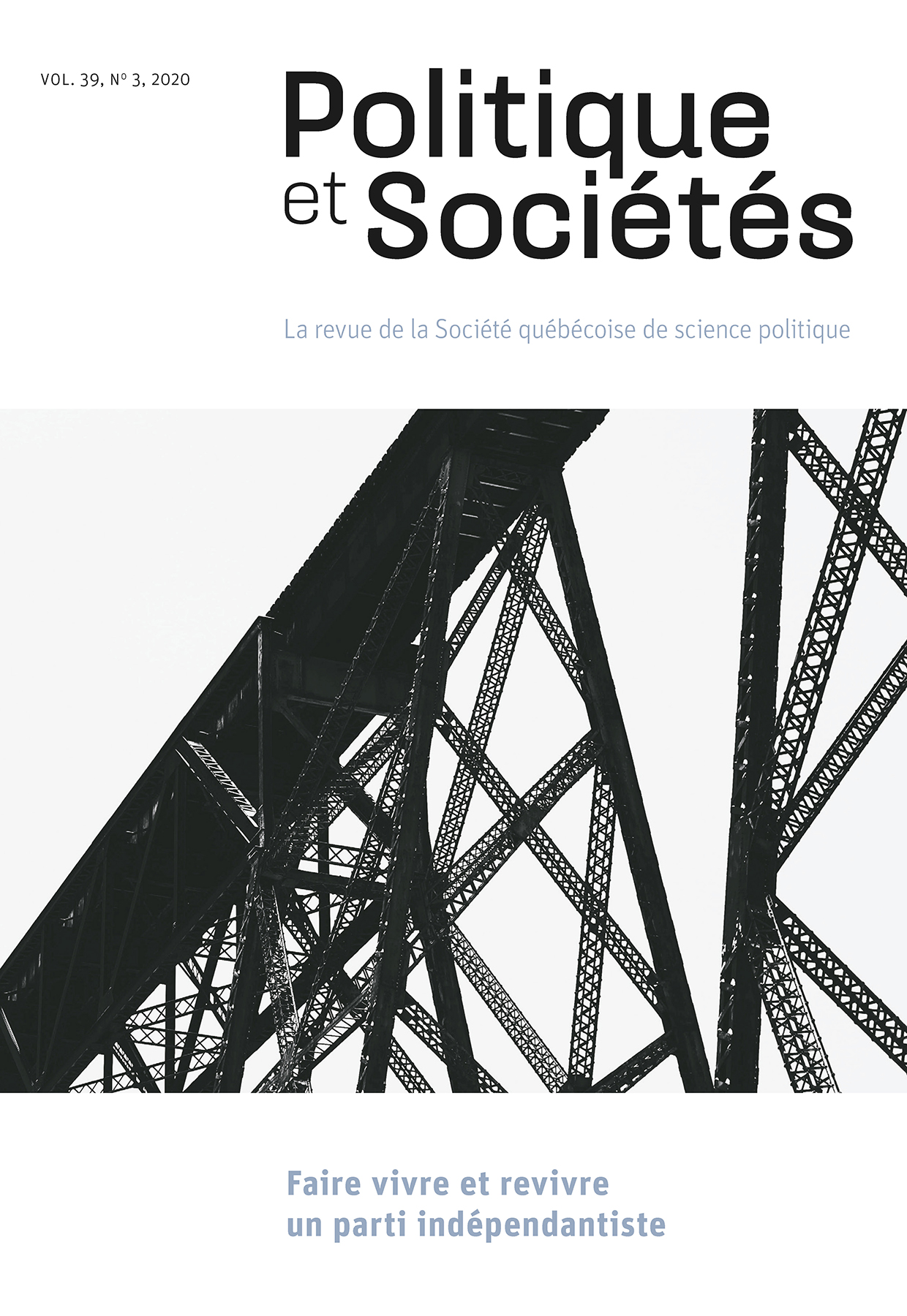
 10.7202/043963ar
10.7202/043963ar