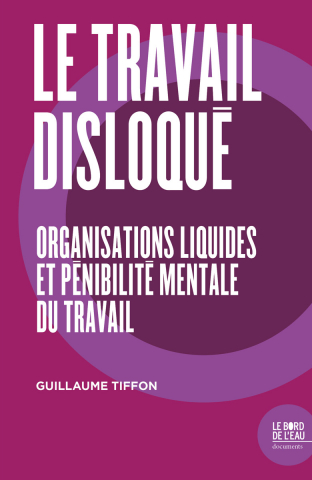Corps de l’article
Figure
Le travail de recherche est de prime abord une activité autonome, non réductible à une logique économique et gestionnaire. Cependant, comme l'expose cet ouvrage de sociologie des chercheurs du privé, une organisation marchande réticulaire tend à les déposséder des finalités et du contenu de leur travail. Dans cette enquête menée au sein de la direction recherche et développement d’un groupe industriel spécialisé dans la fourniture et la distribution d’énergie, l’auteur questionne les relations entre le management du travail scientifique et les pénibilités mentales des chercheurs, un groupe professionnel que l’on pourrait penser épargner par les maux contemporains du travail : stress, épuisement professionnel, perte de sens. Cette enquête[1] a été menée entre 2012 et 2017 auprès d’une population cadre (chercheur), principalement masculine, titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou d’un doctorat.
L'ouvrage, structuré en cinq chapitres, analyse la formation d'une organisation du travail par projet qui perturbe les conditions de l’activité scientifique à tel point qu’une partie des chercheurs éprouvent un sentiment d’inachèvement et une fatigue mentale. Reprenant l'approche de la « société liquide » de Zygmunt Bauman (2006), le premier chapitre décrit les exigences multiples et contradictoires d’une organisation flexible de la recherche fondée sur l’injonction à l’implication permanente. Alors que l’activité cognitive et temporelle des chercheurs était consacrée à la recherche jusqu’aux années 1990, une nouvelle organisation matricielle du travail – précédant l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence (2000) – conduit à le diviser en un pôle recherche restreint et des tâches périphériques (gestionnaires) qui s'accroissent. La richesse des données ethnographiques relatant les contraintes issues des nouvelles règles du jeu permet de mesurer la « managérialisation » du travail de recherche. Le récit qui nous est livré montre ainsi les changements du travail à plusieurs niveaux, structurel, avec un management par objectifs, et un niveau plus relationnel qui exprime la compétition induite par l’organisation en projet. Dans ce contexte, la transformation entrepreneuriale du métier conduit ces chercheurs du privé à n'être qu'une communauté fictive car ils doivent savoir se placer dans des équipes et des projets valorisants (visibles), soigner leur réputation, trouver des financements, afin d’espérer gagner en compétitivité et éviter la marginalisation dans l’organisation. C’est dorénavant l’aval (directions opérationnelles) au travers de relations de marché clients internes-fournisseurs qui commande la production et le financement des recherches; les relations de dépendance marquent ce changement à tel point que les lignes hiérarchiques se recomposent et impliquent un travail horizontal en réseau censé améliorer la productivité et la performance. La valeur des recherches déclinées en « livrables » (études techniques) est appréciée à l’aune de débouchés industriels et commerciaux. C'est ainsi que le travail de recherche connait une hétéronomie car la pression des objectifs conduit les chercheurs à amplifier les bénéfices attendus de tel programme, réduisant les couts et promettant des délais toujours plus courts. Les chercheurs se plaignent d'un manque de sens d’activités périphériques accrues (normes qualité). Les équipes sont de plus reconfigurées au fil des projets (d’un à trois ans), ce qui accroit l’individualisation et la compétition entre chercheurs qui travaillent à distance du fait d’un éloignement des sites. Afin de préserver une réputation fondée sur la capacité à se voir proposer ou rebondir en permanence sur des projets et des équipes démultipliés, les comportements opportunistes ou intéressés sont fréquents selon une logique de force des liens faibles (Granovetter, 1973).
Le second chapitre « La fabrique des mirages narcissiques » éclaire les logiques de consentement selon un double rapport au travail basé sur le registre de l’épreuve (reconnaissance hiérarchique) et celui de la passion (réalisation par l’activité). La typologie des postures professionnelles distingue les « élus » dont les efforts sont reconnus et engagés dans une gestion rationnelle de la surcharge cognitive et physique, les « déçus » (désenchantés) dont les efforts et sacrifices ne trouvent pas ou plus de reconnaissance tant la compétition hiérarchique est rude (peu de places pour beaucoup de candidats), les « passionnés » pour qui la surcharge est assumée car ils sont toujours attachés à un ethos du chercheur scientifique et ont réussi à gagner en réputation, alors que les « contrariés » – plus en retrait – sont ceux dont les activités (ingénierie) sont moins portées vers la recherche du fait d'une organisation compétitive commandée par les besoins du marché de l’énergie. Le concept de travail disloqué permet dès lors de comprendre l’écart entre le travail désiré et un travail réel qui dépend de conventions de valorisation échappant aux chercheurs. Le troisième chapitre « Bureaucratie liquide et débordements du travail » présente une activité scientifique remodelée par une rationalisation gestionnaire du temps de recherche ainsi que l’émergence d’un travail de justification et de traçabilité de l’activité. Cela conduit à accroitre les tâches de coordination car les chercheurs travaillent en équipe sur plusieurs projets de façon simultanée, en plus des tâches administratives et de communication pour s’organiser. Le travail déborde de l’entreprise, soit pour mener son vrai travail de recherche ou rattraper du retard, soit pour anticiper ou réduire les couts de coordination (traiter des mails afin de ne pas retarder l’avancement d’un projet).
Le quatrième chapitre « Les marécages de l’activité » décrit comment l’organisation liquide génère fragmentation et dispersion cognitive. L’environnement numérique et l’interdépendance professionnelle entraînent en effet une dislocation cognitive caractérisée par des interruptions fréquentes de l’activité, des changements de tâches et un cout mental enduré qui nuit à l’activité scientifique. L’observation directe quotidienne restitue de façon précise ces interruptions, prévisibles et imprévisibles, résultant de sollicitations humaines et numériques (devoir répondre à des mails urgents, réunion à distance), ce que confirment les résultats du questionnaire qui montrent que 90 % des chercheurs estiment ne pas pouvoir travailler deux heures d’affilée sans être interrompus (p. 138). Bien qu’ils critiquent les variations de tâches et de temporalités, ces chercheurs les jugent inévitables afin d’entretenir leur réputation en vue de futurs projets. Cependant le « temps perdu » à traiter des micro-tâches altère les capacités de concentration. Le revers de cet engagement se traduit par une forte intensité du travail tant les exigences de disponibilité temporelle sont fortes et amplifiées par les outils numériques de communication. Le travail n’a dès lors plus de frontières, chaque temps « mort » (réunions, transports, loisirs) peut être mis à profit pour rattraper un retard ou s’avancer sur des projets.
Les effets physiques et psychologiques sont exposés dans le cinquième et dernier chapitre « Des corps qui craquent. Symptôme du travail disloqué ». D’après les résultats des questionnaires, un salarié sur trois déclare des atteintes à la santé qui s’expriment par des troubles du sommeil tels que des difficultés à s’endormir et des réveils en pleine nuit pour noter des points non réalisés dans la journée. Les troubles résultent d’un stress typiquement produit par l’implication subjective de l’organisation par projet et les interactions hostiles entre collègues mis en concurrence sur des spécialités communes. L’individualisation du travail conduit certains à se sentir responsables de leur dévalorisation professionnelle. Pour en apprécier les modalités l'auteur a établi une typologie des troubles de santé. Il distingue six profils qui mettent en jeu la charge de travail et la définition de soi (ou valeur professionnelle). Les « surmenés » ne s’arrêtent pas de travailler pour rattraper du retard ou atteindre des objectifs nombreux alors que les « désorientés » souffrent d’une absence d’appréciation du travail fourni et d’objectifs précis. Lorsque persiste une discordance avec les attentes d’une direction, les chercheurs deviennent « contrariés » tant le travail attendu ne correspond plus à leur ethos de chercheur ou aux valeurs d’intérêt général (« le sens de l’usager », p. 180) qui les animaient au moment d’entrer dans l’entreprise publique. Mais c’est aussi le dessaisissement d’un projet scientifique travaillé de longue date qui conduit à des frustrations et à un manque de reconnaissance. Les « inutiles » voient leurs thématiques de recherche peu audible et secondaire au développement de l’entreprise ou à la suite de restructurations d’activité. Ils risquent un déclassement et de passer du côté des « disqualifiés » qui n’arrivent pas à faire reconnaitre leurs compétences ou qui se voient publiquement désavoués (p. 185). Cette situation conduit au 6e profil, les « placardisés », à qui les chefs de projet n’attribuent plus de missions ou bien seulement de façon fictive mais qu’un autre chercheur réalisera.
Cette enquête de sociologie du travail a le mérite de ne pas dissocier l’activité de recherche d’une rationalité instrumentale qui gouverne l’entreprise publique reconfigurée. Le regard sociologique de l’auteur articule de façon pertinente le dédoublement du travail de recherche, cognitif et gestionnaire, afin de consolider sa position mais au prix d’atteintes au corps et au mental. L’enquête aurait cependant pu interroger davantage les contraintes systémiques qui affectent la trajectoire et la réputation des chercheurs[2], sous l’effet de la surveillance du chef de projet[3] qui assure le relais des exigences temporelles et compétitives. L'auteur insiste sur la force d'une situation d'auto-contrôle et la pression entre pairs pour définir l'engagement, mais sous-estime la domination symbolique[4] du chef de projet qui, bien que n'ayant pas de pouvoir hiérarchique, en rappelant pédagogiquement les engagements des chercheurs, suffit comme moyen de pression. Comme la reconnaissance professionnelle, plus que scientifique, s'effectue par la promotion à des postes à responsabilité managériale qui éloignent de l’ethos de chercheur, la perte de sens du travail intellectuel semble inévitable. Reste à savoir comment la compétition, dont la contrepartie est la (dé)valorisation de soi, est devenue un mode de gouvernement légitime partagé par une grande partie des chercheurs de l’industrie.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Cette recherche a été commanditée par le comité d’établissement de l'entreprise publique et un suivi intersyndical des risques psychosociaux, l'objet portait sur les liens entre organisations du travail et santé des salariés. Elle articule des données qualitatives (129 entretiens et des observations in situ) et quantitatives (deux questionnaires, le premier en 2012 auprès de 2 165 salariés avec 51 % de taux de réponse; le second administré en 2015 auprès de 1003 agents dont 58 % de taux de réponse).
-
[2]
L’auteur souligne que le diplôme et l’école d’origine placent favorablement les chercheurs issus des grandes écoles d’ingénieurs (Polytechnique, Supelec) au détriment d'écoles de second rang.
-
[3]
Voir sur ce point David Courpasson, « Régulation et gouvernement des organisations. Pour une sociologie de l'action managériale », Sociologie du travail, n° 1, 1997, p. 39-61.
-
[4]
Mobilisant une approche marxiste de l'appropriation du travail par laquelle le travail abstrait enserre le travail concret, l'auteur ne mobilise pas ce concept de la sociologie wébérienne afin de saisir les formes relationnelles d'adhésion et d'influence. Voir Jean-Pierre Grossein, « De l'interprétation de quelques concepts wébériens », Revue française de sociologie, octobre-décembre 2005, 46-4, p. 685-721.
Liste des figures
Figure