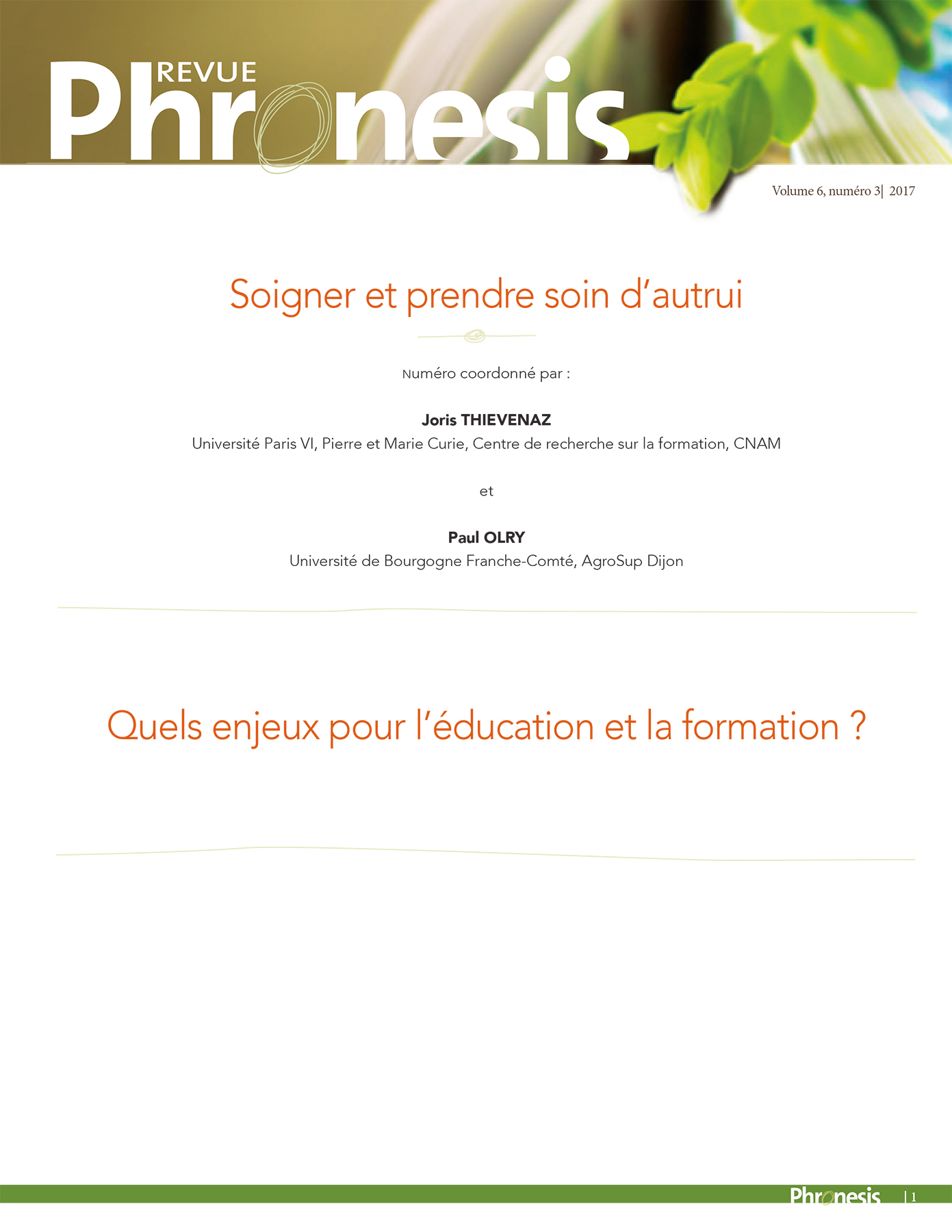Résumés
Résumé
L’article analyse le travail soignant. Il synthétise les principaux résultats d’un travail de recherche ethnographique sur la formation infirmière. Il montre que le travail infirmier représente, dans sa relation au « prendre soin », un exemple paradigmatique des tensions à l’oeuvre entre deux formes de sollicitudes qui sont définies comme opposées car elles fondent des territoires professionnels hiérarchisés. La première est orientée vers la guérison de la maladie, la seconde vers le mieux-être, l’accompagnement d’une personne souffrante. L’auteur conclut en mettant en perspective ces résultats avec l’évolution des besoins de santé actuels qui requièrent une nouvelle articulation de ces deux formes de sollicitude.
Mots-clés :
- care,
- cure,
- formation infirmière,
- sociologie des professions,
- chronicité
Abstract
The article analyses health care work. It summarizes the main findings of ethnographic research in nursing education. It shows that the work of the nurse is, in its relation to care, a paradigmatic example of the tensions at work between two forms of solicitude, which are defined as opposite, as they meld hierarchical professional territories. The first form of care is oriented towards the cure of the disease, the second to well-being and support. The author concludes by putting the results of the research into perspective, in terms of the current evolution of actual health care needs, which require a new articulation of these two forms of solicitude.
Keywords:
- care,
- treatment,
- training nurse,
- sociology of professions,
- chronicity
Corps de l’article
Introduction
Durant la première décennie des années 2000, j’ai mené une recherche ethnographique sur le terrain de la formation de celles que le sens commun associe volontiers au travail de « prendre soin », à savoir les infirmières. Le cadre conceptuel et les aspects méthodologiques de ce travail ont été développés notamment dans Rothier-Bautzer (2016, 2014, 2012).
Mes recherches s’inscrivent dans le cadre de la sociologie des professions, et, plus précisément, au sein du courant développé par Abbott (1988, 2016) qui reprend le projet originel de Hughes (1956). L’accent est mis sur l’analyse socio-historique de l’activité étudiée. Cette dernière est située au sein d’une écologie professionnelle, ce qui signifie que les groupes professionnels sont étudiés dans leurs relations aux groupes qui leur sont proches. Nous nous intéressons à la concurrence que se livrent les groupes professionnels pour établir et défendre des zones de contrôle (aires de juridiction), domaines qui leur sont réservés dans la division du travail. Le terme « juridiction » précise le lien qu’une profession entretient avec son travail, le territoire qu’elle occupe. Ainsi, l’autonomie professionnelle est le produit d’une dynamique développée au sein d’une écologie où les acteurs luttent pour obtenir, puis conserver des domaines réservés. La légitimité professionnelle repose sur la valeur éprouvée du découpage de sa juridiction. Enfin, lorsque les professions entrent en conflit au sujet de leurs frontières, ils se déroulent au sein de trois arènes : le lieu de travail d’une part, l’opinion publique et les médias d’autre part, et enfin, la législation et les pouvoirs publics[1].
Selon cette perspective, j’ai étudié comment les infirmières professionnelles, au cours du XXème siècle ont été formées, formées à éduquer, et comment elles forment leurs pair(e)s depuis les années 1970 en France.
Cette recherche qualitative repose sur des entretiens, des observations participantes, des observations et des analyses des traces écrites des activités[2]. Aux entretiens et aux observations réalisés au sein des instituts qui forment les professionnels qui éduquent et encadrent leurs pairs se sont progressivement ajoutés les instituts qui forment les futurs infirmiers, à savoir, en France, les terrains hospitaliers et les instituts de formations en soins infirmiers mais aussi ceux qui forment les infirmiers spécialisés, notamment les puéricultrices. Enfin, au cours de cette recherche, des réformes des formations soignantes - notamment infirmière - ont fait l’objet de réunions au Ministère de la Santé, et ont généré ensuite des premières initiatives de réformes des formations, que j’ai eu l’opportunité de suivre de près en adoptant une approche d’observation participante au Ministère entre 2006 et 2007. En 2009, est mis en place un nouveau programme de formation infirmière, qui se substitue à celui qui prévalait et datait de 1992.
L’ensemble de la période que j’ai pu étudier s’avère donc particulièrement riche de par les transformations progressives qui ont amené ces changements dans la formation infirmière. Pour les comprendre, j’ai analysé le groupe professionnel infirmier dans sa relation aux groupes professionnels du secteur dans lequel il se situe notamment celui des médecins. En effet, la profession médicale exerce, sur l’ensemble des professions du secteur, une dominance que Freidson (1984) s’est attaché à décrire avec précision.
Je me suis donc intéressée de près aux modalités de formation et aux contenus des programmes, pour comprendre qu’ils ont été, sur ce terrain, fortement influencés par des réformes et des théories anglo-américaines. Au-delà des programmes, c’est la finalité même des activités et des formations infirmières mais aussi médicales qui s’en est trouvée revisitée. La mise en perspective historique et géographique s’est donc avérée essentielle. Elle s’est traduite par la consultation de travaux d’historiens sur ces questions et par le recours à l’analyse systématique des programmes français de formation entre 1955 et 2009 ainsi que des rapports d’experts commandés par les pouvoirs publics au cours de la première décennie des années 2000. Les résultats de ce travail ont fait l’objet de plusieurs publications. Je propose de les mettre en perspective ici en montrant que le travail de l’infirmière représente, dans sa relation au « prendre soin », un exemple paradigmatique des tensions à l’oeuvre entre deux formes de sollicitudes qui sont définies comme opposées car elles fondent des territoires professionnels hiérarchisés. La première forme de sollicitude est orientée vers la guérison de la maladie par l’établissement d’un diagnostic et la mise en oeuvre d’un traitement. La seconde se porte vers le mieux-être, l’accompagnement d’une personne malade ou en souffrance, en la considérant dans son environnement. Je propose d’analyser ces résultats en lien avec les besoins de santé actuels qui requièrent une nouvelle articulation de ces deux formes de sollicitude.
Dans un premier temps, je rappelle donc de manière synthétique le contexte de la formation infirmière en France. J’en précise ensuite les principales caractéristiques et les tensions qui les sous-tendent. Enfin, je résume les constats qui en découlent et je conclus sur les conditions de mutation de la notion de « prendre soin » à la fin de la première décennie des années 2000.
1. La formation infirmière dans les arènes des instituts et hôpitaux (1955-2009)
Jusqu’en 2009, les infirmières diplômées en France étaient titulaires d’un Diplôme d’État d’infirmiers. Depuis 2012, elles sont, en outre, titulaires d’un « grade licence ». Leur formation s’effectue en alternance entre les Écoles d’infirmières, nommées ultérieurement des Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), et les terrains de stage, essentiellement hospitaliers. Au niveau des contenus de formation infirmière, on observe à partir des années 1970, une progressive émancipation des contenus liés aux savoirs médicaux et une redéfinition par les formateurs de contenus centrés sur les soins infirmiers. Leur principale caractéristique est la centration déclarée sur le patient et non sa pathologie, et l’utilisation de grilles d’analyse des besoins du patient issues de recherches nord-américaines. La plus utilisée des grilles étant celle de Virginia Henderson[3].
Cette infirmière américaine, a suivi une formation universitaire aux États-Unis dans les années 1930. Elle est devenue ensuite enseignante à l’Université (Boittin, Lagoutte, Lantz, 2002, Henderson, Colliere, 1994, Henderson Virginia, Nite Gladys, 1978). Selon elle, l’infirmière doit aider les personnes à reconquérir leur indépendance, ce qui nécessite qu’un certain nombre de besoins soient satisfaits. Elle a, dans ce but, formalisé le cadre d’un raisonnement infirmier, dont les 14 besoins du patient, sont l’un des éléments clef[4]. Pour chacun des besoins, le modèle de Henderson définit des « signes de satisfaction » et des « signes de dépendances » (ceux-ci désignent des difficultés du patient dans la satisfaction de ses besoins)[5]. Le travail de l’infirmière vise à faire diminuer cette seconde catégorie. Lorsque sa pratique ne lui permet pas de rendre le patient indépendant, elle en est, selon Henderson, « insatisfaite ». Le sens du travail infirmier réside dans l’autonomie recouvrée du patient. Un patient bien soigné est un patient indépendant. À partir de la grille formalisée par Henderson[6], l’infirmier doit décliner les actions qui lui reviennent en propre. Parallèlement, il est formé, en École ou en Institut et sur les terrains de stage, aux pratiques curatives liées à la délégation d’actes techniques (pansements, surveillances, délivrance des médicaments) par les médecins. Mélange d’expériences, d’apprentissages de discours sur la pratique formulés par l’élite des formatrices inspirées des théoriciennes anglo-saxonnes et canadiennes francophones, les contenus de formation infirmiers ont évolué en IFSI entre 1975 et 1992 en liaison avec les récits que les anciens infirmiers de terrain devenus cadres ont pu transmettre aux nouvelles recrues de leurs expériences et les injonctions méthodologiques portées par les programmes successifs.
Alors que les programmes décrivent peu à peu un infirmier professionnel ouvert sur le secteur social et extra-hospitalier dont le raisonnement s’appuie sur des savoirs infirmiers, les analyses témoignent d’une centration de la formation de terrain sur le secteur hospitalier (Rothier-Bautzer, 2012 :33-45).
Une formation valorisant le travail technique curatif
Les données dont je dispose dévoilent une contradiction entre les conceptions d’un soin infirmier qui place au premier plan la relation avec le patient, et un soin valorisé, aussi nommé soin « en technique » où la relation en tant que telle n’aurait qu’une place résiduelle.
De là, découle toute une hiérarchie intégrée par la forme du cursus de formation qui commence par les soins les plus relationnels, les moins « techniques », ce qui sous-entend qu’ils sont plus « faciles » et se termine par les apprentissages « techniques », jugés les plus difficiles[7]. Du coup, les premiers stages considérés comme « faciles », se déroulent souvent en gériatrie, en psychiatrie, où la dimension technique est réduite et où le « prendre soin » s’inscrit dans la durée. Le « bon élève » n’a qu’une idée en tête, « maîtriser » la technique, qui ferait de lui le bon professionnel. De ce point de vue, c’est bien sur le terrain que l’objectif peut être poursuivi, notamment lors des stages en service hospitalier hyperspécialisé. Les soignants rencontrés expriment leur crainte de ne pas être bons techniquement. Aucun d’entre eux n’a soulevé une inquiétude quant à sa capacité à être efficace sur le plan relationnel.
Ainsi, la relation au patient ne fait que qualifier un type de soin d’où la dimension technique centrée sur le traitement est absente. La relation en elle-même ne fait donc pas l’objet d’une expertise professionnelle car elle est plutôt assimilée à une tâche profane. Notons cependant ici que des infirmiers psychiatriques (formés avant 1992 dans des instituts de formation spécifiques) ont acquis une toute autre vision du soin où la dimension relationnelle est centrale et où le caractère professionnel de cette activité a été travaillé et réfléchi, notamment sur les terrains des soins, en partenariat avec des psychiatres, surtout entre les années 1970 et 1990. Mais les infirmiers dits généraux, formés en Écoles d’infirmières, avaient le droit de soigner en psychiatrie sans que les infirmiers psychiatriques – plutôt des hommes d’origine sociale plus modeste que les autres infirmiers - n’aient le droit d’intervenir à l’hôpital général. Depuis 1992, les infirmiers sont tous formés en IFSI. La spécificité de la formation initiale pour le secteur psychiatrique a disparu en France avec les instituts qui lui étaient dédiés. Ce processus souligne encore la dichotomie et la hiérarchisation entre travail relationnel et travail technique. Le « prendre soin » infirmier s’est donc construit à partir d’une conception peu professionnalisée et peu reconnue du travail relationnel. Il est valorisé dans la relation qu’il établit au traitement technique d’une maladie, particulièrement dans sa phase aigüe. Il contribue ainsi au travail visant la guérison de la maladie diagnostiquée par le médecin dans un temps court.
2. L’émergence du travail professionnel relationnel
Une autre donnée récurrente de notre enquête de terrain concerne la part de plus en plus importante que prennent les aspects « relationnels » du travail du soin dans le contexte de l’évolution de la « technicité » et des connaissances des pathologies aiguës. L’opposition entre soins relationnels et soins techniques prend un sens nouveau pour les infirmiers formés dans les années 1990.
D’une part, les infirmières ne liment plus les seringues entre deux soins « techniques » comme les personnes interviewées le faisaient encore dans les années 1970. Elles utilisent progressivement du matériel jetable. Les soins moins invasifs limitent les tâches de la panseuse. Elles doivent, par contre, désormais consigner leurs actes, tenir à jour les dossiers des patients, tandis que les aides-soignantes se sont vues déléguer les activités de « nursing »[8]. D’autre part, la performance du modèle curatif associé aux changements de mode de vie, contribuent à produire des besoins exponentiels en éducation et en accompagnement de personnes malades chroniques. Ces patients chroniques requièrent un type de relation particulière où la mission du soignant revêt un caractère pédagogique, un travail de prévention, de suivi attentif des possibilités et des modalités d’observances des soins prescrits. La connaissance des incidences de la maladie sur l’expérience de vie du patient et l’accompagnement de ce dernier dans la durée deviennent des éléments centraux du travail de soin. Le travail d’articulation que réalise l’infirmière (Grosjean, Lacoste, 2010) devient d’autant plus important que le nombre d’acteurs concernés croît et se diversifie (professionnels paramédicaux, associations, familles, professionnels du secteur social, éducatif, professions techniques de maintenances des machines). Or, les besoins ont augmenté et se sont transformés mais le système de santé est demeuré, en France, organisé autour de l’hôpital hyperspécialisé, forteresse de l’excellence soignante développée dans la seconde moitié du XXème siècle. Cette forteresse, en préservant son organisation hiérarchique et ses systèmes de division du travail et de valorisation des activités soignantes techniques, tend à devenir contreproductive pour accompagner les mutations qu’elle a contribué à engendrer à la fois à l’intérieur de l’hôpital mais aussi en dehors. Au centre de ces mutations, nous constatons l’émergence d’une nécessité nouvelle, celle qui requiert d’articuler une sollicitude centrée sur le traitement technique de pathologies ciblées dans un temps court, et une sollicitude centrée sur l’accompagnement des personnes malades dans la durée, y compris lorsqu’elles cumulent plusieurs pathologies distinctes.
Cette articulation requise contribue à faire exister d’une manière nouvelle une catégorie restée jusqu’ici profane dans les modes de valorisation du secteur sanitaire, la catégorie qualifiée de « relationnelle ». Très présente dans les propos de l’ensemble des infirmiers interviewés, elle se cherche une place depuis les revendications émancipatrices des années 1970. La performance des sciences et techniques médicales, paradoxalement, contribue à faire apparaître cette catégorie comme un impératif professionnel nouveau. Je reviens donc ici sur l’importance de la catégorie relationnelle telle qu’elle a émergé au cours de mon travail de terrain.
3. La formation en institut comme lieu de valorisation du relationnel
Le facteur relationnel apparaît être un leitmotiv tant dans ce qui a conduit les étudiants à devenir infirmiers qu’en ce qu’il les amène ensuite à quitter le soin, pour l’enseigner ou l’encadrer. Comme le rappelle Véga (2000), la « durée de vie » d’une infirmière est d’environ 8 ans sur le terrain du soin où les professionnelles partagent le même sentiment d’abandon et de solitude que ceux qu’elles soignent[9]. Sur le terrain, les « relationnelles » seraient peu à peu exclues par les autres qui chercheraient à « tenir » en se protégeant du malade.
Pour l’ensemble des cadres-formateurs interviewés, il y a un moment de saturation sur le terrain, énoncé comme lié à la difficulté de réaliser des soins « en relation » avec les patients résumé par la phrase : c’était « trop lourd à supporter ». Les soignants évoquent la douleur des patients, les décès, la gestion et le contact avec les familles. Ils expriment aussi que ces tâches sont d’autant plus difficiles qu’elles ne sont pas reconnues comme telles par l’institution. Une fois l’assurance technique acquise, la personne du patient semble apparaître davantage. L’impossibilité (jugée organisationnelle) de s’en occuper a conduit la majorité des infirmiers interviewés à quitter le soin. Si l’on se réfère ici au modèle de Davis (1966), ces infirmières ne sont pas parvenues au stade de l’intériorisation stable dans laquelle l’incorporation du rôle permet le refoulement stabilisé du moi «profane», le rôle étant ici dévolu à une centration sur les aspects techniques et curatifs du soin et à une invisibilisation du travail de sollicitude déployée envers la personne malade. Dans la lignée des travaux de Reverby (1987), et du courant très étayé autour des politiques du care dans les pays anglo-saxons (Tronto, 2009), je dirai que c’est la dimension pratique et située du travail de care qui est d’autant plus dévalorisée que l’autonomisation de la personne dont on prend soin s’installe dans la durée[10]. L’infirmière insatisfaite, pour reprendre les propos d’Henderson, lorsque le patient ne guérit pas, ne fait que traduire une demande sociale qui survalorise l’autonomie en la confondant avec l’indépendance. Ce processus laisse de côté tous ceux qui accompagnent et prennent soin des personnes dans la durée. Mais il fragilise aussi l’ensemble des infirmiers interviewés, et ce, à mesure que les performances techniques contribuent à l’augmentation des patients chroniques poly pathologiques. Cette attention aux détails mêlée dans la durée au travail technique, sollicite les infirmiers. Mais le manque de reconnaissance associé à ce travail de care tend à les en détourner.
Plus l’on s’éloigne de la maîtrise curative, plus la dimension relationnelle des soins est posée comme un problème. Davantage, elle est sollicitée. L’école de cadres est l’une des voies offertes pour sortir de ces situations inconfortables en ne dispensant plus de soins directs aux patients. Elle permet d’être responsable d’un service de soin ou formateur en institut. La motivation qui porte les soignants cadres vers la formation en institut, est décrite comme une manière de préserver un travail d’ordre « relationnel », sans que cet aspect soit dévoyé ou trop lourd à porter, comme sur le terrain du soin. Il s’agit là d’une manière de réhabiliter les aspects relationnels du « prendre soin », en dehors de son contexte d’exercice initial.
La « pédagogie » apparaît alors comme cette science du relationnel, susceptible de lui redonner des lettres de noblesse. Mais l’indigence de la formation reçue en la matière rend l’entreprise hasardeuse. On enseigne comme on soignait. La formation au métier de formateur est tout aussi professionnelle que la formation des infirmiers sur les dimensions relationnelles de leur activité[11]. Les cadres-formateurs n’en sont souvent pas dupes. Enseigner en Institut, c’est ainsi, d’une certaine manière, chercher à réaffirmer l’importance du « relationnel » dans le soin infirmier en lui ôtant sa dimension profane telle que vécue dans les services. Mais c’est aussi, de façon plus triviale, concilier des horaires de travail avec une vie familiale et gagner en autonomie dans l’organisation de ses tâches. Somme toute, c’est une manière pour l’infirmière, d’essayer de « prendre soin » des autres en prenant davantage soin d’elle-même et des siens. Car, les institutions soignantes, construites comme des usines à produire des soins hyperspécialisés, tendent à sous-estimer l’ensemble du travail émotionnel porté par les acteurs (Molinier, 2005 :314).
4. L’institut, une formation qui s’affranchit du regard médical entre 1970 et 2009
L’institut est aussi le lieu par excellence où l’auxiliaire médicale prend ses distances avec les médecins. Progressivement, à partir du milieu des années 1970, les formatrices, dans les écoles d’infirmières, s’affranchissent de leur rôle d’exécutante des prescriptions, et essaient de faire valoir un rôle infirmier qui s’inscrive dans une certaine distance face aux définitions données par les surveillantes et les médecins. Elles s’appuient sur la définition d’un rôle infirmier autonome, centré sur le patient et non plus sur la pathologie. Ce rôle suppose un travail sur la relation établie avec le patient. Les entretiens témoignent de cette recherche d’émancipation progressive et relative des infirmières face au fonctionnement des services hospitaliers. Mais elles peinent à valoriser et faire valoir ce qu’elles essaient de définir comme relevant de leurs compétences propres. Sur quels savoirs, normes, techniques, valeurs, asseoir en cohérence cette dimension relationnelle du soin ? Les infirmières françaises ne disposent pas pour la majorité d’entre elles du support apporté par les théorisations anglophones des soins infirmiers. Elles ne parviennent pas à faire reconnaitre collectivement l’apport singulier de leur contribution au travail de « prendre soin » en dehors d’un travail médical délégué et centré sur le traitement technique des maladies. La grève de la fin des années 1980 signe à cet égard le profond malaise de la profession infirmière en France. Le fait que leur exercice soit resté hospitalo-centré, avec seulement 15% des infirmières françaises sur un exercice extra-hospitalier, rend difficile l’émancipation d’un statut d’auxiliaire médicale. Cette émancipation signerait conjointement une position sur des terrains moins valorisés de l’activité soignante dans l’accompagnement dans la durée de personnes malades hors de l’hôpital. Elles seraient plus proches alors de secteurs d’activités moins prestigieux dans la hiérarchisation du secteur sanitaire que ceux des soins hyperspécialisés. Elles se rapprocheraient même d’un secteur médicosocial, qui, en lui-même, occupe dans la hiérarchie des secteurs dans laquelle elles sont éduquées, une place moins valorisée.
C’est pourquoi les infirmières demeurent dans une relation ambigüe avec les modes de valorisation de l’excellence médicale[12]. D’un côté, elles remettent en question le manque de considération des aspects relationnels des soins et de la personne malade dans le soin technique centré sur les pathologies. De l’autre, c’est en se rapprochant des médecins les plus spécialisés et les plus reconnus, qu’elles acquièrent, dans leur sillage, un meilleur statut symbolique. C’est pourquoi l’autonomie relative des infirmières dans leur travail s’exerce surtout dans l’espace de liberté qui leur est octroyé dans la mise en oeuvre des prescriptions (la réalisation des pansements et la gestion des aspects techniques des soins), et ce, au moins jusqu’à la fin des années 1990.
Les formatrices ont gagné le droit d’enseigner le rôle propre[13] en Institut, se constituant ainsi un territoire des soins infirmiers autour du « prendre soin » du patient qui intègre la dimension relationnelle des soins. Sur le terrain des soins hospitalier, le territoire occupé s’inscrit depuis la seconde moitié du XXème siècle, dans l’espace des soins techniques centrés sur le traitement des pathologies et de plus en plus spécialisé. Si les termes d’éducation des patients, d’accompagnement des malades chroniques émergent sur le terrain des soins depuis les années 1970 mais surtout depuis la fin des années 1990, leur traduction dans un espace professionnel reconnu reste marginale. L’évolution des fiches de postes témoigne de leur faible incidence sur le travail professionnel.
Des représentants des instituts de formation ont contribué à appuyer la réforme de la formation de 2009 (Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres). Elle représentait pour eux un accès possible à une reconnaissance de leur formation à un niveau universitaire. Cette revendication est un leitmotiv des représentants des formatrices, sur le modèle de filières de sciences infirmières dont elles connaissent bien sûr l’existence dans nombre de pays anglophones et au Canada francophone, mais aussi au Liban et chez la plupart de nos voisins européens. Même si la réforme de 2009 ne propose pas la création de filière universitaire pour les infirmiers, elle permet aux instituts de former en vue d’un grade licence en plus du diplôme d’état, ce qui contribue à satisfaire en partie aussi les revendications des étudiants.
Mais l’un des effets probablement peu évalués au départ par les représentants des formatrices, a été le « retour des médecins » dans la formation infirmière[14]. Alors que, depuis 1975, ils intervenaient ponctuellement et à la demande des directrices et formatrices, ils sont amenés désormais à travailler ensemble pour produire le nouveau programme sur tout ce qui relève des savoirs scientifiques biomédicaux. Dès lors, la mise en oeuvre du programme de 2009 est apparue hétérogène et parfois houleuse. Les équipes sont nombreuses à remettre en question le bénéfice apporté par l’université de par cette présence et ce regard médical porté sur leur travail en institut. Davantage, par ce qu’il représente que par ce qu’il produit, il occupe désormais pour certains le rôle d’objet-problématique de la réforme. Les points de vue, les savoirs, et les pratiques étant fort distincts désormais entre les facultés de médecine et les formateurs, les tentatives de nouvelles délégations (correction des copies des cours magistraux faits par les médecins, réalisation de leurs travaux-dirigés) ont représenté pour les formateurs un retour au point de départ dans leur relation de soumission au médecin mais, cette fois, en institut de formation. Auxiliaires sur le terrain des soins, les formateurs se sont sentis parfois placés dans un même statut d’auxiliaire pour organiser les formations. Ce processus compromet la segmentation du groupe professionnel infirmier sur le modèle anglo-saxon. Il remet en question l’autonomie d’action du segment des formateurs. La dimension relationnelle d’accompagnement et de suivi des étudiants retrouve, dans sa relation à l’université, le rang d’ordre second qu’elle occupe sur le terrain des soins.
L’idée des promoteurs médicaux de ces parcours, éloignés des formations infirmières depuis une trentaine d’années au moins, était de construire surtout des masters, comme ils en existent notamment dans les pays anglo-saxons, afin de déléguer de nouvelles tâches médicales aux infirmiers (Rapports Berland). Mais pour construire des masters, il s’agissait de permettre plus facilement aux infirmiers « de base » d’accéder à un diplôme en lien avec l’université. Dans les pays qui servent de modèles pour ces nouveaux masters, les infirmières ont accès à des cursus diversifiés à l’université depuis le début du XXème siècle. D’autres infirmières continuent d’être formées dans des cursus techniques courts en dehors de l’université. Les clivages entre infirmiers de base et l’élite infirmière sont très importants et sources de conflits internes en Angleterre et au Canada notamment.
En France, les savoirs scientifiques de base ne sont pas clairement définis pour les infirmiers. Les « soins infirmiers » sont devenus des « sciences et techniques infirmières » par le biais de l’écriture du programme de 2009 sans que les formateurs qui les portent aient accédé en nombre à des formations universitaires. De quelles sciences et techniques peut-il donc s’agir sinon la continuation de ce que j’avais déjà observé sur un terme de dix ans, c’est-à-dire, des savoirs d’expériences mêlés à des méthodes de raisonnements peu étayées théoriquement ? Dès lors, ce qui pouvait faire sens dans les formations professionnelles en institut, se trouve remis en question dans la relation à l’université mais d’une manière d’autant plus singulière que le conventionnement se fait le plus souvent avec des facultés de médecine. Au sein de ces dernières, la hiérarchie entre recherche, soins et enseignement s’avère prégnante.
En promouvant un étudiant réflexif et autonome, le nouveau programme demande aux cadres formateurs un travail pédagogique différent. Sur le terrain, comme en institut, ils y ont été très peu préparés. Il en résulte un accroissement du fossé et un manque de clarté entre le modèle prôné en institut et les pratiques déployées sur les terrains des soins hospitaliers. Plus que jamais, la formation est clivée et le modèle d’alternance intégrative peine à se mettre en place. En essayant de préserver leurs autonomies respectives, les responsables des formations et les médecins soucieux de nouvelles délégations, ont produit ensemble une réforme de la formation qui ne répond pas à la question majeure de l’articulation des soins hyperspécialisés et des soins inscrits dans la durée.
Dans leur travail, les infirmiers qui ont un rôle pivot dans le système de soin, vivent au quotidien les contradictions liées à la sous-estimation de l’intégration d’une sollicitude centrée sur le patient et d’une sollicitude orientée vers le soin d’une pathologie. Le caractère peu professionnalisé des rôles relationnels des acteurs du secteur sanitaire rend difficile le dépassement de ces contradictions. Elles sont aussi source de malaise chez les professionnels du soin[15]. Or, l’évolution en nombre des personnes malades chroniques soignées, mais non guéries, et le coût humain et financier qui lui est associé, rendent de plus en plus compliqué, tant pour les personnes malades que pour les soignants, le maintien du statu quo défendu par les promoteurs des réformes précitées.
5. L’écologie professionnelle sanitaire peine à articuler le traitement au « prendre soin »
L’analyse montre donc une écologie professionnelle sanitaire dominée par :
-
Une sollicitude visant le diagnostic et le traitement maîtrisé d’une part, la guérison de la maladie dans un temps court d’autre part ;
-
La délégation des soins pratiques dans la durée et la délégation de la sollicitude centrée sur la personne malade aux groupes professionnels ou segments moins établis ;
-
Un coeur de métier centré sur la mise en oeuvre et le suivi des traitements liés aux soins médicaux techniques, centrés sur la pathologie ;
-
Le maintien de la division du travail et des segmentations construites au cours du XXème siècle (au sein des groupes professionnels médical et infirmier et entre ces derniers et entre les secteurs sanitaires, social, et médico-social).
Or, le contexte évolue au cours du XXème siècle avec le développement de situations où les traitements existent mais ne maîtrisent pas la maladie. Ils soignent sans guérir mais requièrent un engagement du patient dans la durée des soins. Les parcours de formation cloisonnés et hiérarchisés entre professions sanitaires, sociales, médico-sociales et au sein des professions sanitaires elles-mêmes, contribuent à produire des situations contre-productives pour l’ensemble des acteurs concernés. On observe en effet :
-
Une discontinuité entre soins curatifs et soins visant les traitements de maladies chroniques ;
-
L’invisibilisation de l’articulation entre une sollicitude centrée sur la maladie et une sollicitude centrée sur la personne malade ;
-
La relation accompagnement/traitement demeure opaque. Elle est déléguée et non professionnalisée.
L’écologie professionnelle et les territoires établis au cours du XXème siècle ne permettent pas d’adresser les soins chroniques complexes qui requièrent un travail centré à la fois sur le traitement des maladies et sur l’accompagnement de la personne malade. Cette expertise suppose de nouvelles formes de relations inter et intra professionnelles ce qui engendre les résistances des professions et des segments professionnels les plus établis qui souhaitent garder le contrôle de l’ensemble des activités et des territoires. Ces transformations concernent plus largement nos manières d’entrer en relation les uns avec les autres à partir du tournant des années 70 où les valeurs et normes de l’autonomie ont pris progressivement une importance croissante (Ehrenberg, 2010). Elles contribuent à mettre en relief une dimension émotionnelle qui restait auparavant marginale. Cette dimension est à la source de la catégorie « relationnelle » soulignée de manière paradoxale par les infirmiers rencontrés, formés depuis les années 1970. Désormais, elle concerne à la fois les professionnels dans leurs relations entre eux et dans celles qu’ils établissent avec les patients.
La formation infirmière est donc un exemple paradigmatique du processus qui produit une place nouvelle pour le travail relationnel et, se faisant, transforme les activités de l’intérieur. La tension d’abord posée entre valorisation des soins relationnels en institut et valorisation des soins techniques à l’hôpital s’expliquait par la difficulté à délimiter un territoire infirmier entre le « bras du médecin » et la « jambe de l’amputé ». Le travail « bras armé du médecin » pour traiter la maladie était placé en tension avec le travail d’accompagnement auprès de la personne malade[16]. Cette invisibilisation de l’articulation des sollicitudes centrée sur le traitement de la maladie et sur le « prendre soin » d’une personne caractérise encore le travail infirmier. La dimension relationnelle a d’abord émergé comme rôle « propre » dissocié du rôle sur prescription sur les terrains des soins et par là même peu pratiqué. Mais progressivement, le développement des techniques et les transformations sociales requiert son intégration au sein même du coeur de métier.
Cette mutation de la place de la dimension relationnelle dans sa relation au coeur de métier concerne plus largement l’ensemble des groupes professionnels consultants (Freidson,1984) dont les modèles de formation et l’organisation du travail se sont mis en place au cours du XXème siècle. À partir des modes relationnels cloisonnés et hiérarchisés dont ces acteurs disposent, ils n’adressent pas, ou mal, la continuité des conseils requis dans les situations les plus complexes. Les groupes professionnels sanitaires, social, médico-social et éducatifs se sont construit autour de coeurs de métier valorisés dans la mesure où ils rendaient possible la maîtrise ou le contrôle des processus dans une durée réduite et dans un espace clos. Lorsque cela n’était pas ou plus possible, le travail était délégué aux segments moins valorisés au sein d’autres espaces. Le développement des situations labiles, des va et vient entre différents espaces, et l’irruption de la contingence au centre des situations à adresser mettent à mal ces modèles clivés. Elles transforment de l’intérieur les coeurs de métier en remettant en question l’articulation de ces derniers aux dimensions relationnelles jusqu’alors reléguées, peu professionnalisées et mal reliées.
Conclusion
« Prendre soin », une question politique et sociale
La nature du travail soignant se transforme au cours du XXème siècle. Plus il contribue par son expertise scientifique et technique à sauver davantage de personnes malades de la mort, plus il participe à la production de nouveaux besoins. En effet, les malades sauvés ne sont pas toujours pour autant guéris. Ils vivent et vieillissent avec une ou plusieurs maladies chroniques qui requièrent souvent des traitements permanents et une transformation des habitudes de vie et des comportements. Ce processus rend nécessaire le développement de modes organisationnels moins cloisonnés entre les secteurs social, médicosocial, éducatif et sanitaire. Il tend ainsi à bouleverser des hiérarchies établies au cours du XXème siècle autour de la dominance du modèle curatif.
Les territoires se sont ainsi déplacés, de la médecine à la santé (prévention, éducation, guérison ou traitements). Les enjeux humains, financiers et professionnels de cette mutation, sont considérables. Ils suscitent des résistances à la mesure des transformations potentiellement induites. Conjointement, ce sont de nouveaux acteurs, jusqu’ici périphériques, par le biais de d’internet, de la création d’objets connectés, de plates formes, qui peuvent contribuer à faire bouger les lignes de ces transformations en cours. Ils introduisent de nouveaux schémas de relations, sous certains aspects, plus horizontales, entre acteurs. Mais ils agissent également sur la définition même du couple soigner/guérir et sur les organisations professionnelles qui lui sont associées. Comme le souligne Abbott, c’est l’arène du public qui devance les transformations des arènes législatives et de l’arène du travail. Jusqu’ici, les articulations et les mises en cohérence de ces différents espaces et marchés font peu l’objet de régulations politiques en France.
Depuis le début des années 2000, les pouvoirs publics introduisent la notion de parcours pour tenter d’adresser de nouvelles formes de continuité là où les trajectoires sont marquées par un risque croissant de discontinuité. Dans quelle mesure cette notion produira-t-elle des effets performatifs pour réorganiser les dimensions du contrôle/labilité des exercices professionnels sanitaires, sociaux et éducatifs ? L’étude des formations professionnelles de ces secteurs, selon la perspective que je développe ici dans la ligne d’Abbott, contribue à éclairer ces questions et ainsi, à rendre visible l’une des facettes de la notion de « prendre soin ».
Parties annexes
Notes
-
[1]
Dans le cas français, l’analyse gagne plutôt ici à considérer l’écologie représentée par les rouages administratifs au sein de l’Etat.
-
[2]
Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des infirmiers avant, pendant et après leur formation cadre et avec des cadres formateurs et cadres de terrain (entre 1999 et 2012), des infirmiers dont certains sont spécialisés et enfin, des stagiaires en formation. Les thèmes des entretiens sont les suivants : l’expérience vécue de la formation infirmière en tant qu’élève puis, le travail en tant qu’infirmier et enfin le travail réalisé au moment où l’entretien est mené. A partir de ce matériau, j’ai procédé à une démarche de codage (Yinn, 2009, Saldana, 2009) qui repose sur un travail itératif entre catégories produites par les professionnels, thématisations de ces catégories, puis retours vers les personnes rencontrées, les programmes et les rapports pour affiner, revoir, et compléter ces thématisations.
-
[3]
À partir de 1950, les recherches s’intensifient et favorisent l’émergence de concepts clés sur lesquels vont se fonder un grand nombre de théorie en soins infirmiers. Parmi ces théories, notons celles d’Hildegard Peplau (1952) qui insiste sur la relation Infirmier / patient qui a eu un impact surtout en psychiatrie, de Virginia Henderson (1955) qui est la première à formaliser une grille d’évaluation des capacités du patient, reprise et encore utilisée dans un très grand nombre de pays dont la France.
-
[4]
Le modèle identifie successivement les besoins suivants (B pour « besoin ») : : B1 = besoin de respirer, B8 = besoin d’être propre et de protéger ses téguments, B2 = besoin de boire et de manger, B9 = besoin de sécurité, B3 = besoin d’éliminer, B10 = besoin de communiquer, B4 = besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne position, B11 = besoin de pratiquer sa religion et d’agir selon ses croyances, B5 = besoin de dormir et de se reposer, B12 = besoin de s’occuper de façon à se sentir utile, B6 = besoin de se vêtir et de se dévêtir, B13 = besoin de se recréer, B7 = besoin de maintenir la température du corps, B14 = besoin d’apprendre.
-
[5]
Beauverger et al. rappellent que le cadre de référence de Virginia Henderson influence la pratique infirmière, en particulier en France à l’hôpital et en pratique libérale. « Le modèle de Virginia Henderson a été diffusé en 31 langues depuis 1960 par le Conseil International des Infirmières (CII). Il a été reconnu en 1990 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et sert de base à l’enseignement des soins infirmiers en France depuis 1972 ».
-
[6]
En France la grille d’Henderson est encore largement reprise par les formateurs sur les terrains des écoles pendant la période observée.
-
[7]
De ce point de vue, l’analyse d’Anne Piret (2004) sur l’apprentissage de la toilette en IFSI s’avère particulièrement instructive.
-
[8]
Cf. Arborio, 2001.
-
[9]
Nous devons manier ces chiffres avec prudence car ils sont très variables. Les chiffres de la DREES tendent à décrire davantage de stabilité moyenne tout en soulignant le manque de fidélité des données Adeli.
-
[10]
Pour Tronto (2009), la traduction du mot care suppose d’intégrer 4 phases qui relient en français les termes de sollicitude (identifier le problème ou le besoin et relever des moyens de l’adresser) et de soin (réalisation pratique du soin et vérification auprès de la personne qu’elle répond au besoin posé).
-
[11]
Le Décret et l’Arrêté du 18 août 1995 fonde le diplôme de cadre de santé sur la base une formation cadre qui est ouverte à l’ensemble des paramédicaux. Le décret d’août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé impose une formation sur 42 semaines et 6 modules : Initiation à la fonction de cadre ; Santé publique ; Analyse des pratiques et initiation à la recherche ; Fonction d’encadrement ; Fonction de formation ; Approfondissement des fonctions d’encadrement et de formation professionnels. Ces formations « maison » sont gérées et organisées par les institutions (APHP, Croix-Rouge française, unions d’hôpitaux régionaux). Elles se sont progressivement rapprochées de l’université par le biais de partenariats et conventions tout en demeurant autonomes.
-
[12]
J’ai développé cet aspect dans mon ouvrage (2013).
-
[13]
Depuis la loi du 31 mai 1978, la profession infirmière française est définie par deux rôles : un rôle sur prescription (médico-délégué) - qui constitue le lien hiérarchique entre l’infirmier et le médecin et repose sur la mise en application des prescriptions médicales et la surveillance des effets secondaires ou complications qui pourraient survenir - et un rôle « propre ». Le décret du 15 mars 1993 précise que relèvent du rôle propre infirmier les soins infirmiers liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ainsi, le rôle propre de l’infirmier est précisé aux articles R 4311-1 à R 4311-5 du code de la santé publique et ne se réfère pas au rôle délégué (par le médecin). Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier doit identifier les besoins de la personne, poser un diagnostic infirmier, formuler des objectifs de soins, mettre en oeuvre les actions appropriées et les évaluer. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son domaine de compétence.
-
[14]
En 2013, la position du CEFIEC qui réunit les cadres responsables de formation tend à interroger la pertinence de la réforme et du lien avec les universités.
-
[15]
Estryn-Behar, 2004.
-
[16]
Voir, à ce sujet mon livre publié en 2012.
Bibliographie
- Abbott A. (1988). The system of professions: an essay of the division of expert labour. Chicago, University of Chicago Press.
- Abbott A. (2003). « Ecologies liées » dans Menger Pierre-Michel (dir.) Les professions et leurs sociologies. Modèles théoriques, catégorisations, évolutions. Paris. Ed MSH.
- Arborio A.M. (2001). Un Personnel invisible, Les aides-soignantes à l’hôpital. Anthropos Economica. Coll. Sociologies. Paris.
- Barlet M. Cavillon M. (2010). La profession infirmière : situation démographique et trajectoires professionnelles. Document de travail, série Etudes et recherche. Drees. N°101.
- Belorgey N. (2010). L’hôpital sous pression, enquête sur le « nouveau management public ». Paris Ed La découverte.
- Berland Y. (2003). Rapport commission «Coopération des professions de santé : le transfert de tâches et de compétences» (premier rapport d’étape).
- Boittin Lagoutte, Lantz. 2002(Mars). Virginia Henderson : 1897-1996. Biographie et analyse de son oeuvre. Recherche en soins infirmiers. Pp 5-17. N°68.
- Bourgueil Y. L. Ulrike Durr. Gérard de Pouvourville. Sophie Rocamora-Houzard. 2002(Mars). « La régulation des professions de santé études monographiques. Allemagne. Royaume-Uni, Québec, Belgique, Etats-Unis ». Rapport final n° 22, DREES, série Etude et Document de travail n°462002.
- Cohen D. (2000). Profession infirmière, Une histoire des soins dans les hôpitaux du Québec. Les Presses de l›Université de Montréal.
- Com-Ruelle L. Midy F. Ulmann P. (2000). La profession infirmière en mutation, CREDES.
- Davis Fred. (1966). The nursing profession: five sociological essays. Wiley. New York.
- Diebolt E. Fouché N. (2011). Devenir infirmière en France, une histoire atlantique ? (1854-1938). Publibook. Sciences humaines et sociales, histoire contemporaine.
- Demazière Didier. Jouvenet Morgan (dir.). (2016). Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago. Volume 1. Paris. EHESS. coll. « En temps et lieux ».
- Ehrenberg A. (2005). « Agir de soi-même ». Revue Esprit. pp.200-209.
- Ehrenberg A., (2009). « L’autonomie n’est pas un problème d’environnement, ou pourquoi il ne faut pas confondre interlocution et institution » Comment penser l’autonomie ? Entre compétences et dépendances, Jouan Marlène. Laugier Sandra (dir.). Paris, PUF, pp 203-219.
- Ehrenberg A. (2010). La Société du malaise. Paris. Éditions Odile Jacob.
- Estryn-Behar M. (2O04). Enquête Prexnet Santé. Satisfaction au travail et abandon du métier de soignant. Etude européenne sur les conditions de travail des soignants, Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Paris.
- Feroni, Kober Smith (2005). La professionnalisation des cadres infirmiers : L’effet de l’action publique en France et en Grande-Bretagne dans Revue Française de Sociologie pp 469-494. 46-3.
- Freidson E. (1984). La profession médicale. Payot. Paris.
- Grosjean M., Lacoste M. (2010). Communication et intelligence collective, Le travail à l’hôpital. PUF. Paris.
- Henderson V. Colliere M.F. (1994). La nature des soins infirmiers. Interéditions.
- Henderson V. Nite G. (1978). Principes and practice of nursing, Macmillan US.
- Knibiehler Y. (2008). Histoire des infirmières en France au XXe siècle, Hachette littérature éd. Coll pluriel.
- Kober-Smith, A. (2010). Le système de santé anglais à l’épreuve des réformes managériales. Presses Universitaires de Rennes. Collection « Des Sociétés ».
- ODIS (Observatoire du Dialogue Social) (2002). Analyse du turn-over des infirmière(e)s en Ile de France. Rapport d’étude.
- Picot G. (2005). Le rapport social entre médecins et infirmières à l’hôpital public : un rapport social instable. Revue française des affaires sociales n°1.
- Piret A. (2004). Description et analyse des processus de socialisation corporelle en contexte de formation professionnelle : le cas de la formation en soins infirmiers, Doctorat en Sociologie. Université de Namur (Belgique)Faculté des sciences économiques sociales et de gestion.
- Reverby S. (1987). Ordered to Care: the dilemma of American nursing. New York : Cambridge University Press.
- Rothier Bautzer E. (2012). Entre Cure et Care, Les enjeux de la professionnalisation infirmière. Éditions Lamarre. Wolters Kluwer.
- Rothier Bautzer E. (2013). Le Care négligé. Les professions de santé face au malade chronique. Bruxelles. Éditions De Boeck.
- Rothier Bautzer E. (2014). Care et profession infirmière dans dossier thématique Care et professions de santé. Rubrique autour des mots. Revue Recherche et Formation (ENS, Ecole Normale Supérieure, Lyon). N°76 pp 93-106.
- Rothier Bautzer E. (2016). Une approche sociologique du soin comme travail relationnel in Journal International de Bioéthique (JIB) dossier « innovations pédagogiques et éthique en santé ». vol. 27. N°1 pp 41-59.
- Tronto J. (2009). Un monde vulnérable, pour une politique du Care, La Découverte.
- Véga A. (2000). Une ethnologue à l’hôpital. L’ambiguïté du quotidien infirmier. Paris. Éditions des archives contemporaines.