Résumés
Résumé
Comment incarner les devenirs-mères dans la pluralité et la complexité de ce que cela engage? Quels sont les statuts et états des paroles et des corps qui accompagnent les contingences des devenirs-mères? Quelles en sont les traversées lors de la périnatalité, l’accouchement et la maternité? Autant de questions posées par Valérie Gaudissart, metteure en scène de la compagnie Rêver Tout Haut, dans sa pièce Bercer l’enfant manquant (2021), créée à partir de témoignages de femmes s’exprimant librement sur ce qui est d’ordinaire tu ou nié, comme l’avortement, l’accouchement sous X, la dépression post-partum, la fausse couche, la césarienne, la procréation médicalement assistée ou encore l’adoption, ici traités sous le prisme de l’enfant manquant, idéalisé, non né, incréé, et qu’il s’agit dans cette contribution d’examiner.
Mots-clés :
- périnatalité,
- maternité,
- accouchement,
- devenir-mère,
- enfant
Abstract
How can we embody the plurality and complexity of motherhood? What are the statuses and states that accompany these contingencies of becoming mothers? What are the experiences of perinatality, childbirth, and motherhood? These are the questions raised by Valérie Gaudissart, director of the company Rêver Tout Haut, in her show Bercer l’enfant manquant (2021), created from testimonies of women expressing themselves freely about issues that are usually hushed up or denied, such as abortion, anonymous childbirth, post-partum depression, miscarriage, cesarean section, medically assisted reproduction and adoption. These topics are addressed here through the prism of the missing child (unborn, uncreated or even idealized).
Corps de l’article
Bercer l’enfant manquant, avec Sidonie Dubosc. Le Réservoir, Saint Marcel (France), 2019.
C’est donc la fragilité seule qui forme la demeure de l’impérissable dans le monde.
Seule la barque fragile de la voix humaine peut jeter son ancre dans le ciel.
Jean-Louis Chrétien, Fragilité
Qu’est-ce qu’être mère? Comment incarner les devenirs-mères dans la pluralité et la complexité de ce que cela engage? En quoi donner naissance n’implique pas systématiquement d’occuper la qualité de mère? Que reste-t-il des fantasmes d’une grossesse, d’un accouchement, d’une parentalité quand ils ne sont pas assouvis? Comment donner naissance à un être déjà mort? Comment porter un enfant autrement que par le ventre? Comment vivre une labilité émotionnelle, une dépression postnatale ou encore un émoussement affectif quand les moeurs et diktats imposent d’être en joie à la venue d’un enfant? Comment accepter d’être médicalement assistée? Comment parvenir à la résilience après des violences obstétricales? Comment aimer ce à quoi on a donné naissance alors même qu’il est vecteur de souffrance? Comment accepter que les fragilités ne soient pas des échecs, qu’un lâcher-prise ne soit pas la conséquence d’un abandon? Quels sont les statuts et états de la parole et des corps qui accompagnent ces contingences des devenirs-mères?
Ce sont précisément à ces questions que Valérie Gaudissart, art-thérapeute, autrice, réalisatrice et metteure en scène française de la compagnie Rêver Tout Haut a fait le choix de se confronter en s’engageant dans la création de Bercer l’enfant manquant[1] (2021), une pièce théâtrale et musicale axée sur les problématiques relatives aux liens entre mère et enfant. Cette contribution ambitionne de l’analyser pour interroger la mise en récit et en scène d’un théâtre de la naissance en gestation constante et ses poétiques de l’accouchement. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement ici d’un théâtre utérin – c’est-à-dire un théâtre mettant en lumière les figures de la matrice, du ventre ou de l’utérus, notamment par la « vaginisation[2] » (Mercier, 2019) de la scène –, mais plutôt d’un théâtre davantage relatif au nidus – c’est-à-dire enclin à mettre en lumière toute structure qui s’apparente à un nid ou en occupe les fonctions, ou encore ce qui relève d’un espace de reproduction (y compris des parasites) –, cette oeuvre explore ce sur quoi on fait silence lors de la périnatalité, de l’accouchement et des maternités, que ce soit par l’acte de porter un enfant ou compris étymologiquement par l’état de mère. Seront ainsi traités à la fois la procréation médicalement assistée (PMA), la fausse couche, la césarienne, l’amniocentèse, l’accouchement sous X, l’avortement, la dépression post-partum, l’adoption, etc., ainsi que l’ambivalence – souvent inattendue, déconcertante, immaîtrisable et fréquemment tue par les parents – des émotions, des états corporels, des pressions sociales, des injonctions médicales, des méprises et des doutes.
Le processus de création du spectacle, au croisement du théâtre documentaire et documenté, répondant d’une poïétique du glanage et du bricolage[3], sera d’abord abordé, en particulier par la focale de la fictionnalisation du réel et du texte-matériau. Ensuite, l’écriture dramatique sera interrogée sous le prisme des « non né·es[4] » (« unborn »; Kane, 2006 [2000] : 9) – terme employé par Sarah Kane dans 4.48 Psychose ainsi que dans l’aphorisme de Paul Klee[5] (1959 [1957] : 310) mis en exergue par Claude Régy (1999 : 3) – de l’incréé·e et de l’enfant manquant, c’est-à-dire celui qui n’est pas venu au monde : l’enfant idéalisé ou rêvé, l’enfant que nous avons été et celui enfoui, l’enfant dont l’ombilic n’a pas été coupé ou qui n’a pas vagi. Enfin, grâce à une analyse dramaturgique du texte dramatique Bercer l’enfant manquant, les devenirs-mères seront également examinés par les variations de l’expérience de l’accouchement et de la rencontre des deux regards d’une part, et par le partage des états de fêlure et de fragilité, au sens entendu par Francis Scott Fitzgerald (1981 [1936]) et Jean-Louis Chrétien (2017), d’autre part.
Poïétique du glanage et du bricolage des maternités, théâtre documentaire et texte-matériau de l’accouchement
L’objet de la compagnie Rêver Tout Haut s’axe sur quatre entrées combinées, à savoir une invitation « à dire par la création ce que l’on parle tout bas », « pour que l’imaginaire reprenne sens et vigueur dans le quotidien », « exprimer et transformer ce qu’il est difficile de dire et d’élaborer », « pour que se remette en mouvement la pensée » (Rêver Tout Haut, s.d.a). De sa poïétique à sa praxis, cette compagnie procède donc à des démarches à la fois sociales, politiques, culturelles et artistiques. Elle parvient à faire théâtre des histoires de chacun·e, à la fois en partageant des expériences in situ dans des institutions spécialisées, parmi les acteur·trices locaux·ales et parties civiles, en collectant la matière de ses créations à même la vie quotidienne, en sondant des thématiques sociales et politiques contemporaines et en récoltant des témoignages comme autant de réalités traversées par les personnes qui y sont confrontées.
Cette exploration poïétique commence dès 2008, par la conduite d’un atelier audiovisuel mené par Gaudissart à la maison d’arrêt des femmes de Dijon, et la sortie du court-métrage Les mains nues (2009) qui en découle l’année suivante. Elle s’affirme en 2011 par la création d’un spectacle de théâtre traitant des violences conjugales intitulé Les êtres humaines, écrit à partir de témoignages de victimes alors hébergées au centre d’accueil de la Résidence de l’Écluse de Chalon-sur-Saône et de travailleuses sociales oeuvrant à leur reconstruction et à leur émancipation. Plus que d’utiliser leurs paroles à des fins artistiques, il s’agit, dans une visée thérapeutique, de faire théâtre « par elles, pour elles et avec elles » (Gaudissart, entretien du 23 janvier 2023) et d’en expérimenter l’incarnation en les invitant à devenir à la fois autrices et interprètes. Ainsi, pendant trois ans, aux côtés de comédiennes professionnelles et d’un musicien, huit femmes mettent en corps et en voix leurs récits autofictionnels. « Convaincu.e.s de la nécessité de continuer dans cette veine qui relie les vécus, souvent douloureux, qui les transforme par la création artistique et les transmet, les fait entendre, les reconnaît, et pour quelque temps, les répare » (Rêver Tout Haut, s.d.b), les membres de la compagnie Rêver Tout Haut poursuivent des démarches similaires dans l’élaboration et la diffusion du projet Bercer l’enfant manquant.
Dans la lignée des investigations précédemment réalisées, les problématiques soulevées dans cette nouvelle création sont celles relatives aux liens entre mère et enfant; elles se déploient à partir de témoignages de femmes, de mères, de bénévoles d’associations d’innovations sociales, d’éducatrices spécialisées, d’assistantes sociales et de soignantes des unités de gynécologie-obstétrique et de soins psychiatriques, recueillis en 2015 et en 2016, pendant les résidences de création organisées à Chalon-sur-Saône. Outre les membres de la compagnie Rêver Tout Haut, ces dernières engagent plusieurs acteur·trices locaux·ales, professionnel·les ou bénévoles, et parties civiles, par la mise en place de partenariats pluriels, notamment avec le service de la maternité et le Centre de Péri-Maternité (CPM) du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, avec l’Unité mère-enfant (UME) et soins en néonatologie de celui-ci et avec le pôle Psychiatrie Infanto-Juvénile Départementale de l’Établissement public de santé mentale (EPSM). Soulignons également les nombreux partenariats avec des organismes sociaux, soit la Maison de quartier Plateau Saint-Jean (également responsable de La Maison verte, lieu d’échange et de pratique artistique); le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de l’Écluse; les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM); les services Enfance des communes et communautés de communes; le Réseau d’écoute, d’accueil et d’accompagnement de la parentalité (REAAP); la Caisse d’Allocations Familiales; les Lieux d’Accueil et d’Écoute de la Parentalité (LAEP); les centres de protection maternelle et infantile (PMI); les services de l’Aide Financière d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) du Conseil Départemental; les centres de planification et d’éducation familiale; les lieux de médiations familiales; le réseau de l’Équipe Pluridisciplinaire Intervention Crise Enfants Adolescents (EPICEA); les services et réseaux de travailleur·euses sociaux·ales; l’association Maman Blues; l’association À la Croisée des Chemins (fusionnée avec l’association Le Pont depuis 2020) qui lutte contre l’exclusion; et l’association Pêle-Mêle qui propose un soutien aux adultes en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.
En cela, le processus de création de la compagnie Rêver Tout Haut associe recherches scientifiques et études sur le terrain, objet investi et objectif de la recherche, lien social et soin, créations artistiques et médiation culturelle, spectacles vivants et transformations sociales. Bien qu’elles ne soient ni conventionnelles ni académiques, les démarches engagées sont comparables à celles entreprises dans une recherche-création d’une part, ainsi que dans celles d’une recherche-action d’autre part. Dans le premier cas, cela s’explique parce que les démarches sont effectuées « par l’artiste sur, ou à partir de, ses agirs créateurs » (Boutet, 2018 : 296), et parce qu’elles tendent à « la production d’un artefact ou événement original et inédit ainsi qu[’à] la production de connaissances à propos de celui-ci » (Paquin, 2020 : 1). Dans le second cas, les démarches obéissent aux principes de l’action research listés par Kurt Lewin (1939), notamment par une « action délibérée de transformation de la réalité; [leurs] recherche[s] ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations » (Hugon et Seibel, 1988 : 13).
Outre cette dimension, la compagnie Rêver Tout Haut déploie une poïétique du glanage et du bricolage. En effet, en abordant une thématique déjà traitée ou vécue par un·e autre, en amassant et collectant la parole de témoins, en rassemblant et en collant ces témoignages pour en faire dramaturgie, la compagnie renoue avec les sens à la fois étymologique et figuré du terme « glaner ». Elle en fait de même avec le terme « bricoler », en allant ici et là sur le territoire investi, en usant de certaines stratégies de la ruse dans l’écriture dramatique et scénique – telles que le processus de fictionnalisation du réel selon des degrés variables (Guay et Thibault, 2019), les « paraboles » (Sarrazac, 2002) et figures du « détour » (Sarrazac, 2004) – et en cherchant à réparer quelque chose par l’art-thérapie, par la sophrologie et par des actions sociales et culturelles. Enfin, concernant Bercer l’enfant manquant, la compagnie répond à une double poétique de l’accouchement, entendu dans son sens à la fois littéral et figuré et dans sa relation transitive ou intransitive. Il s’agit effectivement autant d’aborder le naître et le faire naître dans l’écriture dramatique et sa poïétique que de mettre en application l’expression familière et métaphorique « accoucher d’un fait ou d’un état » ou « faire accoucher quelqu’un » en racontant un événement, un souvenir ou une émotion malgré les résistances de cette personne ou en parvenant à lui faire verbaliser quelque chose non sans difficultés, comme c’est précisément le cas pour les personnes écoutées, témoins en scène de leurs propres histoires qui ont servi de matériaux dramaturgiques. À ce titre, Gaudissart précise : « Comme un enfant in-utero [sic] qui avant sa naissance est déjà porteur d’une histoire, la pièce a déjà une mémoire dont nous sommes dépositaires » (Gaudissart, 2019a : 6). Il s’agit pour elle d’en être l’accoucheuse, à la manière de ce qu’avance Philippe Avron : « On ne sait pas ses propres métamorphoses, on ne les connaît pas. C’est la chose la plus inconnue qu’on ait. Alors, il faut que quelqu’un nous aide. Être un accoucheur. Les metteurs en scène sont […] des accoucheurs. Ils vous aident. Je suis capable de faire ça, grâce à lui. Ils vous donnent la permission » (Avron, cité dans Carasso et Roy, 1999).
Ce faisant, cette création s’ancre dans une approche du « texte-matériau » (Sarrazac, 2005) d’une part et du « détour » (Sarrazac, 2004) d’autre part, notions définies par Jean-Pierre Sarrazac, tant elle mêle diverses sources et références (retranscriptions d’entretiens, paroles rapportées, journaux intimes des femmes, données médicales, écrits des ateliers, paroles de chanson, etc.), tout en se saisissant du réel par le « matériau historique quotidien » (Sarrazac, 1975 : 50), en mesurant l’« indispensable tension du mode de fiction choisi avec l’étude fragmentaire de notre situation historique dans ses strates essentielles, idéologique, économique, politique » (ibid. : 63). Obéissant à ce procédé, le théâtre de Gaudissart se situe à la croisée du théâtre documentaire et du théâtre documenté. En effet, il répond aux objectifs décrits par Jacques Rancière à propos du documentaire, c’est-à-dire qu’« il n’oppose pas le parti pris du réel à l’invention fictionnelle. Simplement le réel n’est pas pour lui un effet à produire. Il est un donné à comprendre » (Rancière, 2001 : 202). Par ailleurs, bien qu’il s’affranchisse du cadre formel établi par Erwin Piscator et Peter Weiss – à qui l’on accorde la parentalité historique du théâtre documentaire – le théâtre de Rêver Tout Haut fait « sur la scène un choix qui converge vers un thème précis, la plupart du temps social ou politique » (Weiss, 1968 : 8) et « ne représente plus la réalité saisie dans l’instant, mais l’image d’un morceau de réalité arraché au flux continu de la vie » (ibid. : 10). De facto, il s’apparente davantage au « néo-documentaire » conceptualisé par Lucie Kempf et Tania Moguilevskaia (2013), notamment en contribuant à l’expression libre sur scène d’une population invisible ou invisibilisée, inaudible ou censurée – en l’occurrence, dans Bercer l’enfant manquant, celle des femmes au sujet des tabous liés aux périnatalités, accouchements et maternités – tout en proposant une interprétation du réel, par réappropriation, subjectivité et fictionnalisation volontaires – ici dans le but de donner à ces histoires authentiques, bien que partagées par plusieurs, une résonance à la fois intime, sociale et politique et de permettre à d’autres femmes d’y trouver un écho. « Car tout n’est pas si facile, si rose, si naturel et les bouleversements traversés par les mères sont divers et universels. Et comme ils sont souvent tus, gardés secrets, il nous a semblé essentiel de les faire entendre, par ce spectacle » (Rêver Tout Haut, s.d.b), explique la compagnie. Comme l’exprime Kathrin-Julie Zenker dans son compte-rendu de l’ouvrage d’Hervé Guay et Sara Thibault (2019) portant sur les théâtres documentaires québécois,
[q]ue ce soit par la revendication d’une approche subjective […] ou par le jeu avec différents niveaux de fictionnalisation, par l’intégration de témoignages réels dans le corps du texte ou encore par l’invitation du public à participer activement à l’interprétation du réel (re)présenté, la création documentaire joue clairement un rôle d’éclaireur esthétique […]. Contrainte par des limites éthiques que lui impose le réel humain dont elle traite, elle se voit obligée de recourir à des solutions esthétiques innovantes, provoquant des percées formelles au sein de la création théâtrale en général (Zenker, 2021).
En ce cas, les témoignages des femmes rencontrées deviennent la matière première de l’écriture dramatique et scénique, matière qui informe (c’est-à-dire tout à la fois renseigne et donne forme) la dramaturgie par hybridation, montage, collage, recyclage des textes archivés ou produits pour l’occasion. Cela signifie que, par « rhétorique du prélèvement chirurgical d’un fragment dans le tissu du monde » (Métais-Chastanier, 2014 : 140) d’abord, puis par réappropriation et réagencement de ce dernier, les femmes témoins deviennent les « autrices-rhapsodes » de ce théâtre, pour reprendre le concept de rhapsodisation de l’écriture dramatique développé par Sarrazac : elles « pratique[nt] la vivisection, coup[ent] et cautérise[nt], cou[sent] et décou[sent] à même le corps du drame » (Sarrazac, 1999 [1981] : 40-41), drame qui n’est autre que le leur dans Bercer l’enfant manquant. En conséquence, Gaudissart, autrice du texte dramatique final, déplace la notion de geste rhapsodique pour que « vécus, témoignages et expériences se transforment sur scène et se transmettent » (Rêver Tout Haut, s.d.b) par le biais de l’enfant manquant.
Le motif de l’enfant manquant, non né, incréé
Bercer l’enfant manquant s’inscrit donc dans ce travail de création qui mêle théâtre, musique, accès à la culture et à l’imaginaire et nécessité du travail social et soignant. La compagnie conçoit en effet son travail comme une passerelle entre ces différents univers, estimant que c’est dans ces échanges que s’ouvrent les idées, circule la parole, tombent les clichés [et que ces échanges] viennent en aide à des situations compliquées, préviennent et prennent en compte des souffrances réelles. Utiliser le spectacle vivant comme un terrain d’expérimentation artistique et sociale, et comme un outil de médiation, telles sont les ambitions de la compagnie et des longs projets qu’elle met en oeuvre.
Valérie Gaudissart, Bercer l’enfant manquant
Dans cette pièce sont ainsi abordés l’échographie, la fausse couche, la mort in utero, l’enfant mort-né, la grossesse gémellaire, l’accouchement idéalisé, réel ou sous X, l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la césarienne, la naissance prématurée, la PMA, l’amniocentèse, la péridurale, la périnatalité en exil, la maternité à l’étranger, les malentendus culturels, la dépression post-partum, l’adoption, la première rencontre, etc., ainsi que les sentiments de protection, de responsabilité, de détresse, de culpabilité, de méprise, de dépendance, de lassitude, d’alexithymie, d’incompétence, de danger, d’angoisse de la mort, d’espoir et de joie, etc., comme autant d’états susceptibles de les accompagner par surgissements, souvent inattendus, déroutants, insaisissables, incontrôlables, et majoritairement tus ou niés par les personnes concernées ou leur entourage.
Nonobstant, si les histoires sont singulières, elles se déploient toutes, dans cette pièce, sous le prisme de la pluralité et complexité des devenirs-mères en mettant au jour les problématiques relatives aux liens entre mère et enfant, aux impacts qu’impliquent les situations ou états susnommés sur la filiation, la transmission et la maternité. C’est pourquoi la dramaturgie de l’oeuvre s’appuie sur un invariant, une figure résistante qui persiste malgré le manque qui la caractérise, ou justement par celui-ci, et qui affirme sa présence par son absence : l’enfant manquant, l’enfant idéalisé, non né, incréé.
À l’instar de Régy, qui affirme que « la part d’incréé fait partie de la création [et que] ce qui n’a pas été écrit est aussi dans l’écriture et c’est cette part là qu’il faut essayer de sonder et de capter » (Régy, cité dans Mariani, 2006), l’enfant incréé, inarticulé, voire impensé ou interdit hante la création de Gaudissart, au même titre que les « non né·es ». Si ce sont pour eux·elles qu’écrit Kane, et qu’il·elles motivent l’ardeur de Klee, chez Gaudissart, il·elles obéissent au statut de ceux·celles mis·es en lumière par Régy. Les enfants « non nés » sont ceux qui ne sont jamais venus au monde, ceux qui incarnent à la fois la vie et la mort, ceux qui rendent tangibles pour les naquis « la jouissance effrénée d’une vie fallacieuse et […] une peur de la mort complètement épouvantable » (Régy, cité dans Veinstein, 2002), ceux qui garantissent un « dépassement à l’infini », une « communication avec les autres et le monde », une ouverture à l’« univers entier » (Régy, 1999 : 97). Ils sont aussi l’infans éternel, c’est-à-dire celui qui n’aura jamais accès à la parole, dont le corps en sera déserté. Il s’agit de l’enfant qui jamais ne vagira, qui se perdra symptomatiquement dans une forme d’insignifiance, car l’ombilic n’aura pas pu être coupé, selon l’analyse réalisée par Denis Vasse dans L’ombilic et la voix :
La fonction symbolique de la clôture ombilicale […] conditionne le jeu de l’ouverture et de la fermeture de tous les « autres trous du corps ». […] Par le jeu de la voix qui lui interdit de se noyer dans sa propre image, le sujet se trouve franchir « la sphère du substantiel » pour advenir dans « la sphère subtile du langage » et l’articulation à la loi. Les enfants finissent par nous parler parce que quelqu’un a écouté. C’est à l’écoute de cette parole qu’en définitive nous sommes ici conviés (Vasse, 1974 : 288).
À ses côtés, l’enfant manquant est bercé dans la création de Gaudissart, tel que l’annonce le titre. Qu’il soit espéré, empêché, fantasmé, rêvé, idéalisé, regretté, enfoui, dénué, endormi, inerte, déchu, absent, disparu, mort, spectral, fruit de privation, d’insuffisance ou d’échec, ou encore celui que nous avons été, celui que nos parents ont été, l’enfant manquant, dans la pièce, revient nous visiter et regagne son berceau, son nid ou sa matrice pour y être apaisé, calmé, soulagé et s’y endormir. Il y imprègne sa silhouette ou y laisse son ombre. En cela, il est vecteur d’ambivalences et de paradoxes, car c’est précisément parce qu’il fait défaut que son image résiste, parce que son absence est (re)marquée qu’il affirme sa présence. Alors, comme l’invite Gaudissart, l’enfant manquant est aussi « celui qu’il faut parfois oublier pour pouvoir accueillir l’enfant réel » (Gaudissart, entretien du 23 janvier 2023) ou dont il faut accepter l’état, celui du manque, pour vivre sans hantise.
Quoiqu’il advienne, cet enfant représenterait ce que Patrice Pavis nomme « la toile de fond, la situation fondamentale, le cadre général à l’intérieur d’une unité narrative plus large » (Pavis, 2016 : 22), et en devient de fait le motif. Or il s’agit là d’un topos du théâtre, comme aime à nous le rappeler, par exemple, Georges Banu dans L’enfant qui meurt : motif avec variations (2010) ou encore Sandrine Le Pors dans « L’enfant qui nous regarde : persistances de l’enfance dans les écritures textuelles et scéniques » (2022). Par ailleurs, les présences et manifestations de cet enfant sont déterminantes pour l’écriture dramatique et scénique de Bercer l’enfant manquant, puisqu’il guide l’isotopie de l’oeuvre (Pavis, 2016) et permet le traitement de paradoxes, de situations taboues, d’états ambivalents, de relations problématiques et de devenirs-mères complexes, voire en légitime la mise en exergue, en dédouane les porteur·euses et en écarte le jugement. Dès lors, les enfants non nés, incréés et manquants s’envisagent comme des figures du « détour » (Sarrazac, 2004) et des points d’ancrage de la parole des femmes ou des mères dont ils creusent la béance, sans s’en faire néanmoins les relais. Bercer l’enfant manquant se conclut d’ailleurs sur ces paroles :
On a tous en nous un enfant manquant, on porte tous un enfant manquant
L’enfant manquant, c’est le petit dernier que nous n’avons pas fait, on s’est tâté, on le fait, on le fait pas, et puis finalement le temps est passé,
L’enfant manquant, c’est peut-être celui qui fait devenir grand-parent,
L’enfant manquant, c’est celui qui ne vient pas, qui résiste au désir de ses parents parfois pendant très longtemps,
c’est l’enfant que nous avons préféré ne pas avoir,
c’est l’enfant placé, l’enfant de la garde alternée
c’est l’enfant disparu en naissant
l’enfant manquant, c’est aussi l’enfant décevant, parce qu’il naît fille ou bien garçon et qu’on aurait aimé le voir différent
c’est l’enfant idéal que l’on s’était imaginé, confronté à l’enfant de la réalité
l’enfant manquant, c’est l’enfant qui nous aurait permis d’être meilleur parent
mais l’enfant manquant, c’est aussi l’enfant que nous avons été et que nous avons oublié mais qui parfois revient nous visiter,
l’enfant manquant, c’est l’enfant que nos parents ont été, que nos grands-parents ont été,
l’enfant manquant, c’est l’enfant que nous aurions pu être et qui aurait fait de nous des adultes différents... (Gaudissart, 2019b : 19).
Devenirs-mères : variation des expériences de l’accouchement et de la rencontre des deux regards
Dans la première scène de la pièce, intitulée « Merveille », l’enfant est littéralement sondé au cours d’un examen échographique mené par une gynécologue-obstétricienne qui commente en un monologue la manière dont elle perçoit à la fois le bébé et l’acte gynécologique qui confirme sa présence :
En salle d’échographie, on est dans le noir, dans la pénombre, […] ça fait comme un utérus en fait. […] Et moi j’adore l’échographie, on voit à travers le bébé, on le voit sourire. […] On dévoile un secret que seul Dieu a le droit de connaître. […] Il faut faire attention à ce qu’on dit dans une salle d’échographie […] parce que les parents commencent à se projeter, ils se mettent à rêver. […] Moi je pense qu’il vaut mieux être déçu à l’échographie qu’au moment de la naissance. Parce que j’ai vu des gestes..., c’est une fille, j’en veux pas. Eh bien, le bébé naît en voyant ce geste-là, et il le ressent très bien (ibid. : 1).
Par une quadruple traversée intime, le·la lecteur·trice entend d’abord les pensées de la gynécologue, puis pénètre l’intérieur de la salle d’examen, comparée à un espace utérin, puis l’utérus lui-même, et enfin franchi le charnel de l’être en gestation, rendu diaphane par la technique d’imagerie employant des ultrasons. Alors même que sa corporéité semble instable, voire spectrale, par son opalescence, le bébé est déjà sujet de convoitise – « Je suis toujours dans l’émerveillement, mais des fois je me dis, eh oh, c’est pas ton bébé! » (idem), dit aussi l’obstétricienne – et de projections, notamment genrées, des parents sur celui à naître. S’ensuit un théâtre anatomique quand la chirurgienne relate ses expériences de césariennes de la manière suivante : « J’adorais ouvrir, tu vois le bébé comme dans un hublot, comme dans une boule de neige […]. Les bébés, ils se doutent pas du tout qu’ils vont naître, ils sont complètement détendus » (idem).
L’accouchement par incision de l’abdomen et de l’utérus, régulièrement associé à un traumatisme psychologique et physique pour la mère, ou vécu comme un échec de ne pas avoir pu mettre au monde par voie basse, est ici examiné à travers le prisme de la « parabole » (Sarrazac, 2002), c’est-à-dire une « sorte de réalisme diffractant où l’objet est déformé pour être mieux vu, mieux saisi. Vision oblique qui, comme la métis des Grecs, est une ruse de l’esprit (et de l’art), une supériorité du regard en biais qui permet d’éviter d’être pétrifié par le réel » (Villeneuve, 2003 : 183). L’analogie établie entre l’organicité du corps incisé et une boule à neige participe à l’art du détour défendu par Sarrazac, entendu comme l’acte de « substituer, en somme, une problématique collective du détour, c’est-à-dire du retour de la fiction sur le réel, à la vision a-historique et individualiste du recul qu’un auteur prend sur la réalité » (Sarrazac, 1976 : 95). Selon le même procédé, seront ensuite abordés les gestes d’obstétrique, notamment ceux accompagnant une naissance par le siège ou l’usage de forceps, qui dans leurs descriptions sont semblables à une chorégraphie ancestrale, voire sacrée, réaxant le corps du bébé pour lui conférer la vie. À ce titre, la médecin confie : « Des fois tu sors de garde, mais t’es sur un nuage, c’est indescriptible, tu planes, tu es dans l’espace de la toute-puissance! […] Et je suis toujours autant émerveillée devant ces bébés qui naissent et qui savent tout, qui ressentent tout, non mais c’est dingue! » (Gaudissart, 2019b : 2.) La gynécologue-obstétricienne évoque ensuite l’enfant manquant tel que celui que nous étions, en associant l’accouchement de la mère à sa propre naissance et son accompagnement dans la sororité. Ainsi, dit-elle, « beaucoup de femmes appellent leur mère quand elles accouchent, c’est un moment très suspendu l’accouchement, où la femme est en contact avec sa propre naissance et peut-être avec celles de toutes les générations qui l’ont précédée » (idem).
La prise de parole de la sage-femme se clôt sur la douleur et la délivrance que représente, de manière à la fois littérale et figurée, l’accouchement, sur l’état bestial – bien que stéréotypé – qui métamorphose les femmes au moment de la poussée et sur la force qui les submerge – peut-être l’ardeur des êtres non nés évoqué par Klee. La sage-femme conclut : « Il y a une force incroyable surtout au moment de l’expulsion, avec des cris de bêtes, des cris qui viennent de très très profond, d’une énergie! Comment la décrire cette énergie, cette douleur? […] Je ne sais pas. Ce que je crois par contre, c’est qu’une naissance, c’est toujours une réparation » (idem).
Or le caractère mystérieux de l’enfant manquant, non né, incréé, ici esquissé, est repris et développé, dans la huitième scène, par une autre sage-femme qui tente d’y mettre des mots pour le rendre, si ce n’est intelligible car abscons, si ce n’est palpable car transfiguré, au moins imaginable dans le « partage du sensible » (Rancière, 2000) :
Les premiers accouchements que tu accompagnes, tu comprends rien. Je crois que si je fais ce métier de sage-femme, c’est pour approcher le mystère. […] Techniquement, scientifiquement, je comprends mais par contre pourquoi y’a des bébés qui arrivent et d’autres qui n’arrivent pas, pourquoi y’en a qui naissent alors qu’ils ne sont pas viables et pourquoi y’en a qui meurent avant de naître alors que tout se passait bien, pourquoi y’a des femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfants et d’autres qui en ont et qui n’en veulent pas et qui en ont sans arrêt? C’est pas que la conscience, on porte des choses qui sont inconscientes. Être relié à l’univers, c’est peut-être accepter de ne pas tout comprendre (Gaudissart, 2019b : 9).
La dimension démiurgique et la conscience spirituelle d’une connexion à l’univers insinuées précédemment par des questionnements philosophiques et existentiels, à portée tacitement heuristique, s’affirment dès lors qu’elle évoque la grossesse, l’accouchement et la rencontre avec le nourrisson. Est ici suggéré que la présence de l’enfant et ses caractéristiques en sont les manifestations :
Le bébé quand il arrive, il semble venir d’un monde flottant. C’est parce qu’il peut repartir. […] Ce qui m’étonne toujours, c’est que le bébé soit tout bien fini, tout bien fait, donc il a déjà une histoire, alors on se demande d’où il vient cet enfant. Parce que bon, deux cellules qui font deux quatre huit, oui d’accord mais il vient d’où? L’impression qu’il vient d’un autre monde, tu vois, qu’il porte en lui quelque chose de mystérieux, par son regard. […] C’est marrant, ce qu’on porte en nous, on ne le sait pas. Notre conscience des choses, elle est tellement petite (idem).
Cette théorie, elle l’applique également à ses propres enfants, dont elle constate ensuite le vieillissement. Bien que celui-ci soit un marqueur physique du temps qui passe, sa perception en est autre et la mise au monde est encore vive dans l’esprit et le corps de la mère, qui explique : « c’est perturbant la vitesse, y’a pas longtemps j’allais entrer en salle d’accouchement. […] Pour moi c’était hier, et là, il va se dégarnir » (idem). L’enfant nouveau-né se fait alors manquant et rappelle à la mère son propre vieillissement et sa disparition future, mais aussi le fait qu’en donnant la vie, elle a également donné la mort. « Quand tu donnes la vie, tu comprends que tu donnes tout ce qui va avec, y compris la mort. […] En fait, la maternité car c’est un travail sur la mort. […] Ça nous met face à la réalité, ça nous fait regarder la mort en face » (ibid. : 10), formule-t-elle.
Le regard dont parle la sage-femme de la huitième scène, celui qui défie la mort et réveille la fureur de vivre, est encore décrit dans la seizième. Une autre sage-femme relève sa qualité « mystique » :
Moi ce que j’aime dans les accouchements, c’est le regard. Le regard du bébé qui regarde sa mère dans les yeux à peine sorti de son ventre. Ce regard est très fort, on a cette rencontre, ce regard, c’est impressionnant. Et puis on a le regard du père parfois. C’est beau, c’est vrai que c’est beau. Y’a quelque chose, quoi. Des fois le bébé n’est pas désiré mais ce regard du bébé vers sa mère existe toujours. Alors est-ce que la maman va le chercher ce regard? Pas tout le temps. […] Les parents sont étonnés de ça, de la force de ce regard qui les agrippe. Et on a du mal à s’en détacher de ce regard. Ça surprend, ça interroge, y’a pas besoin de paroles. C’est magique, c’est mystique, et là on se dit, ah l’humanité peut avoir quelque chose de bien. La naissance, pour moi, c’est la rencontre de deux regards (ibid. : 16).
Ce regard se déploie dans un autre contexte : celui de l’adoption, qui demande aussi le tissage d’un lien d’attachement. La cinquième scène, « État civil », retrace le parcours dans lequel les parents s’engagent pendant « 9 mois, comme une grossesse » (ibid. : 6) pour devenir postulants à l’adoption. Paperasse administrative, enquête sociale et psychologique, rencontre avec les membres de la commission, écriture du projet d’adoption – pour « confirmer qu’on est bien à sa place » (idem) – y sont brièvement énoncées, avant que n’arrivent l’annonce de l’accueil de l’enfant manquant, sa rencontre et sa reconnaissance par l’action de regarder. La mère adoptive se souvient :
Elle m’a dit : un bébé vous attend. […] Je me rappelle que j’étais très calme, je lui ai dit bonjour, j’étais très calme. […] Le lien il a commencé à se faire quand on était ensemble à la maison tous les trois. […] Nous on a passé une semaine à le regarder. On s’est fait comme une grossesse en accéléré. Dans un[e] espèce de cocon. On faisait rien, il neigeait et on le regardait (ibid. : 6-7).
La puissance de la première rencontre des deux regards et son analogie à la naissance se réitèrent dans la dix-septième scène et se poursuivent par un premier souffle d’engagement dans la vie. Il y est rendu possible après un parcours prénatal complexe, ponctué de fécondations in vitro, d’inséminations artificielles, d’échecs multiples de PMA, d’une remontée du placenta, d’un alitement, d’une hémorragie, d’une hospitalisation, d’une amniocentèse, d’un monitoring alarmant, d’une détresse cardiaque, d’une césarienne, d’une prématurité, d’une réanimation, d’une couveuse, de tirages de lait répétés, etc. :
Il est là, il est minuscule, il est entier, il nous regarde. Il avait une manière de nous agripper avec ses yeux, il nous a tout de suite montré sa force, sa volonté et sa capacité d’être en relation. […] Mais il s’est passé une chose magique lors de cette première rencontre, le bébé en notre présence, il a fait ça, comme ça, avec sa main, il a rejeté le tube qui le faisait respirer. […] Le médecin lui a enlevé le tube pour respirer et du coup, on a entendu son premier souffle, son premier vrai souffle. Ça a été pour moi comme une deuxième naissance (ibid. : 17-18).
Qu’en est-il ou que reste-t-il alors des expériences de rencontre, des liens entre mère et enfant, des devenirs-mères et de leurs états quand les périnatalités, accouchements ou maternités se heurtent à l’insoupçonné et à l’imprévu, comme c’est précisément le cas ici?
Partage de l’intimité face à l’insoupçonné et l’imprévu : états de fêlure et de fragilité
L’importance du regard échangé, perçu comme indicateur d’un lien entre l’enfant et sa mère, est mise à mal dans la quinzième scène, intitulée « La petite cuillère », dans laquelle une stagiaire de l’Unité de jour, « Mère Bébé » de l’hôpital de Chalon-sur-Saône, destinée à l’accueil des parents et des bébés présentant des troubles du lien ou de dépression grave, accompagne une infirmière pour visiter une mère et sa fille pendant le déjeuner. Elle assiste à une scène de maltraitance, informulée car non conscientisée, de la mère envers son enfant pendant qu’elle lui donne à manger. Par usage de la figure textuelle relationnelle de « répétition-variation » (Vinaver, 2000 [1993] : 904), la stagiaire axe ses propos et son regard sur celui de la mère qu’elle observe et décrit comme impassible, inerte, inexistante et désaxée : « Sa mère regarde alternativement l’assiette et la bouche de sa fille. L’assiette et la bouche de sa fille. L’assiette et la bouche de sa fille » (Gaudissart, 2019b : 16). En revanche, l’enfant, lui, cherche désespérément le regard de sa mère : « La petite suit du regard le geste de sa mère » (idem). Comme le précise Le Pors en introduction de « L’enfant qui nous regarde », « [l]e théâtre sous l’oeil de l’enfant […], c’est au premier chef cet instant et cet espace où un enfant devient, si ce n’est le foyer d’un regard, un organe de concentration […] de la vision » (Le Pors, 2022 : 9).
La deuxième scène, intitulée « Hors de question », expose également une dépression post-partum, se présentant certes selon un autre contexte, degré et impact sur les personnages. Cette fois, elle conduit à l’abandon réfléchi d’un enfant, initialement conçu pour répondre non pas à un désir d’enfant ou de parentalité, mais à un désir de vie, dont le besoin s’est fait ressentir à la suite du décès de proches. Avec grande sincérité, clairvoyance sur son traumatisme, et cette fois-ci sans détours, la mère se confie dans un soliloque :
Je ne voulais pas d’enfant c’était hors de question, ça ne faisait pas partie de mes projets, ça ne m’intéressait pas, ça ne faisait pas partie de mon imaginaire, ça n’existait pas. Mais mes parents et mon petit frère sont morts dans un accident. Et 9 mois après leur décès, comme par hasard, j’ai voulu de la vie. Je ne peux dire que je voulais un enfant, mais je voulais de la vie. C’était un désir d’enfant mais c’était surtout un désir de remettre de la vie dans la famille. […] Et j’ai trouvé ça génial d’être enceinte, j’ai trouvé ça génial d’être mammifère, ça a fait du bien à tout le monde, c’était quelque chose de très positif après quelque chose de très compliqué. Mais ça a été compliqué (Gaudissart, 2019b : 2).
Dans un premier temps, l’enfant s’inscrit dans une dimension salvatrice et réparatrice d’un traumatisme pour la mère et représente la pierre d’achoppement de sa résilience. Mais, né d’une gestation de deuil de neuf mois, il porte en lui, bien que malgré lui, le poids des mort·es et des remords et « la gravité de sa conception » (ibid. : 3). Comme l’évoque sa mère : « Cet enfant est arrivé, […] je savais pas comment m’en servir, enfin m’en servir! Je savais à quoi il servait mais je ne savais pas comment faire. […] C’est pas que je l’aimais pas, c’était vraiment trop de choses » (idem).
D’après ces paroles, le lien d’attachement n’est pas tissé et la relation entre la mère et l’enfant n’est ni saine ni sereine, car il occupe, à son détriment, une fonction complexe de service, d’assistance et de soin aux yeux de sa mère. Or, si le bon développement psychique et affectif du nourrisson s’appuie sur une figure d’attachement et de soin, le processus semble ici inversé, puisque c’est l’enfant qui incarne cette figure pour sa mère. Consciente de ce déboire, elle prend la décision déchirante, dit-elle, de laisser son fils à son père et de ne pas en avoir la garde « pour vivre sa vie » (idem). Ce n’est qu’à l’adolescence que le fils exprime le souhait de retrouver son « berceau » (idem) en demandant à sa mère de retourner vivre avec elle, malgré les liens davantage fraternels qui les unissent. L’enfant est doublement marqué par le manque, qu’il porte et projette, car jamais il ne sera l’enfant convoité par sa mère; dans le même temps, il demeurera privé de sa figure maternelle. Cette scène s’achève sur la prise de conscience, à la fois fulgurante et détachée, de la mère qui admet :
J’ai eu une pensée horrible. Je me suis dit qu’en fait, d’avoir fait des enfants ça a été la plus grosse lâcheté de ma vie. […] C’est tellement facile de se sentir vivant en ayant des enfants. C’est trop facile. C’est une façon de se réaliser qui est évidente et qui ne dure qu’un temps et qui se fait sur le dos de quelqu’un d’autre, c’est tellement plus facile de s’occuper de quelqu’un d’autre (idem).
De la même manière, sans être nommée, la dépression postnatale est aussi narrée dans la sixième scène, mais s’inscrit cette fois dans un contexte radicalement différent et se manifeste tout autrement, notamment par émoussement affectif et anhédonie. Alors que ce nouveau personnage éprouvait une joie intense à l’annonce de sa grossesse, un potentiel problème aux reins de son foetus a été détecté, occasionnant la pratique opératoire d’une amniocentèse :
Donc je vous rappelle qu’on vous fait une amniocentèse. […] Le fait d’avoir entendu ces mots... ça a été un vrai choc. […] Et puis en fait, tout était normal, le bébé était normal. Mais moi je ne l’étais plus. Je n’arrivais plus à croire à l’existence de ce bébé. Ce bébé n’existait plus. Et je voyais le gouffre qui se trouvait devant moi. […] Mon grand espoir était que tout s’arrangerait quand le bébé serait né. L’accouchement s’est passé très facilement. J’ai compris très vite que mon bébé allait très bien, qu’il était très costaud, mais que c’est moi, qui n’allais pas bien du tout. J’arrivais à tout faire, je l’allaitais comme il fallait, je m’en occupais bien. Mais je ne ressentais rien pour lui. J’étais complètement vide, vide de sentiment. C’était mon enfant, je le savais, mais je le savais intellectuellement. Mais je ne ressentais rien. Un jour, je le promenais au parc dans sa poussette, y’avait du vent. Le bébé me regardait et je me suis dit : la seule chose que je suis capable de ressentir, c’est le souffle de vent dans mes cheveux (ibid. : 8).
Dans ce cas présent, bien que l’enfant soit né, il demeure incréé pour la mère depuis le « choc » de l’annonce d’une présumée anormalité et creuse une béance émotionnelle dont le champ lexical sera repris dans le discours par « effet-miroir » ou « écho » (Vinaver, 2000 [1993] : 903).
D’autres figures textuelles, notamment la liste et l’inventaire, portées par des discours monologués ou à l’aspect stichomythique, sont repérables dans la troisième scène, intitulée « Panique ». D’abord, un personnage, seul, s’applique à énumérer les choses qu’il reste à faire avant l’arrivée de l’enfant, comme s’il cochait sa to-do list :
Le papier peint, c’est collé?
C’est bon, c’est collé
La moquette, c’est aspiré, désinfecté?
Désinfectée
Le lit?
Il est monté
La table à langer?
Elle est repeinte
La poignée de porte tu l’as réparée?
Ce soir! juré?
Et le store, il descend
Oui il descend, et il remonte!
Les doudous, y’en a combien?
Y’en a six! quatre!
Bon alors, pour la valise? (Gaudissart, 2019b : 3.)
Il s’adresse à lui-même des réponses courtes aux questions rhétoriques et intérieures posées. Dans la pièce cohabitent ainsi non seulement un flux de paroles continu et débordant, mais aussi des régimes de phrasés cadencés et dissonants. Le personnage est ensuite rejoint par un autre avec lequel s’établit un faux dialogue, décousu, marqué de répliques flottantes de recensement d’éléments accumulés dans une valise, si bien que l’appareil énonciatif devient, à bien des égards, comparable à un catalogue ou un état des stocks d’un magasin de puériculture :
- La gigoteuse
- Le kit d’allaitement confort!
- Biberon valve anticolique,
- anti régurgitation,
- anti aérophagie
- Tétines 3 vitesses
- la baignoire qui maintient l’eau à la bonne température
- Cale bébé ergonomique
- Coussin morphologique
- Chaise haute évolutive
- Siège auto first class
- Babyphone visiophone, caméra additionnelle large portée
- chauffe-biberon de voiture
- le mouche bébé électronique
- le range goupillon
- Sucette anatomique, qui brille dans la nuit
- Le Système hygiénique de gestion de couches avec verrouillage rotatif
- La Tasse anti-dérapante
- Le Réducteur de WC
- Poussin ou coccinelle? (Ibid : 4.)
La fin de cet inventaire est ponctuée par l’irruption d’un troisième personnage, qui s’interroge : « Et les barrières de sécurité?? / Ah!! les barrières de sécurité! » (idem); il rompt et parasite ainsi le continuum dialogal construit à partir de l’effet de listage. Comme l’ont déjà examiné Bernadette Bost (2002), Sophie Milcent-Lawson, Michelle Lecolle et Raymond Michel (2013) ou encore Sandrine Le Pors (2016), la liste et l’inventaire représentent des « matériaux poétiques, narratifs ou dramatiques qui, obstinément, délient le drame et les éléments qui le composent (obéissant, sous leur impulsion, à une esthétique fragmentaire) mais aussi sont-ils ce qui lie ou relie, met en relation (couturant ensemble des éléments épars) » (Le Pors, 2016 : 110). Plus que de conduire à de « vibrants sursauts discursifs » (ibid. : 99) dans Bercer l’enfant manquant, l’effet de listage crée, d’une part, des figures textuelles relationnelles, comme le bouclage ou l’emboîtement et la fulgurance (Vinaver, 2000 [1993] : 903-904) et, d’autre part, des nuances, des associations ludiques d’idées incongrues, un recyclage de souvenirs, une fouille dans les archives d’images mentales, une revendication contre la consommation, des jeux langagiers, une frénésie de la parole, un rythme soutenu, une tension palpable, une fatigue physique et une dépense psychique, une impatience quant à l’enfant à naître. Cette dernière est substituée par l’énumération quand le manque de l’enfant est comblé par l’accumulation d’objets attestant déjà de sa future présence. Finalement, en attendant de pouvoir le bercer, les parents reproduisent inconsciemment ce balancement par la langue, et « listes, énumérations et inventaires produisent […] des ritournelles apaisantes » (Le Pors, 2016 : 99). « Avec la liste, qui relève toujours à la fois d’une restitution et d’un inachèvement, se cristallise ce qui est en train de naître à la fois dans le devenir et dans le déclin » (idem), comme c’est précisément le cas pour l’enfant manquant de cet acte. Dans le monologue qui s’ensuit, le·la lecteur·trice comprend combien la liste et l’inventaire, dans le format et le cadrage qu’ils impliquent, reflètent la psychologie du personnage de la mère qui en fait usage. Cette dernière exprime son besoin insatiable d’être dans le contrôle et la programmation de ses projets de vie, y compris quand elle choisit de la donner. Ainsi argumente-t-elle : « J’ai choisi d’avoir un enfant quand j’ai voulu. Tout était programmé dans ma tête. Dans la vie je me disais “il faut maîtriser”. Le travail le mari la maison le bébé. Je me suis décidée j’avais 28 ans. J’avais lu plein de bouquins, des tonnes de magazines. Je tombe enceinte tout bien comme prévu » (Gaudissart, 2019b : 4).
Là encore, la naissance et l’accouchement nous rappellent, s’il en était besoin, qu’il n’est pas possible de prévoir l’imprévisible et de maîtriser ce qu’il ne nous appartient pas de dominer. Aussi apprend-elle qu’elle vit une grossesse gémellaire. Les enfants manquants se dédoublent donc dans cette histoire. Outre le désarroi et l’affolement que cela provoque, elle observe avec désemparement sa transformation corporelle, subit avec impuissance la césarienne qui s’impose pour les extraire de son ventre et le tourment que représente la gestion de jumeaux :
Je pesais cent quatre kilos, j’avais la peau du ventre qui craquait, je voyais plus mes pieds. La beauté de la femme enceinte, je la cherche encore! Et en plus, ils étaient gros! Du coup césarienne! IIs ont dit : « On ouvre madame! » Je me débattais comme si je voulais me sauver. Quand je me suis réveillée j’ai vu une couveuse, avec une tête d’un côté et une de l’autre comme sur les cartes à jouer. […] Ils les emmenaient tous les soirs à la nursery. Je disais oui oui emmenez-les. Le matin, à 6 heures, quand j’entendais les roulettes du chariot, je me disais, oh non les revoilà! […] À un moment, ils m’ont dit : « c’est bon madame, vous pouvez rentrer chez vous »? j’ai dit « je peux pas vous les laisser? Je reviendrai les chercher plus tard » (ibid. : 4-5).
Dans ce récit monologué, la mère est à la fois porteuse de l’histoire qui se joue, narratrice de la fiction, actrice des événements, témoin de ses états et médiatrice des paroles rapportées du corps médical. Bien qu’absent·es en tant que personnages, les professionnel·les de la santé s’incarnent par la voix de la mère. Cela crée une rupture dans la situation d’énonciation et le discours direct, d’une part par l’apparition d’un « discours composite » (Vinaver, 2000 [1993] : 902) et, d’autre part, dans le déploiement de la fiction qui se déplace ailleurs, ouvrant un autre espace de parole et suscitant une écoute singulière de ce témoignage.
Si l’hypothèse de laisser le nourrisson a été émise par le personnage précédemment évoqué dans une parole échappée, elle est rendue effective dans la quatrième scène, intitulée « Sous X ». En effet, une sage-femme y relate deux souvenirs d’accouchement sous le secret. Ceux-ci ne présentent pas la mise au monde, mais les choix exposés pour l’abandon qui s’ensuit. Dans le premier cas, il y a réminiscence des visages et des noms – bien que l’anonymat soit respecté dans la pièce – et un partage sensible dans l’acte de laisser son nouveau-né, notamment par la mention faite d’une lettre écrite par la mère – « une petite jeune en études » (Gaudissart, 2019b : 5) – à sa destination. Dans le second cas, sont davantage étayées par paroles rapportées les raisons de l’abandon comme autant de facteurs pour porter un jugement négatif à son endroit. Malgré elle, la sage-femme porte un tel jugement sur cet acte avant d’avoir le recul nécessaire pour l’accepter, en reconnaître les motivations, voire la bienveillance :
C’était un 4ème bébé et elle me dit, […] on est au chômage tous les deux, on n’a pas d’argent, je veux accoucher sous X. Je me dis « elle a gardé les 3 autres et celui-là, elle le garde pas ». […] Quand j’ai commencé mes études, ces mamans, je leur en voulais : comment on peut abandonner son bébé? Et puis y’a une sage-femme qui m’a dit, « mais c’est le plus bel acte d’amour qu’elles puissent faire ». Alors […] j’ai compris. […] Et d’ailleurs le terme d’abandon n’est pas juste. Parce que ces femmes, elles ont un projet pour ce bébé, elles lui souhaitent quelque chose de meilleur. L’enfant qui nait sous X, c’est drôle, il est très calme, il pleure jamais, c’est comme si il savait qu’il devait se faire oublier (ibid. : 6).
Bien que la situation ne soit en rien comparable avec celle partagée dans la septième scène, consacrée à l’IVG, la figure textuelle du « plaidoyer » (Vinaver, 2000 [1993] : 903), ou plutôt de l’aveu, s’y retrouve. La désormais vieille mère, ayant « l’âge d’être grand-mère maintenant » (Gaudissart, 2019b : 8), dévoile son secret quarante ans après l’avoir vécu. Elle explique : « j’y pense souvent, c’est quelque chose qui est là tout le temps, et pourtant c’est pas un regret, pas du tout » (idem). Elle révèle ainsi son avortement, dont la pénibilité ne se situe pas là où on l’attendrait, puisque cette reconnaissance s’accompagne d’une confidence – celle d’un autoavortement :
L’avortement pour moi, c’était pas une décision, c’était pas un choix. C’était un empêchement. Un empêchement de vivre. Quelque chose en moi ne pouvait pas vivre et la personne qui ne pouvait pas naitre, qui ne pouvait pas être vivante, c’était moi. […] J’ai avorté de moi-même en quelque sorte. Enfin je ne peux même pas dire, j’ai avorté, mais je dirais plutôt ça a avorté. Et quand j’ai été mère plus tard, mère d’une enfant vivante, […] je me suis di[t], mais cette enfant-là que je tiens dans mes bras, c’est le premier ou c’est le suivant? Je n’ai pas la réponse à cette question (ibid. : 8-9).
Il n’est pas précisé si l’IVG réalisée est instrumentale ou médicamenteuse, et il n’est fait mention d’aucune indication sur le stade de la grossesse. Quoiqu’il en soit, l’intervention consiste à aspirer ou expulser l’oeuf en dehors de son lieu de nidation. De surcroît, c’est précisément ce qu’endurent les femmes lors de la mort foetale in utero[6], alors même qu’il ne s’agit indéniablement ni d’une contextualisation identique à l’avortement ni d’une traversée d’états comparable. Dans les deux cas, la femme sera médicalement considérée comme primigeste, tout en demeurant nullipare[7]. La neuvième scène, intitulée « Le coeur muet », décrit l’une de ces expériences comme suit : « J’entendais que mon coeur, pas le coeur rapide du bébé. Donc j’ai compris qu’il était mort. […] Et puis trois jours plus tard, j’ai accouché de ce bébé-là. […] Et puis on m’a fait passer une échographie pour vérifier et on m’a dit, “c’est bon, y’a plus rien”. Mais moi, j’ai cru voir le bébé sur l’écran » (ibid. : 10). Dans cette scène, l’enfant manquant résiste à son décès par persistance rétinienne. Sa sur-vie est notifiée par son image, même si elle n’est que spectrale. Par elle, il est (re)mis au monde. Le statut du motif de l’enfant y est cependant incertain, car, bien que mort, il n’est ici ni entièrement incréé, ni pleinement manquant, ni même vraiment né. Toutefois, la mort a bien été enfantée. Cela induit implicitement des questionnements relatifs au seuil déterminant le fait de devenir mère : quand est-on mère? Quand l’enfant paraît? Quand on le porte? Quand on le conçoit? Dès lors que le désir de l’être s’exprime? Quand celui-ci devient une obsession? Quand on se l’imagine? Quand l’entourage en fait la projection sur nous? Alors même qu’on se refuse à l’être? La problématique de cette fluctuation statutaire, que ce soit pour l’enfant ou pour la mère, est également posée par l’aide-soignante dans la scène suivante quant aux enfants mort-nés : « Ces enfants-là, ils ne sont pas vraiment nés. Ils n’ont pas d’acte de naissance. Ils ont un acte d’enfant né sans vie. Donc ils ne sont jamais nés en fait, puisque naître, c’est naître à la vie » (ibid. : 11).
Lorsqu’elle n’est pas visuelle, comme dans le cas précédent, la persistance de la présence de l’enfant in utero peut se révéler et se fixer par les autres sens qui nous relient à la vie et assurent la perception du monde qui nous entoure. Par sensorialité foetale et mémorisation des perceptions sensorielles reçues, le foetus puis le nourrisson peuvent éprouver la vie extra-utérine et reconnaître les éléments déjà touchés, ouïs ou goûtés. Réciproquement, il est possible de sentir l’enfant in utero, même après sa sortie du nidus, par hyperosmie (sensibilité accrue aux odeurs) et haptonomie (communication basée sur le toucher affectif) notamment, comme en témoigne la douzième scène, écrite à partir de faits scientifiques :
Il parait que les premiers sons que le bébé entende, c’est des ondes qui passent quand la maman touche son ventre; et il semblerait que quand la maman touche son ventre, le bébé boive du liquide amniotique. Et le liquide amniotique, c’est pas pour se nourrir, c’est pour le goût, il est parfumé de ce que la mère aime manger. Le bébé boit pour découvrir ce que sa mère aime manger. Ça crée déjà un lien. Je me souviens de l’odeur du liquide amniotique sur mes doigts. Ça sent le bébé frais. L’odeur elle disparaît après. Je me souviens d’une fois, j’ai dit venez voir les filles, ça sent le curry dans la salle d’accouchement! Le bébé il était déjà tout imprégné (ibid. : 12).
Cette traversée de l’intime à l’extime s’envisage dans les deux sens et participe, dans cette scène, d’une traversée des continents par une « périnatalité hors de son berceau culturel et une maternité exilée » (Gaudissart, 2019a : 3). Le personnage y évoque la difficulté
d’accoucher d’un enfant hors de sa culture, parce qu’elles sont seules ces femmes exilées quand elles accouchent. […] Elles ont des rites qu’on ne comprend pas et qu’on ne leur permet pas de faire. […] Et nous, on arrive avec nos habitudes qu’on impose, nos trucs organisés, on est sûr d’avoir raison et du coup on leur renvoie une image de mauvaise mère (Gaudissart, 2019b : 13).
Au-delà des malentendus provoqués, des privations engendrées et de la solitude vécue, c’est la maternité qui est remise en question. L’affirmation de l’identité culturelle se décèle à la fin de la scène par l’insertion d’une chanson traditionnelle. Ce moment chanté crée un « micro-drame périphérique » (Le Pors, 2011 : 181), comme l’envisage Le Pors, et une « situation d’insularité pour le personnage », « à la fois isolement du personnage et fragmentation interne du “moi” » (Issartel, 2020).
Outre cela, l’incursion de la chanson est utilisée à plusieurs reprises dans la pièce et s’impose dans plusieurs scènes uniquement construites à partir d’elle, comme la onzième intitulée « Je m’en bats les couilles », ainsi que les scènes treize « Mon oncle », quatorze « Motivée » et dix-huit « Décharges d’émotions ». Elle s’envisage à la fois dans l’interdisciplinarité, dans son ouverture à d’autres formes non textuelles et objets hybrides, tout en préservant sa spécificité et sa singularité, en particulier par la séparation de l’espace-temps alternatif dans laquelle elle déploie, au coeur du drame, un espace de revendications. Le caractère dialectique de l’écriture se manifeste dès lors dans l’hybridité convoquée et l’incursion de nouveaux langages.
Quel que soit l’espace-temps créé ou renouvelé, dans la pièce Bercer l’enfant manquant s’ouvre un laboratoire de la parole et du corps dans lequel se dévoilent des états de fragilité et de fêlure qu’il ne s’agit ni de nier ni de juger, mais d’accompagner et de révéler, voire d’embellir, à l’instar du kintsugi, art japonais ancestral signifiant littéralement « jointure d’or » (de kin, « or » et tsugi, « jointures ») pratiqué depuis le XVe siècle. Loin de la faiblesse ou de la vulnérabilité – fruits de tous les poncifs bien trop souvent attribués à la femme enceinte ou accouchante et de celle presque mère ou nouvellement mère –, la pièce investit un « lieu commun », soit celui de la fêlure et de la fragilité tel que l’aborde Jean-Louis Chrétien : « ce n’est pas moi, ici, qui me brise ou m’effondre (même si cela peut en être la conséquence), mais le sol sur lequel je me tenais, les conditions d’existence que j’avais considérées comme acquises, et qui définissaient mon rapport habituel au monde et ma place en lui » (Chrétien, 2017 : 7). Autrement dit, les témoignages des femmes et leur mise en récit éclairent ceux·celles qui les écoutent sur les possibilités de se briser, parce que « sous [leurs] yeux se réalisent l’improbable, l’invraisemblable et même souvent l’impossible » (Fitzgerald, 1981 [1936] : 136). Les états traversés sont autant de sens de l’existence qu’il s’agit de transmettre sans nécessairement y porter un jugement ou une critique. Dès lors s’y enracine un partage de l’intime, de l’indicible et du sensible que la scène sera chargée d’explorer, de poursuivre, voire d’accentuer.
***
Pour conclure, par une poïétique du glanage et du bricolage, la compagnie Rêver Tout Haut donne la parole à ceux·celles qui ne l’ont pas / plus et invite ainsi les parties invisibles ou invisibilisées, inaudibles ou censurées de la société à s’exprimer (parfois directement sur scène). Outre le caractère heuristique de ces poïétique et praxis, s’engage un regard phénoménologique porté sur soi par les témoignages qui en résultent, leur réécriture dramatique et leur mise en voix et en corps. Recelant des potentialités dramaturgiques, voire théâtrales, ils révèlent des poétiques – en l’occurrence celles de la naissance et de l’accouchement dans Bercer l’enfant manquant – qui imprègnent le texte-matériau. L’écriture de Gaudissart participe à la mise en récit et en dialogue des devenirs-mères dans les variations des expériences, des rencontres et des états qu’elles traversent par les motifs de l’enfant manquant, incréé et non né qui, dans la création, se rencontrent. De fait, du processus de création à la réception, Rêver Tout Haut s’inscrit dans cette pensée de Sarrazac :
Ce qui, dans la vie, est trop vite entendu, doit être montré au théâtre dans ce que le regard perd de ce « vite entendu »; ce qui est vite vu, on doit pouvoir faire en sorte que l’oreille y devienne attentive. [...] Comment rendre les gens, en l’occurrence le public de théâtre, attentifs aux choses importantes, pour en revenir une fois de plus […] aux comportements et […] à leurs chutes? (Sarrazac, 1976 : 95.)
À cela, Gaudissart choisit de répondre par l’écriture d’une « pièce-paysage » (Vinaver, 2000 [1993]) dans laquelle chaque témoignage devient une scène à part entière : par un dispositif scénique frontal et intime; par un espace scénique « utérin, qui permet la réflexion, le voyage dans ses propres sensations et souvenirs, et l’apaisement en même temps » (Gaudissart, 2019a : 6); par l’interdisciplinarité, impliquée par le théâtre documentaire et le texte-matériau d’une part, et le recours à la musique, au chant, aux objets scéniques, à la marionnette au plateau d’autre part; par une adresse à tous les publics (spectacle à partir de douze ans); par une diffusion dans des lieux destinés ou non initialement aux arts de la scène; et enfin par des actions de médiation en direction des mères, des enfants et des institutions spécialisées. En cela, elle parvient à faire théâtre, là où on ne l’attend pas, des histoires de chacun·e, à partir d’éléments initialement non dramatiques – mais indéniablement à qualité théâtrale. En définitive, le théâtre des naissances et les poétiques d’accouchement déployés par Gaudissart dans Bercer l’enfant manquant s’apparentent à ceux examinés par Régy et y trouvent écho :
Qu’on travaille avec la volonté de rendre compte de toute la masse de désespoir contenue dans le simple fait de vivre, mais aussi dans le fait de vivre justement dans l’humanité et les sociétés d’aujourd’hui. […]
Chaque expérience qui se crée entre les gens qui sont là, les sons qu’on entend, et les volumes qu’on voit dans la lumière, c’est une chose tout à fait nouvelle, qui n’existe que là et n’existera plus.
C’est la beauté de l’éphémère, suspendu comme de la poussière.
Filmage interdit.
On m’a beaucoup dit que ce que je faisais n’était pas du théâtre. Mais quelle importance que ce soit du théâtre ou pas. D’autres ont pensé, au contraire, que c’était peut-être l’essence du théâtre.
Et si le théâtre n’était pas du tout où on l’attend (Régy, 1999 : 97-98).
Parties annexes
Note biographique
Amandine Mercier est maître de conférences en arts de la scène et du spectacle vivant à l’Université d’Artois – pôle d’Arras et membre de l’équipe Praxis et esthétique des arts – Textes et Cultures (EA 4028). Le premier volet de ses recherches s’attache aux dialogues des arts et aux orientations majeures d’une scène considérée comme lieu de fabrique des origines en tant qu’espace de l’ob-scène. Le deuxième volet de ses recherches porte sur les politiques culturelles alternatives d’innovation culturelle et sociale. Elle est notamment l’autrice de « Sur le concept du visage du fils de Dieu de Castellucci : puissances de récits médiatiques, source d’un scandale et du spectacle dans les rues », paru dans l’ouvrage Violences et radicalités militantes dans l’espace public en France des années 1980 à nos jours (2019), codirigé par Béatrice Fleury et Jacques Walter; « Emboîtement, effacement et exaltation des corps dans les mises en scènes d’Ilka Schönbein » (2020) dans la revue A.R.T.S., dirigée par Dominique Traoré; « Livre-cadavre : corps stigmatisés et langue de la scène dans le théâtre de Romeo Castellucci » dans « Corps scéniques, textes, textualités » (2019), dossier de la revue Percées codirigé par Louis Patrick Leroux et Catherine Cyr; « L’enfant errant et l’errance de l’enfance du “Teatro Infantile” de Chiara Guidi » dans « Crianças performers » (2023) de la Revista brasileira de estudos da presença; « Le corps scénique : incarnation dramaturgique du pouvoir dans l’Orestie de Romeo Castellucci » dans « Body and Power in the Performing Arts » (2023), dirigé par Tarik Abou Soughaire.
Notes
-
[1]
Puisque le texte dramatique Bercer l’enfant manquant n’est ni publié ni diffusé publiquement, l’autrice a accepté de m’en transmettre une version datant de juin 2021 après un entretien réalisé avec elle le 23 janvier 2023.
-
[2]
L’emploi de ce terme est proposé pour qualifier l’action de devenir un vagin.
-
[3]
Sur ces notions, je vous renvoie à ma thèse de doctorat (Mercier, 2019).
-
[4]
« Juste un mot sur une page et c’est le drame / J’écris pour les mort·es / les non né·es / Après 4.48 je ne parlerai plus jamais » (« Just a word on a page and there is the drama / I write for the dead / the unborn / After 4.48 I shall not speak again »; Kane, 2006 [2000] : 9). Cette citation a été traduite par mes soins.
-
[5]
« Mon ardeur est plutôt de l’ordre des morts et des non-nés [sic] » (Klee, 1959 [1957] : 310).
-
[6]
Médicalement, la mort in utero et la fausse couche sont à différencier. Dans le premier cas, l’embryon décède d’une mort naturelle in utero. Dans le second, il y a décrochement de l’oeuf.
-
[7]
« Primigeste » est un terme médical désignant une femme ayant déjà été enceinte. « Nullipare » désigne une femme qui n’a jamais accouché ou dont la parité est nulle, c’est-à-dire que sa grossesse n’a pas donné lieu à l’accouchement d’un enfant vivant. Si cela avait été le cas, le terme « primipare » se serait appliqué.
Bibliographie
- BANU, Georges (dir.) (2010), L’enfant qui meurt : motif avec variations, Paris, L’Entretemps, « Champ théâtral ».
- BOST, Bernadette (2002), « Listes et inventaires dans les textes dramatiques contemporains », Études théâtrales, nos 24-25, p. 18-27.
- BOUTET, Danielle (2018), « La création de soi par soi dans la recherche-création : comment la réflexivité augmente la conscience et l’expérience de soi », Approches inductives, vol. 5, no 1, p. 289-310.
- CARASSO, Jean-Gabriel et Jean-Noël ROY (1999), Les deux voyages de Jacques Lecoq, Paris, On Line Productions; Montreuil, Association Nationale de Recherche et d’Action théâtrale.
- CHRÉTIEN, Jean-Louis (2017), Fragilité, Paris, Minuit, « Paradoxe ».
- FITZGERALD, Francis Scott (1981 [1936]), La fêlure, trad. Suzanne V. Mayoux et Dominique Aury, Paris, Gallimard, « Folio ».
- GAUDISSART, Valérie (2019a), « Bercer l’enfant manquant : pièce de théâtre sur les liens mère / enfant et médiation. Dossier de présentation », Rêver Tout Haut, www.revertouthaut.fr/bercer-l-enfant-manquant-dossier.pdf
- GAUDISSART, Valérie (2019b), Bercer l’enfant manquant, manuscrit inédit.
- GUAY, Hervé et Sara THIBAULT (dir.) (2019), L’interprétation du réel : théâtres documentaires au Québec Montréal, Nota bene, « Études culturelles ».
- HUGON, Marie-Anne et Claude SEIBEL (dir.) (1988), Recherches impliquées, recherches action : le cas de l’éducation, Bruxelles, De Boeck Université.
- ISSARTEL, Ariane (2020), « Chant et chansons au théâtre : des insularités “incomparables” », TRANS-, no 25, journals.openedition.org/trans/3722#
- KANE, Sarah, (2006 [2000]), 4.48 Psychosis, Londres, Methuen.
- KEMPF, Lucie et Tania MOGUILEVSKAIA (2013), Le théâtre néo-documentaire : résurgence ou réinvention?, Nancy, Presses universitaires de Nancy.
- KLEE, Paul (1959 [1957]), Journal, trad. Pierre Klossowski, Paris, Grasset.
- LE PORS, Sandrine (2022), « L’enfant qui nous regarde : persistances de l’enfance dans les écritures textuelles et scéniques », Études théâtrales, no 71.
- LE PORS, Sandrine (2016), « Que souffle la liste sur son passage? Énumérations et effets de listage dans les écritures théâtrales pour la jeunesse », dans Isabelle De Peretti et Béatrice Ferrier (dir.), Théâtre d’enfance et de jeunesse : de l’hybridité à l’hybridation, Arras, Artois Presses Université, « Études littéraires », p. 99-110.
- LE PORS, Sandrine (2011), « Le théâtre contemporain et la chanson », dans Guy Freixe et Bertrand Porot (dir.), Les interactions entre musique et théâtre, Paris, L’Entretemps, « Les points dans les poches », p. 172-186.
- LEWIN, Kurt (1939), « Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods », American Journal of Sociology, vol. 44, no 6, p. 868-896.
- MARIANI, Diphy (2006), « Claude Régy : “La part d’incréé fait partie de la création” », entretien avec Claude Régy mené par Laure Adler, À voix nue, 13 juillet, www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-voix-nue/claude-regy-la-part-d-incree-fait-partie-de-la-creation-4136862
- MERCIER, Amandine (2019), « Transfiguration, disruption de l’ob-scène et engendrement des corps : les scènes contemporaines comme lieu de fabrique des origines », thèse de doctorat, Valenciennes, Université Polytechnique Hauts-de-France.
- MÉTAIS-CHASTANIER, Barbara (2014), « Ceci n’est pas une fiction : stratégies documentaires dans le théâtre contemporain », dans Alison James et Christophe Reig (dir.), Frontières de la non-fiction : littérature, cinéma, arts, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Interférences », p. 129-140.
- MILCENT-LAWSON, Sophie, Michelle LECOLLE et Raymond MICHEL (dir.) (2013), Liste et effet liste en littérature, Paris, Classiques Garnier, « Rencontres ».
- PAQUIN, Louis-Claude (2020), L’articulation de la recherche à la création, lcpaquin.com/Ecriture/Ecriture_articulation_RC.pdf
- PAVIS, Patrice (2016), « Thèses pour l’analyse du texte dramatique », dans L’analyse des textes dramatiques : de Sarraute à Pommerat, Paris, Armand Colin, « U », p. 11-35.
- RANCIÈRE, Jacques (2001), La fable cinématographique, Paris, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle ».
- RANCIÈRE, Jacques (2000), Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, La Fabrique.
- RÉGY, Claude (1999), L’ordre des morts, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, « Comment te dire ».
- RÊVER TOUT HAUT (s.d.a), « Rêver Tout Haut », www.revertouthaut.fr/rever-tout-haut
- RÊVER TOUT HAUT (s.d.b), « Historique », www.revertouthaut.fr/historique.html
- SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.) (2005), Lexique du drame moderne et contemporain, Belval, Circé, « Poche ».
- SARRAZAC, Jean-Pierre (2004), Jeux de rêves et autres détours, Belval, Circé, « Penser le théâtre ».
- SARRAZAC, Jean-Pierre (2002), La parabole ou L’enfance du théâtre, Belval, Circé, « Penser le théâtre ».
- SARRAZAC, Jean-Pierre (1999 [1981]), L’avenir du drame, Belval, Circé, « Poche ».
- SARRAZAC, Jean-Pierre (1976), « L’écriture au présent : nouveaux entretiens », Travail théâtral, nos 24-25, p. 82-102.
- SARRAZAC, Jean-Pierre (1975), « L’écriture au présent ou l’art du détour », entretiens avec Georges Michel, André Benedetto et Xavier Pommeret, Travail théâtral, nos 18-19, p. 55-85.
- VASSE, Denis (1974), L’ombilic et la voix : deux enfants en analyse, Paris, Seuil, « Champ freudien ».
- VEINSTEIN, Alain (2002), « Claude Régy : rencontre en Avignon », entretien avec Claude Régy et Jean-Claude Ameisen, Surpris par la nuit, 13 juillet.
- VILLENEUVE, Rodrigue (2003), compte-rendu de Jean-Pierre Sarrazac, La parabole ou L’enfance du théâtre, L’Annuaire théâtral, no 33, p. 183-185.
- VINAVER, Michel (dir.) (2000 [1993]), Écritures dramatiques : essais d’analyse de textes de théâtre, Arles, Actes Sud, « Babel ».
- WEISS, Peter (1968), « Notes sur le théâtre documentaire », dans Discours sur la genèse et le déroulement de la très longue guerre de libération du Vietnam illustrant la nécessité de la lutte armée des opprimés contre leurs oppresseurs, trad. Jean. Baudrillard, Paris, Seuil, p. 7-15.
- ZENKER, Kathrin-Julie (2021), « Le réel vu à travers l’oeil du théâtre », Percées, no 5, percees.uqam.ca/fr/article/le-reel-vu-travers-loeil-du-theatre

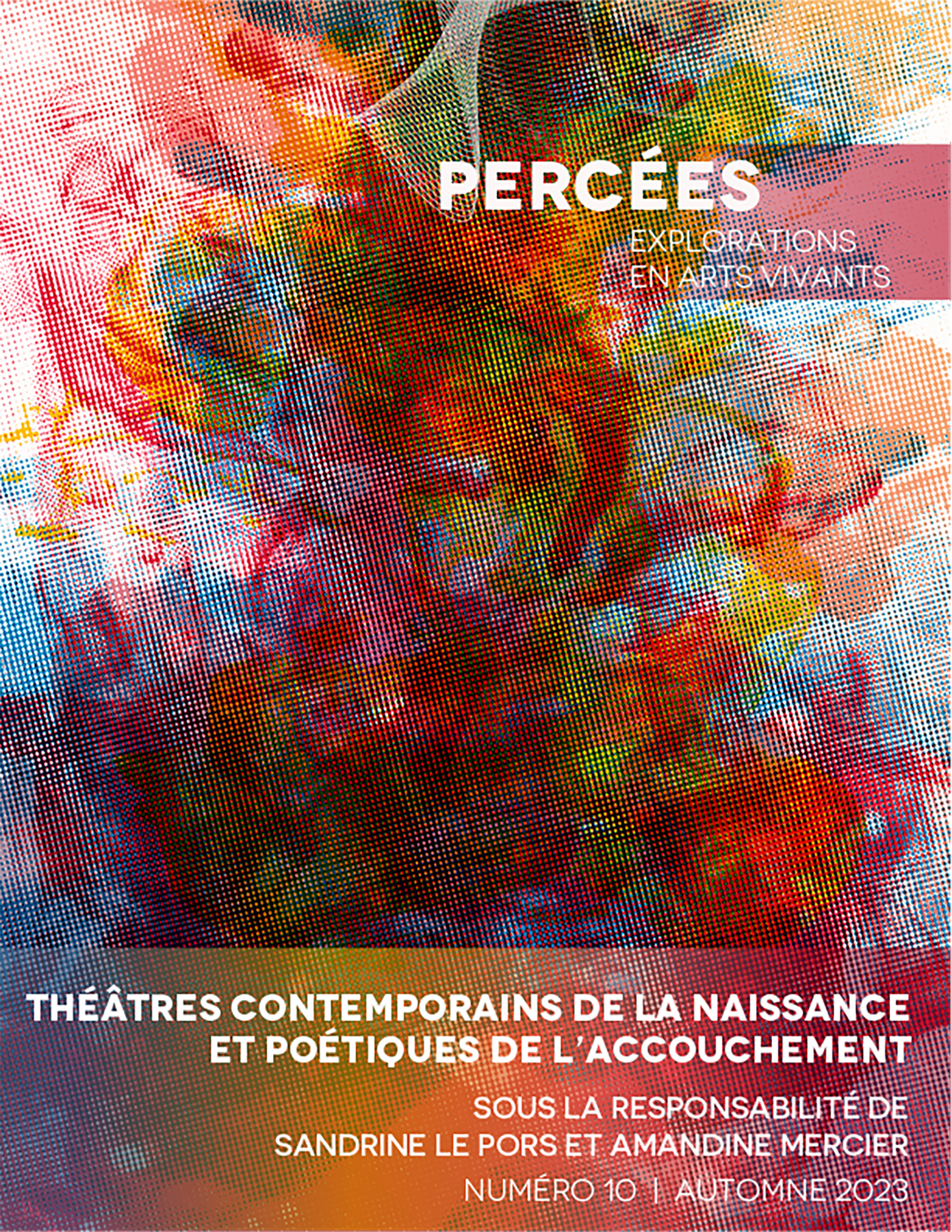


 10.7202/1045161ar
10.7202/1045161ar