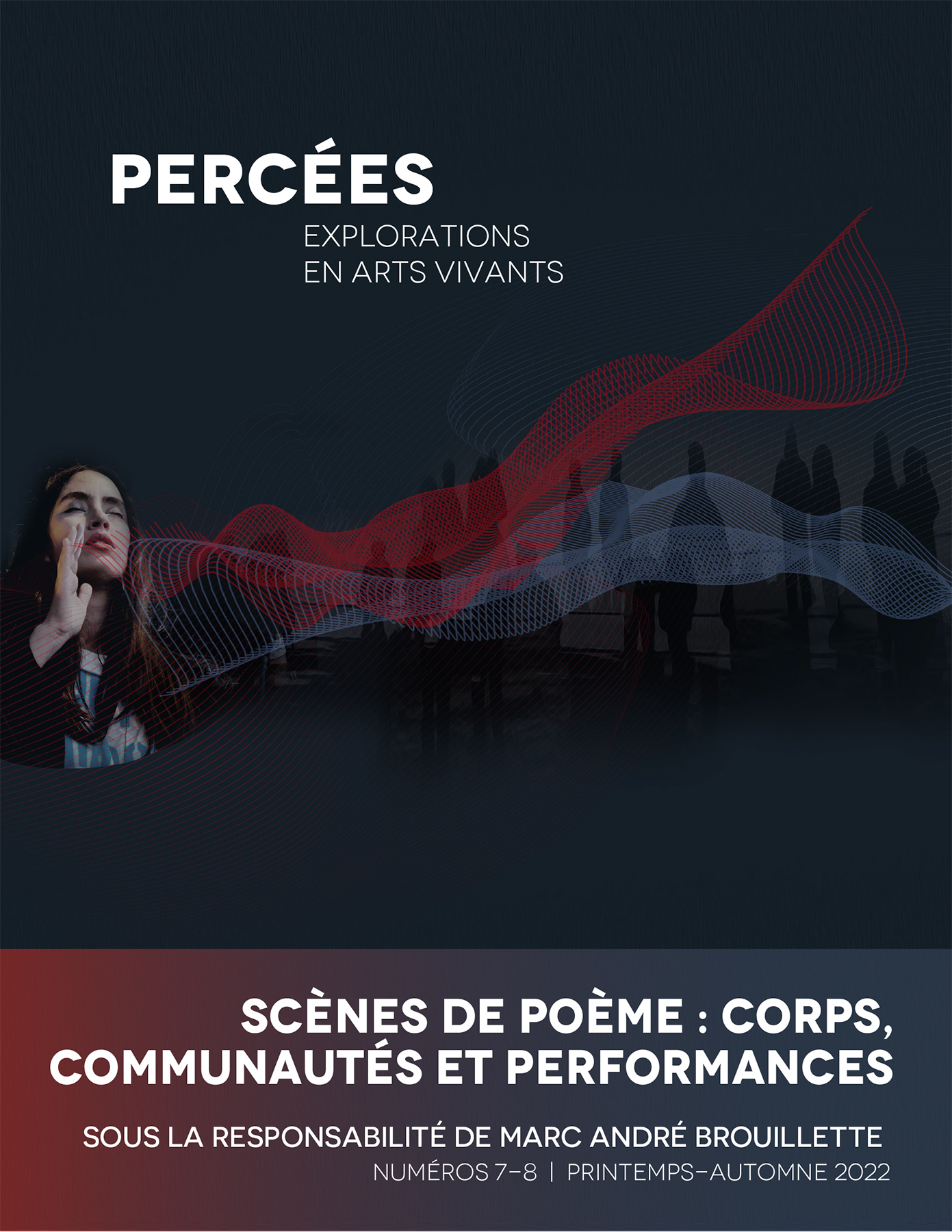Résumés
Mots-clés :
- décor,
- scénographie,
- théâtre extra-occidental,
- représentation,
- présentation
Quiconque s’intéresse à l’espace scénique sait combien il est rarement abordé par une lorgnette autre que celle de l’évolution du théâtre occidental, de l’Antiquité grecque à nos jours. Publié sous la direction de Romain Fohr, le deuxième volume de l’ouvrage intitulé Du décor à la scénographie, « Anthologie commentée de textes sur l’espace scénique extra-occidental », tente de pallier ce manque de références. Livre autonome paru à la suite d’un premier volume consacré à l’espace scénique occidental, il nous est présenté comme un recueil de textes sous des formes extrêmement diverses : journaux, articles, notes personnelles, lettres, extraits de livre, etc. Il couvre un large territoire, soit cinquante-sept pays répartis sur six continents et présente cent-dix-huit auteur·trices qui sont soit explorateurs, scientifiques, archéologues, ethnoscénographes, missionnaires, acupuncteurs, diplomates, enseignants, architectes, poètes (deux prix Nobel de littérature), peintres, journalistes, musiciens, metteurs en scène ou chorégraphes. Depuis Zéami, grand dramaturge japonais du XIVe siècle, on traverse la question de l’espace scénique jusqu’à nos jours. Deux index, l’un par auteur·trice et l’autre par pays, donnent des entrées différentes au lectorat alors que les notices introductives permettent de situer le propos de l’auteur·trice, le contexte historique, sociologique, culturel, esthétique et géographique, et ce, sans véritablement commenter le texte associé. La structure même de l’ouvrage, composé de courts textes, fragmente nécessairement la lecture, d’autant que les extraits sont présentés chronologiquement, ce qui dissémine les informations sur un sujet donné à travers le livre. Il faut aussi souligner que dû à l’absence d’iconographie, il est presque impératif de compléter sa lecture par des recherches rapides sur Internet pour véritablement faire image des très précises et nombreuses descriptions de lieux qui parsèment le volume. Alors que le Japon, l’Inde et la Chine sont les pays les plus représentés, la lecture nous mène de la Polynésie au Tibet, en passant par l’Arctique, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Haïti, Madagascar, le Vietnam et bien d’autres. Depuis les marae de la Polynésie, le panggang indonésien, l’al-halqa du Maghreb, le tazieh persan, le küttampalam indien, l’ortaoyunu de la Turquie, l’Indra Jatra népalais jusqu’au Karagheuz libanais, l’ouvrage nous fait voyager de la forme rituelle au théâtre dramatique. La couverture du Japon est particulièrement étendue : la lecture nous laisse avec une connaissance assez exhaustive de l’histoire et de l’évolution à la fois du nō et du kabuki, deux formes théâtrales extrêmement complexes où l’espace scénique est un acteur important de la composition dramaturgique. « Comment penser au-delà du théâtre occidental qui organise souvent notre réflexion sur le théâtre contemporain? » (8), se demande Fohr en introduction, sans tomber dans le piège de la comparaison et en laissant à chacun des textes son autonomie propre. Évidemment, la parution des deux volumes incite à une lecture comparative des deux univers, occidental et extra-occidental. Se crée alors une tension entre, d’une part, l’envie de trouver des ressemblances ou des différences entre les diverses incarnations scéniques à travers les multiples cultures abordées et, d’autre part, celle d’apprécier leurs particularités si nombreuses. Difficile par ailleurs de passer sous silence l’influence des esthétiques extra-occidentales sur la réflexion esthétique occidentale de la représentation. En effet, Adolphe Appia, Jacques Lecoq, Antonin Artaud, Eugenio Barba, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Peter Brook, Jean Cocteau, Jacques Copeau, Jerzy Grotowski, Louis Jouvet et Ariane Mnouchkine, entre autres, ont tous·tes revendiqué des influences non occidentales dans leurs travaux. Fohr a d’ailleurs retenu certains de leurs textes parmi ses choix; Artaud notamment nous parle de Bali, Brecht de la Chine et Brook d’Haïti. Par la force des choses et l’accessibilité restreinte des textes qui traitent du sujet, le regard qui est posé ici est …