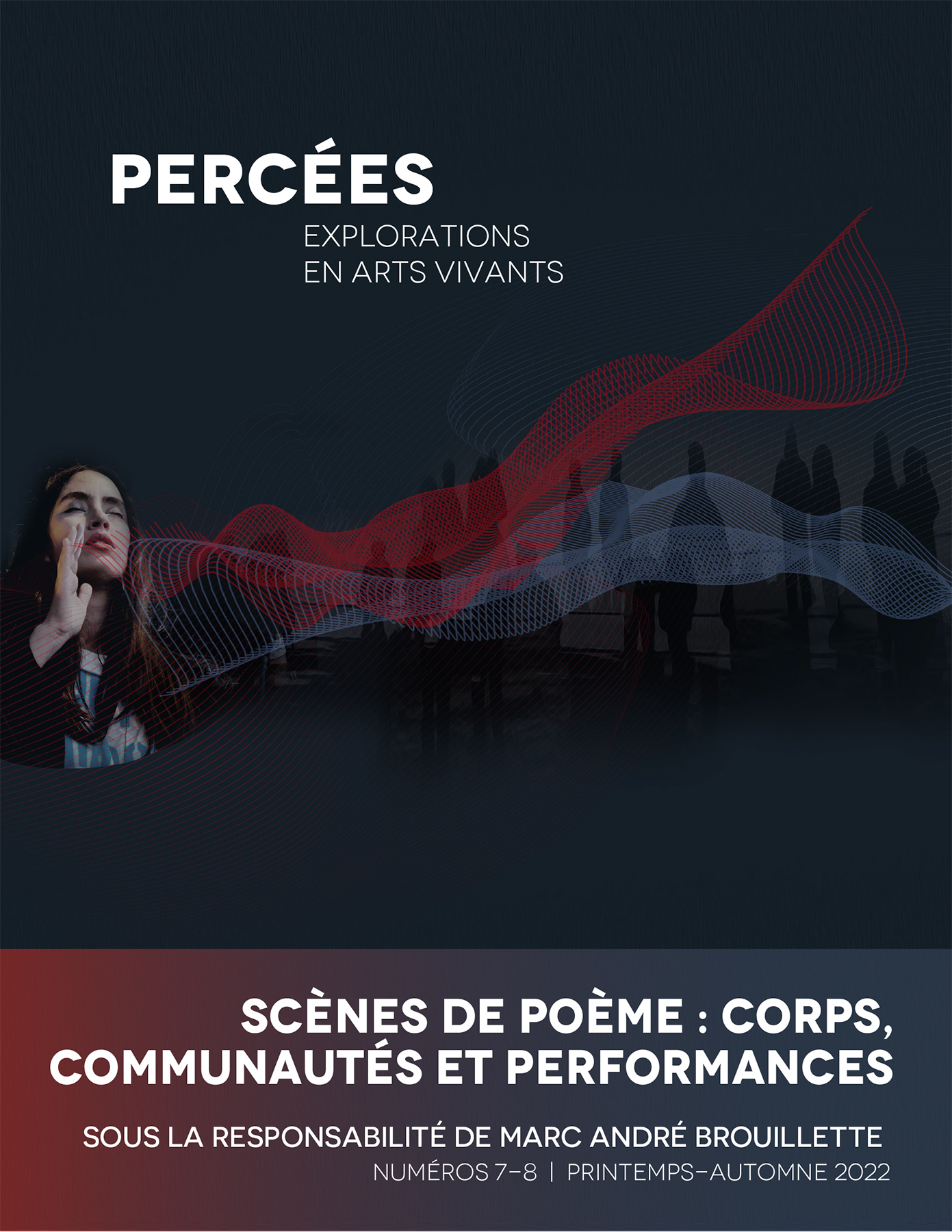Résumés
Mots-clés :
- cinquième mur,
- formes scéniques,
- théâtralité,
- dramaturgie
Issu d’un séminaire public tenu au Centre dramatique national Nanterre-Amandiers, Le cinquième mur : formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités est l’occasion pour trois chercheur·euses de réfléchir à l’esthétique théâtrale contemporaine. À l’aide d’un corpus formé de onze spectacles, il·elles proposent des analyses et dégagent à partir d’elles un certain nombre de caractéristiques de la production actuelle. Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Éric Vautrin ont d’ailleurs reçu les créateur·trices des spectacles retenus durant les séances de leur séminaire où ceux-ci ont été étudiés. À l’exception de Kelly Cooper et Pavol Liska du Nature Theater of Oklahoma, ce sont des artistes européen·nes. Tous et toutes figurent parmi les plus en vue de la danse et du théâtre contemporains. Et il en va de même des productions choisies, l’ouvrage s’ouvrant d’ailleurs sur de très belles photos couleur de Jerk (Gisèle Vienne, 2008), de La mélancolie des dragons (Philippe Quesne, 2008), de Life and Times: Episode 1 (Nature Theater of Oklahoma, 2009), de Sur le concept du visage du fils de Dieu (Romeo Castellucci, 2011), de Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni (Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, 2013), d’Adieu et merci (Latifa Laâbissi, 2013), de By Heart (Tiago Rodrigues, 2013), de Monument O : hanté par la guerre (1913-2013) (Eszter Salamon, 2014), de 69 positions (Mette Ingvartsen, 2014), de Compassion : l’histoire de la mitraillette (Milo Rau, 2016) et de Nachlass : pièces sans personnes (Stefan Kaegi et Dominic Huber, 2016). Nourri·es du travail de ces artistes, Boisson, Fernandez et Vautrin s’efforcent, à partir d’une démarche inductive, de saisir « des tendances, des moyens communs, des gradations, des passages labiles entre des pôles opposés, des modes similaires au sein d’esthétiques fort hétérogènes » (46) qui toucheraient une frange significative de la danse et du théâtre contemporains. L’élément central à partir duquel est observé cet ensemble est justement ce « cinquième mur » qui donne son titre à l’ouvrage. Castellucci désigne par ce syntagme « l’écran noir de l’esprit du spectateur », « pellicule vierge où la troisième image s’imprime » et qui « se développe à la manière d’une épiphanie individuelle qui échappe totalement [au] contrôle » (93) du·de la metteur·e en scène. Les auteur·trices soutiennent donc que la manière dont la relation avec les spectateur·trices se noue au sein de la représentation est au coeur de l’esthétique théâtrale actuelle – ce que plusieurs théoricien·nes ont déjà affirmé –, mais il·elles parviennent à le démontrer en interrogeant avec justesse le corpus qu’il·elles ont sélectionné et en interviewant avec doigté les créateur·trices qui ont réalisé ces spectacles. Ces entrevues forment d’ailleurs une partie importante de l’ouvrage, propos réinvestis par la suite dans les analyses. Parallèlement à l’attention accordée au public par les créateur·trices étudié·es, Boisson, Fernandez et Vautrin mettent en relief l’hétérogénéité des objets fabriqués et celle de leur composition ainsi que la propension de leurs auteur·trices à continuer de dramatiser, qui se fait jour à l’intérieur de ces oeuvres, dont le mode d’adresse est toujours savamment situé. La force du Cinquième mur est sans doute moins de repérer de nouveaux éléments et procédés typiques du début des années 2000 que de reprendre, en les développant et en les synthétisant autour de la figure clé du·de la spectateur·trice, plusieurs dimensions cruciales de l’événement théâtral mentionnées ailleurs. Le rapport à la réalité en est un : « Chez ces artistes, la distinction classique entre vrai / faux, fiction / documentaire, littéralité / simulacre se muerait en une fine réarticulation (voire indistinction) entre ces termes » (145). La question de la présence en est une autre : « Les scènes contemporaines réunies ici …