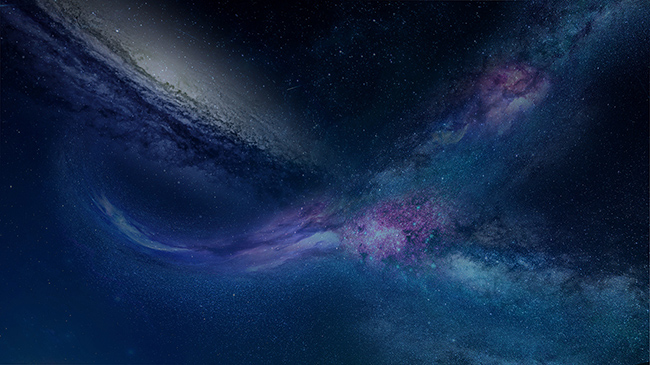Résumés
Résumé
Le présent texte porte sur l’installation immersive L’infini, présentée en 2021 à Montréal. Dans un premier temps, l’auteur analyse les enjeux esthétiques et les dispositifs de ce spectacle selon une perspective intermédiale afin de saisir sa portée dramaturgique qui se déploie avec le numérique. Dans un deuxième temps, l’auteur revient sur la conception d’« expérience esthétique » de Hans-Georg Gadamer, articulée dans son ouvrage Vérité et méthode (2018 [1960]). L’hypothèse de travail est que l’application de la théorisation de Gadamer au spectacle L’infini fraye la voie à une herméneutique technologique et permet une meilleure compréhension du régime spectaculaire dans ce spectacle qui se tourne vers le numérique.
Mots-clés :
- intermédialité,
- numérique,
- scène,
- herméneutique,
- nouvelles technologies
Abstract
The following article focuses on the immersive installation L’infini, presented in 2021 in Montreal. In the first part, the author analyzes the aesthetic stakes and the scenic devices of this installation from an intermedial perspective in order to grasp its dramaturgical scope that unfolds with the digital. In the second part, the author revisits Hans-Georg Gadamer’s conception of “aesthetic experience,” as articulated in his book Vérité et méthode (2018 [1960]). The working hypothesis is that the application of Gadamer’s theorization to L’infini paves the way for a technological hermeneutic and allows for a better understanding of the spectacular regime in this performance that turns to the digital.
Corps de l’article
Ébahi et ébloui, c’est dans son tout dernier texte qu’Alexander R. Galloway a pu résumer le sentiment général que nous vivons dans une culture hyperconnectée : « Le monde est imprégné dans les données![1] » (2022 : 211.) Si cette phrase est aujourd’hui devenue paradigmatique du monde informatisé qui est le nôtre, c’est qu’elle trouve également un écho dans le domaine esthétique. À l’ère et à l’aune du temps (post)pandémique, à l’époque de la multiplication des espaces numériques et virtuels, au prisme d’une « révolution numérique », la question de la création artistique et celle de son ordre interprétatif se posent en termes plus larges. Les processus entropiques engendrés par la crise sanitaire ont fait en sorte que la technologisation de nos sociétés est désormais la norme : du travail à distance, en passant par la télémédecine et les téléthérapies, jusqu’à l’enseignement en ligne, le monde technico-technologique envahit presque tous les domaines de l’activité humaine. Après deux années marquées par le spectre de la disparition de l’espèce humaine dans le monde entier – et dont l’orage d’acier des fronts russo-ukrainiens constitue le prolongement – une reconfiguration profonde dans la façon de penser la culture et l’art est inévitable. Quel statut esthétique peut-on attribuer à des oeuvres scéniques qui se créent dans la crainte d’une « disparition » sociétale? Quelle herméneutique peut-on envisager afin de décrypter l’influence de différentes technologies qu’un certain nombre de pratiques théâtrales incorporent dans leur démarche créative? Afin de répondre à ces questions, le présent texte s’intéresse à deux avenues convergentes. Dans un premier temps, nous analyserons le spectacle immersif L’infini, présenté à Montréal le 10 septembre 2021. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur la conception de l’expérience esthétique de Hans-Georg Gadamer (2018 [1960]) pour mieux saisir le sens esthétique de L’infini. Nous tenterons de dégager une analogie étonnante entre les deux en vérifiant l’hypothèse de travail selon laquelle la conception gadamerienne jette un nouvel éclairage sur les enjeux techno-scientifiques de L’infini. Ainsi, d’un point de vue strictement méthodologique, la démarche est à la fois analytique et spéculative. C’est-à-dire qu’en analysant les dispositifs scéniques dans L’infini, nous souhaitons mesurer comment le spectacle contribue à une esthétique de la disparition puisqu’aucun·e acteur·trice en chair et en os ne figure dans la construction de la représentativité. Enfin, en déplaçant l’analyse sur le terrain théorique, nous aborderons le spectacle à travers le prisme du « jeu » tel que conceptualisé dans Vérité et méthode : les grandes lignes d’une philosophie herméneutique (2018 [1960]) de Gadamer.
Dans son livre Understanding Media: The Extensions of Man (2013 [1964]), le chercheur canadien Marshall McLuhan s’appuie sur le domaine médical afin de rendre compte de l’agentivité des nouvelles technologies dans les sociétés occidentales. Avec l’éclectisme propre à la pensée du théoricien, l’ascension vertigineuse des technologies – ainsi que les modalités médiatrices qui en découlent – est décrite à l’aide du modèle des trois stades du syndrome général de l’adaptation (SGA) : l’alarme, la résistance et l’épuisement. Le SGA désigne la capacité d’adaptation de l’organisme humain lorsque celui-ci est confronté aux agents stressants ou à tout autre trauma psychophysique. Selon la thèse de McLuhan, l’accélération technologique a fait en sorte que nos sociétés sont passées à travers les trois phases du SGA :
L’effet des technologies électriques a d’abord été de l’ordre de l’anxiété. Aujourd’hui, il semble que c’est plutôt de l’ennui qu’elles provoquent. En effet, nous sommes passés à travers les trois stades : l’alarme, la résistance et l’épuisement qui constituent les invariants de la progression de toute maladie ou tension, qu’elles relèvent du malaise individuel ou collectif[2]
(2013 [1964] : 26).
Cinquante-huit ans après le parcours balisé par McLuhan, on peut dire que ces mots résonnent singulièrement avec le domaine théâtral d’aujourd’hui. Les nouveaux médias ont d’abord été appréhendés avec anxiété par la communauté universitaire[3]. La reproduction sonore, l’utilisation de vidéos pendant les spectacles, l’expérimentation avec des robots et des machines et leur substitution à l’acteur·trice vivant·e durant les représentations ont provoqué une grande résistance non seulement parmi les spécialistes, mais également parmi les membres de la communauté artistique. L’« anxiété », disions-nous, en reprenant le terme de McLuhan, ou plus justement l’insistance sur la « pureté » du corps du·de la comédien·ne et sa présence vivante, est le seul élément qui garantit le caractère éphémère de l’événement théâtral. Rappelons ici – sans pourtant insister ni sur le débat formel quant aux questionnements soulevés par ces thèses (notamment l’idée que la présence physique représente l’« essence » du théâtre) ni sur l’évolution du champ théâtral dans son ensemble – comment Walter Benjamin a évoqué la « déperdition de l’aura propre d’une oeuvre unique » à l’époque de sa « reproductibilité technique » (2013 [1939] : 22), ou encore comment Peggy Phelan a insisté sur le fait que les technologies nouvelles représentent la « trahison de la promesse ontologique du théâtre » (1993 : 146). Ces jugements sont sans doute sévères, mais non sans fondement, puisque le théâtre a longtemps été considéré comme une discipline artistique qui repose sur la voix naturelle et la présence physique de l’acteur·trice, sans relais technologique. Autrement dit, l’alarme technologique provoque l’anxiété. L’anxiété provoque la résistance. Et dans la résistance, se lit la volonté des créateur·trices de défendre l’ontologie théâtrale dans un contexte de changement incessant afin d’affirmer la supériorité du « naturel » sur l’« artificiel ». Or, malgré cette résistance quant à l’utilisation des différentes technologies scéniques, force est de constater que la pratique actuelle repose largement sur leur utilisation. Compte tenu de ce contexte, l’approche intermédiale s’avère appropriée pour en faire l’analyse.
Les études intermédiales, qui n’ont que trente-cinq ans, ont largement contribué à l’émergence d’un autre discours sur le théâtre et sur la relation de réciprocité créatrice qu’il engage avec la question des technologies. Intrigué·es par la complexité de l’expérience spectatorielle[4] contemporaine, les premier·ères intermédialistes ont réfléchi sur les principes de coprésence autres que ceux entre les êtres humains. Pour Lars Elleström (2018), Freda Chapple et Chiel Kattenbelt (2006), Jean-Marc Larrue et Marie-Madeleine Mervant-Roux (2016), ainsi que Chris Salter (2022) (pour n’en mentionner que quelques-un·es), la dimension audiovisuelle des spectacles produit un nouvel agrégat de coprésence qui privilégie désormais la dualité « être humain / machine » ou, dans le cas d’un petit nombre de spectacles de l’extrême contemporain, « machine / machine[5] ». Comme le rappelle Larrue, « il existe en effet des spectacles sans aucun acteur vivant sur scène […] où toutes les présences scéniques sont médiatisées par des technologies de reproduction du son et de l’image » (2016 : 228). Selon la vision scénique des intermédialistes, le théâtre peut effectivement se débarrasser de toutes les conventions scéniques, y compris la présence du·de la comédien·ne, tout en restant du théâtre. Le corps du·de la comédien·ne n’est qu’un élément parmi de nombreux autres de la fabrique théâtrale et les technologies opèrent comme un tissu conjonctif dans sa dimension audiovisuelle. De toute évidence, il s’agit d’une rupture paradigmatique, d’un angle de vue tout à fait novateur qui assimile les technologies à la production du spectaculaire, tout en cherchant différentes modalités médiatrices – la « médiation radicale[6] » (Grusin, 2015), l’« excommunication[7] » (Galloway, Thacker et Wark, 2013), la « remédiation[8] » (Bolter et Grusin, 1999), etc. – pour mieux appréhender le paysage esthétique contemporain. Ainsi, ce qu’on observe dans la logique théorique intermédiale et dans plusieurs autres créations scéniques d’aujourd’hui, c’est la troisième phase mcluhanienne du SGA : l’épuisement. Effectivement, la pratique théâtrale actuelle épuise la dimension technologique, et ce, de manière dramatique parfois : certaines oeuvres totalisent l’expérience esthétique à travers des machines complexes, des projections vidéo et des environnements numériques. Autrement dit, le chemin réflexif est ici inversé par rapport à la conception théâtrale « conventionnelle ». Dans l’alarme, on retrouve effectivement l’anxiété. Dans l’anxiété, on observe les regards innovants sur les possibilités de l’évolution du fait théâtral. Dans l’évolution, on s’engage à l’épuisement technologique. Et dans l’épuisement, on retrouve une autre herméneutique de l’oeuvre d’art à haute implication technologique. Comme nous le verrons dans les prochaines pages, le spectacle L’infini est un exemple emblématique de ces tendances.
L’infini a été présenté à l’automne 2021 au centre d’art contemporain Arsenal. Le spectacle était une coproduction de Felix & Paul Studios, Studio PHI et TIME Studios. Ces compagnies sont connues pour la création d’expériences en réalité virtuelle, réalité augmentée et réalités mixtes engageantes. Elles combinent ces différentes plateformes technologiques pour engendrer des expériences immersives grâce à la simulation numérique. Selon le programme officiel du spectacle, L’infini est envisagé comme une création qui nous transporte à la station spatiale de la NASA pour découvrir « la vie en orbite que seulement 250 astronautes ont vécue[9] ». Ce « voyage spatial » est en fait une incursion dans les moments filmés en 3D et à 360 degrés par huit astronautes de la station; le spectacle fait découvrir leur vie quotidienne, leurs défis, les tâches exécutées en orbite. À l’accueil, les spectateur·trices, divisé·es en groupes de quinze personnes, sont attendu·es par l’équipe technique qui leur explique le déroulement du spectacle. Le public doit passer par les différentes sphères dispersées dans l’immense salle d’Arsenal[10], avant de finir le parcours au fond où un voyage immersif les attend. Immergé·es dans la noirceur de la salle, équipé·es d’un casque de réalité virtuelle, les spectateur·trices sont invité·es à toucher les sphères lumineuses leur donnant accès à des capsules vidéo en 360 degrés par lesquelles il·elles deviennent témoins des récits professionnels et personnels des spationautes. Au total, les spectateur·trices peuvent traverser sept zones spatiales et ainsi entendre sept récits différents. On notera avec intérêt que l’aspect technologique y est assez sophistiqué : les casques produisent un véritable monde numérique qui ressemble à la réalité physique. En outre, chaque spectateur·trice se voit attribuer son propre avatar, c’est-à-dire qu’une fois équipé·e de son casque, il·elle peut voir les gants d’un·e astronaute sur ses propres mains, ce qui lui donne l’impression d’être habillé·e en combinaison. Le·la spectateur·trice a la possibilité de marcher partout dans le vaisseau spatial, de pénétrer différentes parties de la station et de se trouver à quelques centimètres des astronautes lorsqu’il·elles communiquent entre eux·elles. Les technologies engendrent une expérience multisensorielle et interactive : les astronautes réagissent à l’arrivée du·de la spectateur·trice dans la pièce, il·elles lui adressent la parole et par le biais d’une gestuelle hyperréaliste[11], il·elles lui racontent leur vie en orbite. Le fil narratif de L’infini épouse un mouvement en crescendo. Lorsque le·la spectateur·trice touche les premières sphères lumineuses, les discours d’astronautes sont descriptifs et quotidiens, allant du nombre d’heures de sommeil à l’insatisfaction à l’égard de la nourriture spatiale. Toutefois, vers le milieu du spectacle – et donc au moment où les spectateur·trices se trouvent au milieu de la salle –, un moment particulièrement fort surgit lorsqu’une astronaute explique au·à la spectateur·trice qu’elle a appris que son père était décédé sur Terre et communique sa tristesse de n’avoir pas pu se rendre aux funérailles. Le public observe la jeune femme déchirée, en train de pleurer; il écoute sa voix tremblante, ce qui crée un contraste par rapport aux scènes introductives. Quelques sphéro-instants plus tard, on remarque un autre astronaute en détresse psychologique. Il affirme ne plus pouvoir supporter l’espace fermé de la station de la NASA. Les deux scènes du milieu du spectacle jouent continuellement sur la sphère perceptuelle du public en accentuant le sentiment d’immersion : le spectacle cherche constamment à provoquer des émotions, de l’empathie, de la curiosité chez le·la spectateur·trice. Il s’agit d’un intervalle spectaculaire bien particulier, car derrière cet exploit technologique, on découvre une expérience purement humaine. Félix Lajeunesse, cofondateur de Felix & Paul Studios, a déclaré que l’objectif de L’infini était précisément de révéler ce qu’est la vie isolée en orbite, avec toutes ses difficultés et tous ses drames humains :
On voulait [que les astronautes] puissent parler authentiquement de leur expérience et d’eux-mêmes en se laissant aller, dire comment ils se sentaient les uns par rapport aux autres et donner leur vision de ce que c’est que d’être un groupe d’humains qui vit isolé de la planète Terre pendant un certain temps. On voulait trouver la vérité psychologique et émotionnelle de ça
(Lajeunesse, cité dans Vigneault, 2021).
La « vérité psychologique et émotionnelle » que Lajeunesse évoque semble créer une tension, dans l’écriture scénique, entre les technologies et la vulnérabilité de l’être humain dans le Cosmos. Or, même si la création est conçue selon une logique hypertechnologisée, L’infini met en scène une nature humaine dénouée, débarrassée de toute idéalisation d’une vie parfaite dans le Cosmos. La mise en valeur de l’expérience concrète en dépit des opérations technologiques complexes fait réfléchir à la durabilité de la vie humaine, aux questions de finitude et de disparition. Les scènes du milieu de L’infini ne sont donc rien d’autre qu’une subjectivisation émotionnelle, une image forte de l’intimité fragile des êtres humains derrière une odyssée fantastique. C’est donc par un contraste entre l’exceptionnalité de la mission spatiale et la proximité affective des individus qui ne sont au fond que des êtres humains qu’intervient l’instance numérique dans cette partie du spectacle. Ainsi, l’une des technologies les plus avancées dans le domaine scénique qui, de plus, remplace l’acteur·trice en chair et en os dans cette création, engendre des rapports forcément « analogiques » – sensibles, immédiats, expérientiels, émotionnels, sensoriels, bref, humains. L’infini semble constamment jouer des tensions entre le vivant et l’artificiel, entre le numérique et l’analogique dans la production de l’effet théâtral. C’est-à-dire que la théâtralité est en constante mouvance entre la simulation et la représentation, entre l’univers numérique de l’action scénique et la réalité des spectateur·trices physiquement présent·es.
Lorsque les spectateur·trices se déplacent, il·elles peuvent suivre une trajectoire numérique particulière qui les guide vers le fond de la salle. Durant la déambulation, la scénographie numérique est en reconfiguration perpétuelle : à un moment, les participant·es visionnent l’entraînement des astronautes en mission; quelques instants plus tard, il·elles regardent la célébration de l’anniversaire d’un astronaute – avec un grand gâteau flottant, faute de gravité terrestre. Dans ces intervalles de la promenade cosmique, une image se distingue par sa puissance expressive. En effet, dans un long corridor de la station, le·la spectateur·trice se trouve à côté d’immenses fenêtres qui donnent vue sur la planète Terre. Nous apercevons notre planète, telle une mosaïque de paysages extraordinaires s’élevant au-dessus de l’horizon lunaire. Nous sommes ainsi frappé·es par l’immensité du Cosmos et par les images très détaillées de l’Univers. Des étoiles, la Lune et des continents sur Terre s’ouvrent aux yeux des spectateur·trices dans leur plénitude visuelle. Cette image crée un régime représentatif singulier. Comme un miroir inversé, le·la spectateur·trice, se trouvant sur Terre, a l’occasion de s’observer lui·elle-même depuis l’espace cosmique. S’installe désormais un phénomène aussi étonnant que concret : nous sommes observé·es tout en observant. Projeté·es dans l’imagerie d’un univers du lointain, nous nous découvrons nous-mêmes en train de contempler ce même « nous ». Autrement dit, le régime représentatif instaure ici une double observation, celle qui réside dans l’ordre de deux espaces convergents : l’espace numérique et l’espace physique. À travers l’espace physique se manifeste l’observateur·trice. À travers le numérique, se concrétise l’observé·e. Et à travers les deux, se profile la réflexivité, concrète, inéluctable où confluent l’imaginaire et le réel dans l’acte spectaculaire.
La dernière partie de L’infini est une invitation au voyage dans un vaisseau spatial. Une fois la promenade sphérique achevée, le·la spectateur·trice a la possibilité de s’installer dans un grand fauteuil inclinable, toujours muni·e de son casque de réalité virtuelle. Une voix féminine procède à un décompte. Et lorsque le « zéro » est prononcé, les moteurs du vaisseau s’activent et le décollage commence. On quitte ainsi la Terre et on se dirige vers les différentes galaxies lumineuses. Les images sont assez impressionnantes. On aperçoit différents rayons de lumière, des halos d’univers lointains, on longe la surface lunaire et traverse des nuages interstellaires et des supernovae. Vers la fin du voyage, les images s’obscurcissent tandis que des comètes et des astéroïdes frappent frénétiquement le vaisseau : s’agit-il d’une évocation de la matière noire, de l’énergie sombre? On poursuit notre parcours à travers le chaos tandis que les différentes forces gravitationnelles continuent de gronder dans le « vaisseau spatial ». Dans ce dernier moment de l’expérience immersive, une attention particulière est accordée à la dimension sonore. Se succèdent dès lors différents paysages sonores (soundscapes) composés dans un registre extrêmement bas. Ce que nous entendons, ce sont des infrasons[12] vibratoires à très haut volume qui accompagnent le voyage en orbite. À cela s’ajoutent plusieurs explosions réverbérées lorsque des astéroïdes touchent le vaisseau. Les captations vidéo projetées en 3D et en 360° et le son ambiant diffusé par les écouteurs situés dans le casque créent une « hypermédiateté[13] » (« hypermediacy »; Bolter et Grusin, 1999) complémentaire. Nous voici donc face à une immédiateté radicale, face à un scénario imaginaire pur qui ne passe pas par l’ordre symbolique (le langage), car aucun·e acteur·trice « vivant·e » ne joue sur scène. Les spectateur·trices sont absorbé·es par la puissance plastique dont la médiation ne les renvoie qu’à l’instantanéité du processus médiatique. Autrement dit, la médiation ouvre un intervalle par lequel le public accède à l’imagerie cosmique. Le voyage de la fin du spectacle n’est donc rien d’autre qu’une invitation à s’introduire dans un univers fictif, dans une paraphrénie affective[14] portée par l’image.
De toute évidence, cette création scénique se déroulant sans acteur·trices en chair et en os induit un rapport particulier avec le public, lequel est invité à entrer dans ce qu’on peut qualifier de « jeu médiatique ». Pour penser ce régime esthétique singulier, les outils de l’herméneutique développés par Gadamer dans Vérité et méthode procurent une perspective éclairante que nous tenterons maintenant d’esquisser. D’après sa conception, l’agir est l’une des pragmatiques les plus fondamentales de l’être humain. Gadamer conteste la présupposition selon laquelle le jeu n’est pas une action sérieuse. Pour le philosophe allemand, le concept du jeu comporte un sérieux qui lui est propre. Il soutient que le jeu constitue une part intégrante de la subjectivité humaine, et qu’il est même ontologiquement sérieux[15]. On peut convoquer l’exemple du·de la turfiste qui placerait toute sa mise dans un jeu à partir duquel on peut déduire qu’il·elle vivrait pour cette conduite ludique. Bien entendu, le·la joueur·euse sait que son jeu « n’est qu’un jeu » sans savoir ce qu’il·elle « sait » par là. Et même si le jeu ne reste qu’un « jeu », on s’y engage sérieusement, puisqu’il nous transpose par adhésion et nous renvoie à l’ordre de la fascination. Lorsqu’un·e compositeur·trice de musique joue du piano, il·elle est conscient·e que sa familiarité avec l’instrument lui permet d’éprouver du plaisir, mais il·elle mesure aussi le dévouement, l’attention sérieuse et la détermination nécessaires dans son jeu pour créer une nouvelle oeuvre d’art. Ainsi, le jeu élabore un monde dans lequel le·la joueur·euse s’oublie : dans l’instantanéité du moment vécu, il·elle s’immerge dans le sérieux et se laisse absorber par cette expérience. Pour désigner ce phénomène, Gadamer introduit la formule « sérieux sacré » (2018 [1960] : 174). En s’emparant de la notion de sérieux comme conduite esthétique dans l’existence humaine, Gadamer abandonne la structure horizontale de la compréhension dans la mesure où le sérieux se trouve déjà impliqué dans l’attitude du·de la joueur·euse. Le sérieux n’appartient ni à l’extériorisation ni à l’objectivisation, il n’existe pas de jeu qui serait plus sérieux qu’un autre. En suivant cette proposition, nous sommes donc tenté de penser le sérieux comme un mécanisme imposé sur l’expérience esthétique, à savoir une intervention délibérée de l’interprète plutôt qu’une modalité spontanée de toute activité de « jeu ». Le mode opératoire du jeu, la façon dont il s’exhibe à travers la représentation, n’est ainsi pas une conscience esthétique, mais plutôt une expérience de l’art. C’est-à-dire que le jeu n’est pas seulement le mode de conduite adopté face à un objet, mais aussi la structure préalable à la compréhension d’une oeuvre d’art. En ce sens, Gadamer a pu affirmer que « [l]e véritable sujet n’est pas le joueur, mais le jeu lui-même. C’est le jeu qui tient le joueur sous le charme, qui le prend dans ses filets, qui le retient au jeu » (ibid. : 181).
Ensuite, l’herméneutique gadamerienne introduit un deuxième élément majeur qui est de l’ordre de la représentation elle-même. S’adonner à une tâche ludique entraîne également la transformation du·de la spectateur·trice lors d’une représentation scénique. Gadamer écrit :
Les joueurs jouent leur rôle comme dans n’importe quel jeu; c’est ainsi que le jeu accède à la représentation; mais le jeu lui-même est l’ensemble composé des joueurs et des spectateurs. […] C’est un changement total de direction que subit le jeu comme tel en se transformant en spectacle. Le spectateur y prend la place du joueur. C’est lui, et non le joueur, pour qui et en qui le jeu se joue
(ibid. : 186).
Pour désigner le régime représentatif qui engendre l’expérience esthétique, Gadamer emploie l’expression « transmutation en oeuvre [Gebilde] » (ibid. : 187). Il s’agit d’un principe plus englobant que la dichotomie sujet / objet : le plein accomplissement du jeu est l’oeuvre d’art en tant que telle, et le jeu se base sur une communauté d’exécutant·es. C’est-à-dire que le spectacle n’est pas un objet représentatif fixe, un monde fermé sur lui-même qui se donne à la contemplation, bien au contraire. Si bien que les personnages qui incarnent différents rôles dans le spectacle sont eux-mêmes joueurs dans cette structure du jeu, le véritable jeu se déroulant dans l’esprit du·de la spectateur·trice qui devient finalement un·e coconstructeur·trice, coproducteur·trice, voire un·e complice privilégié·e dans l’acte de la création. Selon cette conception, les spectateur·trices exercent une influence directe sur le déroulement du spectacle, parce qu’il·elles entrent dans la réalité du monde du jeu. Pour Gadamer, le public ne possède jamais un rôle passif. L’oeuvre se crée à mi-chemin entre le jeu des interprètes sur scène et celui des spectateur·trices qui se trouvent absorbé·es par ce même jeu scénique. C’est en ce sens que se déroule la transmutation en oeuvre. La transformation induite par le jeu humain (c’est-à-dire son association cognitive, mentale et émotionnelle avec le spectacle), ce « va-et-vient » constant entre les artistes, les spectateur·trices et le jeu, contribue à la création de l’oeuvre d’art en tant que telle. Ce qui est donc important, c’est que pour Gadamer la transmutation de l’objet en oeuvre n’est pas fixe. C’est un processus, un mouvement singulier à travers lequel se forme le véritable être de l’oeuvre d’art.
Ainsi dépeinte, la représentation dans le spectacle L’infini ne porterait-elle pas en soi l’idée d’une immersion spectaculaire? Le monde métamorphosé par la transmutation en oeuvre ne génère-t-il pas un sentiment d’appartenance à l’action représentée par des interprètes? L’infini semble emblématique d’un tel phénomène. Le vrai jeu de ce spectacle comprend une constellation complexe entre le numérique, les discours scientifiques, l’irruption du réel des spationautes, l’infrastructure audiovisuelle qui intègre le cosmique et, surtout, les spectateur·trices qui sont invité·es à coconstruire le sens. Manifestement, les vrai·es « joueur·euses » dans cette oeuvre ne sont pas les interprètes numériques. Comme dans un jeu vidéo, c’est l’être humain, immergé dans le spectaculaire, qui prend place dans la construction active du jeu scénique. Lorsque nous évoquons ce jeu scénique singulier, nous pensons à l’interaction constante entre le public et L’infini : en touchant les sphères numériques, les spectateur·trices prennent une part active dans la fabrication de la représentativité. Et le véritable jeu, le spectacle authentique, c’est ce point de rencontre inattendu entre le jeu représenté par les avatars et l’engagement sérieux du·de la spectateur·trice dans le jeu. Dans cette perspective, le spectaculaire orchestre une alliance intermédiale privilégiée qui, comme dans la conception gadamerienne, va au-delà de la dichotomie sujet / objet. De fait, les êtres humains et les technologies produisent dans L’infini un agrégat représentatif qui invite à l’interaction continuelle afin de générer une expérience esthétique. Il en ressort que cette herméneutique singulière relève de l’ordre purement technologique, car toute compréhension s’inscrit sur un fond d’interaction, voire de dialogue entre les machines et les êtres humains. Il ne nous semble ni abusif ni excessif d’avancer que l’interprétation de cette création repose sur un décryptage technologique à partir duquel l’art de comprendre l’oeuvre peut prendre assise. Mais de quel décryptage s’agit-il précisément? Lorsque Gadamer décrit la transmutation en oeuvre, il évoque en parallèle la « médiation totale » : « La médiation est, par essence, médiation totale » (ibid. : 202). Si l’on suit ce raisonnement, on peut dire que c’est à travers la médiation que l’oeuvre accède à la représentation et, inversement, que c’est grâce à elle que l’herméneutique trouve sa concrétisation. Ce que nous entendons par là, c’est que dans ce cas l’herméneutique en tant que principe d’interprétation d’une oeuvre se concrétise aux moyens des médiations et non aux moyens d’un texte dramatique, d’un jeu de comédien·nes physiquement présent·es sur scène. Fondamentalement, la médiation serait cette force qui permettrait aux spectateur·trices d’accéder à l’exhibition du spectaculaire. L’infini promet donc la conduite immédiate dans l’imaginaire : il ne postule pas le décryptage par l’entremise d’un texte. Nous voyons que dans L’infini le principe de médiation joue sur le schéma sensoriel et émotionnel des spectateur·trices. De multiples horizons numériques communiquent la disparition, le cosmique, le chaos, la psyché humaine – bref, ce sont les phénomènes humains et extra-humains qui deviennent porteurs du spectacle. Toutefois, cette médiation ne nous renvoie qu’à l’instantanéité de sa propre médiation, qu’à l’immédiateté de son propre processus médial. Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas de dramaturgie textuelle ou d’incarnation de différents rôles sur le plateau. Pas de mise en scène au sens d’une disposition visant à régler le jeu de comédien·nes sur scène. Pas d’acteur·trices « vivant·es » sur scène. L’infini totalise l’expérience esthétique par les forces médiatrices qui nous orientent constamment vers ses propres capacités transmissibles[16]. C’est précisément cette infrastructure intermédiale que nous appelons l’immersion spectaculaire dans ce spectacle.
***
En guise de conclusion, il convient de dire que L’infini (tout comme un grand nombre de spectacles de l’extrême contemporain) propose une reconfiguration majeure dans les règles de la représentation, une autre forme d’herméneutique qui se tourne davantage vers les technologies. Ce que nous avons indiqué, c’est que ce régime de la représentation provoque une immersion dans les dynamiques audiovisuelles. En ce sens, le concept du « jeu » théorisé par Gadamer a permis de voir comment le public devient un partenaire privilégié dans la construction du sens esthétique. En entrant dans un « jeu médiatique » avec les sphères numériques, les spectateur·trices prennent une part active dans la construction du spectaculaire.
Dans un sens plus large, L’infini s’inscrit dans la logique de plus en plus répandue des spectacles de la « disparition » où les technologies absolutisent l’axe créatif. Quel statut peut-on attribuer à ces spectacles qui se créent dans le sillage de l’accélération technologique de nos sociétés? Qu’est-ce que le théâtre qui écarte l’être vivant de la scène? Qu’est-ce que la scène qui invoque et convoque les univers technologiques du lointain[17] dans la construction de la représentation? Il est évident que, depuis au moins vingt ans, les arts de la scène subissent une évolution rapide qui nous incite à repenser nos rapports à la chaîne spatio-temporelle, à l’herméneutique, aux technologies, au rôle des êtres humains et, surtout, à l’instabilité engendrée par ces processus. Au-delà des incertitudes et des inquiétudes relatives au fait que la présence humaine devient accessoire au théâtre, l’instabilité témoigne d’un revirement majeur dans l’organisation de nos sociétés, où la mouvance semble être la nouvelle norme. Le diagnostic posé par Bernard Stiegler dans son excellent livre La technique et le temps est en ce sens particulièrement éclairant :
Loin d’exprimer les modalités possibles du réel, la technoscience explore des possibilités dont le réel n’est que concrétisation transitoire, une stase momentanée dans un processus, et qui ne cesse de devenir pour se trans-former. Ce que nous signifions lorsque nous posions que là où, à l’âge classique, la règle était la stabilité et le changement l’exception, aujourd’hui, époque de l’innovation permanente, c’est la stabilité qui est devenue exception, et le changement règle
(2018 : 817).
À la lumière de ces propos, on peut dire que les spectacles à haute teneur technologique participent en même temps à la vulnérabilité de l’actuel où le changement constant semble devenir la norme. Les dynamiques exponentielles de la disparition bouleversent les relations humaines en se tournant vers d’autres agentivités, extérieures à la subjectivisation humaine. Dans le même ordre d’idées, la singularisation de la vitesse de circulation et de l’ascension technologique fait partie d’une dynamique de l’économie industrielle, d’une machinerie sociétale qui produit des dispositifs de contrôle au nom d’une mise en réseau global. L’omniprésence du numérique dans L’infini appartient à cette sphère : l’oeuvre est construite selon ce modèle d’affaires dont le langage est l’économie politique et dont l’expression est la conquête[18] du cyberespace. Ce que nous entendons par là, c’est le fait que les dynamiques numériques dans L’infini résonnent fortement avec notre monde où l’espace virtuel occupe une place de plus en plus importante. En d’autres termes, ce spectacle sert aussi comme un modèle de notre société informatisée en constante mouvance. La représentation interactive des sphères, l’immersion spectaculaire du public, les dynamiques intermédiales : tous ces éléments esthétiques sont symptomatiques d’une vitesse de circulation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Quelque part entre la production et la consommation, quelque part entre la logique d’une conquête technico-technologique et l’expérience des potentialités technologiques, force est de constater que la réflexion sur le numérique dans sa perspective sociétale est loin d’être épuisée. La mondialisation numérique, que l’ordre néolibéral inscrit dans la logique d’un nouveau cosmopolitisme, crée une autre construction de soi, une nouvelle individuation pulsionnelle foncièrement « branchée », résolument « connectée ». N’oublions pas que L’infini participe de cette artère consumériste : les clics informatiques ad infinitum qui sont devenus la norme à notre époque numérique sont complémentaires aux « clics manuels » des spectateur·trices lorsqu’il·elles touchent les sphères qui vont ouvrir les récits des astronautes. La dramaturgie scénique se trouve donc réduite à une technique opératoire, à une commande prête à être récupérée. Ainsi, il y a une urgence à réfléchir et à analyser la reconceptualisation des fondements ontologiques du monde technico-technologique dans le contexte contemporain. Le numérique doit faire l’objet d’un examen attentif, car sa logique est irréductiblement ambivalente. Même si le numérique est envisagé comme un champ d’action neutre, formel et binaire, sa phénoménalité et son usage politique actuel nous indiquent clairement que les technologies sont tout sauf désintéressées.
Parties annexes
Note biographique
Filip Dukanic est chercheur postdoctoral à l’Université du Québec à Montréal. Il a réalisé sa thèse en cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3. Ses recherches portent principalement sur l’intermédialité dans la dynamique de la création artistique et sur les nouvelles technologies de la scène contemporaine. Il s’intéresse également à un certain nombre de théories récentes telles que le posthumanisme, les nouveaux matérialismes et l’intelligence artificielle. Il est membre étudiant du réseau en recherche-création Hexagram.
Notes
-
[1]
« The world is awash in data! » Toutes les citations en anglais de cet article ont été traduites par nos soins.
-
[2]
« The effect of electric technologies had at first been anxiety. Now it appears to create boredom. We have been through the three stages of alarm, resistance, and exhaustion that occur in every disease or stress of life, whether individual or collective ».
-
[3]
Les exemples sont très nombreux, mais on peut évoquer les essais de Peggy Phelan (1993) du côté nord-américain et de Henri Gouhier (1943) du côté européen.
-
[4]
L’usage du terme « spectatoriel » qualifie notre approche de spectacles à haute teneur technologique. En effet, un bon nombre d’installations scéniques jouent activement sur la perception du public. Ceci est notamment le cas avec les créations présentées à la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal, où la simulation numérique sur scène constitue l’intégralité des spectacles. Entre la volonté de disperser constamment le schéma perceptuel du public par le numérique et le spectaculaire qui en découle, nous préférons le terme « spectatoriel ». Le sens du terme est donc à entendre comme une expérience engendrée dans le contexte de la confrontation de l’être humain et des technologies numériques.
-
[5]
Nous faisons ici référence aux spectacles de la « disparition » qui se déroulent sans acteur·trices en chair et en os. On peut mentionner par exemple Stifters Dinge (2007) d’Heiner Goebbels, ou encore Le sacre du printemps (2015) de Romeo Castellucci.
-
[6]
Nous pensons au concept de Richard Grusin. Voir « Radical Mediation » (2015).
-
[7]
Nous devons à Alexander R. Galloway la première conceptualisation de l’excommunication. Pour approfondir, voir Alexander R. Galloway, Eugene Thacker et McKenzie Wark, Excommunication: Three Inquiries in Media and Mediation (2013).
-
[8]
Dans leur essai-phare Remediation: Understanding New Media (1999), Jay David Bolter et Richard Grusin proposent un panorama des « nouveaux médias » ainsi que du phénomène de la médiation tout en introduisant une nouvelle catégorie, le principe de remédiation.
-
[9]
Présentation de l’événement sur le site Internet de PHI; la page n’est plus disponible.
-
[10]
Les dimensions de la salle principale de l’Arsenal sont imposantes : il s’agit d’un vaste espace totalisant 12 500 pi².
-
[11]
Par le terme « hyperréaliste », nous entendons le fait que les mouvements et les gestes des astronautes ressemblent beaucoup à ceux des êtres humains vivants.
-
[12]
Précisons que les infrasons sont les ondes produites à une fréquence extrêmement basse, entre 10 Hz et 20 Hz. Normalement, ces sons ne sont pas perceptibles par l’ouïe humaine puisqu’ils se trouvent sous le seuil de la limite audible. L’unique façon d’entendre ces sons, c’est lorsque les vibrations électro-acoustiques se répètent à une fréquence très précise, à savoir de seize à vingt fois par seconde. Les infrasons sont massivement utilisés dans les films d’horreur pour tenter de provoquer un sentiment de peur, d’incertitude, etc.
-
[13]
Nous faisons référence à la conception de Bolter et Grusin dans leur essai capital Remediation: Understanding New Media. L’hypermédiateté comprend en effet une série de différentes « fenêtres » (les windows), à savoir la démultiplication ad infinitum des actes et des lieux de représentation. Qu’elle se rapporte à l’univers du Web, au passage aux différents niveaux dans les jeux vidéo ou aux changements de perspective durant la simulation numérique sur scène, l’hypermédiateté désigne le phénomène de redoublement à travers lequel se concrétise une nouvelle expérience subjective. Pour approfondir, consulter la page 31 de leur ouvrage.
-
[14]
Assurément, l’expression est métaphorique et à entendre comme la concrétisation du monde numérique, lequel se superpose au monde réel.
-
[15]
Il convient de noter qu’Hans-Georg Gadamer s’oppose à la conception d’Arnold Gehlen, qui considère que c’est avant tout l’imagination qui se trouve dans la dynamique du jeu humain. Voir à ce propos Arnold Gehlen, L’Homme : sa nature et sa position dans le monde (2021 [1940]).
-
[16]
Nous nous sommes intéressé à d’autres modes intermédiaux qui apparaissent dans les productions numériques similaires. Voir particulièrement Filip Dukanic, « Le dispositif sonore comme dérive d’excommunication » (2019).
-
[17]
Lorsque nous évoquons la notion de lointain, nous entendons le fait que certains spectacles de la déferlante extrême-contemporaine orientent constamment notre expérience vers l’avenir, à savoir vers l’anticipation de l’état futur de nos sociétés. Le spectacle L’infini est emblématique de telles tendances, car il repose sur une dimension science-fictionnelle importante.
-
[18]
Lorsque nous utilisons le terme « conquête », nous voulons dire que d’un point de vue politique le cyberespace est l’objet de la course mondiale des corporations et des gouvernements de différents pays. En effet, il semble, à notre époque technologique, que l’espace numérique devient l’intérêt principal du monde informatisé qui est le nôtre.
Bibliographie
- BENJAMIN, Walter (2013 [1939]), L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, trad. Frédéric Joly, Paris, Payot, « Petite Bibliothèque Payot ».
- BOLTER, Jay David et Richard GRUSIN (1999), Remediation: Understanding New Media, Cambridge, MIT Press.
- CHAPPLE, Freda et Chiel KATTENBELT (dir.) (2006), Intermediality in Theatre and Performance, Amsterdam, Rodopi.
- DUKANIC, Filip (2019), « Le dispositif sonore comme dérive d’excommunication », dans Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano et Jean-Paul Quéinnec (dir.), Dispositifs sonores : corps, scènes, atmosphères, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, « Espace littéraire », p. 181-197.
- ELLESTRÖM, Lars (2018), Transmedial Narration: Narratives and Stories in Different Media, Londres, Palgrave Macmillan, « Pivot ».
- GADAMER, Hans-Georg (2018 [1960]), Vérité et méthode : les grandes lignes d’une philosophie herméneutique, Paris, Points, « Points Essais ».
- GALLOWAY, Alexander R. (2022), « The Golden Age of Analog », Critical Inquiry, vol. 48, no 2, p. 211-232.
- GALLOWAY, Alexander R., Eugene THACKER et McKenzie WARK (2013), Excommunication: Three Inquiries in Media and Mediation, Chicago, University of Chicago Press, « TRIOS ».
- GEHLEN, Arnold (2021 [1940]), L’Homme : sa nature et sa position dans le monde, trad. Christian Sommer, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie ».
- GOUHIER, Henri (1943), L’essence du théâtre, Paris, Plon.
- GRUSIN, Richard (2015), « Radical Mediation », Critical Inquiry, vol. 42, no 1, p. 124-148.
- LARRUE, Jean-Marc (2016), « Son, présence et ontologie : perspectives intermédiales sur les enjeux du son au théâtre », dans Jean-Marc Larrue et Marie-Madeleine Mervant-Roux (dir.), Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle) : histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne, Paris, CNRS éditions, p. 215-235.
- LARRUE, Jean-Marc (dir.) (2015), Théâtre et intermédialité, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, « Arts du spectacle – Images et sons ».
- LARRUE, Jean-Marc et Marie-Madeleine MERVANT-ROUX (dir.) (2016), Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle) : histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne, Paris, CNRS éditions.
- MCLUHAN, Marshall (2013 [1964]), Understanding Media: The Extensions of Man, Berkeley, Gingko Press.
- PHELAN, Peggy (1993), Unmarked: The Politics of Performance, Londres, Routledge.
- SALTER, Chris (2022), Sensing Machines: How Sensors Shape Our Everyday Life, Cambridge, MIT Press.
- STIEGLER, Bernard (2018), « La désorientation », dans La technique et le temps : 1. La faute d’Épiméthée – 2. La désorientation – 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être suivi de Le nouveau conflit des facultés et des fonctions dans l’Anthropocène, Paris, Fayard, « Sciences humaines », p. 315-578.
- VIGNEAULT, Alexandre (2021), « L’infini : fantastique odyssée », La presse, 24 juillet, www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2021-07-24/l-infini/fantastique-odyssee.php