Résumés
Résumé
Le présent article propose une lecture de M.I.L.F. (2018) de Marjolaine Beauchamp en analysant le rapport complexe au corps et à la sexualité des personnages au prisme de la philosophie du corps. En filiation avec la dramaturgie des années 1970-1980, qui a propulsé la parole féministe dans le paysage théâtral québécois, cette pièce contemporaine met en scène des personnages qui, par la parole, tentent d’accepter leur corps imparfait. Nous verrons de quelle manière leurs gestes s’agencent avec leurs mots et comment elles exercent leur agentivité sexuelle.
Mots-clés :
- dramaturgie contemporaine québécoise,
- M.I.L.F.,
- corps féminins,
- sexualité,
- agentivité,
- consentement
Abstract
This article offers a study of M.I.L.F. (2018) by Marjolaine Beauchamp, analyzing the characters’ complex relationship with their body and sexuality through the lens of the philosophy of the body. In line with the dramaturgy of the 1970s and 1980s, which propelled feminist discourse into Quebec’s theatrical landscape, this contemporary play depicts female characters who, through words, attempt to accept their imperfections. We will explore how their actions match their words and how they assert their sexual agency.
Corps de l’article
Apparue vers la fin des années 1960 avec la pièce Bien à moi (1969) de Marie Savard, la parole féministe est à son apogée dans le paysage théâtral québécois au cours de la décennie 1970, grâce aux oeuvres Les fées ont soif (1978) de Denise Boucher et La nef des sorcières (1976), projet collectif dirigé par Luce Guilbeault[1]. Cette dramaturgie présente plusieurs enjeux, liés notamment à la sexualité féminine et à l’émancipation des femmes (Saint-Martin, 1992 : 81). Dix ans plus tard, le corps féminin, sur scène, continue d’être exploré et les rôles sexualisés, déconstruits (Moss, 2009 : 23). Comme l’explique Élizabeth Plourde dans Figures du monologue théâtral ou Seul en scène, c’est à partir des années 1980 que « le monologue délaisse le domaine du public et ses préoccupations collectives pour sonder les territoires de l’intime » (Plourde, 2007 : 344). À cette époque, il est souvent utilisé pour aborder l’amour, le sexe et le corps, sujets qui sont aussi au coeur de la dramaturgie métaféministe des années 1990, dont fait partie, entre autres, Les quatre morts de Marie (1995) de Carole Fréchette. Dans cette pièce, la personnage[2] éponyme ne cesse de répéter « regardez-moi, regardez, regardez, je vous en prie, regardez-moi. Regardez mes mains, mon ventre, mon cou, mon dos » (Fréchette, 1995), faisant référence à ce voyeurisme que subissent les femmes de tout âge et suscitant ainsi une réflexion sur le regard que l’on pose sur elles et sur leur corps. Cette critique de la réalité immédiate qu’est celle des femmes est aussi reprise dans le théâtre contemporain. Le corps théâtral, autrefois politique, autrefois lieu revendiqué de réappropriation de soi, paraît, dans les années 2010, osciller dans ses représentations entre conformisme et marginalité (Tremblay, 2007 : 21). Il y a cinquante ans, les femmes sur scène revalorisaient leurs seins tombants, leur vagin comme source de plaisir, leurs cuisses invitantes et leur ventre mou porteur de vie, tel que le faisait la Fille dans À ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine : « ton ventre cache ton sang. Montre-moi ton sang, parle-moi de ton sang, du sang dans ton ventre! » (Gagnon et al., 1979 : 20). Cependant, dans la décennie 2010, période où s’inscrit l’oeuvre sur laquelle je me pencherai, le corps qui est valorisé en société est idéalisé. Il s’agit d’un corps qui, comme le mentionne la philosophe contemporaine Michela Marzano, « n’a pas d’odeur, sauf [celle] de quelque parfum à la mode, ni de mesures, sauf celles maîtrisées par la gymnastique et les régimes alimentaires » (Marzano, 2002 : 14). C’est un corps contrôlé, très loin du corps réel. Serait-ce donc plus difficile aujourd’hui, pour les autrices, de créer des personnages qui, sur scène, revendiquent leur corps tout en étant parfaitement conscientes qu’il ne correspond pas à l’image vendue par la société? C’est ce que je tenterai d’élucider à travers l’exploration de la parole monologuée des personnages de la pièce M.I.L.F. (2018) de l’autrice québécoise Marjolaine Beauchamp, texte qui s’inscrit dans la troisième vague féministe. Celle-ci, comme l’avance Micheline Dumont, « commence vers 1990 » (Dumont, 2005 : 63) – les chercheuses ne sont pas unanimes à ce sujet. N’en demeure pas moins que les autrices de la troisième vague veulent « renouveler les pratiques et les questionnements théoriques vis-à-vis, notamment, l’homogénéité d’un féminisme “intellectuel, blanc et hétérosexuel” » (Nengeh Mensah, 2004 : 14) qui est, lui, davantage associé au féminisme des années 1970-1980.
Dans un premier temps, il s’agira de cerner comment les personnages, dans leur discours, représentent et se représentent leur corps à travers leurs pratiques sexuelles. Avec M.I.L.F., Beauchamp parvient à présenter des personnages ultra-lucides et critiques de leur réalité. J’observerai notamment leur manière de concevoir les relations sexuelles : se placent-elles comme sujets de la relation, objets, ou instruments (Marzano, 2002 : 87)? Je m’intéresserai par la suite aux poétiques du désir exprimées en mettant de l’avant, entre autres, les manifestations de l’agentivité sexuelle – soit la capacité d’un sujet d’agir en fonction de ses propres désirs (Butler, 1995; Lang, 2011) – au sein des discours.
Artiste multidisciplinaire, Beauchamp a publié deux recueils de poésie aux éditions de l’Écrou : Aux plexus (2010), qui s’est mérité le prix littéraire Jacques-Poirier en 2011, et Fourrer le feu, publié en 2016. Il s’agit d’une artiste reconnue pour ses performances scéniques, notamment pour sa pratique du slam, une forme de poésie qui s’exerce oralement, sur un rythme scandé. Elle a aussi écrit deux pièces de théâtre, dont M.I.L.F. Publiée en 2018, celle-ci lui a valu le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec – Oeuvre de l’année en Outaouais la même année. Cette oeuvre aborde de front l’intimité, la pauvreté, la sexualité féminine et la maternité. Audacieux, le texte donne la parole à un groupe oublié, à des personnes à qui le droit de parole, le droit de se dire, a été enlevé : les mères monoparentales qui, en raison de leur double statut, celui de femme et celui de mère, sont rarement écoutées et souvent jugées par la société, comme le précise Lori Saint-Martin dans son analyse de la place qu’occupent les figures maternelles dans la littérature (Saint-Martin, 1994 : 115). Dans M.I.L.F., l’autrice met en scène trois mères, une MILF (« mother I’d like to fuck »), une MILK (« mother I’d like to kill ») et une MILS (« mother I’d like to save ») qui, à travers leur parole, tentent de se réapproprier leur corps et leur sexualité. Beauchamp aborde ainsi une réalité intime en plongeant dans le coeur de la vie de ses personnages. Je tenterai donc de définir les rapports que celles-ci entretiennent avec le corps et la sexualité. Contrairement à la MILF et à la MILK, la MILS n’a pas de rapports sexuels dans la pièce[3]. Je me pencherai surtout sur les deux premières afin d’examiner l’agentivité sexuelle à l’oeuvre dans le texte.
La MILF et le corps idéal
Dans M.I.L.F., les trois protagonistes racontent de manière crue leur vie, leur quotidien rempli de réussites et d’échecs. Elles parlent notamment de sexualité, de corps et de leur difficulté, en tant que mères monoparentales, à élever leurs enfants, à trouver du travail, à avoir une vie sexuelle épanouie. Les personnages semblent se représenter leur corps non pas comme un idéal à atteindre, mais comme une réalité à accepter. Le corps idéal est celui que le monde médiatique, le cinéma, les publicités, les vidéoclips nous bombardent : un corps « hégémonique qui tentera d’effacer toute différence raciale, ethnique et sexuelle » (Bordo, 2003 [1993] : 24) comme le constate Susan Bordo, philosophe américaine et féministe. Cependant, accéder à cet idéal n’est pas aussi facile pour tous·tes selon, notamment, le sexe, la classe sociale, l’âge. Dans le cas de M.I.L.F., comme les personnages appartiennent à une classe sociale démunie et qu’elles ont un corps maternel qui porte les traces d’un accouchement, il leur est plus difficile d’exercer un certain contrôle sur leur corps afin d’atteindre le corps idéal. Or, comme l’affirme Marzano, celui-ci est « compact, ferme, jeune, musclé » (Marzano, 2002 : 20), c’est-à-dire sujet à toute transformation. Il est le lieu de tout changement, de toute altération physique. Les femmes ont un corps et habitent leur corps. Marzano détaille cette double ontologie ainsi : « nous sommes notre corps tout en l’ayant » (ibid. : 83). Sans être seulement leur corps, les femmes cherchent à le façonner. Cette articulation oscille entre leurs goûts personnels et ceux de la société, qui encourage un physique éternellement jeune. Comme le précisait l’essayiste Naomi Wolf il y a déjà trente ans – et rien n’indique que la situation a changé –, le seul moyen pour les femmes de vieillir tout en demeurant sexuellement attirantes est de « bien vieillir » en gardant leur « air de jeunesse[4] » (Wolf, 1991 [1990] : 277). Et comme les personnages de la pièce M.I.L.F. n’ont ni un corps de jeune fille, parce qu’il a subi au moins un accouchement, ni l’argent pour recourir à des chirurgies esthétiques, leur corps réel, avec vergetures, cicatrices, gras, rides, est très loin du corps idéal, presque inatteignable. La MILF et la MILK alternent, dans leur discours, entre l’acceptation de leur corps réel qui, elles le savent, ne correspondra jamais au corps idéal, et leur désir de lui ressembler, de correspondre à cette idée de la mère parfaitement mince même après trois accouchements. Vers le milieu de la pièce, nous apprenons les circonstances dans lesquelles la MILF s’est séparée du père de son bébé. Par l’entremise d’un monologue intérieur, elle raconte la fin de leur relation :
(Beauchamp, 2018 : 45).J’étais fécondée
Comme un chevreuil
On était su’l’bord de s’laisser
Mais on l’savait pas encore
Elle précise que maintenant qu’elle est enceinte, le père de l’enfant à naître ne la voit plus comme une femme désirable qu’il convoite; elle est désormais une indésirable, un corps fécondé. La MILF nous partage sa conscience de son corps réel : un corps transformé par la grossesse, un corps qui serait « baisable » (idem) s’il était ferme et tonique. Consciente de son corps informe de « chevreuil », elle fait référence à elle-même en tant que femme « fécondée » et non « convoitée » (idem), fractionnant ainsi son image en deux. Comme le souligne Wolf, il est normal, pour les femmes, « puisqu’elles sont perçues d’un point de vue externe, masculin, que leur corps, supposé être familier, échoue à les faire sentir entières. Elles deviennent plutôt étrangères face à elles-mêmes et divisées en deux[5] » (Wolf, 1991 [1990] : 157). Et c’est ce qui arrive dans le cas de la MILF. Grâce à son discours, elle transmet sa conscience du corps idéal qu’elle n’est pas et ne possède pas, double ontologie mentionnée un peu plus haut, mais aussi de son « corps réel ou naturel, avec ses désirs et ses sensations » (Marzano, 2002 : 19).
Comme le rappelle Marzano, être enceinte ne signifie pas qu’on ne peut pas avoir d’envies sexuelles, et encore moins qu’il faut « renoncer à vivre dans son corps l’expérience de la grossesse afin de vivre librement sa sexualité » (ibid. : 110). La MILF, enceinte, demeure à l’écoute de ses désirs. Elle redécouvre son corps et peut enfin vivre une « relation avec sa propre corporéité et [une] nouvelle relation avec le monde extérieur » (ibid. : 113), ce qui explique peut-être sa première relation non hétérosexuelle. La lente acceptation de son corps réel se fait de plus en plus sentir au fil de la scène. Après avoir raconté sa séparation, elle relate son expérience avec une autre femme :
(Beauchamp, 2018 : 46).Elle me frenchait comme si j’étais un ananas juteux
Comme si j’tais pas passée date
Comme si j’tais mûre
[…]
C’tait la première fois qu’être une mère m’avait semblé
être du capital de consistance
À travers son monologue, elle aborde une expérience sexuelle qui lui donne l’occasion de se reconstruire, de vivre une sexualité plus douce et d’expérimenter le plaisir. Même si elle est loin du corps idéal, son apparence physique séduit pour ce qu’elle est réellement. Et le temps d’une rencontre, cette mère monoparentale arrête de se battre avec le corps idéal. La MILF prend conscience de son « capital de consistance », et son discours souligne sa capacité à séduire une autre femme avec son corps réel. Ainsi, une certaine paix règne au coeur de la MILF qui est confrontée à son corps réel, celui au ventre mou, aux vergetures saillantes, ce corps qui lui laisse croire malgré tout qu’elle peut encore séduire. Cette scène met ainsi en relief le chemin qu’elle a dû parcourir pour tranquillement accepter son corps réel qui lui permet en fin de compte de vivre une expérience sexuelle positive. De cette manière, sans totalement accueillir son corps réel, la MILF commence à l’apprécier, à le voir tel qu’il est : un objet de désir pour une personne qui sait le regarder. Or peut-il aussi exister aussi en tant que sujet désirant?
Le corps-sujet et le corps-objet
Puisque la sexualité n’existe pas sans le corps et que le plaisir sexuel, comme le désir sexuel, se situe dans le corps, sexualité et corps deviennent inséparables. Comme l’exprime Marzano, lorsqu’on parle d’envie sexuelle, il est question d’un sujet désirant, mais aussi d’un sujet désiré (Marzano, 2002 : 85). L’attirance sexuelle passe par l’attirance charnelle d’un·e autre étant donné qu’il « n’y a pas de désir entre deux esprits désincarnés, […] le désir requiert toujours la pensée du corps et l’existence de nous-mêmes et des autres comme créatures incarnées » (ibid. : 87). Cependant, nous ne projetons pas seulement nos envies vers le corps, mais aussi à travers lui (ibid. : 88). Et même si le corps est convoité, cela ne veut pas dire que la personne est réduite à celui-ci.
Dans M.I.L.F., l’ambivalence face à la représentation du corps comme objet ou sujet semble traverser les personnages. Il a été établi que la MILF peut se sentir désirée, malgré l’absence d’un corps idéal. En approfondissant l’analyse de la scène où elle partage un lit avec une femme, je tenterai d’établir si elle peut ressentir de l’attirance pour quelqu’un d’autre, si elle peut être sujet de son désir. Dans la scène intitulée « Icône », la MILF fait part du plaisir ressenti lors de cette relation sexuelle :
(Beauchamp, 2018 : 45-46).C’tait une sorte d’icône
[…]
J’me sentais sexy
Désirable
J’suis allée dans son lit
En traînant ma carcasse de trop d’chair
Mais j’tais légère
J’étais légère pis la vie était légère pis sa bouche
était puissante
[…]
J’préfère être celle qui goûte
Grâce aux caresses et aux baisers de sa partenaire, la MILF se sent « sexy », « [d]ésirable ». La bouche de cette « icône », avec qui elle partage un moment d’intimité, est si « puissante » qu’elle a la capacité de lui faire oublier le poids de son corps. Comme le précise Marzano, « dès qu’une personne devient l’objet du désir, le regard et les caresses du sujet désirant ont le pouvoir de l’incarner » (Marzano, 2002 : 92). Il est évident que la MILF est l’objet du désir de sa partenaire, mais cette objectivation du désir ne fait pas d’elle un instrument. Au contraire, elle est ici « l’objet d’une incarnation » (ibid. : 93; souligné dans le texte), ce qui fait qu’elle est reconnue dans sa subjectivité. Pour une rare fois dans la pièce, la MILF exprime qu’elle se sent vue pour ce qu’elle est, convoitée pour son « capital de consistance ». Son sentiment de confiance lui permet d’agir en fonction de son envie. Il y a possession réciproque. La MILF s’ouvre à l’autre, en même temps que le corps de celle-ci s’ouvre à elle, lui permettant de jouir de sa présence. Un corps-sujet est capable de désirer tout en se laissant désirer. C’est d’ailleurs le désir de la partenaire qui enflamme la MILF et qui la fait se sentir si bien qu’elle a la chance d’agir et de profiter pleinement de la relation. Le plaisir de la MILF transparaît dans sa parole, dans le choix des mots qu’elle utilise. En affirmant préférer « être celle qui goûte », elle laisse deviner une réelle satisfaction éprouvée lors des rapports sexuels.
Par ailleurs, même lors de ses relations avec des hommes, la MILF semble toujours sujet de son corps (ibid. : 89). Alors que les trois mères – réunies autour d’une seule et même table – échangent des confidences, la personnage de la MILF formule clairement, dans un long monologue, ses désirs et ses intentions envers les hommes plus mûrs :
(Beauchamp, 2018 : 37-38).Moi mon top fantasme, c’est de baiser un homme avec
du pouvoir
Un homme à l’aise
En anglais, on dit : « I wanna fuck the privilege out
of you »
C’est comme un cercle
Lui y veut baiser ma vulnérabilité, mes approximations,
mon intelligence, ma répartie […]
Moi j’veux baiser son pouvoir, son assurance, son cash,
même si j’m’en crisse de son cash, j’veux baiser son cash
J’veux être le boss, le t’nir dans ma main, voir sa p’tite
face distorsionnée par la jouissance, l’avoir vu l’échapper
Le best c’est qu’y soit pus capable de s’passer de moi,
qu’y veule me revoir souvent, pas nécessairement pour
le sexe, juste parce qu’y s’sent stimulé
La MILF rêve d’avoir des relations sexuelles avec des hommes riches et en situation de « pouvoir ». En plus d’espérer qu’ils la désirent, elle souhaite les revigorer. Il y a, ici encore, une possession réciproque qui réalise d’ailleurs une subjectivation mutuelle (Marzano, 2002 : 93). La MILF est parfaitement consciente de ses désirs et ne se laisse pas utiliser comme un simple objet. Se référant à plusieurs portraits nus féminins du XIXe siècle, l’auteur et critique d’art John Berger stipule que « la présence d’une femme exprime sa propre attitude face à elle-même, et définit ce qui peut ou ne peut pas lui être fait » (Berger, 1976 [1972] : 49). Mais ce que ce dernier extrait met en lumière, c’est plutôt la capacité, pour les personnages de la pièce, d’exprimer ce qu’elles ont l’intention de faire, et non ce qui peut leur être fait. Cette reprise du pouvoir par la MILF, qui affirme vouloir « être le boss, le t’nir dans [s]a main, voir sa p’tite / face distorsionnée par la jouissance », démontre son opposition aux fantasmes imposés par la société, selon lesquels la femme cherche à être désirée et regardée. Comme le résume si bien Berger, « être homme c’est agir, être femme c’est paraître. Les hommes regardent les femmes alors que les femmes s’observent en train d’être regardées » (ibid. : 51; souligné dans le texte). Mais dans cette scène, la MILF exprime, au contraire, son envie de « baiser [le] pouvoir, [l’] assurance, [le] cash » de son partenaire. Elle exhibe ainsi une sexualité décomplexée de tout jugement, ce qui lui permet d’afficher sa subjectivité.
Alors que la MILF partage son désir pour les hommes plus vieux, la MILK, grâce à un jeu de monologues croisés, relate sa nuit fantasmatique avec un homme noir, amorcée dans un taxi au retour d’une soirée bien arrosée :
(Beauchamp, 2018 : 41).C’est impressionnant de baiser avec un noir
Faut pas l’dire publiquement parce que ça fait fétichiste
Mais crisse, c’est marquant
J’saurais pas comment l’dire autrement
Ta peau blanche
Sa graine noire
Son dos, ses fesses
J’avais l’impression de faire de la magie
Mais c’est juste des flashs parce que j’tais saoule
en tabarnac
Ici, le mot « magie » laisse deviner qu’elle apprécie son expérience, qu’elle trouve désirable ce corps masculin et donc qu’elle agit en fonction de ses propres désirs. Les termes « criss, c’est marquant », « fétichiste », « graine noire » et « son dos, ses fesses » soulignent l’intérêt de la MILK pour le corps de son partenaire davantage que pour sa personne. L’autre est vu comme objet du désir plutôt que comme sujet.
En se référant à la théorie de Marzano, il est possible de comprendre que l’être humain dont le corps se retrouve objectivé peut tantôt être considéré comme un simple instrument d’assouvissement des désirs d’autrui, tantôt estimé pour sa personne et sa subjectivité. Il y a donc une énorme différence entre un corps-instrument et un corps-sujet (Marzano, 2002 : 91). La MILK ne rêve pas d’avoir une relation sexuelle avec l’homme lui-même, mais bien avec la représentation d’un homme noir. Il est l’instrument de ses fantasmes, de son fétichisme à l’égard duquel son discours exprime tout de même de la gêne : « Faut pas l’dire publiquement… ». Au fil de la scène, ses souvenirs laissent place à la manière dont elle est traitée pendant ces rapports sexuels :
(Beauchamp, 2018 : 41-42).Tu pues le sperme pis les fluides
T’es hangover
Pis t’essaies d’expliquer quelque chose à ta conscience
Mais dans ta tête ça hurle
WHAT THE FUCK?
Quessé que t’as faite?
Pis là tu t’rends compte que t’as mal au cul
Comme si ça dégelait d’un coup
T’as vraiment fucking mal au cul
Mais j’fourre jamais dans l’cul dans vie
Mais là tu l’sais en esti que tu l’as faite
T’es pas juste hangover
T’as pas juste baisé un beau corps noir
Tu t’es faite enculer!
Ahh… Mais y avait le tour
Y m’donnait des p’tites tapes su’é fesses
Esti j’avais hâte que quelqu’un me l’fasse
Ça m’fait feeler un peu sale
Plus ça avançait plus on essayait des trucs style film
de porn
Après ça
Fuck
J’m’en rappelle pus
J’avais juste mal au cul
La MILK se remémore, avec une certaine honte, le matin suivant sa nuit torride dans un taxi. Le plaisir ressenti avec cet homme est en effet mis en contraste avec la douleur du lendemain de veille. Il est flagrant, grâce à la présence de nombreux sacres, qu’elle vit ce qu’elle-même semble considérer comme une sexualité partiellement désirée. Les termes en lettres majuscules « WHAT THE FUCK » et l’affirmation « j’fourre jamais dans l’cul dans vie » l’indiquent clairement. Dans son monologue, la jeune femme évoque son état d’ébriété, lequel suggère qu’elle n’est pas parfaitement consciente lors des événements et que ses capacités d’agir et de vouloir sont altérées. Ainsi, il paraît aisé d’affirmer que son corps est, au moins en partie, utilisé en tant qu’instrument pour assouvir des désirs pervers, « des trucs style film / de porn ». De plus, tel que le souligne Marzano, « si l’objectivation implique une instrumentalisation de l’objet, la personne ainsi objectivée ne peut être rien d’autre qu’un outil » (Marzano, 2002 : 91). Dans ce cas-ci, la MILK donne l’impression de n’être qu’un moyen d’obtenir du sexe anal pour son partenaire.
La permission de la jeune femme n’est pas explicitement demandée : elle se fait convaincre par des tapes sur les fesses. Ses mots « Ahh… Mais y avait le tour » indiquent seulement que son partenaire a la bonne manière de la persuader et qu’elle avait secrètement envie « que quelqu’un [le lui] fasse ». La militante féministe Gayle Rubin rappelle qu’« une activité hétérosexuelle peut être choisie librement ou contrainte par la force » (Rubin, 2010 [1984] : 198) et donc que ce n’est pas parce qu’il y a une relation entre un homme et une femme, en couple ou non, qu’il y a nécessairement consentement. Le consentement, comme le rappelle le professeur en sciences sociales Jacques Marquet, est le « critère ultime de relations légitimes, [et] traduit une transformation radicale du rapport entre les hommes et les femmes qui s’incarne dans une parole libérée » (Marquet, 2011 : 34). Toutefois, la MILK ne peut s’exprimer, son consentement n’est pas vérifié. Même si elle dit avoir eu « hâte que quelqu’un [le lui] fasse », rien, du moins dans son langage verbal, n’indique son envie d’avoir ce genre de relation sexuelle à ce moment-là. Par ailleurs, son désir inavoué d’avoir des relations anales se trouve tout de même assouvi, mais non grâce à une prise d’initiative de sa part, puisque son taux d’alcool l’empêche de prendre des décisions éclairées et d’exprimer son intention dormante. C’est en fait grâce à l’homme qui use de son pouvoir d’influence pour pratiquer la sodomie qu’elle se fait « enculer ». Cette scène met ainsi en évidence toute l’ambiguïté entourant le consentement. Qu’est-ce qu’un acte consentant? Quand est-ce qu’il y a agression? Où est la limite? Certes, dans ce cas-ci, l’homme amorce le mouvement, mais l’alcool désinhibe la MILK et lui permet d’assouvir son désir autrement inexprimé. Ici, la MILK consent « mollement[6] », en plaçant, passivement, son corps dans une position d’objet. On désire son corps-instrument. Et lorsque quelqu’un se voit réduit à son corps-instrument, « le désir devient urgence et l’acte sexuel devient obscène en se séparant de l’intentionnalité des acteurs et en dépersonnalisant l’objet du désir » (Marzano, 2002 : 101). Ainsi, la singularité de la MILK s’efface au profit de sa capacité à satisfaire le besoin urgent de la personne qui désire, l’homme.
Les personnages de M.I.L.F. ont une sexualité où désirs et fantasmes s’entremêlent. Les relations sexuelles décrites par la MILF témoignent d’une telle réciprocité qu’elles permettent aux désirs de grandir : le corps qu’autrui a et est s’ouvre ainsi à l’autre (ibid. : 95)… comme « un ananas juteux ». Au contraire, les relations sexuelles racontées par la MILK semblent parfois n’être que des moyens d’assouvir des envies : le corps devient presque une source de honte, de gêne. L’absence de consentement clair et de verbalisation du désir chez la MILK contraste étrangement avec l’expression marquée des envies sexuelles de la MILF, ce qui fait se demander si toutes deux manifestent une agentivité sexuelle – soit la capacité de se respecter soi-même et ses propres désirs (Lang, 2011 : 91).
L’agentivité sexuelle
Dans la scène où la MILK raconte sa première fois avec un homme noir, ses rapports sexuels semblent s’inscrire dans une relation de pouvoir où il y a domination d’une personne sur une autre. Néanmoins, il n’est pas automatiquement exclu de penser que la relation sexuelle puisse être agentive : comme l’énonce la philosophe et féministe américaine Judith Butler, avoir des relations sexuelles qui se situeraient « “en dehors” ou “au-delà” du pouvoir est une impossibilité culturelle et un rêve politiquement irréalisable » (Butler, 2005 [1990] : 106). Tel que le précise la doctorante en communication Marie-Ève Lang, « il y a donc une distinction à établir entre le comportement en tant que tel et les motifs qui justifient et guident la décision d’adopter un comportement » (Lang, 2011 : 194). La MILK entretient une relation sexuelle dans laquelle son partenaire la domine; elle se fait « enculer » en étant utilisée comme objet de désir. Mais elle a ce rapport sexuel par envie, tel qu’en témoignent ses paroles : « j’avais hâte que quelqu’un me l’fasse ». Avec son langage cru – « Tu pues le sperme pis les fluides »; « T’as vraiment fucking mal au cul » – la personnage parvient à dépeindre une image qui s’oppose à celle proposée par la pornographie hétérosexuelle, où la pénétration semble très agréable pour la femme, et où il n’y a ni odeur ni douleur[7] (Butler, 2015 : 186). C’est donc « à travers ce déplacement qu’il est possible d’entrevoir une diversité de formes d’agentivité sexuelle » (Lavigne, Laurin et Maiorano, 2013 : 53). Ses paroles « Esti j’avais hâte que quelqu’un me l’fasse / Ça m’fait feeler un peu sale » expriment son désir d’avoir des relations anales, puis la satisfaction de se sentir « un peu sale ». L’intention est présente, tout comme la critique de l’image pornographique traditionnelle. En tenant compte, comme l’explique la sexologue Carol Queen dans le film éducatif Bend Over Boyfriend (1998), que les femmes ne sont pas habituées à exprimer ce qu’elles veulent (Butler, 2015 : 191), le fait que la MILK réussisse à nommer son désir pour les hommes noirs permet de qualifier son expérience comme étant partiellement agentive : l’agentivité sexuelle, rappelle Lang, ne se limite pas à l’agir, elle renvoie aussi à l’idée de l’expression de sa sexualité (Lang, 2011 : 191). Ce n’est donc pas nécessairement par l’action que la MILK devient agentive, car elle la subit plutôt qu’elle ne l’initie, mais bien par la parole. Cependant, elle ne parvient à formuler son attirance envers les corps noirs et à critiquer sa relation sexuelle que par la suite, lorsque la relation anale est terminée depuis longtemps. Son agentivité demeure donc limitée, vu qu’elle a été incapable, en raison de son état d’ébriété peut-être, d’exprimer ses limites pendant l’acte sexuel (Hammers, 2009 : 782).
Une agentivité plus assumée
Marie-Ève Lang, qui s’appuie sur les travaux de Sharon Lamb (2010), souligne que l’agentivité sexuelle des femmes se définit en fonction des choix qu’elles font pour réaliser leurs propres désirs et non en fonction d’un discours dominant, soit celui de l’hétéronormativité (Lang, 2011 : 193). L’agentivité sexuelle permet donc de transgresser les scripts sexuels établis. La théorie sociologique des scripts sexuels élaborée par William Simon et John Gagnon (1973) postule qu’il y a des scénarios, des représentations culturelles, qui sont perpétués par la culture à travers les médias, la littérature, les publicités et les discours sociaux; ils donnent l’opportunité de faire des liens avec ce que nous percevons comme sexuel, comme désirable dans une société. Heureusement, il y a toujours des variations interprétatives personnelles de ces scénarios qui proviennent des scripts intrapsychiques de chacun·e (Gagnon, 2008 [2004] : 78). La transgression du script sexuel, selon la professeure en théories féministes Lucie Guillemette, se fait d’ailleurs au moyen de la triade regard-parole-action qui consiste en
une prise de conscience, au moyen du regard, des mécanismes d’oppression enfermant la femme dans l’idéologie dominante, puis en une affirmation, par le biais de la parole, d’un désaccord quant aux croyances imposées par cette idéologie. Le sujet féminin peut poser des gestes significatifs à l’intérieur même de ce système dans le but de transgresser l’ordre établi et de proposer de nouvelles significations
(Guillemette, 2005 : 156).
Si l’on reprend la scène où la MILF explore sa sexualité avec une autre femme, il est possible d’observer que la personnage suit parfaitement cette triade. Au début, elle observe cette femme qu’elle trouve magnifique, qu’elle compare à « une sorte d’icône » (Beauchamp, 2018 : 45). Ensuite, elle communique son désir par la parole, puis elle passe finalement à l’acte en l’embrassant, en profitant de chaque parcelle de son corps :
(ibid. : 46).Je l’ai savourée en mettant tous mes silences accumulés
dans mes gestes
Elle qui semblait avoir accès à tout l’plaisir du monde
Elle qui n’avait pas besoin de moi
Se recroquevillait, happée par ma dévotion
Les termes « savourée », « gestes » et « dévotion » indiquent que la MILF exerce sa capacité d’action. Elle agit en fonction des désirs qui sont les siens et qui dévient des scripts dominants. Tout en s’affirmant hétérosexuelle, elle a des relations sexuelles avec une femme. Et même si cette agentivité ne se perpétue pas dans le temps, puisque son désir s’estompe à un certain moment, la MILF parvient à l’exprimer en agissant selon ses propres envies qui, par le fait même, rompent avec les scripts hétérosexuels.
Le non-respect du script hétérosexuel se lit non seulement dans le genre de la partenaire, mais aussi dans son statut d’amante. La MILF trompe son amoureux alors que le script hétérosexuel privilégie les relations exclusives, non libertines. La MILF mentionne que sa relation avec l’autre femme s’est déroulée tandis qu’elle était encore en couple avec le père de son futur enfant, au moment où leur relation faiblissait :
(ibid. : 45).Montréal
Pas baisée enceinte
Pas baisable
Le père disait que c’tait parce qu’on s’chicanait trop
Mais moi je l’savais
J’étais rendue dans league de sa mère
J’étais pus la convoitée
Ici, le script hétérosexuel – avoir des relations sexuelles avec son·sa conjoint·e du sexe opposé – ne convient plus ni à l’homme ni à la femme. Il fait défaut : parmi les éléments jugés propres à susciter excitation et désir, la variable de la jeunesse est absente. En effet, tel que le précise Joëlle Papillon, professeure spécialiste de la littérature contemporaine des femmes, « la femme désirée [dans les scripts sociétaux hétérosexuels] est par définition jeune : lolita » (Papillon, 2013 : 176). Ainsi, jugeant qu’elle intègre la « league de [l]a mère » de son conjoint, la MILF estime qu’elle s’éloigne trop de la « lolita » pour être désirée par lui. De ce fait, elle est d’autant plus incitée à chercher ailleurs une relation sexuelle qui lui conviendrait mieux que celle proposée par le système hétéronormatif. Effectivement, l’hétéronormativité joue un grand rôle dans ce que nous percevons comme sexuel et désirable. Comme l’affirment les conférencières en sociologie Stevi Jackson et Sue Scott, elle propage la supposition selon laquelle « les femmes et les hommes sont “faits pour être ensemble” par l’entremise d’une définition commune de ce qu’est “l’acte sexuel”, soit la pénétration vaginale par le pénis[8] » (Jackson et Scott, 2010 : 92). De cette manière, elle encourage une « sexualité […] censée se conformer à un modèle unique » (Rubin, 2010 [1984] : 163). Et bien que plusieurs chercheuses féministes aient contesté cette idée, elle persiste plus que jamais dans cette ère du viagra (Jackson et Scott, 2010 : 92). Toutefois, certaines oeuvres de fiction montrent qu’il est possible de modifier les scripts propagés par la société, comme le fait M.I.L.F. par l’entremise de la scène intitulée « Icône ». La MILF est non seulement placée dans la position de celle qui désire, mais présentée en tant que femme qui en désire une autre.
***
Enfin, même si la MILF et la MILK n’agissent pas nécessairement, ou pas complètement, à l’encontre des scripts prescrits pas la société patriarcale, leur regard critique envers leur comportement les amène à prendre en considération ce qu’elles veulent réellement, sans pour autant l’assumer pleinement dans leur corps et leur sexualité. Leur rapport à ces deux éléments demeure ambigu : ce sont des sujets parlants critiques, mais dont les actions sont ambivalentes. Dotées d’une conscience aiguë de la réalité dans laquelle elles vivent, les femmes de cette pièce sont capables de distinguer leur corps réel du corps idéal propagé par la société, tout en l’estimant désirable. Ce processus vers l’acceptation d’elles-mêmes semble néanmoins plus concevable lorsqu’elles ne se restreignent pas au schème de l’hétéronormativité.
Apparaissant tantôt comme les sujets de leur sexualité, tantôt comme des objets, les personnages n’en demeurent pas moins agentives : même si elles n’arrivent pas toujours à agir en fonction de leur désir, elles sont capables de critiquer leurs comportements sexuels. Si, pour Marzano, il existe une opposition entre la subjectivation et l’instrumentalisation d’un corps sexué, les personnages de cette pièce parviennent à faire cohabiter ces deux modalités. En utilisant la définition plus neutre de l’agentivité sexuelle proposée par Julie Lavigne, Audrey Laurin et Sabrina Maiorano, soit « [la capacité d’imiter] la norme de la représentation sexualisée du corps féminin pour mieux la déplacer, la subvertir » (Lavigne, Laurin et Maiorano, 2013 : 53), on peut mettre en évidence le fait que la MILK et la MILF réussissent à se positionner en tant qu’instruments de leur sexualité, tout en opérant une certaine déformation critique de l’image pornographique / érotique traditionnelle. En somme, bien que les deux personnages reproduisent les scénarios traditionnels d’objectivation du corps féminin, comme le fait la MILK dans une voiture de taxi, leur critique acerbe de leur propre sexualité font d’elles, à travers la prise de parole, des femmes en possession de leur puissance d’agir.
En outre, c’est en présence les unes des autres qu’elles parviennent à articuler leurs désirs. Leur amitié et leur complicité, le soutien qu’elles se portent, n’ont pu être explorés davantage. Or cette proximité féminine ne constitue-t-elle pas en elle-même un lieu sûr propice à leur croissance personnelle, à l’expression de leur personne? Ces personnages, qui oscillent entre l’acceptation de leur corps réel et le désir d’un corps idéal, entre l’instrumentalisation et la subjectivation de leur corps, réussissent à porter un regard lucide sur leur réalité, à l’exprimer devant leurs consoeurs et, de ce fait, à exercer une certaine agentivité, quoique limitée dans le cas de la MILK. Leur cohésion groupale, qui fait écho au caractère collectif qui caractérisait les pièces des années 1970, serait peut-être partiellement responsable de cette propension à l’expression de soi.
« Nous voici devant toi debout, nouvelles. Imagine » (Boucher, 1989 [1978] : 100), scande la Statue au nom de toutes les femmes à la fin de la pièce Les fées ont soif de Boucher. Des femmes qui, par la parole, reprennent possession de leurs corps. Et ce cri trouve écho dans la pièce M.I.L.F., plus contemporaine. « On s’fait une brigade de connes, de folles, de putes, / de salopes, de nymphettes, de MILF, de cougars, de / malades mentales, de borderlines, de maniaques » (Beauchamp, 2018 : 60), hurlent les trois personnages. Parleuses, dénonciatrices, ces femmes osent, elles aussi, dénoncer les attentes inatteignables de la société envers elles, leur sexualité et leur corporalité. Leur cri du coeur, leur cri du corps, associés au théâtre des femmes et issus de celui-ci, résonnent encore aujourd’hui. Et j’espère qu’on pourra continuer, pendant longtemps, d’entendre le cri de ces personnages, de ces femmes qui, à travers la fiction, font fi des tabous et parlent de leur réalité sexuelle, personnelle, politique[9] (Moss, 2005 : 118). Je crois sincèrement que la parole de ces femmes irrévérencieuses se doit d’être entendue. Et si la parole des femmes pouvait fracasser les murs? « Imagine. Imagine. Imagine » (Boucher, 1989 [1978] : 100)...
Parties annexes
Note biographique
Marie-Andrée Labonté-Dupuis a complété un certificat en création littéraire (2015) et une maîtrise en études littéraires (2021) à l’Université du Québec à Montréal, sous la direction de Catherine Cyr. Son mémoire portait sur les imaginaires du rapport au corps et à la sexualité exprimés, à travers différents dispositifs d’énonciation, par les personnages de deux oeuvres dramaturgiques québécoises contemporaines. Depuis longtemps intéressée par l’image corporelle des femmes en société, elle publie, pour la revue Artichaut, un texte de fiction portant lui aussi sur le corps féminin (2018). Elle est actuellement enseignante de français et littérature au Collège Champlain et s’assure, dans chacun de ses cours, de donner aux autrices la place qui leur revient.
Notes
-
[1]
Ce texte reprend quelques concepts déjà analysés dans le cadre de mon mémoire, « Les imaginaires du rapport au corps et à la sexualité à travers la parole féministe des pièces de Marjolaine Beauchamp et La fureur de ce que je pense de Marie Brassard » (2021). Toutefois, il s’attarde seulement sur la pièce M.I.L.F et pousse plus loin et plus en profondeur mes réflexions, ce qui permet de dégager un rapport à la sexualité plus nuancé et complexe.
-
[2]
Dans le cadre de cet article, le nom « personnage » prendra le genre féminin.
-
[3]
Je souligne que la pièce sur laquelle je me concentre porte sur des imaginaires du féminin qui sont hétérosexuels, cisgenres et hétérocentrés, puisque le genre des personnages coïncide avec leur corps et leur identité personnelle, et que ces personnages, sauf la MILF, ont exclusivement des relations sexuelles avec des hommes et se présentent comme hétérosexuelles. Par ailleurs, le terme même de « MILF » désigne un genre pornographique hétérosexuel. Une pornographie créée par des hommes, pour des hommes, et mettant en scène des femmes d’âge mûr qui susciteraient le désir de jeunes garçons : a mother I’d like to fuck. Compte tenu de l’origine du terme, et de la façon dont celui-ci irrigue l’imaginaire de la pièce, il me serait difficile de situer mon analyse à l’extérieur du cadre hétérocentré.
-
[4]
« We claimed the freedom to age and remain sexual, but that rigidified into condition of aging “youthfully” ». Toutes les citations en anglais de cet article ont été traduites par mes soins.
-
[5]
« Since their bodies are seen from the point of view of strangeness, and desire, it is no wonder that what should be familiar, felt to be whole, becomes estranged and divided into parts. What little girls learn is not the desire for the other, but the desire to be desired ».
-
[6]
Cette citation provient de l’article « Étranges “séductions” » (2015) de Lori Saint-Martin, publié sur le site de Françoise stéréo qui n’est plus disponible.
-
[7]
D’ailleurs, comme le souligne Heather Butler, le plaisir, dans ce genre de pornographie, se situe « du côté de celui qui pénètre, et les preuves du plaisir “viennent” sous forme d’éjaculation du pénis » (Butler, 2015 : 186), non pas d’un orgasme féminin.
-
[8]
« […] women and men are “made for each other” is sustained through the commonsense definition of vaginal penetration by the penis as “the sex act” ».
-
[9]
« Le privé est politique » est un slogan utilisé par les féministes dès les années 1960, mais popularisé dans les années 1970. Il visait la libération des femmes dans la vie privée.
Bibliographie
- BEAUCHAMP, Marjolaine (2018), M.I.L.F., Montréal, Somme toute, « Répliques ».
- BEAUCHAMP, Marjolaine (2016), Fourrer le feu, Montréal, L’Écrou.
- BEAUCHAMP, Marjolaine (2010), Aux plexus, Montréal, L’Écrou.
- BERGER, John (1976 [1972]), Voir le voir, trad. Monique Triomphe, Paris, Alain Moreau.
- BORDO, Susan (2003 [1993]), Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body, Berkeley, University of California Press.
- BOUCHER, Denise (1989 [1978]), Les fées ont soif, Montréal, Typo, « Théâtre ».
- BUTLER, Heather (2015), « Que dit-on d’une lesbienne aux doigts longs? : le développement de la pornographie lesbienne et gouine », dans Florian Vörös (dir.), Cultures pornographiques : anthologie des porn studies, Paris, Amsterdam, p. 161-193.
- BUTLER, Judith (2005 [1990]), Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, trad. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte.
- BUTLER, Judith (1995), « For a Careful Reading », dans Seyla Benhabib et al., Feminist Contentions: A Philosophical Exchange, Londres, Routledge, « Thinking Gender », p. 127-143.
- DUMONT, Micheline (2005), « Réfléchir sur le féminisme du troisième millénaire », dans Maria Nengeh Mensah (dir.), Dialogues sur la troisième vague féministe, Montréal, Remue-ménage, p. 59-73.
- FRÉCHETTE, Carole (1995), Les quatre morts de Marie, Montréal, Les Herbes rouges, « Théâtre ».
- GAGNON, Dominique et al. (1979), À ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine, Montréal, Remue-ménage.
- GAGNON, John (2008 [2004]), « L’utilisation explicite et implicite de la perspective des scripts dans les recherches sur la sexualité », dans Les scripts de la sexualité : essais sur les origines culturelles du désir, trad. Marie-Hélène Bourcier, Paris, Payot, « Essais Payot », p. 69-135.
- GAGNON, John et William SIMON (1973), Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality, Chicago, Aldine.
- GUILBEAULT, Luce et al. (1976), La nef des sorcières, Montréal, Quinze.
- GUILLEMETTE, Lucie (2005), « Les figures féminines de l’adolescence dans l’oeuvre romanesque d’Anne Hébert : entre le mythe du prince charmant et l’agentivité », Globe, vol. 8, no 2, p. 153-177.
- HAMMERS, Corie (2009), « Space, Agency, and the Transfiguring of Lesbian / Queer Desire », Journal of Homosexuality, vol. 56, no 6, p. 757-785.
- JACKSON, Stevi et Sue SCOTT (2010), « Is Heterosexuality Still Compulsory », dans Theorizing Sexuality, Maidenhead, Open University Press, p. 74-100.
- LAMB, Sharon (2010), « Feminist Ideals for a Healthy Female Adolescent Sexuality: A Critique », Sex Roles, vol. 62, p. 294-306.
- LANG, Marie-Ève (2011), « L’“agentivité sexuelle” des adolescentes et des jeunes femmes : une définition », Recherches féministes, vol. 24, no 2, p. 189-209.
- LAVIGNE, Julie, Audrey LAURIN et Sabrina MAIORANO (2013), « Images du désir des femmes : agentivité sexuelle par la subversion de la norme érotique ou pornographie objectivante », dans Isabelle Boisclair et Catherine Dussault Frenette (dir.), Femmes désirantes : art, littérature, représentations, Montréal, Remue-ménage, p. 35-55.
- MARQUET, Jacques (2011), « Clés pour comprendre la sexualité contemporaine », La revue nouvelle, nos 7-8, revuenouvelle.be/Cles-pour-comprendre-la-sexualite-contemporaine/
- MARZANO, Michela (2002), Penser le corps, Paris, Presse Universitaires de France, « Questions d’éthique ».
- MOSS, Jane (2005), « Carole Fréchette et le théâtre au féminin », The French Review, vol. 78, no 6, p. 1117-1126.
- NENGEH MENSAH, Maria (dir.) (2005), « Une troisième vague féministe au Québec? », introduction à Dialogues sur la troisième vague féministe, Montréal, Remue-ménage, p. 11-30.
- PAPILLON, Joëlle (2013), « Derrière le masque : la disparition du désir féminin dans l’oeuvre de Nelly Arcan », dans Isabelle Boisclair et Catherine Dussault Frenette (dir.), Femmes désirantes : art, littérature, représentations, Montréal, Remue-ménage, p. 143-156.
- PLOURDE, Élizabeth (2007), « Explorer les territoires de l’intime : le monologue dans la nouvelle dramaturgie québécoise », dans Irène Roy (dir.), Figures du monologue théâtral ou Seul en scène, Montréal, Nota bene, « Convergences », p. 343-356.
- REDNOUR, Shar et Jackie STRANO (1998), Bend Over Boyfriend, San Fransisco, S.I.R. Video Productions.
- RICH, Adrienne (1981), « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles questions féministes, no 1, p. 15-43.
- RUBIN, Gayle (2010 [1984]), « Penser le sexe », dans Surveiller et jouir : anthropologie politique du sexe, Paris, Epel, « Les grands classiques de l’érotologie moderne », p. 135-210.
- SAINT-MARTIN, Lori (1994), « Le corps et la fiction à réinventer : métamorphoses de la maternité dans l’écriture des femmes au Québec », Recherches féministes, vol. 7, no 2, p. 115-134.
- SAINT-MARTIN, Lori (1992), « Le métaféminisme et la nouvelle prose féminine au Québec », Voix et images, vol. 18, no 1, p. 78-88.
- SAVARD, Marie (1979 [1969]), Bien à moi, Montréal, La Pleine Lune, « Théâtre ».
- TREMBLAY, Larry (2007), « One Body Show », dans Irène Roy (dir.), Figures du monologue théâtral ou Seul en scène, Montréal, Nota bene, « Convergences », p. 13-21.
- WOLF, Naomi (1991 [1990]), The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women, New York, William Morrow.

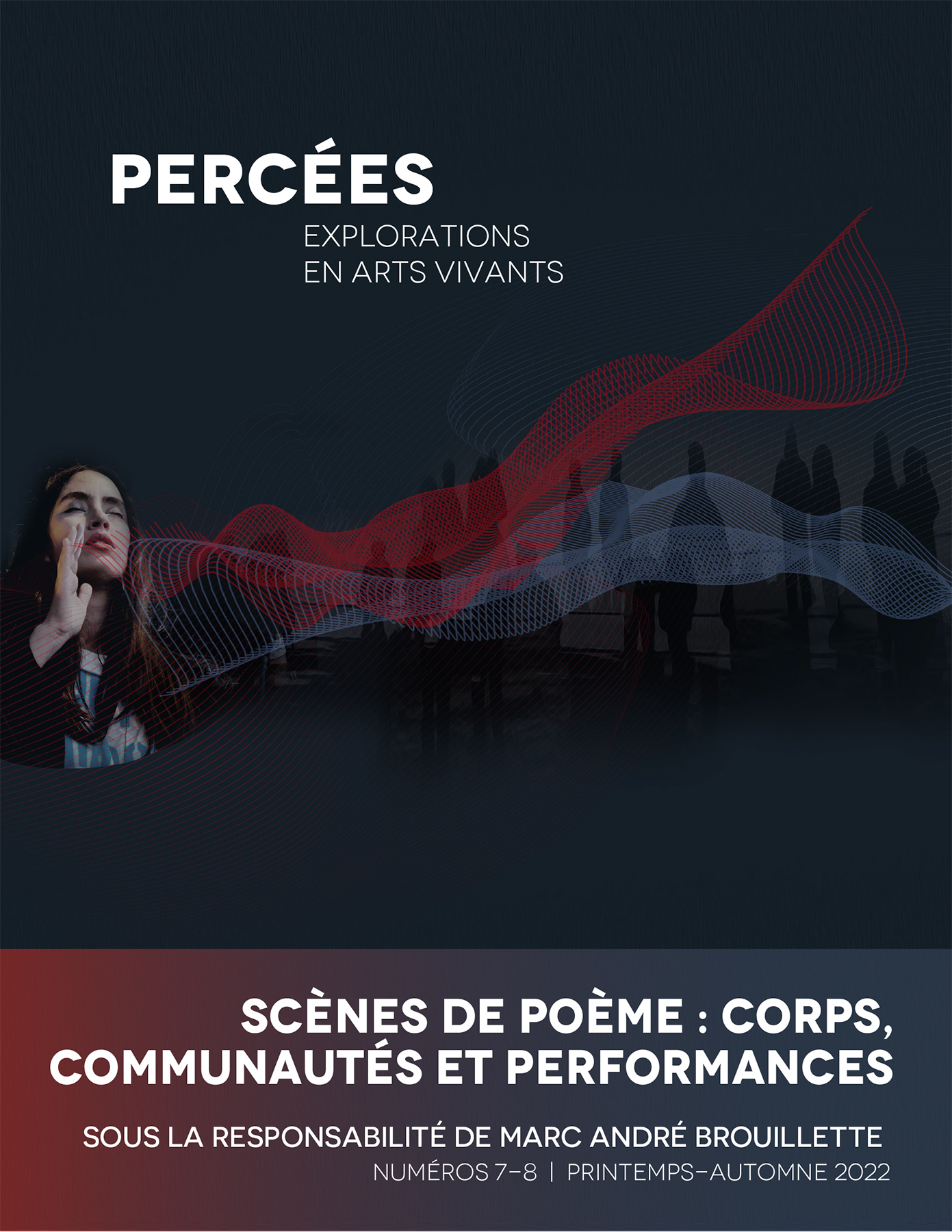


 10.7202/1000913ar
10.7202/1000913ar