Résumés
Résumé
Cet article propose le témoignage de l’écrivain et chercheur en littérature Stéphane Ledien. Celui-ci revient sur trois expériences d’écriture marquantes : l’une au sein d’un atelier d’artistes peintres situé dans une bâtisse ancestrale à Québec, l’autre dans les cabinets d’écriture de la célèbre Maison de la littérature, la troisième enfin dans la revue numérique Le Crachoir de Flaubert. De la présence attentive en des lieux inspirants à l’exploration des possibilités infinies de l’espace numérique en passant par l’influence des architectures et des ambiances, l’auteur analyse les liens qui, dans le processus créatif, se sont tissés entre le sensible et l’imaginaire, et entre le physique et le virtuel.
Mots-clés :
- création littéraire,
- inspiration,
- espace-temps,
- atelier d’artiste,
- écriture créative
Abstract
In this article, writer and researcher Stéphane Ledien reflects on three significant moments of writing: one within a painters’ workshop located in an ancestral building in Québec, another in the writing rooms of the famous Maison de la littérature, and the third in the digital magazine Le Crachoir de Flaubert. From the attentive presence in inspiring places to the exploration of the infinite possibilities of the digital space, passing through the influence of architectures and atmospheres, the author analyzes the links that, in the creative process, have been woven between the sensory and the imaginary, and between the physical and the virtual.
Corps de l’article
En guise d’introduction : se présenter aux autres comme à soi
Écrivain de fiction, mais aussi directeur littéraire, rédacteur, enseignant et chercheur-créateur en études littéraires, je gagne principalement ma vie par l’écriture. Comme bon nombre de mes pairs auteur·trices, je dois m’approprier des espaces de travail autres que mon domicile pour trouver le calme et sortir du cadre des contingences purement quotidiennes. Cette nécessité côtoie l’idée que « l’artiste est entouré de multiples environnements, qu’ils soient familiaux, socio-culturels, économiques, matériels ou géographiques, qui encadrent et influencent son oeuvre, mais [qu’]il y a aussi l’environnement que l’artiste se crée lui-même […], celui de l’atelier » (Korff-Sausse, 2016 : 23). C’est précisément cet environnement protéiforme que je me propose d’aborder à travers le récit et l’analyse de trois expériences différentes en tant qu’écrivain-chercheur.
Permettez-moi d’abord d’établir un état des lieux de mes expériences en lien avec la notion d’atelier, aussi bien physique que symbolique, à la fois comme cadre géographique et spatial, et comme activité dans le moment présent.
Centre d’Art Maison Blanchette, Québec (Canada), 2021.
De l’atelier traditionnel à l’espace numérique, le cheminement d’une pensée et d’une écriture
En 2013 et en 2014, j’ai bénéficié, en tant qu’écrivain en début de carrière, d’une résidence d’artiste au sein d’une galerie-atelier au Centre d’Art dit « Maison Blanchette[1] » de Cap-Rouge, un quartier résidentiel au bord du Saint-Laurent dans l’agglomération de Québec. J’y ai notamment avancé l’écriture de ce qui est devenu en 2015 le roman noir Sur ses gardes et en 2017, le recueil de nouvelles Des trains y passent encore (textes où se croisaient les genres du noir, de l’étrange et du récit historique). L’immersion dans un univers pictural, de même que le caractère ancestral des lieux (c’était une bâtisse historique) et la fréquentation au quotidien de femmes artistes peintres aux parcours riches de sens ont contribué à l’émergence d’une écriture truffée d’expériences sensorielles et d’images fortes (métaphores, comparaisons, hypotyposes, gradations, etc.). Certes, cette écriture, « chacun [la] porte en soi avant de venir » s’attabler ici ou là pour créer; « [n]éanmoins, l’atelier [comme espace] met à la disposition de [chaque artiste] des conditions et des ressources indispensables à la production de la création » (Lamy, 2009 : 39).
En 2017 et en 2018, j’ai ensuite souvent disposé de l’un des cabinets d’écriture de la Maison de la littérature[2] (administrée par l’Institut canadien de Québec), et j’ai ainsi pu profiter à nouveau d’un univers stimulant et inspirant pour progresser dans mes expérimentations. Avec une discipline incitée par l’épure architecturale de cet espace unique en Amérique du Nord, j’y ai mené deux chantiers d’écriture de roman noir d’une grande ampleur, romans dont au moins l’un d’eux devrait mener à une publication d’ici l’hiver 2024.
De 2019 à 2021, enfin, j’ai effectué une résidence d’écriture, virtuelle cette fois, d’une durée d’un peu plus d’un an et demi, au Crachoir de Flaubert, revue en ligne consacrée à la création et à la réflexion sur la création en milieu universitaire, et qui a par ailleurs été la première à s’intéresser à la notion de recherche-création. Même si le comité de rédaction m’avait donné carte blanche, je me suis inscrit, en acceptant cette résidence, dans un contexte de création à la fois universitaire, détaché (la virtualité y était pour quelque chose) et ancré dans mon intimité de par les sujets que j’ai choisi d’aborder[3]. Cette résidence, en fin de compte, a pris des allures d’atelier d’écriture avec moi-même. J’y ai notamment découvert ce qu’était
l’essence même du travail d’atelier; c’est-à-dire le point autour duquel la question de la création (et du style lui-même) cesse d’être […] l’expression d’un lyrisme personnel pour devenir un travail de détachement de soi. Un travail, si l’on veut bien, par lequel l’auteur se dégage de la certitude de déjà savoir quelque chose pour entrer tout entier dans une activité de connaissance nouvelle, dans une tension esthétique
(Lapierre, 1994 [1988] : 13).
On le voit, j’ai développé et bénéficié en dix ans de trois approches d’isolement à visée créative. Il s’agit maintenant de rendre compte des façons d’être et d’écrire pleinement dans le moment présent, au sein de ces structures et formes de résidence artistique certes très différentes, mais complémentaires.
La phénoménologie du lieu de création, entre clôture et infinité des possibilités
L’atelier, nous dit la psychanalyste Simone Korff-Sausse, est « le lieu de l’univers secret de la création » (Korff-Sausse, 2016 : 24). Mais ne peut-on pas dire aussi que le lieu de la création recèle des secrets qui influencent l’écriture (dans mon cas) ou la création en général?
Dans sa thèse sur la création littéraire, Jean-Simon Desrochers aborde « la pertinence d’une phénoménologie de l’être au monde dans un contexte où le nécessaire rapport à l’autre relève d’un acte de création, de simulations incarnées des états de l’autre […] [qui] peut être texte, image, trace ou tout autre sujet intentionnellement déterminé comme figure d’altérité » (Desrochers, 2014 : 287; souligné dans le texte). Cette phénoménologie, l’écrivain·e en résidence ou qui oeuvre, par exemple, au sein d’ateliers d’artistes, la vit avec une certaine intensité : soit il·elle la met en application consciemment, soit il·elle se laisse guider par elle. Dans tous les cas, des influences se jouent et des cadres, tout autant abstraits que concrets, se créent.
Le pictural comme expérience sensorielle
Isabelle L’Italien-Savard postule que la peinture « aide à comprendre certaines caractéristiques des courants littéraires en montrant une façon différente de les exprimer » (L’Italien-Savard, 2011 : 30). En côtoyant des femmes artistes peintres et en évoluant dans le même univers qu’elles, je me suis sans cesse rappelé cette clé de lecture de la littérature d’autrefois. L’essayiste explique le processus intellectuel et instinctif dont il est question : « Chacune [de ces différentes disciplines] illustre, avec les moyens dont elle dispose, la vision du monde dans lequel elle baigne et dont elle veut tirer un sens pour le mouler dans une esthétique qui lui correspond » (ibid. : 36). Ce sont, écrit-elle encore, des « façons d’encoder le réel pour lui donner une forme à la mesure des idéaux des artistes » (idem). Je crois qu’au contact des matériaux, des toiles, d’un certain folklore aussi – bâtisse ancestrale, boiseries, décor champêtre à l’extérieur (vue sur le Saint-Laurent depuis la fenêtre de gauche, vue sur la rivière du Cap Rouge depuis celle de droite) –, mon écriture s’est enrichie d’une dimension pittoresque, d’un caractère quasi pastoral dans certains passages de textes renforcé par une volonté de rustique avec, en guise de palette de couleurs et de techniques picturales au figuré, le déploiement de métaphores, de comparaisons et d’hypotyposes significatives. Comme je l’ai évoqué plus haut, je travaillais alors sur des nouvelles qui formeraient plus tard un recueil ayant pour motif principal – je serais même tenté de parler de personnage – le Tracel de Cap-Rouge, un incroyable viaduc ferroviaire situé à l’ouest de Québec. Partie intégrante d’un segment qui relie Moncton à Winnipeg, ce très étonnant pont à chevalets, par ailleurs centenaire et reconnu site historique national de génie civil, figure parmi les plus longs et les plus élevés au monde. Au-delà de son gigantisme impressionnant, il faut aussi relever l’environnement champêtre dans lequel cette construction s’inscrit aujourd’hui avec harmonie : le bord du fleuve et ses falaises de schiste en parallèle de la voie ferrée, les arbres majestueux dans ce secteur autrefois lieu de villégiature de prédilection à Québec, ou encore la rivière qui coule au pied de la structure. Ce panorama d’exception que le Tracel contribue à caractériser de façon unique a motivé ma volonté de composer un récit à la fois vivant et visuel : j’ai imaginé à grande échelle un récit choral où les destinées se croiseraient au fil des époques et dans un paysage local et typique aussi bucolique qu’étrange. Grâce à l’influence combinée des tableaux des artistes de l’atelier où j’écrivais chaque jour, de l’ambiance générale qui régnait dans et autour de la bâtisse ancestrale abritant l’atelier, et de l’idéalisation de la tradition et des techniques picturales, ma discipline s’est en quelque sorte transformée. Le style d’une des nouvelles sur lesquelles je travaillais s’est vu marqué par une prolifération de tropes et de procédés destinés à brosser des tableaux plus qu’à décrire simplement des milieux rustiques et bocagers.
À l’instar – toutes proportions gardées bien sûr – d’un Joris Karl Huysmans « concevant la description littéraire à partir des arts visuels » (De Georges-Métral, 2013), je me suis demandé à quel point mon antre d’écrivain et, à titre plus global, les conditions et le contexte de création que je vivais alors conféraient à mes « descriptions romanesques de nouvelles modalités » (idem). Celles-là mêmes, en fait, avec lesquelles tout·e écrivain·e
parvenu[·e] à l’ère du visuel [...] souhaite construire un référent fictionnel dont le[·la] lecteur[·trice] – transfiguré[·e] pour l’occasion en spectateur[·trice] – puisse percevoir non pas la seule surface visible, mais aussi la dimension temporelle et la matérialité palpable. C’est dire [dans ce cas] que l’écriture ne doit pas se contenter de prendre à la peinture son bien, mais de rédimer les manques de ces deux arts, grâce à un effet de bascule incessant entre différents codes
(idem).
Décrire et raconter en ces lieux favorisaient au bout du compte cette « théorisation d’une mimesis littéraire et visuelle » (idem). Les métaphores et les tableaux profonds et colorés brossés dans le texte reflétaient sans aucun doute cet état d’être en lien avec le quotidien et les contingences d’artistes peintres. Mais un autre effet est apparu. Phénoménologiquement parlant, il en a résulté une projection dans un ailleurs sensoriel, au-delà de l’atelier et de la bâtisse, un alter-réel, pour ainsi dire, dont le ressenti prolongeait l’expérience de mimèsis. On le sait, chez Huysmans, les descriptions paysagères fouillées et les hypotyposes
crée[nt] un effet de vortex où le réel immédiat est éjecté au profit des écrans discursifs multiples qui préservent le spectateur, le lecteur, l’esthète de ce réel [...]. Le dilettante fin de siècle, le décadent s’est constitué comme sa propre référence culturelle [...]. Aussi se projette-t-il sans cesse en circuit fermé comme artiste de la rêverie, image et spectateur. Il fait du regard jeté sur la toile un geste d’art et une règle de vie. Le but est d’en arriver à être totalement absorbé par ces jeux de miroir […]. Cette abstraction au réel se construit sur le gommage de toute référence à ce réel par jeux successifs d’interpicturalité
(Pellerin, 1985 : 34).
Il me semble avoir connu l’effet de cette interpicturalité entre le paysage observé à travers la fenêtre, le réel automnal que la narration (re)mettait en scène, et les représentations des tableaux disposés ici et là dans mon bureau comme dans les couloirs de la bâtisse. L’atelier jouait là son rôle d’invitation à la rêverie et aux jeux de miroirs – cadres et reflets plus ou moins concrets que constituait chacune des toiles environnantes.
Le cadre architectural comme un lien de structure de pensée et de narration
À la Maison de la littérature, l’expérience s’est révélée différente. Pour rappel, la Maison de la littérature à Québec est une bibliothèque publique – gérée par l’Institut canadien qui y siège aussi – sise dans une ancienne église méthodiste de 1848. La blancheur des murs et du mobilier et la dimension patrimoniale des lieux apparaissent complémentaires et exaltantes aussi bien pour la lecture que pour l’écriture : l’histoire et la tradition rattachées à la bâtisse ne s’y révèlent jamais pesantes et, comme on peut s’y attendre, de hauts murs immaculés inspirent calme et sérénité. Cette « maison » à caractère unique célèbre en fait la modernité à l’intérieur de l’ancestralité : transparence, lumière, épure du décor et nouvelles technologies forment un tout harmonieux encadré de grandes baies vitrées et de hauts vitraux chapeautés par un toit mansardé. Rappelons que ce projet a reçu, au moment de sa conception, de nombreux prix architecturaux. Un jury a notamment reconnu qu’il y avait là une scénographie inspirante qui s’inscrivait en appui à la structure et au style : « Les rapports architecture / scénographie sont cohérents, ouverts et équilibrés, laissant présager plusieurs déploiements possibles. Le traitement neutre des surfaces intérieures offre la perspective d’une ambiance sereine et enveloppante. Les contenus seront mis en valeur dans cet écrin blanc » (White, 2013 : 26).
En bénéficiant à de nombreuses reprises de la possibilité de pratiquer mon art dans l’un des cabinets d’écriture de cet établissement, j’ai ressenti la sérénité, la solennité, mais aussi l’enveloppement sensoriel, la stimulation de l’acte de création. Cette fois, j’ai moins recherché des descriptions hautes en couleur, rustiques ou « impressionnistes » qu’oeuvré à la construction d’intrigues complexes, à la charpente d’un récit où de multiples histoires et personnages se croiseraient, et à la pratique d’une écriture plus sèche tendant justement à l’épure. Je me suis demandé s’il n’y avait pas là une contagion de l’esprit architectural et culturel de la Maison de la littérature, qui exercerait alors sur ses résident·es habituel·les une influence esthétique et déciderait d’une exigence formelle unique, peut-être jamais ressentie ailleurs. C’est ainsi que j’ai amorcé un projet de roman noir dit « choral ». En m’attelant à la rédaction de ce manuscrit, où la narration accorderait toute la place aux violences et à la corruption dans les milieux policiers et l’industrie de la construction en « cheville » avec la mafia italo-canadienne, j’ai voulu déployer une vision canonique. D’emblée, ce chantier d’écriture répondait à des enjeux d’expérimentation et de perfectionnement pour affiner, épurer et même radicaliser le style déployé dans mon précédent polar, Sur ses gardes. Ce nouveau manuscrit devait au demeurant me permettre de travailler au corps les codes et les thèmes du roman noir tel que le conçoivent aujourd’hui plusieurs auteur·trices, en particulier ceux et celles de l’Hexagone, où sécheresse stylistique et amplitude narrative se frôlent, mais où poéticité et brutalité s’entremêlent aussi. Dénonciation transparente des stratagèmes suspects qui avaient pu se produire au Québec lors des deux décennies précédentes, la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (dite « commission Charbonneau ») m’a semblé à l’époque constituer un matériau de base parfait pour un roman policier noir violent dont l’intrigue se déroulerait à Montréal et à Québec à la fin de l’année 2012. J’avais en tête une fiction qui n’exclurait pas d’aborder en parallèle beaucoup d’autres aspects, condamnables puisque criminogènes, de nos réalités économiques et sociales à l’échelle du pays : ententes véreuses entre personnalités d’affaires et politicien·nes, lobbyisme douteux et décisions industrielles qui entraînent des dommages collatéraux bien au-delà des frontières envisagées à l’origine, puisqu’ils s’étendent à l’ensemble du continent nord-américain. Le roman noir consiste par essence à établir des ramifications et des liens, même ténus, même incroyables, entre des causes et des effets connus de tous et de toutes, dispersés dans les médias et l’opinion publique, éléments qui n’ont a priori rien à voir les uns avec les autres, mais qui pourraient nourrir une machination globale. Les cabinets d’écriture de la Maison de la littérature m’ont offert ce cadre privilégié – cette trame, pourrais-je même dire – de pensée : l’ordonnance des lieux a contribué à me faire façonner, bâtir une intrigue complexe et vertigineuse où opacité et transparence, lumière (blancheur de l’hiver pendant lequel se déroule le récit) et noirceur (assassinats à répétition…) étaient en interconnexion.
Au bout du compte, deux maisons pour une multitude de sensations
C’est certain, au coeur de la Maison de la littérature comme au Centre d’Art Maison Blanchette, mais de manière différente, il s’est produit un je-ne-sais-quoi sensible et corporel – un ressenti profond, un état d’être et de créer que je n’aurais pas expérimenté ailleurs. Et surtout pas enfermé chez moi, seul dans mon bureau confortable, même si j’y étais serein aussi. Il est avéré qu’« avec l’atelier, les artistes créent leur environnement en correspondance avec leur démarche artistique et leur style » (Korff-Sausse, 2016 : 27). L’inverse cependant m’a paru se vérifier : ce sont le contexte, le décor, l’atmosphère de ces bâtisses et ateliers chargés d’histoires, de traditions, mais aussi d’innovations qui ont déterminé ma démarche, validant avec une quasi-certitude l’idée que « l’atelier serait le lieu propice et nécessaire pour faire le travail de mise en forme de ces éléments issus de la sensorialité primitive, une matrice favorisant la capacité de rêverie, d’où émergeront les formes » (idem). Les narrations que j’ai concrétisées dans ces circonstances m’ont semblé davantage reliées à mes émotions, à ma sensibilité et à mon corps, d’autant plus que la posture (physique) d’écrivain que j’y ai adoptée confinait à mon ouverture vers les autres – aussi bien les êtres humains que les histoires, univers et parcours que ces murs abritaient. L’acte de création en ces temps et lieux concourait en définitive à l’idée de trouver sa place tout en confortant une dynamique à travers laquelle « la nature imprévisible et immaîtrisable de ce qui constitue le réel est révélée à l’existant » (Brunel, 2016 : 52). À l’instar d’un Henri Maldiney poursuivant « la recherche phénoménologique dans le sillage de Merleau-Ponty qui place la corporéité au centre de son interrogation, [l]a phénoménologie de la perception laisse [ici] progressivement place à une ontologie du sensible, et l’art [...] est l’expression de ce qui fait retour vers l’ancrage originaire de l’[être humain] dans le monde » (idem). Cette place par ailleurs n’est pas que physique, réelle ou sensible : elle est aussi, en d’autres contextes résidentiels, technologique, numérique ou virtuelle.
L’atelier virtuel : un espace de création à la fois personnel et collectif, statique et mouvant
En ce qui concerne la résidence virtuelle qui m’a été accordée de 2019 à 2021, la relation à l’espace (d’hébergement et d’inspiration) comme au temps de création s’avère plus complexe. Sur son site, Le Crachoir de Flaubert présente ainsi les enjeux d’une telle résidence et de l’appropriation d’un cadre d’écriture désigné comme libre et libéré :
[La revue] accueille des chercheur[s]-créateurs ou des chercheu[ses]-créatrices en résidence qui bénéficient d’un espace privilégié pour explorer les différentes possibilités de sa double posture. La résidence est un lieu virtuel que l’artiste peut investir de la manière qui lui convient le mieux. À mi-chemin entre le blogue, la chronique et le feuilleton, cette résidence permet à l’artiste d’exposer à un vaste public les résultats de sa réflexion ou de sa création, les hypothèses qui sont les siennes, ses coups de tête et ses coups de gueule concernant la recherche-création. Ce lieu unique au monde lui appartient le temps de son séjour parmi nous et les propos tenus ici n’engagent que l’artiste, qui a carte blanche pour créer et réfléchir
(Le Crachoir de Flaubert, s.d.).
Investir, oser le « coup de tête » et le « coup de gueule » avec l’assurance que ceux-ci seront validés (à moins d’une grave entorse à l’éthique littéraire ou que la création soit diffamatoire), c’est, en d’autres termes, disposer de la possibilité de perdre sa réserve et de s’exprimer sans retenue. Les pulsions peuvent trouver là une voie d’expression, même si un tel exercice n’exclut pas non plus l’ironie et le double jeu du moi « écrivant ». Korff-Sausse part de l’hypothèse intéressante que l’atelier « est la reprise de la construction du premier espace physique et psychique. Ce serait un lieu qui aurait une fonction contenante, dont le but serait [notamment] de contenir les pulsions sadiques et destructrices qui sont à l’origine de toute création[4] et de les transformer ensuite » (Korff-Sausse, 2016 : 25). Cette réflexion sied bien à l’idée d’une résidence virtuelle avec carte blanche, lieu d’expérimentation a priori sans limites physiques : le projet de courtes fictions choc intitulé Meutes (2019-2021) m’a entre autres permis de plonger dans des esprits ravagés par la colère sociale, la haine ou les préjugés de toutes sortes, sans jamais chercher à condamner – pas ouvertement en tout cas – le narrateur anonyme ni aucun des personnages. À travers cette recherche-création, l’impulsif s’est immiscé encore plus facilement dans l’écriture que dans un cadre et dans une « maison » éditoriale classique et, disons, normée.
S’agissant de la dimension pulsionnelle que facilite un tel contexte, Korff-Sausse parle aussi d’ateliers collectifs dans des institutions d’accueil de personnes souffrant de troubles psychiques. « Pourrait-on dire », questionne-t-elle, « qu’ils offrent un refuge à ceux qui ont du mal à habiter le monde? Hors des exigences sociales, des codes culturels trop normatifs, des pressions familiales » (ibid. : 26). La psychanalyste cite aussi Maldiney, pour qui « [l]’art ménage à l’homme un séjour », « un espace où nous avons lieu, un temps où nous sommes présents » et où « nous communiquons avec les choses, les êtres et nous-mêmes dans un monde, ce qui s’appelle habiter » (Maldiney, cité dans Korff-Sausse, 2016 : 26). « Créer », nous dit encore Korff-Sausse, « c’est donc trouver un lieu, être dans un temps, sentir le monde et soi-même. L’art permet de s’habiter soi-même et d’habiter le monde » (Korff-Sausse, 2016 : 26).
Avec l’atelier virtuel, l’artiste habite son propre espace psychique interne en même temps que l’espace social, communautaire, qu’est le numérique, ce lieu ouvert, infini et qui demeure, pour reprendre une qualification employée par les chercheurs Marcello Vitali-Rosati et Éric Méchoulan, « à la fois structuré, mouvant et collectif » (Vitali-Rosati et Méchoulan, 2018).
Mais l’atelier virtuel, c’est aussi l’idée d’un cadre de création pensé en tant qu’environnement en extension. Les impressionnistes sortaient de leurs ateliers pour travailler dans la nature; les artistes urbain·es investissent la rue ou des entrepôts, des zones industrielles, des voies ferrées, etc. L’artiste en résidence virtuelle, même s’il·elle est écrivain·e, inscrit son processus créatif au-delà de son carnet de notes, d’une feuille de papier format A4 ou lettre, et du cadre de l’écran de son ordinateur; il·elle les couche, les soumet à l’équipe éditoriale. Certes, l’écrivain·e seul·e le fait aussi avec un manuscrit papier, mais il·elle en commente ou anticipe par ailleurs l’interprétation, la conception, la modulation. L’artiste en résidence virtuelle peut même revenir sur l’oeuvre, la modifier alors qu’elle est exposée et en cours de diffusion – comme les journalistes ou blogueur·euses le font, mais sans avoir besoin d’ajouter une notion d’erratum. L’erratum, à cet égard, fait partie de la création : il est un processus d’essai-erreur qui n’appartient qu’à l’artiste, dans son atelier seulement et non plus, sauf exception ou dispositif particulier, devant le public ou entre les mains des lecteur·trices. La résidence virtuelle, en fin de compte,
peut fonctionner comme communauté parce que les usagers partagent volontairement des documents et qu’ils peuvent les modifier, mais aussi parce que chaque document et chaque modification est archivable. Il y a création de « communs » parce qu’il y a échange « direct » entre les membres (on peut savoir qui se branche sur le document et le réutilise, ou qui propose une modification, ouvrant ainsi un espace de travail partagé) et mémoire des échanges. Cela nous permet au passage de saisir que ces espaces numériques sont avant tout des affaires temporelles
(idem).
Plus près de la concrétude du corps et de l’esprit, la psychologue Christine Lamy postule que « certaines productions vous emportent dans un autre environnement, car les descriptions fines, précises et touchantes, vous donnent l’illusion de vivre la scène et de ressentir […] des émotions intenses » (Lamy, 2009 : 38). Cet autre environnement se trouve justement représenté par la résidence d’écriture virtuelle elle-même, en plus des lieux créés par la fiction et l’expérimentation. Car dans le cadre d’une résidence virtuelle, il y a en somme mise en abyme : création d’espaces (dans le cas de Meutes, c’était une ville, des rues, un quartier, un pâté de maisons, un appartement particulier, ainsi que l’intérieur d’un taxi, une aire de stationnement, une autoroute sans fin, etc.) dans lesquels se déroulaient des histoires choc. Mais il y a aussi la conception d’un espace – d’un cadre – d’expression libérée (à laquelle on a donné « carte blanche ») où l’écrivain·e s’affiche dans son acte d’écriture, c’est-à-dire qu’en mentionnant sa résidence, il·elle dresse en quelque sorte des miroirs autour de lui·elle qui reflètent l’altérité (donc le monde qu’il·elle décrit et réinterprète) et son propre processus de création dans le moment présent. L’écriture est une forme de présence attentive; la résidence virtuelle crée la matérialité de l’acte d’écriture. Cette mise en abyme rejoint, à certains égards, le point de vue de Desrochers lorsqu’il parle, dans sa thèse « Processus agora : approche bioculturelle des théories de la création littéraire », du réel et des réalités qui selon lui « ne sont pas des notions distinctes, mais des concepts mutuellement gigognes » (Desrochers, 2014 : 143). En « [r]ègle générale », énonce Desrochers, « on oppose le réel à l’imaginaire afin de distinguer ce qui est relatif aux choses (réel) et ce qui est présent sans l’être (imaginaire) » (ibid. : 145). « Dans un contexte bioculturel évacuant l’admissibilité d’une dualité corps / esprit », avance-t-il encore, « l’imaginaire, en tant que phénomène, est réel, tout comme l’imagination qui le génère » (idem). Peut-être la démarche réflexive se révèle-t-elle transposable à la projection à laquelle se livre l’écrivain·e en résidence virtuelle : en imaginant sa résidence, l’écrivain·e construit l’image d’un havre de pensée et d’expression fidèle, là encore, à sa démarche, en même temps qu’il·elle élabore un espace aux codes et aux conventions reconnaissables, intime mais ouvert aux incursions. « La fonction créatrice qu’est l’imagination en tant que phénomène réel », ajoute Desrochers à ce sujet, « tient d’un infini, se présentant ainsi comme insaisissable dans sa totalité » (ibid. : 148). La résidence virtuelle, selon ce que j’ai pu vivre et observer au Crachoir de Flaubert, rejoint à de nombreux égards ce point de vue : autant elle matérialise une maison des idées de l’écrivain·e et son antre d’expression ou, si l’on préfère, son cocon de création, autant elle correspond à une expérience immersive dans un espace abstrait et pour ainsi dire sans fin, ce qui d’ailleurs peut être un piège sensoriel ou conceptuel pour l’artiste. Piège parce qu’il y a possibilité de s’y perdre, de ne jamais « boucler » un texte, d’y revenir sans cesse (si l’on exclut en tout cas les décisions éditoriales qui s’y rattachent). Piège aussi parce qu’après sa parution en ligne, la création se disperse tôt ou tard dans le flux de l’information numérisée.
Pour conclure : l’atelier lui-même est sans limites… et est un acte sensible
En chacun de ces lieux, à la fois intériorisés et ressentis comme espaces d’influence, l’écriture s’est déployée dans un sentiment de stimulation sensorielle et d’encadrement serein ou constructif. Pour un écrivain comme moi dont les univers de fiction se veulent à la fois réalistes (bucoliques ici, urbains et criminels là…), mais aussi sis dans un imaginaire fertile (nouvelles historiques, anticipation, fantastique étrange, etc.), ces maisons / ateliers / résidences tant physiques que numériques, aussi concrets qu’abstraits, ont correspondu à chaque fois à une démarche de connexion à l’instant présent et à sa perception dans un espace bien délimité – même s’agissant du virtuel aux possibilités infinies. Cette délimitation, quand elle n’est pas si nette, l’esprit la projette et la façonne en vertu d’un idéal artistique en lien avec des perceptions traditionnelles, sinon fantasmatiques : l’image romantique ou très dix-neuviémiste de l’atelier du·de la peintre; le cliché de l’écrivain·e travaillant dans une immense demeure patrimoniale à l’architecture impressionnante; et puis la vignette futuriste du·de la créateur·trice de mots (ou de toute autre forme de contenu) déployant ses talents dans le monde virtuel, en s’inventant peut-être des conditions de création idéales, affranchies de toute limite. Dans « Processus agora », Desrochers évoque ainsi un « dialogue entre l’auteur et la simulation incarnée du texte » qui « s’incarne dans un contexte spatio-temporel réel » (ibid. : 312). Liant intrinsèquement la création et la spatialité, il interprète « l’expérience de la création comme expérience d’une spatialité soulevant de nombreux problèmes […], ne serait-ce que de lier l’aspect linéaire du texte à la perspective spatiale propre à sa réalisation » (idem). Avec ses architectures chargées d’histoire et de caractère, ses situations géographiques particulières et ses aménagements inspirants – ou non, d’ailleurs! –, l’atelier d’artiste de l’écrivain·e constitue peut-être l’une des solutions à cette carence ou problématique de liaison. Cependant, une autre interrogation émerge en filigrane de cette considération spatiale : une pratique – écriture ici, peinture, sculpture, etc., ailleurs – ne risque-t-elle pas de perdre sa singularité, son unicité, si elle se décline en différents lieux et se plie à chaque fois aux lois de l’atelier dans lequel elle se déploie et se renouvelle?
Les chercheurs Hajer Guizani Ghaya et Sami Ben Ameur ont analysé dans leurs travaux la notion de lieu de l’oeuvre d’art dans la pratique artistique contemporaine. S’ils ont eux aussi démontré une « interdépendance entre l’oeuvre d’art et le lieu » reposant entre autres sur « la transgression des frontières de l’art (cadre, mur [...], architecture) », ils se sont prononcés au bout du compte sur un potentiel « éclatement du médium » (Guizani Ghaya et Ben Ameur, 2017). L’artiste qui choisit la multiplicité des espaces de création ne peut que se sentir stimulé·e. Mais avec cette « déstabilis[ation] des limites entre l’oeuvre et le lieu » (idem), il·elle prend aussi le risque d’une dispersion.
Parties annexes
Note biographique
Stéphane Ledien est écrivain, chercheur, directeur littéraire et chroniqueur de livres et de films. En tant qu’auteur de fiction, il a notamment publié des nouvelles aux Éditions de La Table ronde ainsi que dans la revue XYZ. Il a aussi signé quatre ouvrages, dont le roman noir Sur ses gardes (2015) et le recueil Des trains y passent encore (2017). Par ailleurs docteur en études littéraires, il a vu paraître ses essais sur la littérature dans la Revue critique de fixxion française contemporaine, les Cahiers Robinson, la revue Rilune ou encore la revue électronique de littérature générale et comparée TRANS-.
Notes
-
[1]
Après 2016, le Centre d’Art a été reconverti en bâtisse commerciale en lien avec les voyages et le bien-être. Pour se faire une idée de ce qu’offrait la Maison Blanchette à l’époque, voir le lien suivant : grandquebec.com/capitale-quebec/maison-blanchette/
- [2]
-
[3]
Notamment autour d’un thème général titré Meutes (2019-2021). Voir le lien suivant : www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/category/en-residence/stephane-ledien
-
[4]
La psychanalyste se réfère en cela aux travaux du pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott (1978 [1963]).
Bibliographie
- BRUNEL, Sarah (2016), « Création artistique et approche phénoménologique de la temporalité dans l’oeuvre de Maldiney », L’enseignement philosophique, vol. 66, no 1, p. 51-62.
- DE GEORGES-MÉTRAL, Alice (2013), « Les Paraphrases de Huysmans : une écriture visuelle et sonore », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, no 24, journals.openedition.org/bcrfj/7131
- DESROCHERS, Jean-Simon (2014), « Processus agora : approche bioculturelle des théories de la création littéraire », thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal.
- GUIZANI GHAYA, Hajer et Sami BEN AMEUR (2017), « Le lieu de l’oeuvre d’art dans la pratique artistique contemporaine : transgression des frontières et éclatement du médium », thèse de doctorat, Tunis, Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis.
- KORFF-SAUSSE, Simone (2016), « L’atelier de l’artiste », Le carnet PSY, vol. 199, no 5, p. 23-27.
- LAMY, Christine (2009), « Les ateliers d’écriture », Le journal des psychologues, vol. 272, no 9, p. 36-39.
- LAPIERRE, René (1994 [1988]), « L’exigence de la forme », dans René Lapierre et al., Dans l’écriture, Montréal, XYZ, « Travaux de l’atelier », p. 9-49.
- LE CRACHOIR DE FLAUBERT (s.d.), « En résidence », www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/category/en-residence/page/2/
- LEDIEN, Stéphane (2017), Des trains y passent encore, Montréal, Lévesque éditeur, « Réverbération ».
- LEDIEN, Stéphane (2015), Sur ses gardes, Montréal, À l’étage, « Noir ».
- L’ITALIEN-SAVARD, Isabelle (2011), « Littérature et peinture : un couple bien assorti pour faciliter l’enseignement des oeuvres littéraires du XIXe siècle », Québec français, no 161, p. 30-36.
- PELLERIN, Gilles (1985), « J.-K. Huysmans : Gustave Moreau, Détail (1884) », Études françaises, vol. 21, no 1, p. 31-44.
- VITALI-ROSATI, Marcello et Éric MÉCHOULAN (2018), « L’espace numérique », Sens public, www.erudit.org/fr/revues/sp/2018-sp04510/1059029ar/
- WHITE, Jacques (2013), « Le concours d’architecture de la Maison de la littérature de l’Institut canadien de Québec », Architecture-Québec, no 165, p. 26-32.
- WINNICOTT, Donald Woods (1978 [1963]), « Élaboration de la capacité de sollicitude », dans Processus de maturation chez l’enfant, Paris, Payot, « Science de l’Homme Payot », p. 31-42.







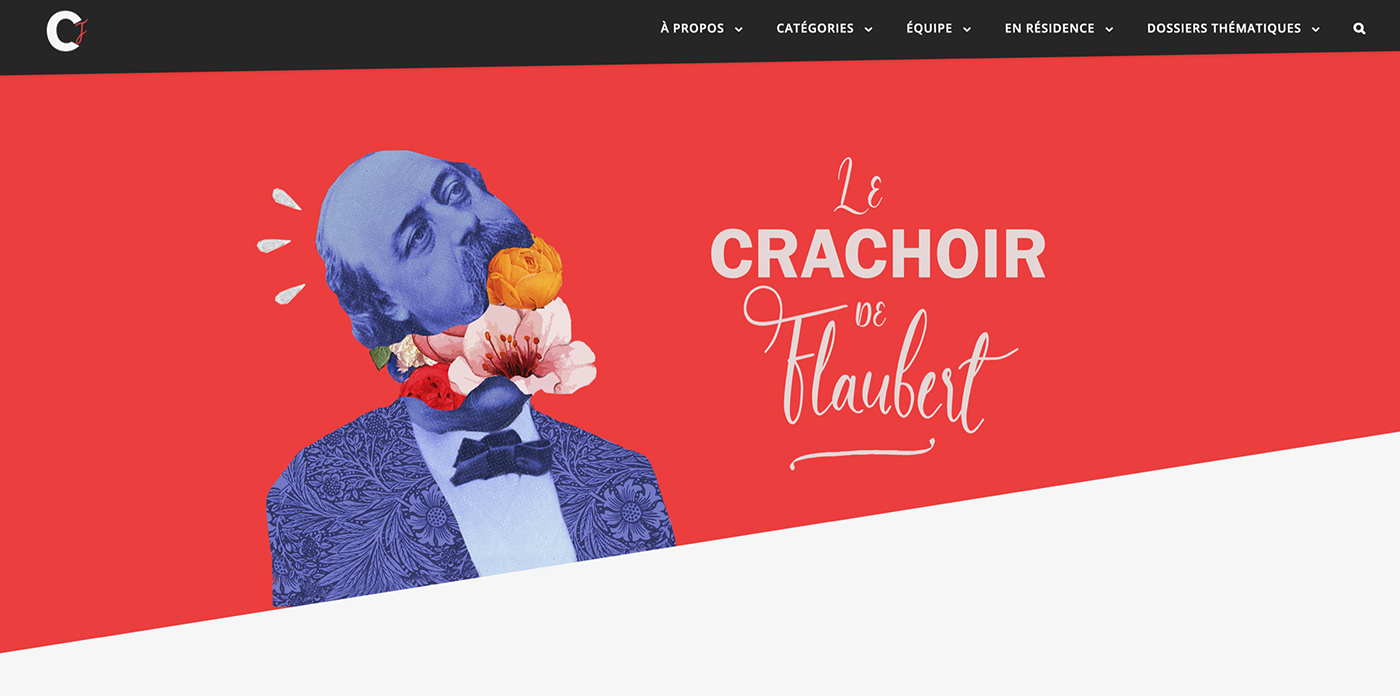
 10.7202/036847ar
10.7202/036847ar