Résumés
Résumé
À la fin de Médée, La Péruse fait tenir à l’héroïne des propos particulièrement inquiétants, puisqu’elle indique que le spectacle qui vient d’avoir lieu pourra « [apprendre] à [son] sexe à se pouvoir vanger » (La Péruse, 1990 [s.d.] : 42). Comment comprendre ces vers? On peut conclure à l’ironie du dramaturge, puisque Médée, infanticide et régicide, ne saurait être sérieusement érigée en exemple. Néanmoins, si on se met à l’écoute de la Colchidienne, on peut observer d’autres résultats : La Péruse semble insister sur les pouvoirs de la parole féminine, si bien que Médée pourrait apprendre aux femmes non le meurtre, mais la puissance des mots.
Mots-clés :
- La Péruse,
- Médée,
- tragédie,
- parole,
- féminin
Abstract
At the end of Médée, La Péruse has his heroine make a disturbing statement, suggesting that the play has the potential to “teach [her] sex how to take revenge” (La Péruse, 1990 [s.d.] : 42). This raises questions about the playwright’s intentions. One interpretation is that La Péruse is being ironic, as the character of Médée, who is a murderer, should not be held up as an example for women. However, if we listen to La Colchidienne, we can argue that La Péruse is emphasizing the power of female speech and that Médée can serve as a model for women to use the power of words instead of violence.
Corps de l’article
Introduction : La Péruse « revengeur des Dames »?
Comme les premiers de la pièce, les derniers vers de Médée de La Péruse sont réservés à l’héroïne – qui s’adresse alors à Jason –, et ils sont particulièrement forts :
(La Péruse, 1990 [s.d.] : 42.)Qui aura desormais de faus amant le blasme,
À l’exemple de toi se garde du danger
Par qui j’apran mon sexe à se pouvoir vanger!
Si les premières tragédies françaises se concentrent sur des personnages de femmes, à qui les auteurs donnent la parole et à qui ils permettent de défendre leur point de vue (Hugot, 2021), cet exemple d’ouverture aux spectatrices reste sans équivalent dans les oeuvres contemporaines du dramaturge; au contraire, l’Italien Lodovico Dolce met par exemple en garde les jeunes filles contre les paroles fausses de Médée[1]. Or, les vers de La Péruse ne trouvent pas leur source chez Euripide ou Sénèque[2]. Comment les comprendre? L’héroïne ne s’adresse pas directement aux femmes, mais aux hommes, et, mieux encore, aux hommes infidèles : c’est, à la lettre, non Médée, mais Jason qui serait l’exemple donné par la pièce[3]; cependant le dernier vers indique que les femmes sont le réceptacle d’un enseignement pratique, celui de la vengeance. Dès lors, faut-il conclure d’emblée à l’ironie de La Péruse – Médée est une mère infanticide et une régicide, il serait difficile de l’ériger sérieusement en exemple –, ou peut-on penser qu’il nous invite à nous mettre à l’écoute de son héroïne et à nous demander dans quelle mesure, et dans quel champ, elle pourrait servir d’exemple aux femmes[4]?
Médée est très présente dans les traités de la querelle des femmes, côté misogyne mais aussi côté philogyne : « le “cas” Médée motive autant qu’il cristallise deux conceptions antagonistes du genre féminin » (Schweitzer, 2007 : 2). N’atténuant pas le crime de Médée, mais rappelant que ce dernier est la conséquence de la trahison de Jason, La Péruse ne semble pas condamner absolument la Colchidienne (Hugot, 2021 : 293-296; Schweitzer, 2007); peut-on considérer pour autant qu’il entend la défendre[5]? L’étude de la réception contemporaine de la tragédie ne saurait nous éclairer : les pièces liminaires attestent une réception certaine, mais ne commentent pas précisément la présentation du personnage[6]. Quant aux performances théâtrales, relativement rares, elles ne nous ont pas transmis de réactions sur le contenu de la pièce[7]. Si le dramaturge, mort à vingt-cinq ans de la peste, ne s’est en outre pas explicitement prononcé sur la question des femmes, son recueil poétique révèle tout de même un intérêt pour ce sujet. Dans deux poèmes, La Péruse donne directement la parole à des jeunes femmes, qui se lamentent, pour l’une, de la coutume qui favorise les mariages forcés, et, pour l’autre, de l’absence de son amant (La Péruse, s.d. : 85-89). Or nous pouvons noter que, dans son « Amourette », il se fait appeler, par son amante qui prend fictivement la parole au discours direct, « revengeur des Dames » (ibid. : 138-139)[8]. Plus tôt dans son recueil, le poète répond en effet à un « médisant » qui blâme des femmes à tort, dans une série de textes courts dont le premier s’intitule « Pour des dames contre un médisant » (ibid. : 104-105). Par ailleurs, il semble que le je poétique déployé dans ces pages partage certains traits avec Médée – l’amour contrarié, la jalousie, et la vengeance donc, même si la sienne est purement littéraire. Ainsi, ce portrait du poète en « revengeur des dames », sensible à la cause féminine et à la réputation du sexe, peut-il se transférer à sa tragédie? Sans trancher sur cette question, puisque l’intention de l’auteur nous restera de toute façon inconnue, nous ferons ici le pari de nous mettre à l’écoute de la Colchidienne et d’accorder du crédit à ses ultimes déclarations pour observer les conséquences sur l’interprétation du texte et de ses effets.
La pièce comme tribune : Médée à son public
Faut-il bien, ou peut-on bien, tout d’abord, accorder de la valeur aux derniers mots de Médée? La critique a montré que, par rapport à ses sources, La Péruse donnait une image plus négative de Jason et, symétriquement, moins négative de la Colchidienne. Or, la faute de Jason, c’est sa déloyauté, et, plus précisément, sa parole fausse[9] : la pièce est alors « la tragédie de la parole trahie qui prend sa revanche[10] » (Fragonard, 1990 : x). En effet, lorsqu’au premier acte, le messager demande à Médée de quitter les lieux, sur ordre du roi, celle-ci s’en prend avec virulence à un Jason absent :
(La Péruse, 1990 [s.d.] : 9.)O déloïal Jason! où est ores la foi
Qu’en Colches me promis, quand me donnai à toi?
Où est l’amour constant, où est le mariage,
Dont ta langue traitresse allechoit mon courage?
O infidele foi! ô grand’ déloïauté!
O langue manteresse! ô dure cruauté!
O Jason trop ingrat! ô maudit Himenée
O moi sous le Souleil la plus défortunée![11]
Le héros grec est caractérisé par son manque de foi et sa « langue manteresse » et « traitresse ». Médée lui en fait directement le reproche au quatrième acte :
(Ibid. : 30.)O méchant déloïal, coeur rempli de faintise,
Esse la loïauté que tu m’avois promise? […]
As-tu eu le courage
De violer les droits du sacré mariage?
Sont-ce les propos sains qu’en Colches me tenois
Quand, malheureuse las! le moïen t’aprenois
D’aquerir la toison, aimant trop mieus te suivre
Qu’avéque mes parents honorablement vivre?[12]
Là où son amant est condamné pour sa parole mensongère, Médée se définit quant à elle par une parole vraie[13]. En effet, lorsque la nourrice lui demande de dissimuler ses desseins, elle refuse :
(ibid. : 3).Trop leger est le mal où conseil est receu :
Courrous tel que cetui ne peut qu’il ne soit sceu.
Sus donq, Médée, sus : je veux que tous le sachent,
Il est bien mal-aisé que les grans maus se cachent,
Il est bien mal-aisé que les humaines loix
Empêchent le destin de la race des Rois[14]
La Colchidienne rejette le mensonge et la dissimulation parce qu’elle veut faire de son histoire un spectacle. Elle ne réglera pas son comportement d’après les normes du vulgaire : sa grandeur lui impose une attitude autre, qui réside dans la monstration. Plus loin dans cette scène, lorsque la nourrice se lamente du fait qu’il ne reste plus rien à Médée, celle-ci rétorque :
(ibid. : 6).Je reste encor, Nourrice, et en moi tu peus voir
Assamblés tous les maus que le Ciel peût avoir,
Pour punir grievemant les enormes injures
Des amans fausse-fois, et des maris perjures.
Non, non, nourrice non : ne crain point qu’en danger
Tu me voïes tomber, sans m’en pouvoir vanger.
Voici, voici la main, main forte et vangeresse,
Main qui nous vangera des Heröes de Grece[15]
Médée affirme son être dans le spectacle, comme l’indique la récurrence du verbe « voir » : elle ne saurait donc user de dissimulation. Pourtant, au troisième acte, lorsqu’elle se trouve face à Créon, elle utilise, comme nous le verrons, différentes stratégies rhétoriques visant à manipuler le roi, et lorsque celui-ci quitte la scène, elle révèle immédiatement l’insincérité de ses propos :
(ibid. : 26).Donques je m’en irai? donques vivra sans danger
Ce déloïal Jason? donques sans me vanger
Je m’en irai ainsi? et Glauque glorieuse
Prandra heur de celui qui me fait malheureuse!
Non, je m’en vangerai, je ferai que la Grece
Connoitra combien peut Médée vangeresse[16]
Dès lors, sa parole ne se définit-elle pas également par le mensonge? Comme on le comprend dans les derniers vers cités, Médée ne trompe Créon que pour mieux le détromper – il connaîtra bientôt, comme l’ensemble de la Grèce et le public, la vérité de ses desseins. Elle clame encore au quatrième acte :
(ibid. : 29).Bref, je me veus vanger : je veu ruiner tout :
Je veu que mon savoir soit connu à ce coup.
Je ne puis plus celer le mal qui m’époinçonne,
Et l’échauffé courrous qui dans mon coeur bouillonne[17]
Il s’agit non seulement de se venger, mais de se venger aux yeux de tous et de toutes, de donner le spectacle de sa puissance et de son « savoir »[18]. C’est dans ce même esprit qu’il faut comprendre son refus de fuir une fois Créon, Glauque et le palais brûlés par le feu magique; Médée se réjouit plutôt de sa vengeance : « On ne dira jamais, courageuse Médée, / Que sans te revanger un méchant t’ait blessée[19] » (ibid. : 41).
Le « qu’en dira-t-on » est au coeur du projet de la Colchidienne. Ainsi, la parole de Médée est vraie : elle peut mentir ponctuellement, mais elle entend faire coïncider son être avec ses mots parce qu’elle veut révéler sa puissance aux yeux du monde et faire de son histoire un spectacle. Or, les derniers vers de la pièce nous invitent à penser que ce spectacle a vocation à constituer une leçon pour le public, et que cette leçon serait à double entente, en fonction du genre du ou de la destinataire.
Pour Phillip John Usher (2013), le sens politique de la pièce réside dans l’insistance sur la nécessité de la prudence, puisque son absence chez les personnages les conduit à la catastrophe. En effet, les derniers vers l’indiquent, Jason aurait dû « se garde[r] du danger » (ibid. : 42) représenté par Médée, et cette leçon s’étend à Créon et à Glauque. Du reste, l’idée des dangers représentés par les femmes est un topos qui dépasse La Péruse : on peut par exemple citer l’adage 1921 d’Érasme, « Mulieri ne credas, ne mortuae quidem »; « Ne te fie pas à une femme, même morte » (Érasme, 2013 [1500] : 519). Le choeur du deuxième acte le signale encore, la nature peut bien surpasser l’être humain :
(La Péruse, 1990 [s.d.] : 19).Mais quand une fame
Jalouze s’enflame
Contre son mari,
Sa fureur est pire
Que feu, qu’eau, que l’ire,
De Juppin marri[20]
De même, la méfiance est ce qui a manqué à Médée dans sa relation avec Jason. Or, au premier acte, la Colchidienne semble déjà s’adresser aux femmes pour leur enjoindre de tirer des leçons de sa mésaventure :
(ibid. : 9).O que foles nous sommes
De croire de leger aus promesses des hommes!
Nulle d’orenavant ne croïe qu’en leur coeur,
Quoi qu’ils jurent beaucoup, se trouve rien de seür.
Nulle d’orenavant ne s’attende aus promesses
Des hommes déloïaus, elles sont manteresses :
S’ils ont quelque desir, pour en venir à bout
Ils jurent Terre et Ciel, ils promettent beaucoup,
Mais tout incontinant qu’ils ont la chose aimée,
Leur promesse et leur foi s’en vont comme fumée[21]
Médée considère que son histoire doit créer une rupture : elle est la preuve de la déloyauté masculine, si bien que « d’orenavant », les femmes ne doivent plus croire en la parole de leurs amants. Si elle n’emploie pas la cinquième personne, le subjonctif remplace ici l’impératif; en outre, les spectatrices peuvent d’autant plus se sentir concernées par son propos qu’elles sont incluses dans un « nous » dont le sens genré ne fait aucun doute. Ainsi, si la pièce promeut la méfiance, la leçon adressée aux hommes et celle adressée aux femmes ne prennent pas le même sens : la Colchidienne distingue le public masculin ennemi et le public féminin empathique. Elle avertit les hommes des dangers représentés par les femmes pour leur faire peur, c’est-à-dire pour les pousser non à la violence contre leur épouse, mais à la fidélité; en revanche, lorsqu’elle met les femmes en garde contre les mensonges des hommes, elle entend les mener à l’action violente en leur montrant les chemins de la vengeance.
Les vers finaux entrent donc en écho avec d’autres éléments de la pièce : tout d’abord, Médée se définit, en opposition à Jason notamment, par sa parole vraie, si bien que le spectateur et la spectatrice ont toutes les raisons de l’écouter; en outre, elle répète à plusieurs reprises qu’elle veut faire de son histoire un spectacle, et même un exemple, au sens d’histoire dont le public pourra tirer des leçons. Enfin, elle distingue le public masculin et le public féminin, ce qui peut confirmer la lecture genrée qu’elle propose in fine de son histoire. Si le spectacle est au coeur de la prise de parole de Médée, c’est donc certes parce que celle-ci est classiquement caractérisée par l’exacerbation de son moi, mais aussi – et ceci est plus propre à La Péruse –, parce que l’idée est que la représentation serve d’avertissement aux hommes et d’apprentissage pratique aux femmes. Or, puisque chez La Péruse Médée « est parole » (Fragonard, 1990 : xii), le coeur de son enseignement se situe précisément dans son rapport au langage et à ses pouvoirs.
« C’est trop parlé » : une parole empêchée
Dans la pièce, tous les personnages qui font face à Médée lui demandent de se taire, parfois à plusieurs reprises. Ainsi, lorsque la Colchidienne entre en scène au premier acte et annonce vouloir « punir » Jason pour son « injure », la Nourrice essaie immédiatement de contenir sa parole :
(La Péruse, 1990 [s.d.] : 2).Mais que sert il, ô chere nourriture,
De rechercher par tant de fois l’injure
Que vous a fait ce déloïal Jason?
Mais que sert il rafrêchir l’achoison,
Dure achoison, qui tant d’ennui vous porte,
Et hors de vous, Médée, vous transporte,
Seigneuriant brusquemant voz espris?
Espris, helas! d’une fureur surpris,
Fureur qui a dans vôtre fantasie
Enraciné l’ardante jalousie,
Qui tant vous poingt, qui cause la douleur,
Qui causera aprês douleur malheur,
Aprês malheur, malheur encore pire,
Si n’aprenés à dissimuler l’ire
Qu’avés à droit contre ce déloïal[22]
Ressasser l’injure ne fait que mettre Médée en fureur, ce qui enracine la jalousie, laquelle conduira à la catastrophe[23]. La Nourrice embrasse ici un rôle classique du personnage secondaire, qui est de réfréner les passions du héros ou de l’héroïne pour tenter de désamorcer l’engrenage tragique[24]. La spécificité cependant est qu’elle demande moins à Médée de calmer ses passions que de les « dissimuler » : c’est bien la parole de Médée qui est problématique. Après ces vers, elle fait appel à la constance de sa maîtresse, qui est jusqu’ici restée ferme, et poursuit :
(ibid. : 3).Du mal caché l’on peut prandre vang’ance,
Mais qui ne sçait tenir son dueil enclos,
Ains le têmoigne aveq’pleurs et sanglos,
Pour se vanger celui n’a autres armes
Que pleurs, soupirs, regrês, ennuis et larmes.
Le mal venu, il le faut endurer
Bon gré, mal gré, rien n’i sert murmurer[25]
La nourrice développe un propos stoïcien en apparence – il faut se résigner au malheur contre lequel on ne peut rien –, mais qui s’intègre en fait à une réflexion pragmatique sur les chemins de la vengeance. Plus loin, elle lui demande encore de s’apaiser :
(ibid. : 6).Baillés un peu à vôtre esprit repos,
Et delaissés ces menaçans propos :
N’irrités plus contre vous la Fortune,
Ne soïés plus à vous même importune[26]
Les propos « menaçans » de Médée sont à nouveau aux sources de la catastrophe, non plus parce qu’ils enragent la Colchidienne, mais parce qu’ils irritent la Fortune : la Nourrice conseille à Médée la prudence, l’humilité devant le sort. Après d’autres arguments, elle revient à ses craintes :
(ibid. : 6-7).Je crain beaucoup, lâs! que vôtre langage
Voz ennemis n’aigrisse d’avantage.
Je crain beaucoup, que ce vôtre courrous
N’irrite encor la Grece contre vous,
Et que de vous vôtre malheur ne sorte[27]
Il ne s’agit plus d’irriter l’abstraite Fortune, mais les ennemi·es grec·ques : c’est toujours le « langage » de Médée qui effraie la Nourrice. Lorsque le messager transmet l’ordre du roi, le public comprend du reste qu’elle a raison puisque l’exil est justifié par les menaces de Médée :
(ibid. : 7).Il connoit trop Médée, et sa malice :
Il connoit trop que de rien ne lui chaut,
Qu’elle est cruelle, et qu’elle a le coeur haut,
Qu’elle menace, et d’une fiere audace
Quelque mal-heur contre la Grece brasse[28]
À l’ouverture du quatrième acte, la Nourrice réitère sa demande de silence : « Dieux, qu’est cecy? voulez-vous point cesser? / Voulez-vous point ces propos delaisser?[29] » (Ibid. : 28.) Elle brosse ensuite le portrait d’une Médée furieuse et échevelée : elle souhaiterait que sa maîtresse abandonne sa « rage » (ibid. : 28-29) pour faire cesser sa douleur. Ainsi, à plusieurs reprises, la Nourrice tente de faire taire Médée – ou, du moins, de la faire changer de propos –, mais la rage de la Colchidienne est trop forte.
Au deuxième acte, le choeur de femmes grecques réagit lui aussi à la parole de Médée :
(ibid. : 16).Ces pleurs, ces plaints, dont Médée dolante
Mouille ses ïeus, sa poitrine tourmante,
D’où viennent ils? Esse point pour autant
Que son Jason ainsi la va quittant?
O si ses espris
Elle avoit repris,
Pour y penser bien,
Elle auroit apris
Que ses pleurs et cris
Ne servent de rien[30]
Le choeur donne ici un autre argument, récurrent dans les tragédies : la plainte est vaine et renforce le malheur[31]. Au troisième acte, il reprend :
(ibid. : 28).Comme fame insensée,
De corps ni de pensée
Elle ne prant repos,
Forcenée de rage
Soimême elle s’acourage
Par ses mal-sains propos
Nous retrouvons l’argument de la Nourrice : le langage de Médée l’aigrit et la pousse au crime.
Plus loin, lorsque Créon convoque Médée, et que celle-ci plaide sa cause et indique au roi qu’il agit « contre toute équité », ce dernier lui répond : « Soit droit, soit tort, il faut que mon commandemant / Soit fait, c’est trop parlé, soudain qu’on se dépêche / Et que d’orenavant jamais on ne m’en prêche[32] » (ibid. : 22). L’indifférence de Créon pour le droit peut marquer la tyrannie du personnage, mais le pouvoir politique réclame bien de Médée obéissance et silence. Celle-ci n’en continue pas moins de se défendre – nous y reviendrons –, et Créon réitère alors son commandement : « C’est trop parlé, qu’on vuide[33]» (ibid. : 25).
Au quatrième acte, lorsque Médée affronte enfin Jason, celui-ci l’invite également à se taire. D’abord, il lui explique que ses propos l’ont mise en danger :
(ibid. : 30).Médée, ton courrous, et ton hautain courage
Ne t’ont pas seulemant ici porté dommage :
Mais maintefois ailleurs : Je ne le di pour moi,
Qui ne te puis haïr : je le di pour le Roi,
Que tes propos cruels ont irrité en sorte,
Que sans l’amour de moi, tu fusses déjà morte[34]
Médée n’accepte pas le portrait de sauveur que Jason donne de lui-même, et lui rappelle qu’il est responsable de ses crimes puisqu’elle les a commis pour lui. Il répond alors : « Médée, il n’est pas temps de parler longuement / Mais il te faut pourvoir à ton departemant[35] » (ibid. : 31). Il lui répète ensuite que ses propos sont dangereux : « C’est par trop grande audace / De menacer ainsi et le Roi et sa race[36] » (ibid. : 32).
Ainsi, tous les personnages à qui Médée fait face tentent de contenir sa parole. Faut-il comprendre que le dramaturge condamnerait par-là la parole féminine (dont la pièce démontre, comme nous le verrons, tous les dangers), ou qu’au contraire il dénoncerait l’oppression des femmes, dont la parole serait empêchée? Dans notre optique, celle d’une lecture empathique envers la Colchidienne, c’est la seconde option qui sera retenue : la parole féminine serait opprimée, expérience qu’ont pu partager les lectrices et spectatrices contemporaines de La Péruse[37]. Or, l’exemple donné par Médée est justement celui d’une parole résistante, qui se déploie malgré tout et qui démontre sa puissance et sa supériorité.
Du savoir au pouvoir : la parole comme arme
En tant que magicienne, et en tant que furieuse, Médée pourrait être représentée du côté du cri, aux confins de la parole (entendue comme langage articulé), et ce portrait est présent en filigrane dans la pièce[38]. Au premier acte, lorsque le choeur évoque le topos des méfaits de la navigation, il cite parmi eux les sirènes vaincues par Orphée :
(ibid. : 12).Les filles d’Achelois
Aus gorges nompareilles,
Avoïent ja par leur voix
Aleché les oreilles
Des Princes étrangers
Ja Ja mis aus dangers
Sans le Luth resonnant
D’Orphée mieus sonnant[39]
Or, Médée aussi a une voix charmante, au sens premier, puisqu’elle est le vecteur de son pouvoir magique. Le Gouverneur des enfants décrit ainsi sa maîtresse au deuxième acte :
(ibid. : 14).O Dieus, quels môts, quel propos, quel maintien,
Quels ïeus flambans : tout asseuré je tien
Que si son mal violant ne s’alante,
Veu ses regrés et sa fureur ardante,
Elle fera au Roi Creon sentir,
Que d’un tort fait on se doit repentir[40]
« Mots », « propos », « maintien »; elocutio, inventio et actio indiquent la même chose : Médée exercera sa fureur sur le roi Créon. Le Gouverneur poursuit – Médée n’en est pas à son coup d’essai, mais sa nouvelle fureur lui semble plus grande encore[41] :
(idem).Je la connoi, je l’ai veüe marrie
Par plusieurs fois, je l’ai veüe en furie
Remurmurant ses vers : mais maintenant
Elle a trassé je ne sais quoi plus grand,
Mais maintenant une rage felonne
Plus que devant ses espris époinçonne,
Plus que devant par ses cris furieus
La miserable importune les Dieus
Médée « remurmur[e] ses vers », et pousse des « cris furieus[42] »; en bonne sorcière, elle a un lien privilégié avec les dieux et les déesses – infernaux et infernales, évidemment –, si bien qu’il·elles l’écoutent et lui obéissent :
(idem).Le grand Serpent en neus tortillonné,
Oïant ses vers, se tait, tout étonné :
Puis en sifflant, sa triple langue tire
Prêt à vomir au gré d’elle son ire
De fait, à la fin du troisième acte, Médée annonce sa vengeance :
(ibid. : 26).Sus donq’Médée, sus, repran tous tes espris,
Pratique maintenant ce que tu as apris,
Recherche les secréts de la sainte sciance
Dont tu as mainte-fois fait mainte experiance[43]
Elle rapporte ensuite différents exploits que cette « sainte sciance » lui a permis de réaliser et reprend :
(Ibid. : 26-27.)N’as-tu sauvé Jason par ton magiq’ secours,
Charmant les ïeus veillans par ton remâché carme,
Et armant contre soi le Terre-né gendarme.
N’as-tu pas maintesfois par tes vers murmurés
Tiré des monumans les espris conjurés?
Ce sont bien son « remâché carme » et « [s]es vers murmurés » qui sont le support de son pouvoir magique : c’est par sa parole que Médée détourne les fleuves et parvient à ses fins violentes. Ici, comme chez le Gouverneur, la parole est structurée en « vers » et « carme » : entre les « cris » et les « murmur[e]s », Médée use de différentes tonalités de voix mais elle demeure dans le spectre de la parole, définie comme langage articulé et structuré, y compris lorsqu’elle s’adresse aux puissances surnaturelles.
Au troisième acte, Créon comprend que son sort est menacé, parce qu’il a eu songes, présages et mauvais augures, mais aussi parce qu’il sait que Médée n’a pas quitté la Grèce : « Car on m’a raporté que sa fureur menasse / Moi, ma fille, et Jason, appellant les espris / Du Ciel, et des Enfers, par effroïables cris[44] » (ibid. : 21). Ici, ce sont les « cris » qui caractérisent Médée : faut-il comprendre que Créon décrit le volume de la voix de la magicienne ou plutôt qu’il indique qu’elle se situe pour lui en deçà du langage articulé? Peut-être faut-il voir également dans ce caractère incompréhensible des cris de Médée le signe de son lien avec les puissances surnaturelles : son langage n’est pas accessible aux êtres humains, mais il est compréhensible des dieux et des déesses, puisqu’il·elles accèdent à ses demandes. Lorsqu’il voit arriver Médée, Créon réitère cette qualification : « Mais la voici venir grumellant sa furie, / Qui ne brasse rien moins que meurtre et tuerie » (idem).
Cris et grommellements, donc, caractérisent pour Créon la parole de Médée. Pourtant, le public a accès au déploiement d’une parole particulièrement structurée : comme l’a montré Louise Frappier, Médée présente une fureur « éloquente » (Frappier, 2000 : 41-42), qui ne sombre jamais sur scène dans le cri inarticulé. Mieux encore, elle démontre une capacité argumentative bien supérieure à celle du roi. Lorsque Créon rappelle son édit et commande à Médée de se taire et d’obéir, celle-ci plaide sa cause :
(La Péruse, 1990 [s.d.] : 22).Si de pouvoir Roïal ainsi tu le commandes,
C’est à moi, Roi Créon, à tes dits obeir :
Mais si avant juger il te plaisoit m’ouïr,
Plus equitablement me randre mon merite,
Comme toute equité à ce faire t’invite,
Quoi que lors m’en avint ce seroit justemant[45]
Donnant l’impression d’accepter facilement le pouvoir du Roi, la Colchidienne ne demande qu’à être entendue et jugée « equitablement ». Créon refusant de l’écouter, elle lui assène un propos gnomique sur l’art de gouverner : « Regne sans équité n’est pas long tans durable[46] » (idem). Lorsqu’il lui rappelle ses crimes, elle insiste sur le fait qu’elle n’en a reçu aucun bénéfice; or, autre vérité générale, « celui fait le peché qui le sent profitable[47] » (idem). Médée parvient, en quelques vers, à démontrer son innocence sans pour autant nier ses crimes. Présenter un propos comme gnomique, c’est imposer sa validité et son universalité à l’interlocuteur·trice (Schapira, 1997 : 31). Or, c’est son innocence que Médée impose à Créon. Ce dernier perçoit bien, du reste, la force argumentative de son adversaire, puisqu’il lui rétorque :
(La Péruse, 1990 [s.d.] : 23).Tes mots emmiellés n’auront pas le credit
De faire, que par eus, je revoque mon edit.
Je te commande encor’, que te mettes en voie,
Et que dans mon païs jamais on ne te voïe[48]
Nous sommes désormais loin des « cris », même si les « mots emmiellés » sont toujours perçus négativement : Créon dénonce une rhétorique charmeuse, qui enrobe la vérité pour la présenter à son avantage. Mais, surtout, le roi se montre incapable d’avancer des contre-arguments, contrairement à son homologue sénéquien[49]. Il n’accepte pas pour autant les arguments de son adversaire, si bien que Médée change de stratégie :
(Ibid. : 25.)Où irai-je Créon, sans aucune conduitte,
Pauvre, seulle, éploree? Où prandrai-je la fuitte?
Bons Dieus! Qui eût pensé qu’une fille de Roi
Peût quelque-fois tomber en un tel désarroi?
O Fortune, ô Amour, ô Jason, ô Médée,
O Junon, ô Himen, ô promesses, ô foi![50]
Médée donne d’elle-même un portrait pathétique, celui d’une femme délaissée de tous et de toutes, et insiste sur son statut royal pour susciter l’empathie de son interlocuteur, lui-même roi, et père d’une « fille de Roi ». Elle abandonne ensuite la structure syntaxique pour accumuler plusieurs interjections et donne alors l’impression d’être submergée par l’émotion. Créon résiste d’abord, en demandant à nouveau à Médée de se taire, mais il accède finalement à deux de ses demandes : il gardera ses enfants près de leur père et lui accordera un jour de délai, alors même qu’il pressent qu’elle saura en faire bon usage – « Pour brasser quelque mal tu quiers cet avantage » (idem). Lorsque Médée affronte Jason, elle use d’une stratégie similaire. Elle lui reproche d’abord sa déloyauté, lui rappelle les crimes qu’elle a commis « tant seulemant » pour lui et termine sa tirade sur une note plus pathétique :
(ibid. : 32).Ore pour récompanse
Tu as, me dédaignant, fait nouvelle alliance.
Ores je m’en irai : car pour m’infortuner
Ce n’est assés de toi me voir abandonner :
Il faut, pour m’achever qu’encore sans conduite,
O miserable moi! d’ici je prêne fuite[51]
Là aussi, la stratégie fonctionne : Jason lui répète qu’elle a « bien merité » son exil, mais propose néanmoins de lui « fournir » (idem) ce dont elle a besoin pour partir. C’est alors que Médée lui demande d’offrir une couronne à Glauque, et que, un peu naïvement, ou sous l’effet des charmes de la Colchidienne, Jason en conclut « que [son] courroux s’appaise » (idem) et accède à sa demande[52]. Du reste, il est essentiel que Jason soit persuadé de sa bonne foi, puisque lorsque les enfants viennent offrir la couronne à Glauque, celle-ci la refuse d’abord : c’est parce que son nouvel époux insiste qu’elle la place finalement sur sa tête, comme le rapporte le messager au cinquième acte (ibid. : 38-39).
Si la Colchidienne domine ses adversaires sur le plan rhétorique, beaucoup plus que chez les sources antiques[53], c’est néanmoins par la magie qu’elle en viendra à bout, comme elle l’explique juste après les derniers vers cités. D’abord, elle utilisera des ingrédients spéciaux qu’elle placera dans la couronne destinée à Glauque :
(ibid. : 32-33).Mais pour son beau parti, j’enclorrai dedans l’or
Du sang de Nesse même, et enclorrai encor,
Au dedans du presant, de la brullante aléne
Du taureau souffle-feu
Mais ensuite, ce sont bien ses paroles magiques qui lui permettront d’enchanter la couronne :
(ibid. : 33).Puis par mon art magic (qui si onc, à cette heure
Au besoin m’aidera) toi la noire demeure
De l’Averne profond, et vous les hautains Cieus
Ensemble appellerai d’un cri tout furieus.
Là, si onques jamais, ô lumiere nocturne,
Là je t’invoquerai sou’ l’horreur taciturne,
Et toute échevelée, et aïant les piés nus,
Par les travers secréts des bois les plus feuillus
Je courrai grommellant, et appellant sans cesse,
De suite, tes trois noms : tu m’oirrois, ma Déesse,
Et de mes cris ouïs signe me donneras,
Quand soudain en palleur ta clarté changeras.
Ainsi ce don cruel je charmerai de sorte,
Que quiconque premier dessus son chef le porte
Sera soudain brullé, et qui s’approchera
Pour lui donner secours, encore brullera[54]
Médée révèle les secrets de ses pouvoirs : elle livre la recette de sa potion et décrit la scène d’incantation qui lui permettra d’enchanter la couronne. Ce qui manque au public, dès lors, ce sont les formules magiques : la magicienne n’est cependant pas loin de les dévoiler puisqu’elles résident dans des invocations des enfers, des cieux et de Diane. Ce sont donc bien les mots de Médée qui tuent, d’abord parce qu’elle manipule ses adversaires, et ensuite parce que sa magie lui permet d’enchanter la couronne. Nous sommes au beau milieu d’un siècle de « chasse aux sorcières[55] », et Elsa Dorlin rappelle à cet effet le lien entre les mères, les sages-femmes et les sorcières pour les cas de suspicion d’infanticide[56] : l’histoire de Médée fait nécessairement écho à ces peurs (Dorlin, 2006 : 137-142)[57]. Surtout, et ce point nous semble essentiel, La Péruse réduit par rapport aux sources la part du concret dans l’usage de la magie (Fragonard, 1990 : ix). Or, cela permet de facto de rendre ses savoirs plus accessibles aux spectatrices. En effet, la parole est ici désignée comme la source principale du pouvoir de Médée, et la parole est également détenue par celles qui la lisent et qui l’entendent : les moyens de la vengeance sont donc accessibles à toute spectatrice, y compris celle qui ne maîtrise pas l’art de la sorcellerie.
Une fois cette première étape de la vengeance accomplie, Médée peut passer à la seconde : elle assassine ses fils, parce que « Jason i a part » (La Péruse, 1990 [s.d.] : 41). Juste avant le double meurtre, qui a lieu sur scène, elle a une vision infernale, celle des « rages d’Enfer », « Serpent » et « Megere », envoyée par son frère : même ici, assaillie par les « flambeaus noirs » (idem) des enfers, Médée ne perd ni son sang-froid ni sa rhétorique[58]. Puisque nous sommes au théâtre et que cette pièce ne contient pas de didascalies[59], c’est la parole de Médée qui signe la mort de ses deux fils : c’est lorsqu’elle passe de « Je t’en vai l’un occire » à « Nourrice, pran ce corps » (ibid. : 42) que nous comprenons que le premier fils est mort. De même, pour le second, le passage de « il mourra » à « Tien voilà l’autre fiz. Or l’un et l’autre est mort[60] » (idem) signale la mort au lectorat, mais aussi au public, puisqu’il faut constater la mort, au théâtre, pour la rendre tangible[61].
Ainsi, la parole de Médée est une parole efficace[62]. Une des spécificités de la Colchidienne par rapport aux autres héroïnes tragiques françaises de l’époque est qu’elle accomplit seule sa vengeance. Cette particularité est sensible dès l’ouverture de la pièce, puisqu’elle fait appel aux dieux et aux déesses, certes, mais moins pour l’aider que pour être témoins de sa vengeance :
(ibid. : 1).Vous, ô Dieus, que jura le perjure Jason,
Par moi, méchante helas! Seigneur de la Toison :
Je vous ateste tous, tous tous je vous appele
Au spectacle piteus de ma juste querele.
Et vous ombres d’Enfer, têmoins de mês secréts,
Oîés ma triste voix, oîés mes durs regréts[63]
Elle fait ensuite un voeu, toujours adressé aux Furies, qui scelle le destin fatal de Jason, puisqu’elle souhaite le voir « [p]auvre, banni, craintif, odieus, miserable, / Ne trouvant homme seul qui lui soit secorable[64] » (ibid. : 1-2). Or, dans les derniers vers de la pièce, voici comment elle décrit Jason : « Et en ce triste espoir ton esprit languira, / Pauvre, seul, sans enfans, sans beau pere, et sans fame[65] » (ibid. : 42). Le deuxième vers de cette citation fait écho au premier de la précédente. Médée a accompli sa volonté : dès qu’elle prend une décision, ou plutôt dès qu’elle l’énonce – ce qui, au théâtre, revient au même –, celle-ci est suivie des faits.
Ainsi, la parole de Médée est dangereuse pour ses ennemi·es, puisqu’elle est ce par quoi la mort advient. Doit-on alors conclure que La Péruse représenterait cette parole féminine pour mieux la condamner? Comme l’a montré Zoé Schweitzer à propos de Médée, le choix de représenter ou non les crimes féminins est « à double tranchant » (2007), puisqu’ils révèlent les dangers des femmes, mais aussi leur puissance potentielle. Pour le dire autrement, et pour analyser autrement ce qui a pu être décrit comme une ambiguïté[66], l’exemple de Médée est dangereux pour ses ennemis masculins et ceux qui leur ressemblent (les hommes infidèles), et il est puissant pour celles qui voudraient l’imiter (les femmes trompées) : le contenu de la leçon est fonction du ou de la destinataire.
***
Les trois derniers vers de la pièce de La Péruse invitent à réfléchir à la finalité du spectacle. Ici, nous avons choisi d’écouter sans distance ces propos de Médée. D’autres hypothèses sont possibles : on pourrait penser que le dramaturge ironise sur le supposé contenu pédagogique du théâtre, en montrant avec humour les dangers qui résideraient dans le fait de prendre pour exemples les personnages qui évoluent sur scène. Il est encore possible de considérer qu’il entend démontrer la puissance du théâtre, dont les horreurs menacent de passer de la scène à la salle – anticipant sans le savoir sur les guerres de Religion qui feront de la France un « échafaud » tragique (Hugot, 2021 : 476-485). Dans notre optique, celle d’une lecture au pied de la lettre de ces ultimes vers de Médée, La Péruse n’entendrait pas ériger son héroïne en exemple pour ses crimes : la sorcellerie, l’infanticide et le régicide ne sauraient être sérieusement désignés comme exemplaires dans la France du XVIe siècle. Il est possible néanmoins que Médée soit un exemple pour d’autres aspects de sa vengeance. En effet, en donnant à son héroïne les premiers et les derniers mots de la pièce, et en démontrant sa supériorité rhétorique sur ses adversaires ainsi que l’efficacité de son langage, il insiste sur les pouvoirs de cette femme qui sait faire de sa parole une arme, malgré les invitations au silence qui lui sont répétées. À une époque où la Querelle des Femmes engendre de nombreux textes sur les femmes et le féminin, il semble peu probable que La Péruse n’ait pas mesuré la portée des propos de son héroïne, et ce, d’autant plus que son recueil poétique témoigne d’une sensibilité à la cause féminine. Du reste, le texte, qui a probablement été représenté plusieurs fois au XVIe siècle, a bien pu avoir un effet sur ses spectatrices – même si nous n’en avons malheureusement aucun témoignage –, au-delà de ce que le dramaturge avait pu envisager. Ainsi, si, par rapport aux sources, La Péruse fait de la parole le coeur de la pièce, les derniers vers nous inviteraient à penser qu’il le fait, entre autres choses, pour insister sur la puissance de la parole féminine, qui serait transmissible à la salle. Ce que prouve Médée, en faisant de sa parole une arme vengeresse, c’est certes sa puissance individuelle, mais également la capacité d’une femme, et donc des femmes, à ne pas laisser l’infidélité impunie, en faisant à leur tour bon usage de leur verbe. À bons entendeurs?
Parties annexes
Note biographique
Nina Hugot, agrégée de Lettres modernes, est maître de conférences à l’Université de Lorraine. Si elle s’est d’abord intéressée aux deux tragédies d’Étienne Jodelle, ses travaux se consacrent plus largement au genre tragique dans la France de la Renaissance et interrogent notamment le rôle des personnages de femmes et du féminin dans l’élaboration de l’esthétique tragique au XVIe siècle. Elle a soutenu en 2018 une thèse intitulée « Une femme peut bien s’armer de hardiesse » : la tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583, à paraître. En 2019, elle rédige la partie littérature de l’Atlande sur Hippolyte et La Troade.
Notes
-
[1]
Par exemple : « Deh non vi movan le parole false » (Dolce, 1566 : 3 r°). Voir également Ruggero Campagnoli (2008).
-
[2]
Chez Sénèque, c’est Jason qui a le dernier mot de la pièce, et les derniers vers de Médée ne proposent pas de généralisation semblable (Sénèque, 2013 [s.d.] : 198-199). Chez Euripide, plus tôt dans la pièce (et avant les crimes), le choeur passe également au futur pour indiquer qu’« une dignité gagne la race féminine; les femmes ne seront plus l’objet d’un renom malsonnant », (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 38-39). Voir également George Buchanan (1568 : 155-156). Chez Euripide comme chez Buchanan, le choeur considère donc que l’exemple de Jason doit transformer les chants de muses, puisque les condamnations du sexe féminin doivent désormais passer au sexe masculin; il est donc possible que La Péruse se soit inspiré de ces vers, mais leur sens est assez différent. Amy Wygant y voit la différence principale de La Péruse avec ses sources (Wygant, 2007 : 54).
-
[3]
Sur la notion d’exemple et sa complexité à la Renaissance, consulter John D. Lyons (1989). Il insiste notamment sur le caractère énigmatique de l’exemple, qui n’est pas clairement assignable à un message moral.
-
[4]
Notons que dans son « Ode à un envieus blasonneur », La Péruse commente également, plutôt sur un ton humoristique, la puissance réelle de sa pièce et de son personnage : « Oses-tu dresser la tête / Contre un Tragique Poëte, / Qui peut bien, sans te toucher / Par sa Médée en furie / Comme l’orgueilleus Marsie / Te faire vif écorcher » (La Péruse, s.d. : 78).
-
[5]
Dans sa lecture de ces vers et de la figure de Médée chez La Péruse, Michael Meere propose de voir Médée comme un contre-exemple, alertant les spectateur·trices des effets désastreux de la passion (Meere, 2021 : 112-114). Dès lors, l’insistance sur la trahison de Jason et sur l’humanité de Médée se comprendrait dans cette ambition morale (et que Meere décrit comme profondément misogyne). Si les analyses de Meere sont souvent pertinentes, nous n’interprétons pas la pièce de la même façon, d’autant qu’il nous semble que la tragédie se limite difficilement à la représentation d’un exemple ou d’un contre-exemple (Hugot, 2021 : 288-300).
-
[6]
Plusieurs poètes signent des pièces liminaires ou participent au « Tombeau » qui suivent la tragédie, laissant apparaître sa renommée et la reconnaissance de sa valeur. Si Muret considère que Médée a été « Par les vers Perusins ores renouvelée » (Muret, dans La Péruse, 1990 [s.d.] : A1 v°), Ronsard le compare à Euripide (Ronsard, dans La Péruse, 1990 [s.d.] : 45). Notons encore que Bouchet écrit que l’auteur a « horribl[é] si fort le visage à Médée » et remarque que La Péruse la fait pleurer au moment de l’infanticide, ce qui n’était pas le cas chez les sources, ou encore, qu’elle n’a plus de pitié quand elle décide de tuer ses fils : il montre alors une sensibilité aux traits spécifiques que La Péruse confère à Médée (Bouchet, dans La Péruse, 1990 [s.d.] : A4 v°).
-
[7]
Il semble que la première mise en scène date de 1572 à Parthenay, où une « Médée » a été jouée, sans que le texte en soit attribué à La Péruse. Les renseignements sur cette représentation sont minces, mais on sait qu’un certain Maître Pierre Royer aurait incarné Médée; malheureusement, aucun témoignage de la réception de cette représentation n’a été retrouvé. Voir Nicolas Banachévitch (1970) et Bélisaire Lédain (1862). D’après Raymond Lebègue, il est encore possible que la Médée mentionnée dans les registres de la troupe de Talmy (qui n’évoque aucune actrice) jouée en 1594 à Arras soit celle de La Péruse (Lebègue, 1948 : 19-20). Si l’on sait que des actrices ont bien foulé la scène de l’époque (Evain, 2001; Lacour, 1921; Parussa, 2017), il n’est donc pas certain que Médée ait été incarnée par une femme au XVIe siècle, ce qui, bien sûr, n’enlève rien à la force du personnage et à ses effets possibles sur le public. Par ailleurs, le cadre des représentations (hors collège) nous laisse penser que des spectatrices ont bien pu y assister, mais, là encore, nous ne pouvons que spéculer.
-
[8]
Si, plus loin dans le même poème, il s’inquiète de la fidélité de son amante et évoque un lieu commun sur l’infidélité féminine, il s’en dédit immédiatement et rapporte ce propos à la peur et à la jalousie (La Péruse, s.d. : 140-141).
-
[9]
Phillip John Usher (2013) y voit une réflexion politique sur la prudence, puisque la rupture du serment devrait conduire les personnages à la défiance. Norman Doiron (2013) montre que le mensonge de Jason conduit Médée au mensonge et à l’usage de la sorcellerie. Alessandra Preda montre que cette parole fausse justifie au moins en partie la colère de Médée, « magicienne qui se sert prodigieusement des mots pour venger la parole trahie et répondre au verbe creux du pseudo-héros de la Grèce » (Preda, 2018 : 166). Enfin, Maurizio Busca (2015) considère que cette centralité de la parole a des précédents, chez Ovide et Buchanan, qui sont donc pour lui des sources du dramaturge.
-
[10]
On lit, plus loin : « Médée n’a contre la parole fausse que l’auxiliaire de la parole vraie » (Fragonard, 1990 : xii).
-
[11]
Comparer avec Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 44-45). Médée y insiste également sur le fait que Jason rompt ses serments conjugaux.
-
[12]
Comme l’a montré Busca (2015), la source de ces vers se trouve chez Ovide.
-
[13]
Nous avons montré ailleurs que La Péruse donne de Médée une image plutôt positive (Hugot, 2021 : 293-296).
-
[14]
La Péruse développe Sénèque : « Levis est dolor qui capere consilium potest / et clepere sese : magna non latitant mala »; « Légère est la rancoeur capable de calculs, / De guet-apens. Nul mal, s’il est grand, ne se cache » (Sénèque, 2013 [s.d.] : 139).
-
[15]
La Péruse suit Sénèque : « Medea superest, hic mare et terras vides / ferrumque et ignes et deos et fulmina »; « Médée reste, et tu vois en elle et mers et terres, / Et le fer et la flamme, et les dieux et la foudre! » (Ibid. : 138-139.)
-
[16]
Ici La Péruse suit Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 34-39).
-
[17]
Chez Sénèque : « sternam et evertam omnia »; « J’abattrai tout, je renverserai tout ». Ou encore : « mecum ruina cuncta si video obruta »; « Quand avec moi je verrai tout à bas, ruiné » (Sénèque, 2013 [s.d.] : 156-157).
-
[18]
Sur la vengeance de Médée, voir Elliott Forsyth (1994).
-
[19]
Nous n’avons pas trouvé la source de ces vers.
-
[20]
Chez Euripide, c’est Médée qui tient ces propos (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 24-27). La Péruse suit alors plutôt Sénèque – « Nulla vis flammae tumidive venti / tanta, nec teli metuenda torti, / quanta, cum conjux viduata taedis / ardet et odit » (Sénèque, 2013 [s.d.] : 168-169) –, même si d’autres comparants suivent chez La Péruse.
-
[21]
Nous n’avons pas trouvé chez Euripide et Sénèque la source de ces vers. Le texte d’Euripide présente en revanche de nombreuses généralisations misogynes, notamment dans la bouche de Créon et de Jason, qui sont absentes chez Sénèque et chez La Péruse. Voir par exemple Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 48-51; 82-83), et Claire Nancy (2016) pour une interprétation de ces sentences.
-
[22]
Nous n’avons pas trouvé la source précise de ces vers mais, chez Sénèque également, la Nourrice demande à plusieurs reprises à Médée de se taire.
-
[23]
« Lorsqu’elle est en état de fureur, Médée invoque les Furies et les dieux des Enfers en les suppliant d’appuyer sa vengeance et, par la parole, exacerbe sa rage criminelle » (Frappier, 2000 : 41).
-
[24]
Voir par exemple Françoise Charpentier (1979). Elle montre que la nourrice peut aider sa maîtresse, voire la relayer dans les actes immoraux (on peut songer à Phèdre) ou au contraire représenter la morale face au personnage principal. Nous sommes ici dans le second cas.
-
[25]
La Péruse suit Sénèque : « Sile, obsecro, questusque secreto abditos / manda dolori. Gravia quisquis vulnera / patiente et aequo mutus animo pertulit / referre potuit : ira quae tegitur nocet; / professa perdunt odia vindictae locum »; « Tais-toi, de grâce, enfouis tes plaintes, cache-les / Dans ton coeur douloureux. Qui, jusqu’au bout paitent, / Supporte sans mot dire une grave blessure / Pourra la rendre. Tu, le courroux pourra nuire. / Clamée, la haine perd ses moyens de vengeance » (Sénèque, 2013 [s.d.] : 138).
-
[26]
Voir par exemple chez Sénèque : « Siste furialem impetum, / alumna : vix te tacita defendit quies »; « Calme cet élan fou, Nourrissonne, et tais-toi, moindre des précautions » (ibid. : 139-140).
-
[27]
La Péruse développe à nouveau les propos de la Nourrice.
-
[28]
Chez Sénèque et Euripide, l’ordre ne passe pas par l’intermédiaire du messager.
-
[29]
Voir Sénèque (2013 [s.d.] : 154-155).
-
[30]
Voir Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 16-19).
-
[31]
Voir par exemple Louise Frappier : elle montre que s’opposent dans les tragédies le déploiement des passions et le discours sentencieux des personnages; celui-ci « jette l’anathème sur l’étalage d’une émotivité excessive considérée comme maladive » (Frappier, 2007 : 335).
-
[32]
Chez Sénèque : « Aequum atque iniquum regis imperium feras »; « L’ordre du roi, juste ou injuste, subis-le » (Sénèque, 2013 [s.d.] : 142-143). De même, dès que Créon aperçoit Médée, il demande à ses valets de la faire taire (ibid. : 142).
-
[33]
Chez Sénèque, Créon est moins directif : « Jam exisse decuit. Quid seris fando moras? »; « Tu devrais être loin, que traîner en discours? » (Ibid. : 146-147.)
-
[34]
Voir Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 40-43).
-
[35]
Departemant signifie « départ ».
-
[36]
La Péruse reformule le débat entre Jason et Médée chez Sénèque, sans traduire strictement (Sénèque, 2013 [s.d.] : 158-167).
-
[37]
Concernant la place des femmes dans la société de la Renaissance et notamment leur rapport au pouvoir et à la culture, on pourra consulter Evelyne Berriot-Salvadore (1990), Claude La Charité et Roxanne Roy (2012), Ian MacLean (1980), Linda Timmermans (2005), Éliane Viennot (2006), Thierry Wanegffelen (2008) et Natalie Zemon Davis (1975).
-
[38]
Sur la fureur de Médée, voir Vincent Dupuis (2015 : 21-40).
-
[39]
Voir Sénèque, où l’évocation est plus brève (Sénèque, 2013 [s.d.] : 152-153).
-
[40]
Le Pédagogue ne prononce pas ces mots chez Euripide.
-
[41]
Médée confirme cette idée à la fin du troisième acte, lorsqu’elle se rappelle ses exploits passés : « C’est trop que cela, ce sont faits de pucelle, / Tu ne savois pour lors que c’est d’être cruelle : / Hausse-toi maintenant, horrible ta fureur, / Tes faits facent aus Dieus et aus hommes horreur » (La Péruse, 1990 [s.d.] : 27).
-
[42]
Il évoque également son « furieus hurlemant » (ibid. : 15).
-
[43]
Chez Sénèque, elle ne se retrouve pas seule après le dialogue avec Créon. La Péruse suit donc Euripide, voir notamment les vers 401-402 (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 38-39).
-
[44]
Chez Sénèque, Créon voit également arriver Médée mais sa réplique est beaucoup moins longue et il n’insiste pas sur sa parole (Sénèque, 2013 [s.d.] : 140-143).
-
[45]
Médée est plus respectueuse que chez Sénèque (ibid. : 142-143) et moins plaintive que chez Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 26-35).
-
[46]
Chez Sénèque « Iniqua numquam regna perpetuo manent »; « Qui règne injustement jamais longtemps ne règne » (Sénèque, 2013 [s.d.] : 142-143).
-
[47]
Médée dit chez Sénèque, mais à Jason : « cui prodest scelus is fecit »; « qui profite du crime le commet » (ibid. : 162-163).
-
[48]
Ici la source est Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 30-31).
-
[49]
Voir Sénèque (2013 [s.d.] : 146). Voir également Euripide (2012 [431 av. J.-C.] : 26-35).
-
[50]
Chez Sénèque, des vers assez semblables de Médée avaient moins vocation à insister sur son sort présent que sur sa grandeur passée, et dès lors, à avertir Créon de la possibilité de son propre renversement de fortune (Sénèque, 2013 [s.d.] : 142-143). La Péruse reprend le portrait que Médée donne d’elle-même mais chez lui, elle insiste sur sa misère actuelle pour apitoyer Créon. Chez Euripide, nous retrouvons l’origine de ces propos dans un dialogue de Médée avec les femmes de Corinthe (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 22-27). La Péruse suit davantage Sénèque qu’Euripide, puisque le discours est adressé à Créon, mais il reprend au dramaturge grec la tonalité plaintive du propos. Sur l’articulation entre plainte et fureur chez Médée, voir également Florence Dobby-Poirson (2013).
-
[51]
La tonalité n’est pas tout à fait la même chez Sénèque, voir notamment les vers 540-543 (Sénèque, 2013 [s.d.] : 164-165).
-
[52]
Chez Euripide, Médée argumente mieux en faveur de son revirement, ce qui explique donc mieux que Jason soit convaincu. Voir les vers 869-905 (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 80-83).
-
[53]
Concernant Jason, voir par exemple sa longue réplique chez Euripide (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 48-51), suivie d’un commentaire du choeur qui loue sa rhétorique mais lui rappelle sa déloyauté.
-
[54]
Sur cette scène, voir Sénèque (2013 [s.d.] : 179-185).
-
[55]
Voir par exemple Jean Delumeau (1980).
-
[56]
Voir également Aurélie Chevanelle-Couture (2019).
-
[57]
Comme le rappelle également Meere, l’édit de février 1556 proclamé par Henri II fait de l’infanticide un crime capital, ce qui a conduit de nombreuses femmes à être exécutées : la pièce résonne donc singulièrement avec l’actualité (Meere, 2021 : 97).
-
[58]
Sur l’égarement qui précède l’infanticide, voir Françoise Charpentier (1995).
-
[59]
Sur cette question, voir Véronique Lochert (2009).
-
[60]
Voir chez Sénèque (2013 [s.d.] : 195-199). Chez Euripide, les enfants sont tué·es hors scène, mais le public les entend avec le choeur (Euripide, 2012 [431 av. J.-C.] : 112-113).
-
[61]
La critique a montré que puisque La Péruse supprime le dilemme de Médée, la part textuelle de l’infanticide est réduite par rapport aux sources. Nous pourrions là aussi y voir un effet de la concentration sur la parole vengeresse de Médée, plus que sur l’acte lui-même, néanmoins le fait que l’infanticide soit placé sur la scène lui donne une place importante dans le spectacle, et comme le rappelle Meere, la durée de la performance n’est pas nécessairement en lien avec la longueur du texte (Meere, 2021 : 108). Sur l’infanticide, voir Françoise Charpentier (1995), François Lecercle (2001a; 2001b) et Zoé Schweitzer (2008).
-
[62]
« Tout le pouvoir meurtrier de Médée est ainsi concentré dans la force d’une parole magique et surnaturelle : ses mots exercent un véritable pouvoir sur les choses. […] La fureur éloquente de Médée suppose un pouvoir persuasif du pathos, la fécondité oratoire des passions. Médée ne serait-elle pas l’incarnation du versant troublant et inquiétant du pouvoir de l’éloquence? » (Frappier, 2000 : 42.)
-
[63]
La Péruse développe Sénèque, voir les vers 1-23 (Sénèque, 2013 [s.d.] : 128-129).
-
[64]
Chez Sénèque, « vivat, per urbes erret ignotas egens / exul, pavens, invisus, incerti laris »; « qu’il vive errant, dans des cités inconnues, pauvre, / Exilé, apeuré, détesté, sans foyer » (idem).
-
[65]
Nous n’avons pas trouvé ces vers chez Sénèque.
-
[66]
Par exemple : « La parole trahie par avidité engendre ainsi la parole noire de la magicienne, le double discours trompeur avec lequel la barbare, devenue jasonienne, confond et manipule le prince parjure et le “roi félon”, Créon, en préparant, aux troisième et quatrième actes, sa vengeance affreuse. À l’aube de la tragédie française, le jeune humaniste, formé aux études de droit, choisit Médée et affirme sur la scène cette primauté de la parole, sa valeur cérémoniale, créatrice ainsi que son ambiguïté, verbe manipulateur, puissant et fragile à la fois, magie dont toute civilisation devrait garantir les limites » (Preda, 2018 : 171; souligné dans le texte).
Bibliographie
- BANACHÉVITCH, Nicolas (1970), Jean Bastier de la Péruse, 1529-1554 : étude biographique et littéraire, Genève, Slatkine.
- BERRIOT-SALVADORE, Evelyne (1990), Les femmes dans la société française de la Renaissance, Genève, Droz, « Histoire des idées et critique littéraire ».
- BUCHANAN, George (1568), Georgii Buchanani Scoti poetae eximii Franciscanus et fratres, Bâle, Guarinus.
- BUSCA, Maurizio (2015), « Autour de deux sources de la Médée de La Péruse : Ovide et George Buchanan traducteur d’Euripide », dans Michele Mastroianni (dir.), La tragédie et son modèle à l’époque de la Renaissance entre France, Italie et Espagne, Turin, Rosenberg et Sellier, « Biblioteca di studi francesi », p. 47-67.
- CAMPAGNOLI, Ruggero (2008), « Autour du complexe de Médée : trois tragédies du XVIe siècle et quelques emblèmes », dans Peter Schnyder (dir.), Métamorphoses du mythe : réécritures anciennes et modernes des mythes antiques, Paris, Orizons, « Universités », p. 313-329.
- CHARPENTIER, Françoise (1995), « Médée figure de la passion : d’Euripide à l’âge classique », dans Bernard Yon (dir.), Prémices et floraison de l’âge classique : mélanges en l’honneur de Jean Jehasse, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, « Renaissance et âge classique », p. 398-403.
- CHARPENTIER, Françoise (1979), Pour une lecture de la tragédie humaniste : Jodelle, Garnier, Montchrestien, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne.
- CHEVANELLE-COUTURE, Aurélie (2019), Médée, mémoire du théâtre : une poétique du mal (1556-1713), Genève, Droz, « Travaux du Grand Siècle ».
- DELUMEAU, Jean (1980), La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles) : une cité assiégée, Paris, Le Livre de Poche.
- DOBBY-POIRSON, Florence (2013), « Le vocabulaire des émotions tragiques dans Cléopâtre captive d’Étienne Jodelle et Médée de Jean de La Péruse », dans Marie-Dominique Legrand et Keith Cameron (dir.), Vocabulaire et création poétique dans les jeunes années de la Pléiade (1547-1555), Paris, Honoré Champion, « Colloques, congrès et conférences sur le seizième siècle », p. 293-305.
- DOIRON, Norman (2013), « Médée ou la naissance de la sorcellerie : la tragédie oubliée de La Péruse », Revue d’histoire du théâtre, n° 258, p. 217-235.
- DOLCE, Lodovico (1566), Medea, Venise, Domenico Farri.
- DORLIN, Elsa (2006), La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Paris, La Découverte, « La Découverte poche / Sciences humaines et sociales ».
- DUPUIS, Vincent (2015), Le tragique et le féminin : essai sur la poétique française de la tragédie (1553-1663), Paris, Classiques Garnier, « Lire le XVIIe siècle ».
- ÉRASME DE ROTTERDAM (2013 [1500]), Adages : edition minor, Jean-Christophe Saladin (dir.), Paris, Les Belles Lettres, « Miroir des humanistes », vol. 2.
- EURIPIDE (2012 [431 av. J.-C.]), Médée, Louis Méridier (éd.), Paris, Les Belles Lettres, « Classiques en poche ».
- EVAIN, Aurore (2001), L’apparition des actrices professionnelles en Europe, Paris, L’Harmattan, « Univers théâtral ».
- FORSYTH, Elliott (1994), La tragédie française de Jodelle à Corneille (1553-1640) : le thème de la vengeance, Paris, Honoré Champion.
- FRAPPIER, Louise (2007), « Le spectacle des passions sur la scène humaniste : fonction et statut de la lamentation dans les tragédies profanes de Robert Garnier », dans Marie-France Wagner, Louise Frappier et Claire Latraverse (dir.), Les jeux de l’échange : entrées solennelles et divertissements du XVIe au XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, « Études et essais sur la Renaissance », p. 319-341.
- FRAPPIER, Louise (2000), « La topique de la fureur dans la tragédie française du XVIe siècle », Études françaises, vol. 36, n° 1, p. 29-47.
- HUGOT, Nina (2022), « “Si fault-il pourtant clorre le bec” : les adresses aux spectatrices chez Théodore de Bèze (Abraham sacrifiant) et Louis des Masures (Tragédies saintes) », Études épistémè, no 42, https://journals.openedition.org/episteme/15522
- HUGOT, Nina (2021), « D’une voix et plaintive et hardie » : la tragédie française et le féminin entre 1537 et 1583, Genève, Droz, « Travaux d’humanisme et Renaissance ».
- LA CHARITÉ, Claude et Roxanne ROY (dir.) (2012), Femmes, rhétorique et éloquence sous l’Ancien Régime, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, « L’école du genre ».
- LACOUR, Léopold (1921), Les premières actrices françaises, Paris, Librairie Française.
- LA PÉRUSE, Jean Bastier de (1990 [s.d.]), Médée, Marie-Madeleine Charpentier (éd.), Mugron, Éditions José Feijoo.
- LA PÉRUSE, Jean Bastier de (s.d.), La Medee, tragedie : et autres diverses poesies, Poitiers, Marnef et Bouchet, gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86184881
- LEBÈGUE, Raymond (1948), « Le répertoire d’une troupe française à la fin du XVIe siècle (troupe Adrien Talmy) », Revue d’histoire du théâtre, no 1, p. 9-24.
- LECERCLE, François (2001a), « Médée et la passion mortifère », dans François Lecercle et Simone Perrier (dir.), La poétique des passions à la Renaissance : mélanges offerts à Françoise Charpentier, Paris, Honoré Champion, « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance », p. 239-255.
- LECERCLE, François (2001b), « Médée, la barbarie au féminin », dans Jean-Yves Debreuille et Philippe Régnier (dir.), Mélanges barbares : hommage à Pierre Michel, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 71-80.
- LÉDAIN, Bélisaire (1862), « Journal historique de Généroux, notaire à Parthenay (1567-1576) », Mémoire de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres, 2e série, tome 2, p. 1-9.
- LOCHERT, Véronique (2009), L’écriture du spectacle : les didascalies dans le théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles, Genève, Droz, « Travaux du Grand Siècle ».
- LYONS, John D. (1989), Exemplum: The Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy, Princeton, Princeton University Press, « Princeton Legacy Library ».
- MACLEAN, Ian (1980), The Renaissance Notion of Woman: A Study in the Fortunes of Scholasticism and Medical Science in European Intellectual Life, Cambridge, Cambridge University Press, « Cambridge Studies in the History of Medicine ».
- MEERE, Michael (2021), Onstage Violence in Sixteenth-Century French Tragedy, Oxford, Oxford University Press.
- NANCY, Claire (2016), Euripide et le parti des femmes, Paris, Éditions Rue d’Ulm, « Études de littérature ancienne ».
- PARUSSA, Gabriella (2017), « Le théâtre des femmes au Moyen Âge : écriture, performance et mécénat », dans Catherine Croizy-Naquet, Stéphanie Le Briz-Orgeur et Jean-René Valette (dir.), Théâtre et révélation : donner à voir et à entendre au Moyen Âge. Hommage à Jean-Pierre Bordier, Paris, Honoré Champion, « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », p. 303-321.
- PREDA, Alessandra (2018), « La juste colère : autour de la Médée de Jean-Bastier de La Péruse », Atlante. Revue d’études romanes, no 9, p. 163-178.
- SCHAPIRA, Charlotte (1997), La maxime et le discours d’autorité, Paris, SEDES, « Les livres et les hommes ».
- SCHWEITZER, Zoé (2008), « Variations sur la mort des enfants : Médée, Jephté et La Famine », Albineana, n° 20, p. 101-116.
- SCHWEITZER, Zoé (2007), « Sexualité et questions de genre dans les Médée renaissantes et classiques », Silène, www.revue-silene.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=89
- SÉNÈQUE (2013 [s.d.]), « Médée », dans Tragédies, François-Régis Chaumartin (éd.), Paris, Les Belles Lettres, « Classiques en poche ».
- TIMMERMANS, Linda (2005), L’accès des femmes à la culture sous l’Ancien Régime, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques – essais ».
- USHER, Phillip John (2013), « Prudency and the Inefficacy of Language: Re-politicizing Jean de La Péruse’s Médée (1553) », MLN, vol. 128, n° 4, p. 868-880.
- VIENNOT, Éliane (2006), La France, les femmes et le pouvoir, Paris, Perrin, tome 1 (« L’invention de la loi salique (Ve-XVIe siècle) ».
- WANEGFFELEN, Thierry (2008), Le pouvoir contesté : souveraines d’Europe à la Renaissance, Paris, Payot, « Biographie Payot ».
- WYGANT, Amy (2007), Medea, Magic and Modernity: Stages and Histories, 1553-1797, Aldershot, Ashgate.
- ZEMON DAVIS, Natalie (1975), Society and Culture in Early Modern France, Stanford, Stanford University Press.




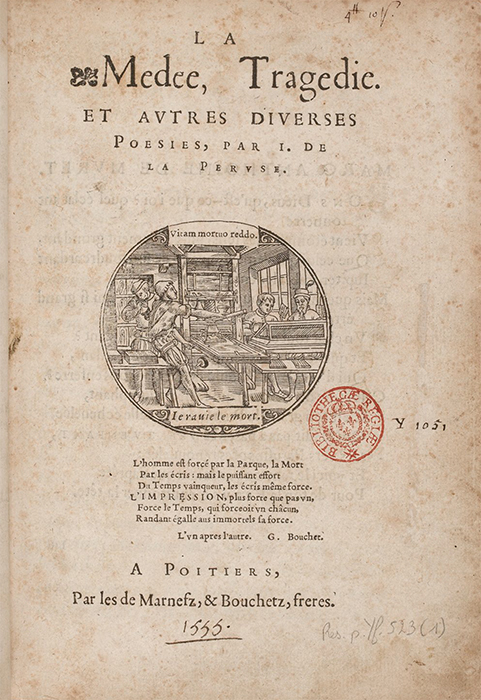
 10.7202/036169ar
10.7202/036169ar