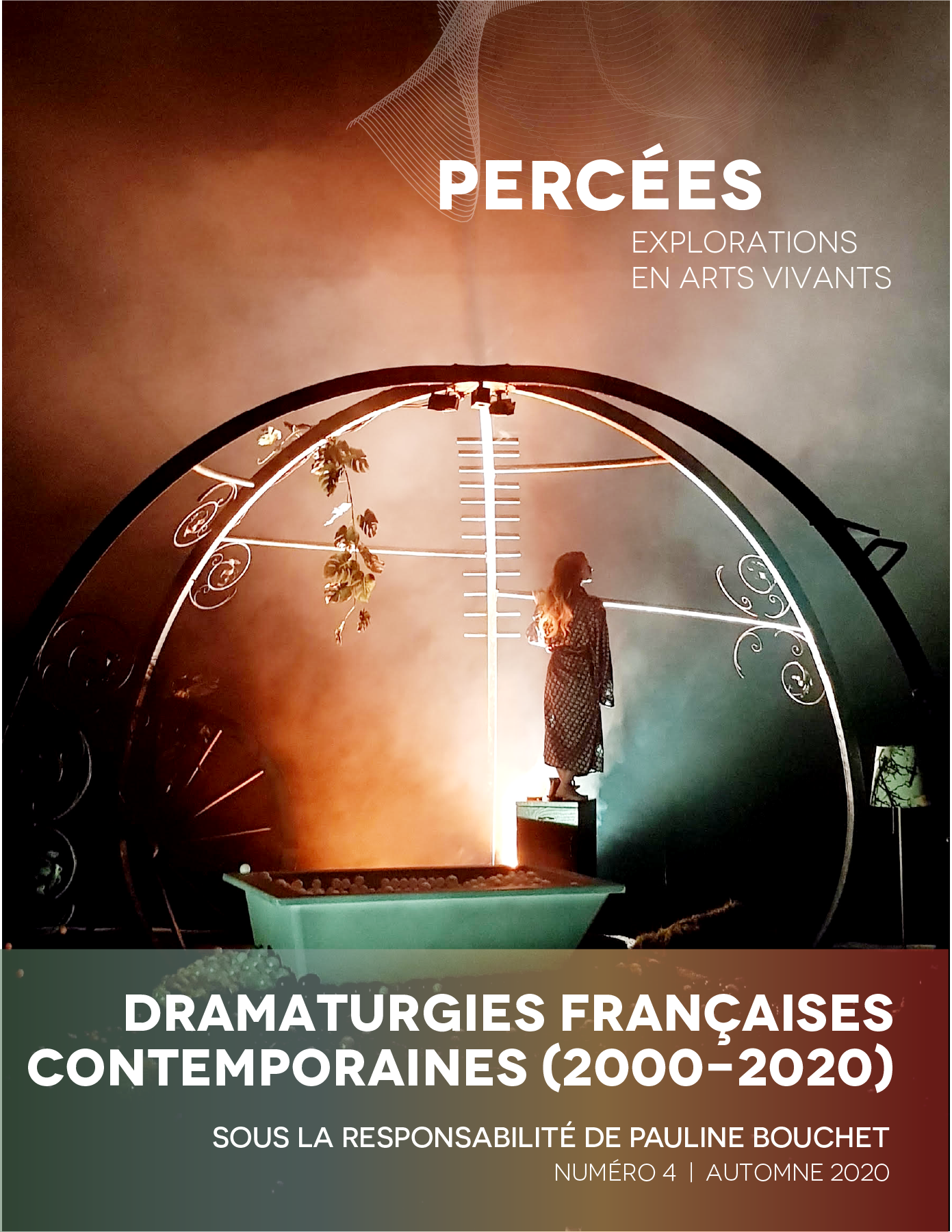Résumés
Mots-clés :
- Goethe,
- Faust,
- Faust augmenté,
- processus de création,
- dramaturgie,
- théâtre contemporain
Dans le prologue, par exemple, c’est étonnant de voir à quel point l’écriture frontale et métathéâtrale du Québécois Étienne Lepage reprend les questions que Goethe posait à son public sur la place du spectacle dans la société. Mais Étienne le fait avec une ironie dont les échos sont acides dans notre contexte sanitaire, où la culture a été bousculée par les restrictions gouvernementales et où la concurrence avec le numérique a été largement encouragée, aux dépens de la notion même d’« art vivant ». Les parties de Pauline Peyrade et de Marine Bachelot Nguyen ont évidemment d’importantes résonances avec les mouvements les plus récents d’émancipation des femmes. Dans les parties consécutives, le texte passe d’un centre de gravité à un autre. Grâce à la cavale de Faust et de Méphisto à travers le monde, on assiste à un déplacement progressif des cercles de personnages, mais aussi des espaces et des enjeux. La seconde partie, « Paradise », tourne autour des États-Unis et des miroirs aux alouettes que ce pays nous tend dans les domaines de la finance ou de la réalité augmentée. La troisième partie, « Ce qui gronde », repose sur la collaboration active de dramaturges importants des Caraïbes, de l’Afrique, de l’océan Indien ou des Premières Nations, dont la plupart se connaissent. Ensemble, il·elles remettent en perspective des enjeux majeurs comme notre relation à l’industrialisation, la gouvernance, l’amenuisement des ressources, etc. Ces voix auront en quelque sorte le dernier mot du spectacle. Dans son dernier livre, Tisser, notre collaborateur Jean-Luc Raharimanana écrit que « chaque point du monde est le centre du monde » (Raharimanana, 2021 : 59). Sans doute la gestation de notre projet commun est-elle inconsciemment influencée par cette pensée. Il est impossible de déterminer un seul motif ou dénominateur commun à toutes ces parties en train de s’écrire. S’il fallait malgré tout tenter d’en extraire un, ce serait hypothétiquement cette obsession qu’a notre modernité de vouloir tout posséder, tout mettre à disposition. L’épopée de Faust et Méphisto nous rappelle le prix à payer de cette entreprise qui semble vouloir le bien du monde, mais qui signe peut-être – c’est très paradoxal – le début d’un égarement. Comme l’écrit le philosophe allemand Hartmut Rosa : « L’élément culturel moteur de cette forme de vie que nous qualifions de moderne est l’idée, le voeu et le désir de rendre le monde disponible. Mais la vitalité, le contact et l’expérience réelle naissent de la rencontre avec l’indisponible » (Rosa, 2020 : 105). Oublieux de cette loi, Faust a peut-être perdu un rapport de résonance avec le monde qui l’entoure, comme si la corde qui le liait à ce dernier ne vibrait plus, comme si la réalité était devenue vide, froide et terne à ses yeux. Il tente de ranimer cette relation par tous les moyens possibles, sans réaliser que cet objectif ne peut être atteint par les seuls modes du volontarisme sans limites ou de la maîtrise technique. Telle est peut-être sa tragédie. Et la nôtre. On pourrait penser que cette initiative tente de donner une forme théâtrale à notre époque dite « mondialisée », mais cette notion à forte connotation économique ne m’inspire pas du tout. Peut-être qu’en faisant circuler un mot comme « mondialité », Patrick Chamoiseau, par exemple, nous invite collectivement à réfléchir de manière bien plus intéressante et fouillée. Selon cet immense écrivain martiniquais, « la mondialité, c’est tout l’humain envahi par la divination de sa diversité, reliée en étendue et profondeur à travers la planète […]. La mondialité, c’est surtout ce que la mondialisation économique n’a pas envisagé, qui surgit et se …
Parties annexes
Bibliographie
- CHAMOISEAU, Patrick (2017), Frères migrants, Paris, Seuil, « Cadre rouge ».
- COCCIA, Emanuele (2020), Métamorphoses, Paris, Payot & Rivages, « Bibliothèque Rivages ».
- DUFOURMANTELLE, Anne (2014 [2011]), Éloge du risque, Paris, Payot & Rivages, « Poche ».
- MBEMBE, Achille (2020), Brutalisme, Paris, La Découverte.
- RAHARIMANANA, Jean-Luc (2021), Tisser, Montréal, Mémoire d’encrier.
- ROSA, Hartmut (2020), Rendre le monde indisponible, Paris, La Découverte, « Théorie critique ».