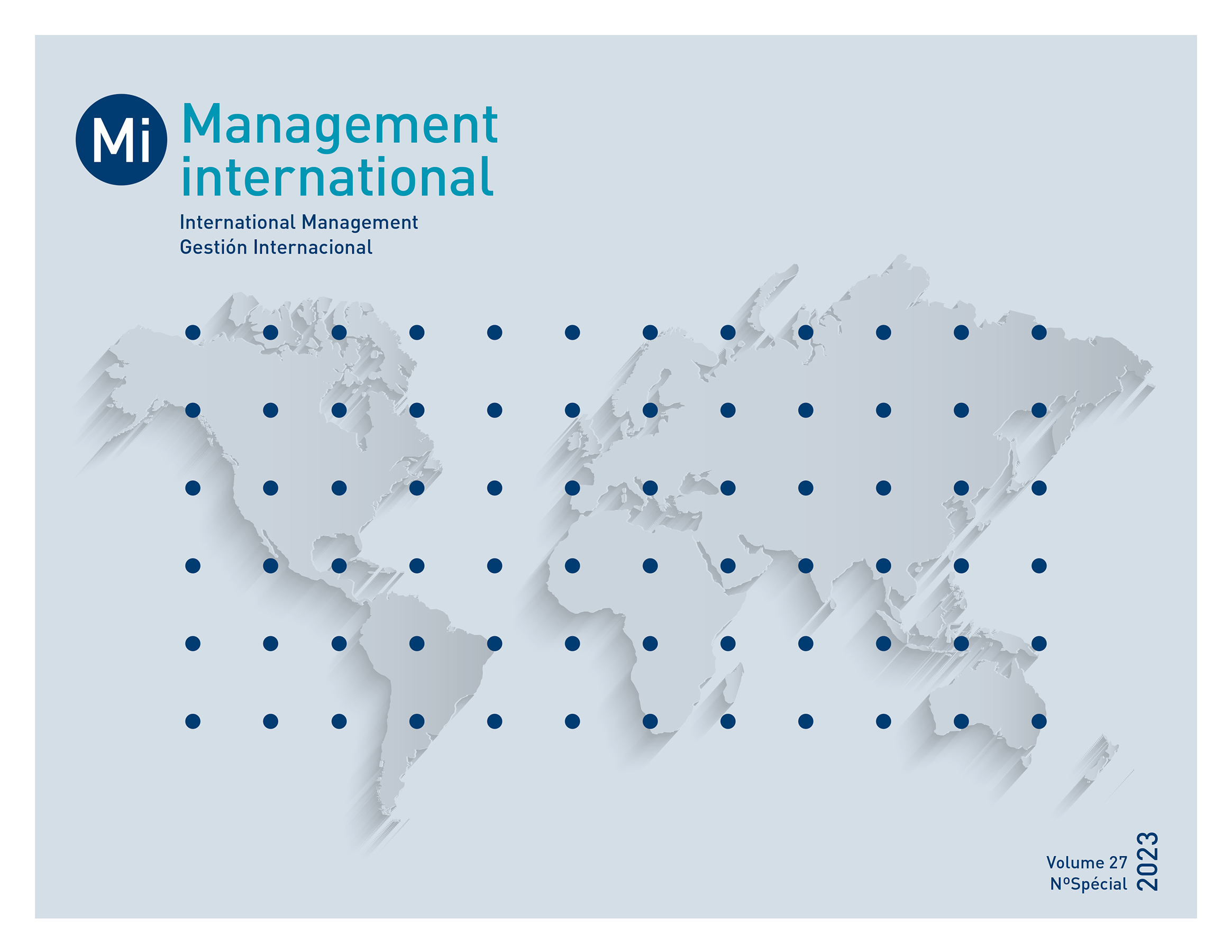Corps de l’article

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès à 93 ans du professeur Robert Le Duff, survenue le 18 août 2023 à la suite de complications médicales. Retracer rapidement sa carrière, le rôle éminent et majeur qu’il a joué avec d’autres dans la reconnaissance des sciences de gestion, et en leur sein du management public, nous semble être la meilleure façon de lui rendre hommage.
Né en 1930, Robert Le Duff a vécu son enfance à Brest. Durant la seconde guerre mondiale, il allait au collège en passant devant la maison où vivait sa grand-mère pour voir si les bombardements de la nuit ne l’avaient pas détruite. Après sa scolarité dans un collège de Brest et au lycée Saint-Jo à Caen, puis des études d’économie à l’université de Caen, il trouva un emploi dans une banque et entreprit de préparer et de soutenir une thèse de doctorat sous la direction de Raymond Barre, qui fut premier ministre du président Giscard d’Estaing (1976-1981).
Il passa avec succès les épreuves du concours d’agrégation de sciences économiques, les sciences de gestion n’étant pas encore reconnues en tant que telles à l’époque. Il fut ainsi nommé professeur à l’université de Rennes où il enseigna aussi les mathématiques. A Rennes, il fut en contact avec Jane Aubert-Krier qui y avait ouvert l’un des cinq premiers Instituts d’Administration des Entreprises (IAE) créés en 1955 par Gaston Berger; ce professeur de philosophie, alors directeur de l’enseignement supérieur, voulait ainsi introduire dans l’université l’équivalent français du fameux Master of Business Administration (MBA).
A cette époque, on se situe à la genèse des sciences de gestion en tant que discipline académique à part entière.
Une carrière au service de l’émergence des sciences de gestion
De retour à Caen, le professeur Le Duff créa l’IAE de Caen. Ce fut l’une des grandes oeuvres de sa carrière, avec l’ouverture du Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises (CAAE), devenu depuis Master d’Administration des Entreprises (MAE). Ce diplôme connut ensuite un grand succès dans tous les IAE de France, désormais au nombre de 38. Parmi les formations qu’il a ouvertes à l’IAE de Caen, Robert Le Duff se montrait très fier de la création de la capacité en gestion, à l’instar de la capacité en droit, qui permet à des personnes de faire des études supérieures de gestion (ou de droit) sans le baccalauréat.
Ayant travaillé au Crédit Agricole avant sa carrière universitaire et grâce à sa personnalité très ouverte sur les autres, il avait le contact facile avec les chefs d’entreprise, qualité importante pour un directeur d’IAE. Il fut ensuite président de l’Association des directeurs d’IAE. Dans ce cadre, il lança ainsi en 1983 le tutorat collectif qui permet encore aujourd’hui à des doctorants en gestion de présenter leurs travaux devant des professeurs confirmés dans le cadre des Journées des IAE, lieu de rencontre annuel des enseignants-chercheurs en sciences de gestion. Il fut aussi président de la section 06 (sciences de gestion) du Conseil National des Universités (CNU) et président d’une session du jury du concours d’agrégation de cette discipline. A ces titres, il put aider de nombreux collègues aujourd’hui confirmés dans leur carrière.
Pour donner une idée supplémentaire de l’esprit « entrepreneur académique » de Robert Le Duff, citons la confection de l’Encyclopédie de la Gestion et du Management (EGM), parue sous sa direction en 1999 chez Dalloz. Cet ouvrage de 1644 pages, qui fut rapidement épuisé sans que l’éditeur ne souhaite une réimpression, a été plébiscité par les enseignants-chercheurs, en particulier par ceux qui préparaient les concours et qui attribuaient une partie de leur réussite à la consultation de cet ouvrage.
Un amoureux des grands auteurs en économie et en théorie des organisations
Robert Le Duff était surtout attaché à la lecture des grands auteurs qu’il recommandait à ses étudiants. Adam Smith avait une place de choix pour sa Théorie des sentiments moraux. Il appréciait Ivan Illich pour ses concepts d’hétéronomie et de contre-productivité, John Rawls pour sa Théorie de la Justice et les ouvrages de Jean-Pierre Dupuy comme Le Sacrifice et l’Envie[1]. Il appréciait Elinor Ostrom pour ses recherches sur les biens communs, mais aussi Amartya Sen pour sa conception de la démocratie, de la justice sociale, et sa proposition de développer les capabilités[2] de chacun dans les programmes publics. Parmi les auteurs en théorie des organisations, il appréciait les grandes synthèses de Henry Mintzberg.
Il était aussi inspiré par les thèses sur la gouvernabilité issues de la théorie générale des systèmes de Ludwig von Bertalanffy[3] comme de la stupéfiante « loi de la variété requise » - ou « loi d’Ashby[4] » qui fournit la condition de contrôle d’un système par son pilote -, mais aussi la théorie (mathématique) des catastrophes de René Thom[5]. Dans ses cours, il accordait une grande place à la théorie de la décision, exposant à ses étudiants des apports éclectiques allant des ouvrages d’Herbert Simon à la critique de la décision de Lucien Sfez[6].
L’appétit intellectuel qu’il transmettait dans ses cours allait vers ces auteurs, précédemment cités, qui surplombaient ce débat avec des concepts éclairant le fonctionnement des sociétés sous un angle radicalement différent et dont les théories se voulaient universelles pour la bonne marche des sociétés.
Robert Le Duff a toujours défendu les approches conceptuelles et la compréhension des phénomènes observés dans leur spécificité. Il portait un regard critique sur les études de terrain faites de prétendues hypothèses vérifiées à l’aide de questionnaires à l’emporte-pièce. Il préférait conseiller à ses doctorants d’imaginer ce qu’auraient pu écrire quelques grands auteurs sur leur sujet de recherche, par exemple sur l’organisation « ville », ou de construire des configurations urbaines idéal-typiques selon la méthode de Mintzberg. Passé l’étonnement, les thésards trouvaient une grande satisfaction dans ce travail stimulant d’imagination. C’était sa méthode, déplorant la tendance à la standardisation des thèses en sciences de gestion au détriment des approches résolument conceptuelles ou créatives.
Un pionnier dans la reconnaissance du management public en France
Le professeur Robert Le Duff fut aussi un chercheur spécialiste reconnu de gestion publique. Il fit ses premiers pas dans cette discipline des sciences de gestion par l’économie publique, une des matrices de la gestion publique qui finalement sera dénommée « management public ». Son investissement débute en 1969 avec le pilotage d’un contrat d’études sur la Rationalisation des choix budgétaires (RCB) dans le cadre de la Direction de la Prévision (DP) rattachée au ministère des finances. Ce fut l’occasion de la création à Caen d’un laboratoire RCB couplé à un diplôme d’études supérieures (DES). Déclinaison française de l’expérience américaine du PPBS, la RCB avait comme ambition le lancement du calcul économique dans les politiques publiques. L’expérience française de la RCB fut un relatif échec qu’il regrettait; parmi les raisons invoquées on retiendra que le couple « objectif-programme » n’était pas compatible avec un système administratif trop centralisé, lourd et compliqué, où chaque administration se saisissait du programme et de son financement et en oubliait les objectifs...
En 1988, il publiera chez Vuibert avec Jean-Claude Papillon, professeur à l’université de Caen, un des premiers manuels intitulé Gestion publique[7]. Pour lui, Paul Samuelson, père du calcul économique et de l’équilibre général étendu à la sphère publique, était au fondement de la définition des biens publics avec ses critères de classification des biens, les biens publics « purs » relevant à la fois de la non-rivalité et de la non-exclusion, et l’inverse pour les biens privés « purs ». Mais il portait un regard particulier sur les « biens mixtes », « rivaux » mais sans exclusion possible a priori sauf par le tarif ou la congestion, qui appellent justement à la mise en oeuvre délicate d’un management non marchand ou collectif. Ainsi, ses « préférences » allaient vers la gestion des organisations hybrides, associant du privé et du public, dans la lignée des organisations hermaphrodites chères à Serge-Christophe Kolm[8].
Il a notamment été l’un des membres fondateurs en 1999 du Recemap (Réseau d’enseignants-chercheurs et experts en management public) et sa transformation en Airmap (Association internationale de recherche en management public). Le Xe colloque de l’Airmap à l’université de la Sorbonne en 2019 lui a d’ailleurs rendu un hommage en lui décernant le prix Airmap de la recherche francophone en management public. Dans ce cadre, il fut également l’un des fondateurs de la revue Gestion et Management Public (GMP), aujourd’hui bien reconnue dans le monde académique.
Il initiera en 1995 avec Jean-Jacques Rigal, professeur à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, les « Rencontres « Ville-Management », considérant que la Ville était un immense et nouveau terrain d’expérimentation et développement pour le management public. Les Premières rencontres, organisées à Biarritz en septembre 1996, sur le thème « Le Maire-Entrepreneur ? » resteront dans la mémoire collective des participants[9].
Sa conception du management public passait par des considérations de philosophie morale, de justice et d’équité, au service d’une régulation économique pour contenir les excès des marchés. On en revient à Adam Smith qui affirmait le primat des sentiments moraux mais ne voyait pas comment enrichir les nations sans le marché fonctionnant comme « un voile de l’ignorance », pour reprendre l’expression de John Rawls.
Un grand attachement au développement de la francophonie
Une fois à la retraite en 1998, le professeur émérite Le Duff oeuvra avec passion et détermination au sein de la Cidegef[10], un des réseaux actifs de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Dans ce réseau dont il était encore le secrétaire général, en passe d’être remplacé par Florian Favreau (EM Normandie), il a organisé durant plus de 20 ans des colloques, en particulier sur les thèmes qui lui étaient chers, notamment ceux de la pédagogie - avec le prix de l’innovation pédagogique imaginé avec le professeur Maurice Lemelin, professeur à HEC Montréal - et de l’employabilité. Cette employabilité, il la voyait valorisée par la pratique des stages et la rédaction de mémoires conçus pour résoudre des problèmes de gestion sur le terrain des entreprises, des administrations et des organisations non marchandes, et dernièrement par la pratique de l’apprentissage ou de l’alternance.
Ces rencontres avec des enseignants-chercheurs des universités partenaires se déroulèrent à Hanoi (Vietnam), Beyrouth (Liban), Bucarest (Roumanie), Bouaké (Côte d’Ivoire), Antanarivo (Madagascar), Port-au-Prince (Haïti), Douala (Cameroun), Québec ou encore à Saint-Louis du Sénégal à l’université Gaston Berger – dont on retrouve la mémoire ici.
Ces dernières années, il avait beaucoup travaillé avec les recteurs haïtiens pour initier des cursus en sciences de gestion dans le domaine de la santé, en coopération avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes, projet entravé par le tremblement de terre de 2004, la crise sanitaire de la Covid-19, et finalement le chaos politique rendant la présence de membres de la Cidegef impossible...
Nous avons vraiment perdu un éminent et brillant collègue et un ami très cher. Un grand nombre de docteurs, devenus maîtres de conférences et professeurs des universités aujourd’hui, sont reconnaissants de son investissement et de ses innombrables apports, tant dans l’émergence et le développement des sciences de gestion en France, que dans l’enseignement et la recherche en management public.
Au-delà de sa remarquable posture de grand professeur, nous retenons aussi et avant tout la belle personne qu’était Robert Le Duff, en particulier pour son attachement envers le travail collaboratif, ouvert et respectueux des apports de chacun ou chacune, et basé sur la simplicité et la confiance. C’est d’ailleurs l’état d’esprit que nous avons tout naturellement adopté à l’occasion de la préparation de ce modeste hommage.
PS - Pour continuer à honorer sa mémoire, plusieurs projets sont en préparation afin de lui rendre un témoignage plus substantiel : des nécrologies plus explicitement centrées sur le management public, à paraître ou déjà parues dans plusieurs revues; un numéro spécial de la revue Gestion et Management Public; la rédaction collective d’une page Wikipedia; l’organisation d’une journée à l’IAE de Caen le 11 octobre 2024, partagée entre témoignages et réflexions sur le management public. Si vous souhaitez participer à l’une de ces initiatives, merci de contacter les signataires.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Paru chez Calmann-Lévy, 1992.
-
[2]
Cet anglicisme (capability) inventé par Sen désigne la possibilité effective qu’un individu a de choisir diverses combinaisons de « mode de fonctionnement » comme se nourrir, se déplacer, avoir une éducation, participer à la vie politique. On pourrait le traduire aussi par « capacité » ou « liberté substantielle ».
-
[3]
Ludwig von Bertalanffy (1973), Théorie générale des systèmes, Paris, Bordas.
-
[4]
W. Ross Ashby [1956] (1958), Introduction à la cybernétique, Paris, Dunod.
-
[5]
René Thom (1977), Stabilité structurelle et morphogénèse, Paris, InterÉditions.
-
[6]
Lucien Sfez (1973), Critique de la décision, Paris, Armand Colin,
-
[7]
Le premier manuel francophone fut celui de Romain Laufer et Alain Burlaud, intitulé Management public. Gestion et légitimité, publié chez Dalloz en 1980.
-
[8]
Voir chez cet auteur l’introduction de l’ouvrage Le service des masses, CNRS-Dunod, Paris, 1971.
-
[9]
Les actes préfacés par Éric Raoult, ministre délégué à la Ville et à l’Intégration, furent publiés par les Presses universitaires de Pau sous le titre « Le Maire-Entrepreneur ? » en 1996. Ces Rencontres seront suivies de sept autres jusqu’en 2006.
-
[10]
Conférence internationale des dirigeants des institutions d’enseignement et de recherche de gestion d’expression française.