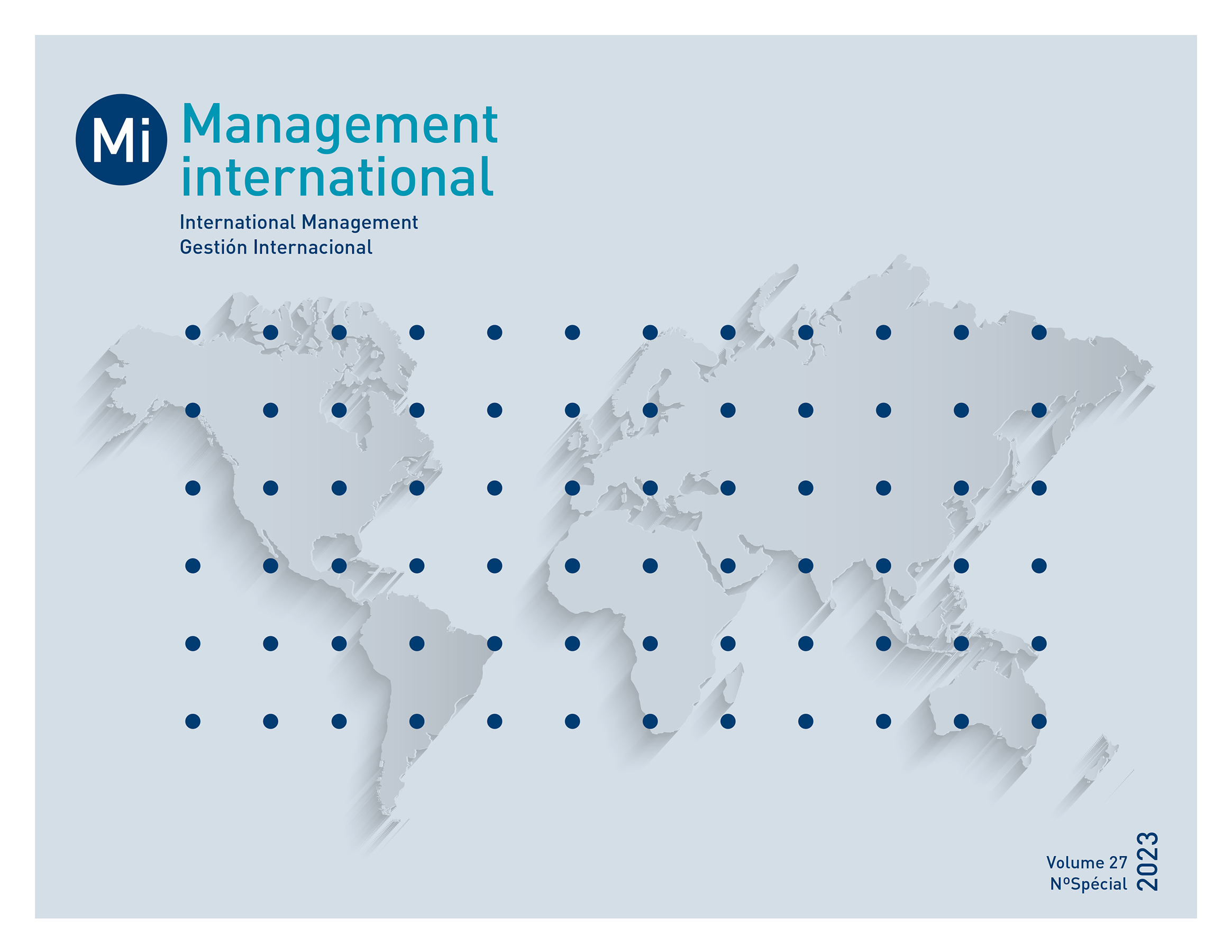Résumés
Résumé
Le mythe de l’entrepreneur paraît sévir sans pour autant qu’on paraisse le saisir tant il confond héroïsme et figure individuelle. Qui est vraiment dupe, nous suggère Paul Veyne ? Cet essai interroge la tension entre mythification et mystification à l’ère d’un renouvellement des mythes au profit de la startup. Ce renouvellement du mythe contribue-t-il à la reproduction d’un « monde mauvais » ou est-il réparateur face à l’effondrement ? L’essai interroge également la performance ou la réalité du mythe pour les populations vulnérables ou mises aux marges de l’entrepreneuriat mais aussi le piège d’une réflexion centrée sur les identités au mépris des vies. Finalement, l’essai nous interroge sur les possibilités d’un activisme entrepreneurial, porteur d’imaginaires, ou d’un entrepreneuriat politique, créateur de relations avec et dans le vivant, qui porterait les possibilités ou dérives d’une autre mythologie.
Mots-clés :
- Mythe relationnel,
- effondrement,
- activisme entrepreneurial,
- vies vivables,
- monde habitable,
- startupisation
Corps de l’article
Le monde de l’entrepreneuriat ressemble parfois à un grand Truman Show dont le régime de vérité parait se confondre à une sorte de comédie générale dont personne ne voudrait être dupe mais que chacun répète et donc renforce. L’entrepreneur (le masculin étant ici de mise) émerge comme personnage héroïque et se fond dans un décor, un scenario, qui le précèdent. Ses gestes et pratiques, chaque pas, sont pensés, ritualisés, au regard d’une structure mythologique, suffisamment forte pour orienter et légitimer les conduites, suffisamment lâche pour croire que chacun maitrise l’histoire dont il est le héros. Le Truman Show parfois se grippe, dérape légèrement… et le rite devient suspect. Truman se défait d’une identité préfabriquée et se découvre essentiellement fait d’émotions et d’affects dans un monde qu’il veut à sa portée.
L’historien Paul Veyne (1983), que le titre de cet essai paraphrase, nous invitait à saisir la complexité des mythes et finalement leur ambiguïté performative. Le mythe se situe en dehors d’un clivage entre le faux et le vrai dont les frontières ne sont pas invariables. Il génère son propre programme de vérité, ses propres règles de légitimité. Il remplit une fonction de cohésion sociale et de connivence tout en suscitant une forme d’ironie et de détachement. En somme, nous sommes assujettis à ce dont nous nous moquons. Le mythe se déploie dans nos pratiques et le mystère consiste à comprendre les modalités de sa vraisemblance et donc de sa réception. A Paul Veyne, l’analyse structurale (par exemple de Lévi-Strauss) ajoute l’importance de saisir les liens qui soudent le mythe au contexte symbolique et culturel de son accueil. Le mythe raconte la société qui l’accueille; il s’y inscrit. Ainsi les mythes circulent, s’épuisent, se chassent et se recyclent… Le mythe participe d’une sorte d’hypocrisie et d’ironie, presque nécessaire, à laquelle les protagonistes de la scène entrepreneuriale se réfèrent pour faire oublier la réalité de leurs actions (Brunsson, 1989).
Il est fréquent de considérer que le champ de l’entrepreneuriat s’est développé à l’abris d’un mythe relativement fort et finalement assez peu accueillant. Les études critiques ont, de longue date, montré que le champ s’était construit autour de la figure de l’homme, blanc, seul, dans le confort d’un pays du Nord, porteur d’hétéronormativité (Ogbor, 2000), et dès lors en cohérence avec un idéal libéral de croissance et de progrès, charriant des valeurs de volontarisme et d’optimisme que la figure du héros entretient (Gill, 2014). On comprend alors ici les effets d’exclusion multiples engendrés par la liturgie entrepreneuriale en même temps qu’un désir d’en être. Le retrait progressif des politiques publiques de solidarité a pris la forme d’une injonction généralisée à (s’)entreprendre particulièrement pour celles et ceux vivant dans les marges. Le mythe s’est donc chargé d’une ambiguïté liée à l’hospitalité présumée du monde entrepreneurial aux « autres ». Il entretient un discours inlassablement optimiste qui promeut les opportunités infinies et occulte les asymétries sous-jacentes de pouvoir et de privilège qui limitent l’éventail réel des possibilités offertes à certaines personnes (Murtola, 2020). Le mythe s’est ainsi propagé sous les traits d’une entreprise anthropologique consistant dans une « entrepreneurialisation » des sociétés (Eberhart, Lounsbury & Aldrich, 2022) et donc des vies. Parce que nos vies sont à entreprendre. Chacun.e étant enjoint.e à un devenir d’« anthropreneur » (Linhart, 2015).
Le rapport à la crise, sinon à l’effondrement, n’a fait qu’alimenter ou renouveler le mythe, même si la figure de l’entrepreneur s’est relativement dégagé des traits du privilège. S’il est ainsi avéré que l’entrepreneuriat a toujours contribué à retourner des situations de crise économique, c’est toujours à l’aune d’un paradigme centré sur le progrès, la croissance et la répétition. La relation entre entrepreneuriat et crise reste prioritairement axée sur le caractère salvateur de l’entrepreneuriat. Le rôle moteur de l’entrepreneuriat dans la production des crises, l’expropriation des ressources et des vies et l’aliénation est assez rapidement évacué (Jones et Murtola, 2012a et b). En somme, le monde entrepreneurial et ses mythes seraient assez vite dégagés de toute responsabilité dans la production d’un « monde mauvais » (expression de Geoffroy de Lasganerie) que l’on verrait s’effondrer.
La startupisation ou l’entrepreneuriat entre mythification et mystification
Les mythes se chassent les uns les autres. Celui de la startup parait aujourd’hui saturer nos imaginaires et contraindre les subjectivités. On peine alors à percevoir les possibilités qu’il offre face à l’effondrement en ce qu’il arrime de manière assez sophistiquée les dimensions paradoxales, « mytifiantes » et mystifiantes, de toute pratique entrepreneuriale. Il entretient de manière forte l’idée qu’entreprendre consiste à produire de nouveaux imaginaires, une multiplicité, des possibles, qu’il s’agit d’actualiser par un agencement de pratiques. Dans le même temps, il repose sur la production d’un mensonge organisé et légitimé par le monde clos qu’il performe — l’écosystème — et qui défait ou virtualise toute possibilité de relation avec le monde sensible et vécu. Les récents fiascos tendent à documenter la manière dont cette tension entre récit nécessaire et mensonge toxique ne résiste pas à l’entreprise de mystification (Buquet, 2020).
Ce mythe émergent, incarnation de la transformation anthropologique plus tôt décrite, ne produit des effets que parce qu’il s’est accompagné d’une industrialisation de l’entrepreneuriat et de la production de technologies entrepreneuriales sophistiquées et prétendues neutres (Germain, Laifi et Blum, 2021). Le mythe de la startup repose sur une infrastructure d’objets, de récits, de signes et de pratiques sociales ce qui accentue sa capacité à s’enraciner mais aussi à se propager à l’ensemble ou au « reste », au monde ordinaire des entrepreneurs. Cette infrastructure et ces technologies entrepreneuriales disposent d’un pouvoir disciplinant et donc d’une capacité à renouveler les formes de l’exclusion. Le mythe est d’autant plus robuste que ses agents sont aussi occupés à travailler au maintien de leur propre industrie et à sa légitimité.
Moins envisagé au regard de la question de l’effondrement, le mythe de la startup, parce que global et total, me semble aussi s’accompagner d’une forme d’artificialisation poussée des conduites entrepreneuriales au mépris des territoires vécus.
Illustration outrancière : des entrepreneurs à l’avant-poste dans la construction ou l’actualisation des mythes entrepreneuriaux qui façonnent le quotidien des entrepreneurs invisibles se disputent de leur côté l’espace comme nouveau lieu de conquête entrepreneuriale. Comme si les excès et l’épuisement des ressources de cette pauvre terre se traduisaient en réalité et en métaphore par une déterritorialisation définitive des projets entrepreneuriaux. Entreprenons une autre planète. En réalité, parce qu’on observe une décontextualisation toujours plus grande des pratiques entrepreneuriales par une certaine conception de la startup : l’entrepreneuriat d’une caste dominante, qui donne le ‘la’ des pratiques aux entrepreneurs ordinaires, se fait par l’envahissement, la dépossession, l’exploitation d’espaces inhabités en même temps qu’elle défait ou méprise les territoires. En métaphore, parce que les ambitions viriles de Musk, Bezos, ou Branson,… traduisent une forme encore plus poussée d’entrepreneurialisation centrée sur les besoins de l’Homme.
A une échelle moins spectaculaire, il reste à mieux comprendre le rôle de cette déterritorialisation accentuée de pratiques entrepreneuriales innovantes dans l’effondrement qui se produit. La perte relative d’ancrage territorial de startups ‘born global’, capables de circuler dans un monde fluide, déconnectées et hyperconnectées, que nous sommes incapables d’encoder, de reterritorialiser pour reprendre un vocabulaire deleuzien, interroge l’importance d’une éthique territoriale, incarnée et vivante, de ce mythe de la startup. Cette artificialisation de la pratique entrepreneuriale, que véhicule en partie le mythe global de la startup, contribue aussi à rendre les vies impraticables.
Du mythe entrepreneurial… aux vies empêchées
Le nouveau mythe s’accompagne d’une artificialisation des pratiques entrepreneuriales qui semble aller de pair avec une hiérarchisation toujours plus grande des vies. « Créer, c’est vivre deux fois », écrivait Albert Camus (1942) dans Le mythe de Sisyphe. Entreprendre nous amènerait sur le chemin d’une « seconde vie » qui « se décale lentement d’elle-même et commence à se choisir, à se réformer », « dégage(ant) des possibles encore inexplorés », nous dirait peut-être le philosophe François Jullien (2017). Reste que l’entrepreneuriat peut aussi être le lieu de vies empêchées, bafouées, interdites.
Si l’entrepreneuriat procède par expropriation de ressources communes et des forces humaines (Jones et Murtola, 2012b), le mythe renouvelé de la startup parait d’abord agir par dépossession de soi et préemption de tout ce qui fait une vie humaine (Han, 2021). Corps, désir, vie personnelle, émotions… sont mis sous contrôle par les technologies entrepreneuriales qui débordent de la sphère de la création d’entreprise pour investir une prétendue création de soi. Création de soi qui à l’ère de l’hypermodernité dérive d’un souci commun de différence qui nous envahirait tous. S’entreprendre dans l’indifférence. La vie dépossédée devient le matériau central de la pratique entrepreneuriale.
Au-delà de la dépossession, le mythe entrepreneurial parait accroitre les inégalités entre les vies là où il prétend les réparer (Bulter, 2004). L’entrepreneuriat procède par une ré-invisibilisation des vies déjà empêchées qui prend la forme d’une interdiction biographique faite, si je suis Hannah Arendt, à celles et ceux qu’il prétend sortir des marges. Les opprimés, mis aux marges, peuvent difficilement dire leur vie autrement qu’en la romantisant ou la commercialisant sous la forme fatiguée du pitch que le mythe organise. Des vies interdites, empêchées et bafouées, car réduites au mieux à des fragments identitaires, sinon à une assignation. La capacité biographique se réduira à être femme, migrante, musulmane qui entreprend. L’entrepreneur mis aux marges n’a pas de corps, ni d’émotions et pratique le silence sur sa vie là où le dominant s’épanche sur les enjeux d’un équilibre entre ses vies.
Se débattre… pour montrer de la valeur dans un monde (entrepreneurial) qui prétend que les vies sont égales. L’opprimé est celui dont la vie est interdite parce qu’elle ne se raconte pas; qu’on la réduit par exemple à une identité de migrant qui entreprend – une étiquette comme un fragment théorique de vie. Pour être viable, cette vie d’exilé doit se transformer en une valeur qu’elle soit marchande, symbolique ou même (inter)culturelle. Le sans-abri qui nettoie notre pare-brise au feu contre quelques pièces a compris que sa vie ne valait que par sa propre transformation en modèle d’affaires.
Le champ de l’entrepreneuriat parait beaucoup préoccupé par la question des identités, qu’elles soient multiples, en mouvement, bricolées, travaillées, contraintes ou émancipées, en particulier dans des contextes du Sud. Certaines vies sont particulièrement empêchées dans des pays où l’effondrement n’est pas un horizon d’attente mais un quotidien qui se répète. La processualité n’est pas ici une ontologie séduisante pour réfléchir une pratique entrepreneuriale indéterminée, toujours en devenir. Elle est la forme de vie précaire. La question n’est plus alors de se poser tranquillement pour réfléchir des enjeux identitaires. L’identité, une femme qui entreprend à Gaza la connait… faire l’expérience d’une vie qui ne s’effondre au milieu d’une écologie de gravas, beaucoup moins… Qu’est-ce alors qu’une vie à entreprendre ?
La question de fonds posée à l’entrepreneuriat, à ses protagonistes (dont les chercheuses et chercheurs), est sa capacité à rendre des vies vivables… dans un monde habitable en prenant pour fondement un principe d’« égalité radicale » (Butler, 2020[1]). Or l’histoire implacable de l’entrepreneuriat nous dit que l’entreprise s’est organisée autour de l’in-habitabilité du monde et l’exclusion-infériorisation de pans entier de l’humanité. D’autres mythes s’imposent et l’effondrement peut en être le vivier.
Les relations au coeur des mythes entrepreneuriaux
Dans ce qui suit, j’évoque des pistes relevant peut-être d’idées simples : penser l’entrepreneuriat avant tout comme agencement de relations, sans mettre de côté la charge politique nécessaire, préservant une pluralité de mythes, parfois dans les marges.
L’effondrement laisse assez peu envisager un entrepreneuriat seulement durable au sens où on peut l’entendre qui conduirait à « inclure » des dimensions écologiques et sociales, un entrepreneuriat de réparation ou de recyclage qui prendrait en charge les déchets que le système dominant continue de produire. Pouvons-nous éviter, pour emprunter à Bonnet, Landivar et Monnin (2021) un entrepreneuriat de renoncement, de démantèlement, de fermeture, qui considère à la fois les effets des pratiques entrepreneuriales mais aussi les technologies entrepreneuriales constitutives du mythe comme relevant des « communs négatifs » produits par et pour les humains privilégiés et qu’il nous faut défaire ? Faire surgir une sorte de contre-mythe à la croissance et au progrès qui semble donc aux antipodes de l’imaginaire entrepreneurial en cours.
Si un entrepreneuriat de réparation et de réconciliation est possible et nécessaire, ce n’est qu’en retournant au caractère profondément relationnel d’une pratique que l’entre-prendre. Longtemps, par sa portée anthropologique, l’entrepreneuriat comme pratique de la création s’est centré sur l’exploration des possibilités humaines, en maintenant une ligne de séparation dans les formes de cohabitation entre nature et culture, en distinguant (certains) humains et autres-qu’humains dans un rapport d’exploitation. Les processus de (re)colonisation se chargeant de montrer que les autres-qu’humains intègre la part infériorisée de l’humanité.
Face à l’effondrement, le projet entrepreneurial deviendrait l’exploration des manières nouvelles d’entrer en relation avec le vivant sans présumer de la supériorité humaine. Un entrepreneuriat qui consiste dans le travail continu des agencements entre ces « mises en relation » en lien avec des contextes pluriels et singuliers, dont on cherche à préserver ou restaurer l’habitabilité. Nous bricolerions alors, avec Lévi-Strauss, des mythes entrepreneuriaux chargés des manières de recréer des relations avec les autres-qu’humains. Entreprendre, c’est créer ou réparer ces relations.
Ces mythes relationnels, alternatifs et pluriels de l’entrepreneuriat ne peuvent prendre leur place sans considérer de manière innocente la résistance des systèmes de domination. L’intrusion de ces mythes recommanderait un activisme entrepreneurial fondé sur le désir de défaire complètement le système capitaliste dominant et de produire des mondes alternatifs, des « possibilités de vie » et des imaginaires en utilisant des « associations de pratiques » fluides, perturbatrices et parfois illégales (Dey & Mason. 2018; Berjani et al, 2022; Mösching & Steyaert, 2022). Redmalm et Skoglund (2022), en empruntant à Agamben, ont montré comment les pratiques de profanation (c’est-à-dire le retour à la sphère du quotidien) de concepts « sacrés » (tels que les mythologies entrepreneuriales résistantes) peuvent constituer une alternative en les ouvrant à une exposition critique. Dans une perspective de transformation sociale, l’activisme entrepreneurial prend la forme d’espaces critiques réflexifs et de collectifs en mouvement dont la mission s’organise autour de pratiques quotidiennes de résistance.
Là encore, ne surestimons pas la capacité d’un entrepreneuriat alternatif à produire le grand soir même s’il importe de redonner un caractère « insurrectionnel » à la pratique entrepreneuriale (Steyaert et Hjorth, 2006). Instaurer un « entrepreneuriat public », créateur de « socialité », notamment dans les discours quotidiens dont il ne faut pas sous-estimer la performativité (Hjorth, 2013), un entrepreneuriat créateur de nouvelles relations entre tous les humains et l’ensemble des autres-qu’humains, c’est aussi envisager qu’il agit par ébrèchement progressif, local, clandestin mais mouvant du système dominant en en retournant parfois les armes, en prenant les apparences de la complicité. Un entreprendre alternatif qui agit par déplacement continu et brouille certaines frontières (Mösching & Steyaert, 2022).
Des pièges d’une héroïsation dans l’effondrement
L’effondrement appelle aujourd’hui une prise en charge à grande échelle et les protagonistes de la scène entrepreneuriale paraissent vouloir prendre leur part dans la redirection écologique et sociale. Le monde entrepreneurial produit une langue qui se régénère constamment à mesure qu’elle perd en effets ou que les jeux de façade se dévoilent. Cela fait partie de la circulation des mythes et de leur efficacité recherchée.
Aujourd’hui, l’entrepreneuriat social ayant montré ses limites en termes de réappropriation libérale ou de dévoiement de conduites d’innovation sociale (Dey et Steyaert, 2018), se propage le discours d’un entrepreneuriat « à impact » mieux à même de contribuer aux « grands défis ». Le discours ou le mythe de l’impact présente la difficulté — les chercheuses et chercheurs en innovation sociale s’y confrontent — de produire une catégorisation claire de ce que sont concrètement les retombées et d’une possible mesure. La difficulté devient ambiguïté profitable lorsqu’elle vient étiqueter des conduites en tout genre aux retombées difficilement manifestes.
Plus encore, nous pourrions questionner ce remplacement d’une figure toujours héroïque passant du registre du sauvetage, de la croissance ou de la résilience économique à celle d’un acteur central de la redirection, de défenseur du bien commun ou de créateur-orchestrateur de communs situés. L’héroïsation peut constituer un levier continu, par-delà les mythes qui se reproduisent, pour façonner les pratiques et s’articuler aux changements contextuels radicaux. Nous avons besoin de mythes réparateurs qui relient au regard d’un effondrement qui révèle lui aussi un agencement des crises. Avons-nous besoins de héros repeints en sauveurs face à l’effondrement ? La question de l’héroïsation ne peut être évacuée du mythe entrepreneurial. Toutefois, il est peut-être de notre devoir de questionner l’émergence de ces figures qui, si elles changent de buts, continuent de mettre de côté de véritables formes collectives de l’action entrepreneuriale et s’éloignent assez peu des enjeux d’appropriation.
Nous nous interrogeons sur les effets sociaux de l’entrepreneuriat sur la société et les principaux remèdes (Weiss et al. 2023). Récemment, Keim, Müller et Dey (2024) questionnent ce « mythe de la panacée » qui suggère que l’entrepreneuriat est le remède universel aux maux sociaux et environnementaux existants parce qu’il exclut des explications explicitement politiques et holistiques des grands défis et notamment les enjeux d’injustice structurelle. La production d’un « mythe de la panacée » qui repose notamment sur « l’agnosticisme politique » ou une « acculturation positive » permet selon les auteurs d’assainir l’image de l’entrepreneuriat en tant que solution privilégiée.
En arrière-plan, se trame ainsi par une renouvellement du mythe et une persistance à l’héroïsation autour de « solutions entrepreneuriales autonomes » (ibid.) la reproduction des formes d’exclusion structurellement propres à l’entrepreneuriat. Le renouvellement continu d’une héroïsation de l’entrepreneuriat habilite une confiscation d’un entrepreneuriat de redirection par des élites, dont la sociologie rejoint grosso modo celle des startups, ce qui ne peut conduire qu’à une reproduction des injustices structurelles qui organisent déjà le monde (entrepreneurial). Le sauvetage resterait entre les mains des gagnants du monde entrepreneurial.
Keim et al. (2024) appellent, en repolitisant nos compréhensions et prises de parole, à « cultiver une représentation plus humble et plus réaliste de la capacité de l’entrepreneuriat à résoudre les problèmes ».
A qui rendons-nous des comptes ? Pour un renversement des injustices épistémiques
Comme chercheuses et chercheurs, nous participons à la coproduction des mythes ou à leur performativité. Nous avons sans doute accompagné la production d’un monde mauvais sans interroger suffisamment les conséquences néfastes de l’action entrepreneuriale et son rôle dans la production de l’effondrement. Le regain d’intérêt pour des approches critiques en entrepreneuriat n’est pas étranger au fait que des élites, aussi intellectuelles, comprennent qu’elles sont également concernées, au moins dans leurs vies personnelles...
Nous appelons parfois effondrement ce dont les peuples du Sud font de longue date l’expérience parce que subissant les pratiques de pillage des ressources et d’expropriation des vies mais aussi les conséquences écologiques qui y sont liées. Leurs mythes accueillent plus fréquemment la diversité des repères, créent des alliances d’évidence avec les autres-qu’humains. Mais cette connaissance infériorisée, souvent rangée dans la catégorie excluante de l’informel, a fait l’objet d’un épistémicide au profit d’une colonisation par des technologies entrepreneuriales faussement neutres.
Si nous souhaitons véritablement accompagner, comme alliés, l’émergence de mythes pluriels et alternatifs qui contribuent à rendent le monde viable et vivable, il nous revient alors d’assumer notre part de la dette en faisant le travail de renoncement et de déconstruction des « communs négatifs ». Renverser les injustices épistémiques, c’est reconnaitre la part de connaissances toxiques que nous continuons à reproduire et qui nous rend possiblement complices. C’est accepter de retrancher ce lot de connaissances qui ont fait l’effondrement et donc ramener au silence certaines voix dominantes qui persistent notamment dans l’artificialisation des pratiques entrepreneuriales.
A qui rendons-nous aujourd’hui des comptes ? Les mythes pluriels et alternatifs, les autres imaginaires,… nous les mettrons au service des héroïnes et héros ordinaires pour qui l’entrepreneuriat, sans qu’ils et elles en soient dupes, constitue la voie présumée d’une vie vivable et viable.
Parties annexes
Remerciements
Ce texte prolonge une conférence invitée donnée en 2021 dans le cadre des Journées Georges Doriot. Je remercie les collègues organisatrices de la conférence, les professeures Christina Constantinidis et Nazik Fadil, ainsi que le professeur Alain Bloch de cette invitation.
Note
Bibliographie
- Berjani, D., Verduijn, K. and van Burg, E. (2022). Enacting (new) possibilities of living : Entrepreneurship and affirmation. In R. N, Eberhart,, M Lounsbury, & H. E. Aldrich, (Eds.) Entrepreneurialism and society : Consequences and meanings (pp. 149-159, Research in the sociology of organizations, Vol. 82). Emerald. https://doi.org/10.1108/S0733-558X20220000082007
- Bonnet, E., Landivar, D. et Monnin, A. (2021). Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement. Paris : Editions Divergences.
- Brunsson, (1989). The Organization of Hypocrisy : Talk, Decisions and Actions in Organizations. Chichester : Wiley.
- Buquet, R. (2020). Au-delà du mythe des start-up : Discours, éthique et engagement dans l’expérience entrepreneuriale. Thèse de doctorat en sciences de gestion, ESCP Europe.
- Butler, J. (2004). Precarious Life : The Powers of Mourning and Violence. London : Verso.
- Camus, A. (1942). Le mythe de Sisyphe. Paris : Gallimard.
- Dey, P., & Mason, C. (2018). Overcoming constraints of collective imagination : An inquiry into activist entrepreneuring, disruptive truth-telling and the creation of “possible worlds.” Journal of Business Venturing, 33(1), 84-99. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.11.002
- Dey, P., & Steyaert, C. (Eds.). (2018). Social entrepreneurship : An affirmative critique. Cheltenham : Edward Elgar.
- Dey, P., Fletcher, D. & Verduijn, K. (2023), Critical research and entrepreneurship : A cross-disciplinary conceptual typology, International Journal of Management Reviews. 25(1), 24-51. https://doi.org/10.1111/ijmr.12298
- Eberhart, R.N., Lounsbury, M. & H. E. Aldrich, (2022) (Eds.) Entrepreneurialism and society : Consequences and meanings (Research in the sociology of organizations, Vol. 82). Emerald. https://doi.org/10.1108/S0733-558X20220000081001
- Germain, O., Laifi, A. et Blum, V. (2021). L’entrepreneuriat est… une industrie. A propos de la (re)production des entrepreneurs. Entreprendre et Innover, 2021/4, 51, 76-80.
- Gill, R. (2014). “If you’re struggling to survive day-to-day” : Class optimism and contradiction in entrepreneurial discourse. Organization, 21(1), 50-67. https://doi.org/10.1177/1350508412464895
- Han, B.-C. (2021). Capitalism and the Death Drive. Cambridge : Polity Press.
- Hjorth, D. (2013). Public entrepreneurship : desiring social change, creating sociality, Entrepreneurship & Regional Development, 25 : 1-2, 34-51. https://doi.org/10.1080/08985626.2012.746883
- Jones C., Murtola A-M. (2012), Entrepreneurship, Crisis, Critique. In : Hjorth D. (Ed.) Handbook of Organizational Entrepreneurship. Cheltenham : Edward Elgar, 116-133. https://doi.org/10.4337/9781781009055.00016
- Jones, C., Murtola, A. M. (2012). Entrepreneurship and expropriation. Organization, 19(5), 635-655. https://doi.org/10.1177/1350508412448694
- Jullien, F. (2017). Une seconde vie. Paris : Gallimard.
- Keim, J., Müller, S., Dey, P. (2024). Whatever the problem, entrepreneurship is the solution ! Confronting the panacea myth of entrepreneurship with structural injustice. Journal of Business Venturing Insights, 21, e00440. 10.1016/j.jbvi.2023.e00440
- Lindbergh, J., Berglund, K., & Schwartz, B. (2022), Alternative entrepreneurship : Tracing the creative destruction of entrepreneurship. In M. M. & H.J. Schau (Eds.), How alternative is alternative ? The role of entrepreneurial development, form, and function in the emergence of alternative marketscapes (pp. 29-55) Advances in the study of entrepreneurship, innovation and economic growth, Vol. 29. Emerald.
- Linhart, D. (2015). La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale. Erès.
- Murtola, A.-M. (2020). Entrepreneurship ad absurdum. In : Örtenblad, A. (Ed.). (2020). Against entrepreneurship : A critical examination. Palgrave Macmillan, 93-110. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47937-4_6
- Ogbor, J.O. (2000). Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse : Ideology-critique of entrepreneurial studies, Journal of Management Studies. 37(5), 605–635. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00196
- Ozkazanc-Pan, B., Clark Muntean, S. (2021), Entrepreneurial Ecosystems : A Gender Perspective, Cambridge University Press.
- Redmalm, D., & Skoglund, A. (2022). Videographic profanations : A companion to the videography “Pride : Alternative Entrepreneurship Enjoyed.” Organization. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/13505084221115840
- Steyaert, C. et Hjorth, D. (2006). Entrepreneurship and social change. Cheltenham : Edward Elgar.
- Veyne, P. (1983). Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Paris : Éditions du Seuil.
- Weiskopf, R., & Steyaert, C. (2009). Metamorphosis in entrepreneurship studies : towards and affirmative politics of entrepreneuring. In D. Hjorth & C. Steyaert (Eds.), The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship (p. 183-201). Northampten, Mass. : Edward Elgar Press.
- Weiss, T., Eberhart, R., Lounsbury, M., Nelson, A., Rindova, V., Meyer, J., Bromley, P., Atkins, R., Ruebottom, T., Jennings, J., Jennings, D., Toubiana, M., Shantz, A. S., Khorasani, N., Wadhwani, D., Tucker, H., Kirsch, D., Goldfarb, B., Aldrich, H., & Aldrich, D. (2023). The Social Effects of Entrepreneurship on Society and Some Potential Remedies : Four Provocations. Journal of Management Inquiry, 32(4), 251-277. https://doi.org/10.1177/10564926231181555