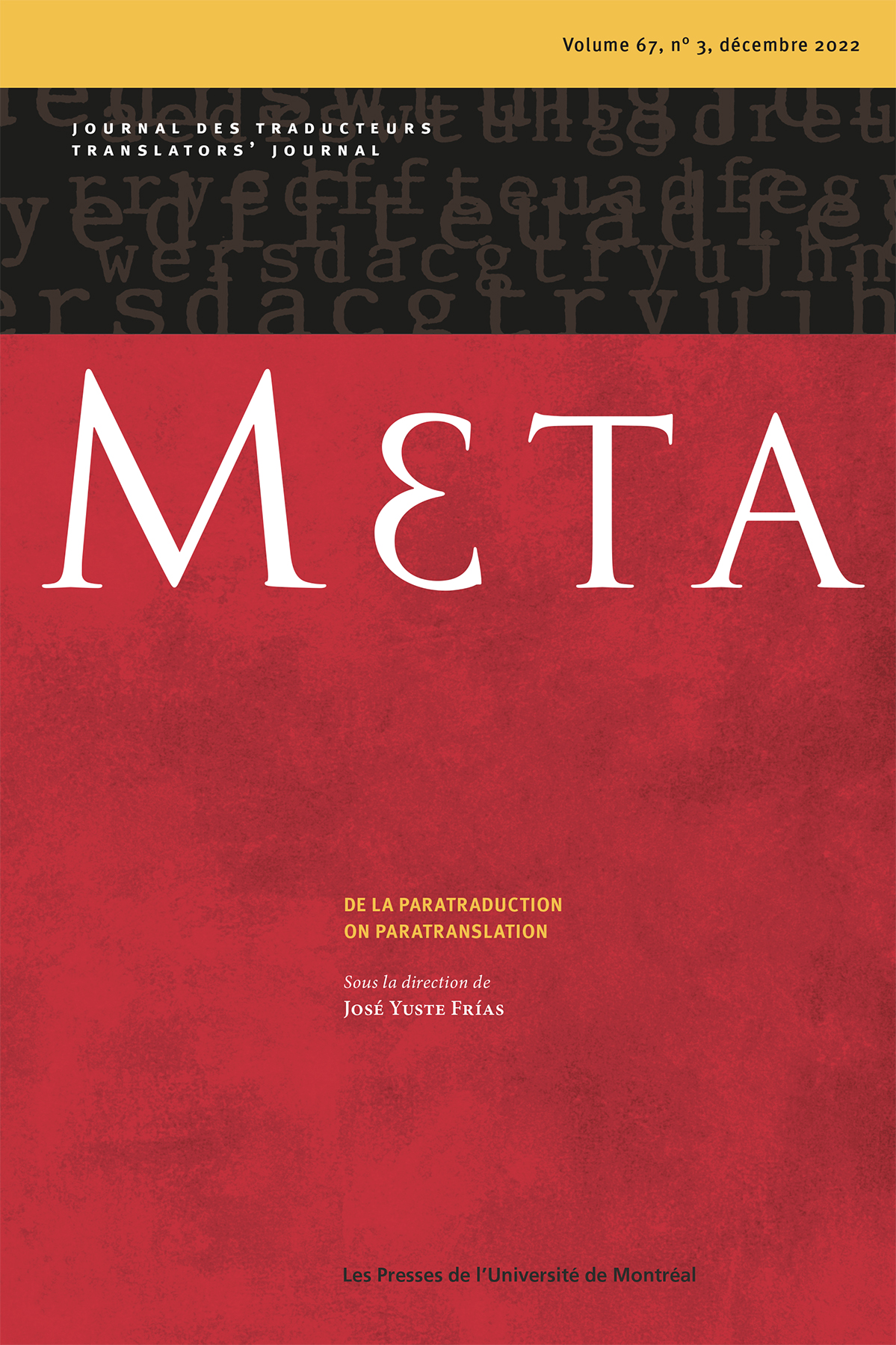Corps de l’article
Dans ce qui suit, je présenterai les intentions des auteurs, la façon dont ils les mettent à exécution et les résultats obtenus, pour me permettre, par la suite, d’offrir une vision personnelle de la façon de présenter les thèmes, en prenant le roumain comme exemple.
Les auteurs se proposent de montrer le rôle joué par la traduction dans la naissance des littératures en « Europe Médiane », une aire culturelle qui est caractérisée par un certain nombre de traits communs, justifiant d’une étude commune, au cours de laquelle la traduction se révèle être « le ferment d’une culture et d’une identité européennes communes » (p. 7).
Ce n’est pas la première fois qu’on est frappé par la similitude des traits culturels et linguistiques qui caractérisent ce que Sandfeld (1930) a appelé « union linguistique balkanique ». Cette fois cependant, l’ouvrage traite d’un nombre de langues bien plus étendu[1], examinées sous l’angle des zones d’influence que représentaient, d’une part, l’Europe occidentale, d’autre part, la Russie. De même, le champ d’investigation est élargi aux différents aspects de l’action traduisante, dépassant l’influence directe des oeuvres traduites, pour thématiser également le rôle de la traduction dans l’introduction de nouveaux genres littéraires et pour montrer l’évolution du statut du traducteur dans la société à travers les siècles : dans les premiers temps, il n’était pas professionnel, mais homme d’Église, puis homme de lettres (avec souvent une visée politique), pour ensuite se professionnaliser avec une tendance à la féminisation croissante de la profession. On remarque aussi l’évolution de la langue vulgaire, accessible à un public de plus en plus large avec la création d’écoles en langues nationales et la création de journaux susceptibles d’offrir un support facilement accessible aux traductions de romans-feuilletons. Les auteurs nous montrent comment le flux de traductions, allant de façon privilégiée de l’Europe occidentale vers l’Europe médiane, a contribué à la création d’une identité européenne.
Outre cette influence directe, exercée par certaines oeuvres, et l’introduction de nouveaux genres littéraires, on peut également observer le rôle joué par les traductions dans la constitution et le développement des différentes langues cibles de l’Europe médiane. Ceci vaut de façon exemplaire pour la Roumanie avec le passage de l’alphabet cyrillique au latin, ainsi qu’avec le renouvellement latinisant du vocabulaire face aux velléités de mainmise politique de la Russie après le traité d’Andrinople.
Si les auteurs (à mon sens) n’ont pas su suffisamment tirer profit de l’exemple convaincant du rôle joué par la traduction dans la constitution d’une identité nationale, de couleur européenne, fourni par la Roumanie, ils ont, par contre, attiré l’attention sur un autre exemple frappant, tel que nous le trouvons en Estonie. L’impératif auquel obéissaient tous ces efforts linguistiques était le besoin d’unification face aux particularismes locaux, qui, en Estonie, pouvait aller jusqu’à traiter la langue nationale comme étant « corrompue » lorsqu’elle ne correspondait pas aux normes de la langue écrite. Ces textes faisaient incontestablement figure d’autorité suprême, de même que les textes des cantiques, qui, ne l’oublions pas, sont partie intégrante de base dans le déroulement du culte. Pour l’estonien, cette mainmise sur la langue estonienne au profit d’une norme écrite, sous l’influence de l’allemand et par le biais de la traduction, ne s’est pas limitée à la première phase, dominée par les textes religieux, mais a perduré jusqu’au début du 20e siècle. Lors de la troisième phase, on a finalement commencé à éradiquer certains germanismes[2].
Les auteurs distinguent en effet quatre phases dans l’évolution de l’activité traduisante. Ces phases diffèrent autant par le genre des ouvrages traduits que par les supports utilisés, par la conception de la traduction par rapport à sa finalité, par le choix des oeuvres traduites, ainsi que par le choix des langues à traduire. La première partie de l’Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane va grosso modo du 9e au 16e siècle et est consacrée à « La traduction des textes religieux ». La deuxième partie – « La formation de la littérature profane » – qui va jusqu’à la Première Guerre mondiale, nous montre comment, avec la création d’écoles et de journaux, le public de lecteurs s’élargit, ce qui entraîne une demande accrue de traductions de textes profanes et introduit de nouveaux genres littéraires, comme le théâtre et l’épopée nationale, nourris des idées romantiques occidentales qui n’ont pas été sans alimenter les mouvements nationalistes, lesquels prenaient naissance avec la perte graduelle de l’influence ottomane (du moins en ce qui concerne les Balkans). La troisième partie – « La traduction et la modernité littéraire » – est caractérisée par la standardisation des langues nationales, sans qu’il soit toujours possible de définir clairement le rôle joué par la traduction dans ce processus (p. 193). La quatrième partie – « Traduire sous le totalitarisme » – introduit de nouveaux aspects comme la censure et oriente vers d’autres littératures comme sources de traduction.
Évaluation : l’ensemble de cet ouvrage donne un peu l’impression d’un squelette auquel quelques éléments carnés auraient avantageusement pu donner vie. Et le sujet – passionnant, comme nous nous proposons de le montrer avec l’exemple du roumain – justifiait de soulever l’intérêt d’un public de lecteurs plus vaste qui aurait pris plaisir à lire cette aventure étonnante. Face à l’énumération des auteurs et des oeuvres traduites, le lecteur risque de perdre un peu l’orientation générale.
Au lieu de nous présenter le traducteur comme un pantin déchiqueté, dans les nombreux sous-chapitres consacrés aux différents aspects de l’activité traduisante, on aurait aimé voir le puzzle reconstitué à la fin des différentes grandes parties par un exemple représentatif de cette époque, comme le serait, par exemple, pour le roumain, Ion Heliade Rădulescu, « honnête homme » et personnage clé du 19e siècle, qui réunissait à lui seul tous les différents aspects caractéristiques du rôle de la traduction et de la façon dont elle pouvait influencer la langue et la littérature : homme de lettres, avec une vision politique clairement définie, qu’il exprime sur un support caractéristique de l’époque (le feuilleton). Rădulescu obtient des résultats qui ont largement contribué à la création d’une identité nationale, qui se solde par l’union des principautés (Moldavie, Valachie) en un royaume. Faire une présentation de cet acteur politique et culturel eût été possible sans vraiment augmenter le volume de l’ouvrage, en insistant un peu moins sur les détails répétitifs, comme celui de la censure, sous le régime communiste, à laquelle le public auquel s’adresse cet ouvrage s’attend et qu’il ne connaît que trop bien.
Quant au vocabulaire, comment ne pas parler des efforts de Rădulescu pour enrichir le vocabulaire par la traduction, en empruntant des mots français pour remplacer les mots slaves, avec des arguments plutôt fallacieux qui prêtent à sourire, comme lorsqu’il invite à remplacer le mot slave slobozie par le mot libertate, en argumentant que l’on y « sent » beaucoup mieux la liberté et en recommandant de donner des « habits roumains » à ces mots, de sorte que coiffeur devient coafor, boxeur, boxer, etc., puisque le roumain ne connaît pas les voyelles antérieures arrondies. Les statistiques disent qu’ainsi 80 % du vocabulaire d’usage courant a été remplacé.
Et finalement, comment ne pas expliquer une réforme de l’orthographe – qui s’imposait dans ce passage de l’alphabet cyrillique à l’alphabet latin et qu’initialement Rădulescu voulait phonétique – par cette même volonté ferme de latinisation, face aux menaces de « slavisation » telles qu’elles percent dans la réflexion d’un messager de Kisselev, qui affirmait que le roumain était une langue slave.
Quand on pense au rôle politique stabilisateur de la Roumanie dans l’aire balkanique et à la relative stabilité de son évolution, dans le cadre des mouvements politiques, liés à l’affaiblissement de l’influence ottomane, on se demande pourquoi les auteurs l’ont traitée quelque peu en parent pauvre. Ce pays de langue latine, dans un environnement slave et finno-ougrien, méritait une attention particulière. Les raisons pour lesquelles Rădulescu a lutté pour une latinisation de l’orthographe et du vocabulaire, en se servant de la traduction, rappellent plutôt ceux de la Pléiade en France et ne sont guère comparables avec celles qui ont présidé aux changements subis par d’autres pays, comme l’Estonie, à laquelle on porte une attention certes méritée, mais comparativement trop importante.
Il eût fallu mettre en évidence que, pour les Roumains, la traduction au service de sa latinité était une question de survie. Et ceci dès les premières traductions de parties de la Bible, par le biais de la langue de relais hongroise, jusqu’aux efforts fournis par Graur (1965) ou Armbruster (1977), pour prouver la « romanité du roumain », face aux tentatives d’un Petrovici (1957), par exemple, qui – dans une linguistique au service du pouvoir communiste – prétendait en démontrer le caractère slave, en inventant de nouvelles théories phonologiques (Stefanink 1980). N’oublions pas que le romaniste H. Schuchardt a pu affirmer qu’« il n’est pas encore prouvé que la langue roumaine est une langue latine » (cité par Weigand 1925 : V) et que Jakobson a parlé du roumain comme d’une langue mixte[3].
À ceci s’ajoute un certain nombre d’inexactitudes. On ne peut pas présenter (même si c’est par maladresse) le traité d’Andrinople – qui a été décisif dans la libération du joug ottoman et pour le développement des langue et littérature roumaines – comme étant dû à la révolte de 1821. Les Roumains n’avaient pas d’armée à l’époque, seulement quelques milliers de panduri (sorte de milice garde-frontière face aux Turcs). Emmenés par Vladimirescu, la révolte de ces derniers a été bel et bien écrasée, en l’absence du soutien des Russes. Il faut rappeler que le traité d’Andrinople est le résultat de la guerre russo-turque 1828-1829, avec des répercussions dangereuses pour le développement culturel et linguistique, auxquelles les Roumains ont pu parer grâce à une politique linguistique menée d’une main de maître, dans le cadre de laquelle la traduction a joué un rôle éminent. Les « Règlements organiques » qui donnaient aux Russes un certain droit de regard sur l’évolution politique et culturelle de la Roumanie, ont, en effet, eu une influence décisive sur les chemins pris par l’évolution de la littérature et de la langue par le biais des traductions et expliquent les choix faits par Rădulescu[4].
Mis à part ce plaidoyer en faveur d’une place plus importante consacrée à la Roumanie, dont les motivations pour le choix des traductions sont particulières, cet ouvrage collectif présente une mine d’informations pour qui veut s’informer sur des questions concernant la naissance de littératures sous l’influence de la traduction, mais à consommer à petites doses, si l’on ne veut pas s’y perdre. Peut-être eût-il été intéressant de mieux mettre en évidence les rapports entre politique et la constitution de cette langue littéraire. Là encore, la Roumanie livre un exemple indéniable. En effet, si Rădulescu a mis tant d’ardeur à prouver la latinité du Roumain, c’est pour parer aux appétits tsaristes de KIsseleff qui voulait profiter de la place laissée libre par les Turcs, suite au traité d’Andrinople, pour intégrer les deux principautés dans l’Empire russe, ceci après avoir prétendu que le roumain était une langue slave. Ceci n’est-il pas de la plus haute actualité depuis le 24 février 2022, si l’on en croit certaines menaces proférées par Poutine à l’égard de la Roumanie ? Sa lecture de l’histoire se serait-elle arrêtée au traité d’Andrinople ?
Parties annexes
Notes
-
[1]
Albanais, bulgare, croate, estonien, finnois, hongrois, letton, lituanien, macédonien, polonais, roumain, serbe, slovaque, slovène, tchèque et ukrainien.
-
[2]
Cet exemple révèle une des faiblesses (pardonnables) de la conception de cet ouvrage : la séparation en quatre époques aux caractéristiques évolutives différentes n’est pas toujours aisée à respecter, les langues évoluant à des rythmes différents. Ainsi l’alphabet glagolitique, utilisé au début pour transcrire des langues vernaculaires à tradition orale, a été employé jusqu’au 19e siècle dans certaines régions de Pologne, alors qu’ailleurs il avait déjà été remplacé par le latin bien avant. Toutefois les auteurs prennent soin d’anticiper ces critiques en s’excusant dès le départ de ces inconséquences partielles.
-
[3]
Il s’agit là de propos recueillis par Bernd Stefanink, au cours de ses discussions avec André Martinet en tant qu’assistant de celui-ci à l’Université de Paris V - René Descartes. Martinet, les tenait de Roman Jakobson.qui lui avait procuré un poste de professeur invité à l’Université de Columbia.
-
[4]
Pour les détails vivants de cette aventure linguistique et culturelle, voir Stefanink, Bernd (1984) : Une politique linguistique au service de l’identité nationale : le rôle joué par les linguistes dans la constitution de l’État national roumain, de 1821 à 1859. In : Henriette Walter, dir. Politiques linguistiques. Paris : Publications de l’Université René Descartes, 36-52 et Stefanink, Bernd (2000) : Sprachpolitik im Dienste der kulturellen und nationalen Identitätsbildung : Das Beispiel Rumänien [Une politique linguistique au service de la formation d’une identité culturelle et nationale : l’exemple de la Roumanie]. In : Eva Reichmann, Hrsg. Narrative Konstruktion nationaler Identität [Construction narrative d’une identité nationale]. St. Ingbert : Rõhrig Universitätsverlag, 293-325.
Bibliographie
- Armbruster, Adolf (1977) : La romanité des Roumains : histoire d’une idée. Bucureşti : Éditions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie.
- Graur, Alexandru (1965) : La romanité du roumain. Bucureşti : Éditions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie.
- Petrovici, Emil (1957) : Kann das Phonemsysterm einer Sprache durch fremden Einfluß umgestaltet werden ? Zum slavischen Einfluß auf das rumänische Lautsystem [Le système phonologique d’une langue peut-il être transformé par une influence étrangère ? De l’influence slave sur le système des sons roumain]. Den Haag : Mouton.
- Rădulescu, Ion Heliade (1939-1942) : Opere, tom I-II. Bucureşti : Ed. Acad.
- Sandfeld, Kristian (1930) : Linguistique balkanique : Problèmes et résultats. Paris : Champion.
- Stefanink, Bernd (1980) : Phonologie et politique linguistique en Roumanie. In : Henriette Walter, dir. Dynamique, diachronie, panchronie en phonologie. Paris : Publications de l’Université René Descartes, 47-64.
- Weigand, Georg (1925) : Balkan-Archiv, I, Leipzig.