Résumés
Résumé
Traduire est une pratique du seuil, traduire est une pensée du seuil. La position paratraductionnelle vient décliner ce double postulat à l’encontre des théories de la traduction comme passage. Sans résistance, le passage entre les deux langues-cultures équivaut à un simple transcodage, la transfusion sémantique d’un corps culturel à un autre, une opération que pourrait prendre en charge une machine et qui mériterait à peine le nom de traduction. Traduire, en d’autres termes, commence lorsqu’on touche à de l’intraduisible, plus exactement lorsqu’on reste sur le seuil du traduisible. La particule du traduire n’est pas en (traduit en japonais, traduit en français, traduit en …) mais entre, entre les deux langues, les deux textes, les deux cultures, les deux historicités. Considérer le seuil comme lieu du traduire permet cet accueil bilatéral. Toute langue étant pour une autre une langue étrangère, les deux langues en présence en suscitent une troisième, nouvelle pour chaque traduction et au seuil de laquelle existent les deux premières.
Mots-clés :
- seuil,
- paratraduction,
- théorie de la traduction
Abstract
Translating is a practice as well as a way of thinking which both find in the threshold a perfect symbol. The paratranslational position expresses this double postulate against the theories of translation as passage. Without any resistance, the passage between two languages amounts to a mere transcoding, a semantic transfusion from one cultural body to another, an operation that could be handled by a machine and which would hardly deserve the name of translation. Translating, in other words, begins when one touches on the untranslatable, more exactly when one remains on the threshold of the translatable. The particle of translating is not into (translated into Japanese, translated into French, translated into …) but between, between the two languages, the two texts, the two cultures, the two historical situations. Considering the threshold as the place of translation allows such a bilateral reception. Every language being for another one a foreign language, the two languages generate a third one, new for each translation, and on the threshold of which the first two stand.
Keywords:
- thershold,
- paratranslation,
- translation theory
Resumen
Traducir es una práctica del umbral, traducir es un pensamiento del umbral. La posición paratraductológica afirma con rotundidad este doble postulado frente a las teorías de la traducción como paso o simple transferencia. Sin resistencia, el paso entre dos lenguas-culturas equivale a una simple transcodificación, a la transfusión semántica de un cuerpo cultural a otro, una operación que podría llevar a cabo una máquina y que apenas merecería el nombre de traducción. En otras palabras, traducir es un acto que empieza cuando se roza lo intraducible, más exactamente cuando uno se queda en el umbral de lo traducible. La partícula del acto de traducir no es a (traducido al japonés, traducido al francés, traducido a …) sino entre, entre las dos lenguas, los dos textos, las dos culturas, las dos historicidades. Considerar el umbral como lugar del acto de traducir permite esta acogida bilateral. Dado que toda lengua es para otra una lengua extranjera, las dos lenguas en presencia provocan la aparición de una tercera, nueva para cada traducción y en el umbral de la cual existen las dos primeras.
Palabras clave:
- umbral,
- paratraducción,
- teoría de la traducción
Corps de l’article
Traduire est une pratique du seuil, traduire est une pensée du seuil. La position paratraductionnelle[1] vient décliner ce double postulat à l’encontre des théories courantes – le cas de le dire – de la traduction comme passage ou comme transfert (sauf au sens psychanalytique). Celles-ci fleurissent dans le décor idéologique du néolibéralisme contemporain privilégiant les principes de mouvement et de circulation planétaire des biens et des capitaux – des personnes, un peu moins. La mondialisation accorderait un rôle majeur à la traduction, censée la servir avec une fluidité et une rentabilité maximales. Toutefois, les guerres, les conflits et les affrontements, perpétrés partout sous des formes et à des degrés divers, viennent infirmer cette vision qui, par ailleurs, conforte le statut secondaire que la traduction a trop souvent accepté au détriment de ses capacités créatrices, transformatrices ou subversives sur lesquelles insiste pour sa part la traductologie contemporaine. Traduire, c’est résister à l’hégémonisation des flux langagiers.
« Franchir le seuil. /Ô premier deuil » (Jabès 1990 : 11). Par cette rime, Jabès illustre la difficulté d’écrire et ce que l’acte implique de renoncement. Similairement, l’acte de traduction recueille ce qui peut s’attacher d’effroi, de crainte, à l’expérience du seuil, « der Schwellenzauber » (Benjamin 1989 : 232), le sortilège du seuil, comme le dit Benjamin dans le Passagen-Werk. Double défection qu’accueille le seuil : quitter sa langue (car on traduit) et abandonner l’autre langue (car on traduit). L’analyse insiste sur la menace potentielle habitant le seuil, sur l’annonce fatale qu’il véhicule, loin des perceptions communes liées à la générosité de l’accueil, à l’hospitalité. Justement : l’accueil est à la mesure de l’effroi que suscite celui[2] qui arrive[3]. Sinon, il n’y a que simple passage, simple entrée, l’empiricité d’un corps qui passe d’un espace à l’autre. En traduction, il importe d’éprouver une telle réaction négative à l’endroit du texte étranger : sans résistance, le passage entre les deux langues-cultures équivaut à un simple transcodage, la transfusion sémantique d’un corps culturel à un autre, un virement de signification d’un compte langagier à un autre compte langagier, bref, sous toutes ces métaphores circulatoires une opération que pourrait prendre en charge une machine et qui mériterait à peine le nom de traduction. Traduire, en d’autres termes, commence lorsqu’on touche à de l’intraduisible, plus exactement lorsqu’on reste sur le seuil du traduisible.
La particule du traduire n’est pas en (traduit en japonais, traduit en français, traduit en …) mais entre, entre les deux langues, les deux textes, les deux cultures, les deux historicités. Il importe d’accepter le tautologique « Une traduction est une traduction » car le refuser en vertu de la lisibilité, de la familiarité, de l’efficacité, bref des attributs de la domestication, revient à accepter l’étranger uniquement s’il est assimilé, selon un discours politique hélas connu et rapidement nauséabond. Considérer le seuil comme lieu du traduire permet cet accueil bilatéral. En effet, le seuil est un opérateur de traduction où l’un se traduit en l’autre, où l’un se déduit de l’autre : « La traduction est cette activité toute de relation qui permet mieux qu’aucune autre, puisque son lieu n’est pas un terme mais la relation elle-même, de reconnaître une altérité dans une identité » (Meschonnic 1999 : 191).
La translatio doit être fidèle au trans qui la porte, instaurant un processus continu d’aller-retour, à l’instar de la transculturation que Ortiz reconnaissait dans son île cubaine (Ortiz 2012). Original et textes traduits dessinent un espace littéraire qui ne les contient pas mais qui évolue au gré de leurs interactions et de leurs devenirs respectifs, ce que, plus idéalement, Batista représentait ainsi : « La traduction, un paradis qui erre éternellement dans la géographie des langues » (Batista 2014 : 23). Une colocution et des colocuteurs davantage que des interlocuteurs sécurisés par des mesures de symétrie qui contiennent le choc de la rencontre alors que seule l’irréductibilité entre deux sujets garantit que l’altérité de l’autre ne sera jamais atteinte, c’est-à-dire effacée. « […] chacun rencontre l’autre, un seul devenir qui n’est pas commun aux deux, puisqu’ils n’ont rien à voir l’un avec l’autre, mais qui est entre les deux, qui a sa propre direction, un bloc de devenir, une évolution a-parallèle » (Deleuze et Parnet 1996 : 13). Le phénomène est connu en histoire de la traduction où les systèmes littéraires gérant, d’une part, l’original et, d’autre part, sa traduction suivent leurs cours séparés, l’histoire des traductions accomplissant encore un troisième parcours, distinct des deux autres et tributaire de paramètres variés d’ordre linguistique, culturel, économique, diplomatique, voire militaire : histoire des traductions du texte homérique ou du texte biblique, du théâtre de Shakespeare ou de la psychanalyse freudienne.
Ni enfermé dans sa langue ni prisonnier de l’autre, le traducteur est dans une position de déportement[4] et sa traduction en conserve la marque. Si le traducteur est d’abord un lecteur, comme il a souvent été remarqué, ce lecteur ne sera ni modèle ni idéal car il ne se tient pas à distance, consommant avec passion ou avec ennui le texte ; il l’examine, l’évalue, le jauge en fonction de ce qu’il pourrait devenir en traduction, bafouant sa souveraineté, niant son autonomie, le voyant déjà autre, c’est-à-dire que la lecture est d’abord déportée vers la langue-culture première, exposée à elle, pour ensuite être déportée vers la langue-culture qui pourrait accueillir le texte. Déportement langagier qu’approche Benjamin lorsqu’il attribue à la traduction la fonction de « faire résonner dans sa propre langue l’écho d’une oeuvre conçue dans une langue étrangère » (Lamy et Nouss, 1997 : 22). L’équivalent visuel est dégagé par Prete qui, après avoir avancé que la langue du traducteur est « le vrai seuil d’où part le plaisir de l’écoute » de la langue de l’original, emprunte au Zibaldone de Leopardi l’image suivante : « De sorte que l’effet sur notre esprit d’un texte écrit en langue étrangère est semblable à celui des perspectives reproduites et vues à l’intérieur d’une chambre noire […] » (Prete 2013 : 18-19). Dans les deux cas, le phénomène n’est pas unidirectionnel mais naît d’une interaction entre une source et un cadre récepteur, propre à qualifier la relation traductive d’inter-intra-linguistique, pour reprendre la typologie de Jakobson : la langue de traduction réagit à l’autre langue et à elle-même, dégageant pour ce faire un seuil de traduction. Au double sens : un lieu pour l’opération et un degré en-dessous ou au-dessus duquel l’opération n’a pas lieu.
L’étymologie laisse à l’hostis d’être un ami ou un ennemi, les deux visages de l’étranger sur le seuil, celui-ci symbolisant l’impossibilité d’assigner un sens et la responsabilité qui en échoit alors au sujet, l’autochtone ou le traducteur. Dans l’Agamennon d’Eschyle dont l’action prend place sur le portique extérieur du palais royal d’Argos, Cassandre est suspecte de ne pas parler la langue grecque, telle une barbare ou une animale, et quand elle se met à parler, ses propos prophétiques sont jugés incompréhensibles ou déments. Intraduisibles. Comme l’écrit Waldenfels, « un seuil n’a pas de périmètre, pas de peri qui l’entoure » (Waldenfels 2009 : 215). Il affirmerait une identité nue, il serait le lieu d’une ontologie primale, sans détermination ou, du moins, il offre au sujet la possibilité de le croire. L’Oedipe d’Oedipe à Colone clame son innocence car il a agi en toute ignorance et sous la pression des dieux (Sophocle 1964 : 288) et pourtant le « Seuil d’Airain », lieu sacré à l’entrée d’Athènes où il trouve refuge dans son exil, le rend libre à deux reprises de son passé coupable : au début de la pièce lorsqu’il y reçoit l’hospitalité des habitants de Colone et à la fin lorsqu’il y meurt, accueilli par Zeus. Tout au long de ses sept épisodes, la tragédie résonne du terme « étranger » par lequel s’interpellent incessamment tous les personnages ainsi que le choeur. N’est-ce pas que le seuil engage celui qui le foule à réfléchir sur son propre statut et se demander si être humain ne signifie pas fondamentalement être étranger ? Le chant final d’Antigone exprime clairement l’association : « […] le seuil mystérieux devant lui s’est ouvert ;/l’ombre sur lui s’est refermée. /[…]/ Au lieu marqué, sur la terre étrangère,/il est mort […] » (Sophocle 1964 : 305).
La traduction, elle, connaît la réponse : toute langue est pour une autre une langue étrangère. De fait, le sujet pourvu d’autochtonie qui rencontre l’étranger possède la même liberté que le traducteur face au texte original : conscient des normes culturelles entourant le geste traductif, il choisit le degré auquel il les respectera ; de même, l’hôte qui peut accueillir l’étranger en soumettant au crible de sa volonté les normes sociales. Car se tenir sur un seuil est une position (active), non une situation (passive). Autant qu’il nous tient, nous tenons le seuil, comme on le dit d’une position. Proust a construit avec La Recherche la somme romanesque l’honorant, entre les premières lignes qui peignent le narrateur au seuil du sommeil et les dernières qui le déclarent au seuil de son oeuvre, prêt à l’écrire. Quant aux sept tomes intermédiaires, non seulement l’auteur se tient résolument au seuil du vécu mais il invite le lecteur à s’y tenir avec lui. La poétique proustienne est tout entière dans ce positionnement distant qui redéfinit la présumée omniscience du romancier en la teintant d’ambivalence. Pour ce qui est du fameux processus mémoriel au principe de l’écriture (« le goût de la madeleine » et aussi la cuillère, les pavés, la serviette empesée, etc.), certes le narrateur doit patiemment attendre sans attendre au seuil de la réminiscence que celle-ci veuille se produire, tel un « miroitement » (Proust 1973 : 872), car il ne saurait en provoquer le surgissement mais un tel dispositif mêlant disponibilité et attention suppose un évident volontarisme et non le désaveu de l’action. Comme la mémoire, la traduction mélange le don et la retenue, le manifeste et le latent, elle retient autant qu’elle accorde. Accepter cette stratégie signe un engagement dont dépend la promesse de l’oeuvre :
[…] il fallait tâcher d’interpréter les sensations comme les signes d’autant de lois, en essayant de penser, c’est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j’avais senti, de la convertir en un équivalent spirituel. Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu’était-ce autre chose que faire une oeuvre d’art ? […] à tout moment l’artiste doit écouter son instinct, ce qui fait que l’art est ce qu’il y a de plus réel, la plus austère école de la vie, et le vrai Jugement dernier.
Proust 1973 : 879-880
Dans une perspective parallèle, le seuil traduit une position existentielle qui trouve son illustration extrême dans le Bartleby de Melville et le « I would prefer not to » que son personnage éponyme oppose aux demandes qui lui sont faites. Pour Deleuze, la « formule » que profère le copiste dans l’environnement stérile du bureau de l’avoué qui l’emploie va « faire croître une zone d’indétermination ou d’indiscernabilité telle que les mots ne se distinguent plus, et les personnages non plus » (Deleuze 1993 : 98), préparant l’anonymat des sociétés industrialisées. Pour Agamben, l’attitude du copiste s’inscrit dans une longue tradition philosophique interrogeant les limites de la création et l’extension du concept de potentialité. La position de Bartleby, quoiqu’il en soit, ouvre à toutes les possibilités puisqu’il n’en refuse aucune.
Le traducteur connaît l’exaltation d’une multitude de choix traductifs possibles face au texte original, ébriété dont il doit dissiper les effets devant la rédaction du texte à venir. Ne pas traduire en état d’ivresse, telle est la règle. Confronté à l’étrangeté diffractante de l’original, il doit trouver un espace où il ne succombera pas à l’altérité tout en se gardant de lui imposer le carcan de ses habitudes langagières et culturelles. Un tel exercice est malaisé si la traduction présuppose l’existence de territoires linguistico-culturels délimités et si elle se conçoit comme le passage de l’un à l’autre. Le passage de l’un dans l’autre, en revanche, appelé par l’expérience du seuil, en autorise la conception : deux territoires mobiles plus qu’une mobilité les parcourant, deux territoires nomades plus qu’un nomadisme les arpentant. Une figure l’illustre, le moiré qui désigne un effet visuel apparaissant dans un tissu ou dans la superposition de deux trames métalliques et que le lexique du graphisme électronique a ensuite adopté. À noter que le terme lui-même charrie une belle histoire transculturelle puisque, venant de l’arabe, il a traversé les aires francophone et anglophone avant de se stabiliser lexicalement. Dans le moiré, la rencontre des deux surfaces en crée une troisième, un processus de métissage repérable en traduction où les deux langues en présence en suscitent une troisième, nouvelle pour chaque traduction et au seuil de laquelle existent les deux premières.
La vertu du seuil, et sa fonction, sont anticipatoires : saisir à l’avance, avant et sans le contact. Demeurant sur un seuil, sans pénétrer dans l’espace adjacent, je m’expose à ce que je perçois, à ce qui demeure à distance, quoique le recevant dans mon intériorité. Regarder de près en gardant mémoire du loin – ce que Benjamin théorisait par la notion d’aura (« l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il », Benjamin 2000 : 278) – définit la stratégie du traduire. Je traduis dans le détail et la proximité des mots et des phrases en conservant une conscience de l’ensemble textuel, je passe sous l’arcade sans perdre souvenir du mur, pour reprendre une autre image de Benjamin avancée dans son essai sur la traduction (Lamy et Nouss 1997 : 25). Le traducteur copie l’original tout en en proposant une version autre. Ce faisant, il ne dissipe pas l’aura de l’original, il la renforce : chaque traduction épaissit l’originalité du texte originel. Raison pour laquelle la retraduction est une pratique admise et courante dans l’économie textuelle propre à la traduction. Une vingtième traduction, en un siècle et demi, de Madame Bovary est parue en anglais en 2012 (Flaubert 2012)[5] et chacune est unique, affirmant la légitimité de l’entreprise ; chacune demeure au seuil de l’original puisque jamais aucune ne parviendra au statut de traduction définitive. Aussi proche que le rendent ses traductions successives, l’original demeure éloigné, protégé par l’aura de sa distance relayée dans celle de chaque traduction.
Dans cet effet auratique, le dedans accueille le dehors sans qu’aucun des deux n’en soit altéré mais non sans incidence sur ma subjectivité, soumise à une oscillation ontologique sévère puisque je perds les repères qui balisent pour moi espace interne et espace externe. Il est significatif que Derrida ait invoqué la figure du seuil dans sa réflexion sur le statut de l’animal en regard du sujet humain, s’arrêtant et refusant de tenir « pour assurée l’existence (naturelle ou artificielle) d’aucun seuil, si par seuil on entend ou bien ligne de frontière indivisible ou bien solidité d’un sol fondateur » (Derrida 2008 : 413). Mais le seuil défait justement la prétention à l’ici et là ou plus exactement contrarie le « et » dans son ambition séparatrice. Nulle prévention d’un tracé dans le retrait du seuil car, au contraire, toute décision se prévaut d’un tel positionnement : bâtir ou garantir, par exemple, tracer un plan ou un paraphe demande une extériorité pour leur réalisation. En vue de légiférer, le législateur a besoin de se trouver (un) hors-cadre, ce que souligne la parabole de Kafka, « Devant la loi », qui fait de l’homme qui attend toute sa vie devant la porte de la loi, plus que le gardien, celui qui proclame que la loi existe. Sa figure revient illustrer la réflexion de Derrida sur « l’idée conjointe de la signature et de l’architecture : la loi du seuil, la loi sur le seuil ou plutôt la loi comme le seuil même, et la porte (une immense tradition, la porte « devant la loi », la porte à la place de la loi, la porte faisant la loi qu’elle est), le droit d’entrer […] » (Derrida 1987 : 512).
Appliquée à l’espace textuel, l’analyse de cette distance franchie mais non abolie permet la définition suivante de la traduction : traduire, c’est décrire dans ma langue ce que me donne à voir ou à entendre l’autre langue, le texte premier ; traduire, c’est représenter ce que je (re)construis comme sa signifiance. Si le langage est ce « contact à travers une distance, rapport avec ce qui ne se touche pas » (Lévinas 1990 : 187) que théorise Lévinas, la traduction, loin d’être une activité seconde ou secondaire du langage, en est l’illustration essentielle. Définition corollaire de la paratraduction : Décrivant ce que je perçois dans et à partir de l’original, j’en suis à la fois à proximité et à distance – de près et de loin ; paratraduire revient à moduler le paradoxe en traduisant non l’original mais ce qui m’en sépare. Un seuil.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Le préfixe para- est pris comme signifiant de liminalité. Les termes de paratraduction et paratraductologie ont émergé des travaux du Groupe de recherche Traducción & Paratraducción de l’Université de Vigo (Espagne) qui a accueilli mes premières réflexions sur le sujet. Voir la dernière publication (Yuste Frías, 2022) et le carnet de recherche HYPOTHÈSES sur la traduction et la paratraduction de José Yuste Frías intitulé Sur les seuils du traduire. Yuste Frías, José (depuis 2013) : Sur les seuils du traduire. Un carnet de recherche sur la traduction et la paratraduction. Marseille-Paris-Lisbonne : Hypothèses_OpenEdition_Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo). CNRS_EHESS_Université d’Aix-Marseille_Université d’Avignon. Consulté le 13 mai 2022 : <https://seuils.hypotheses.org/>
-
[2]
Le masculin, singulier ou pluriel, est utilisé comme genre neutre dans ce texte pour en faciliter la lecture.
-
[3]
Voir sur ce point Derrida, Jacques (1997) : De l’hospitalité. Paris : Calmann-Lévy.
-
[4]
Sur la valeur sémantique et heuristique de cette notion, voir Nouss, Alexis (2021) : Le déportement. Petit traité du seuil et du traduire. Paris, Hermann.
-
[5]
Flaubert, Gustave (2012) : Madame Bovary (Traduit du français par Adam Thorpe) London : Vintage Books.
Bibliographie
- Agamben, Giorgio (1999) : Potentialities : Collected Essays in Philosophy. Stanford : Stanford University Press.
- Batista, Carlos (2014) : Traducteur, auteur de l’ombre. Paris : Arlea.
- Benjamin, Walter (2000) : L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. (Traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac) In : Rainer Rochlitz, dir. OeuvresIII. Paris : Folio essais.
- Benjamin, Walter (1989) : Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages. (Traduit de l’allemand par Jean Lacoste) Paris : Le Cerf
- Deleuze, Gilles (1993) : « Bartleby, ou la formule ». Critique et clinique. Paris : Les Éditions de Minuit.
- Deleuze, Gilles et Parnet, Claire (1996) : Dialogues. Paris : Champs Flammarion.
- Derrida, Jacques (1987) : Cinquante-deux aphorismes pour un avant-propos. In : Jacques Derrida, dir. Psyché. Inventions de l’autre. Paris : Galilée.
- Derrida, Jacques (2008) : La bête et le souverain I. Paris : Galilée.
- Eschyle (2015) : Agamemnon. (Traduit du grec par Pierre Judet de la Combe), Paris : Les Belles Lettres, coll. Classiques en poche no 114.
- Jabès, Edmond (1990) : Le Seuil, Le Sable. Poésies complètes 1943-1948. Paris : Gallimard - Poésie Gallimard.
- Jakobson, Roman (1959) :Linguistic Aspects on Translation, In : Reuben A. Brower, ed. On Translation, Cambridge : Harvard University Press., 232-239.
- Lamy, Laurent et Nouss, Alexis (1997) : L’abandon du traducteur. Prolégomènes à la traduction des « Tableaux parisiens » de Charles Baudelaire. TTR. Traduction, terminologie, rédaction. 10(2):13-69.
- Lévinas, Emmanuel (1990) : Totalité et infini. Paris : Biblio Essais.
- Melville, Herman (1996) : Bartleby le scribe (Traduit de l’anglais par Pierre Leyris), Paris : Gallimard, coll. Folio.
- Meschonnic, Henri (1999) : Poétique du traduire. Lagrasse : Éditions Verdier.
- Ortiz, Fernando (2012) : Controverse cubaine entre le tabac et le sucre. (Traduit de l’espagnol par François Bonaldi) Montréal : Mémoire d’encrier.
- Prete, Antonio (2013) : À l’ombre de l’autre langue. Pour un art de la traduction. (Traduit de l’italien par Danièle Robert) Cadenet : les éditions chemin de ronde.
- Proust, Marcel (1973) : Le temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, tome III. Paris : La Pléiade.
- Sophocle (1964) : Oedipe à Colone. In : Théâtre complet (Traduit du grec par R. Pignare). Paris : Garnier-Flammarion.
- Waldenfels, Bernhard (2009) : Topographie de l’étranger. (Traduit de l’allemand par Francesco Gregorio, Frédéric Moinat, Arno Renken et Michel Vanni) Paris : Van Dieren Éditeur.
- Yuste Frías, José (2022) : Teoría de la paratraducción. In : José Yuste Frías et Xoán Manuel Garrido Vilariño, eds. Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación. Berlina : Peter Lang, coll. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation [Études sur les langues romanes et communication interculturelle] dirigée par Gerd Wotjak, José Juan Batista Rodríguez et Dolores García-Padrón, vol. 142:29-64.

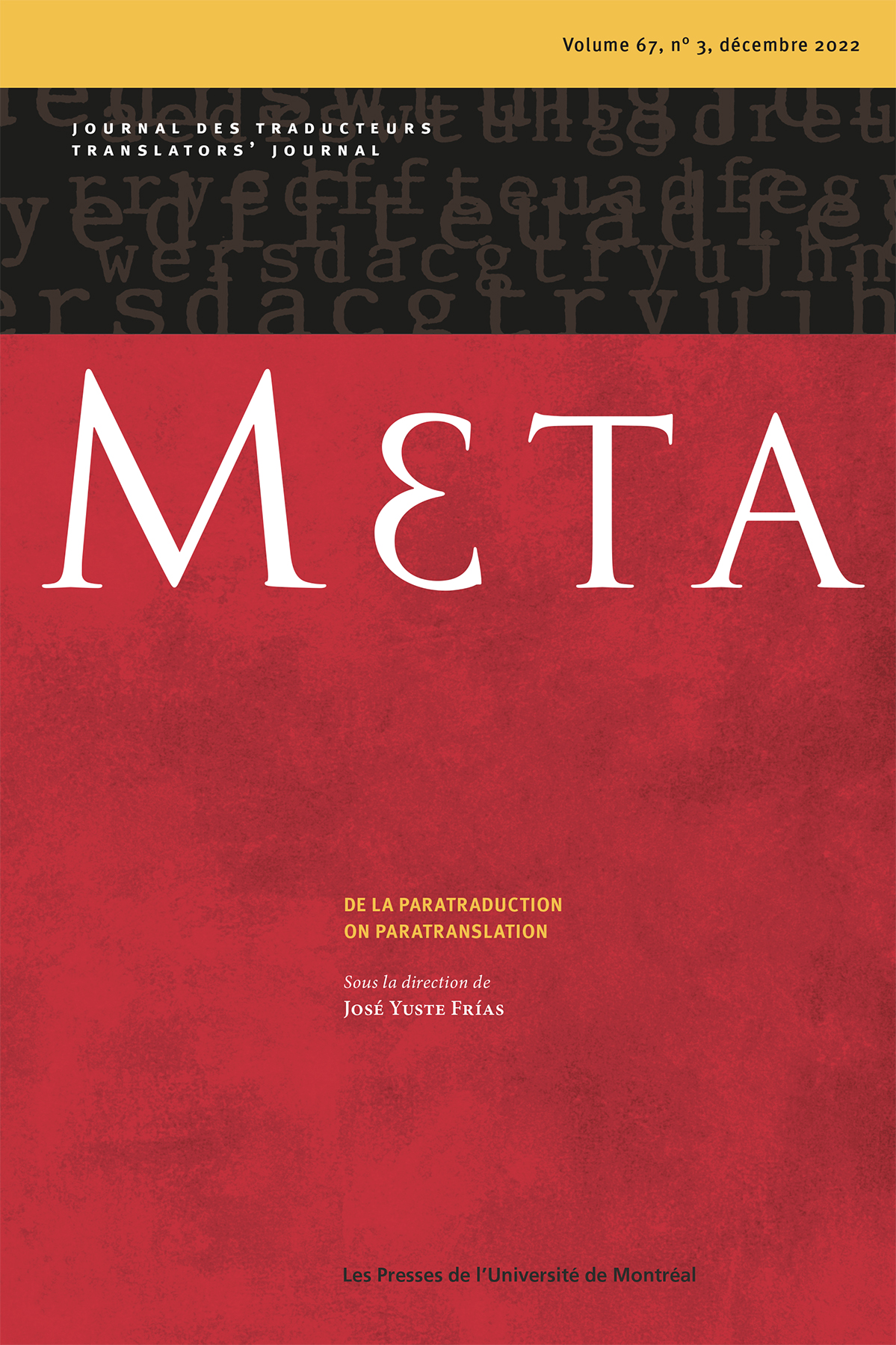
 10.7202/037299ar
10.7202/037299ar