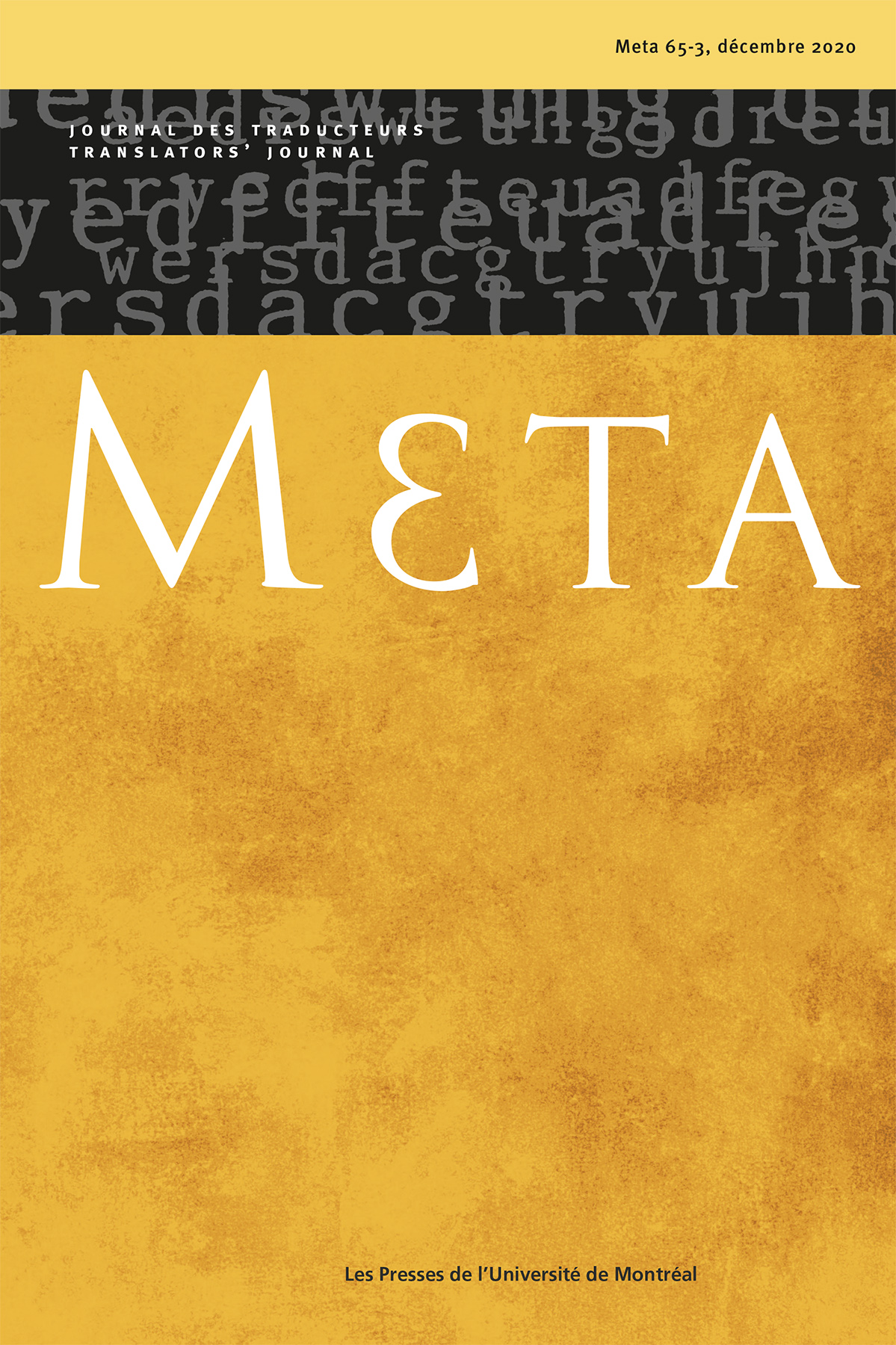S’agissant de rendre compte d’un ouvrage qui se proclame aussi ouvertement polémique, la plus grande injustice serait sans doute de rechercher – ou de feindre – une forme de distance clinique : il nous est clairement demandé, ici, de prendre position. Cela n’interdit pas, néanmoins, de décrire succinctement l’objet auquel nous avons affaire. La structure de l’ouvrage est très claire. Celui-ci commence par deux pages programmatiques, intitulées, là aussi, provocations, numérotées en chiffres romains et invitant le lecteur à abandonner un certain nombre d’idées reçues sur la traduction : il faut arrêter d’envisager cette dernière à l’aide de la métaphore, dire adieu aux appréciations moralistes telles que fidèle ou infidèle, se défaire de l’idée que la traduction, en tant qu’opération, constitue une substitution mécanique, renoncer à vouloir évaluer les traductions en les étalonnant au texte source, et faire litière de l’hypothèse de l’intraduisibilité. En lieu et place de quoi l’auteur suggère d’appréhender la traduction comme une pratique qui allie indissociablement linguistique et culturel, qui doit être définie comme l’établissement d’une équivalence variable par rapport au texte source, cette équivalence procédant d’une interprétation exigeant à la fois sophistication intellectuelle et talents d’écriture. Le document ainsi produit doit aussi être apprécié dans ses relations par rapport à la hiérarchie des valeurs, des croyances et des représentations de la culture cible. Enfin, il faut prendre conscience que tout texte est traduisible puisque tout texte peut être interprété : tout est là (p. ix, x). Lawrence Venuti englobe l’ensemble des hypothèses dont il faut, selon lui, se défaire sous l’appellation d’instrumentalisme (« a model […] that conceives of translation as the reproduction or transfer of an invariant that is contained in or caused by the source text, an invariant form, meaning, or effect », p. 1). C’est, pour lui, le paradigme dominant depuis deux millénaires, en commençant par Cicéron. Et c’est à cette vision des choses qu’il faut attribuer le statut inférieur de la pratique traductionnelle dans la hiérarchie des valeurs universitaires et littéraires. Il faudrait donc la remplacer par un paradigme concurrent, qu’il baptise (peut-être n’est-il pas le seul…) herméneutique – et qui est centré sur les paramètres de la culture de réception. Herméneutique, certes, mais certainement pas heideggérien : l’herméneutique est ici conçue comme reposant sur une interprétation toujours possible, et toujours différente. Il ne s’agit en aucun cas de prôner l’essentialisme (p. 3-5). Suivent trois chapitres, paginés en chiffres arabes, déclinant ce programme dans différents domaines et intitulés respectivement « Hijacking Translation » (p. 41-82), « Proverbs of Untranslatability » (p. 83-126), et « The Trouble with Subtitles » (p. 127-172). Le premier questionne la place de la traduction dans la littérature comparée, s’en prend à la traduction anglaise de certains articles du fameux Dictionnaire des intraduisibles dirigé par Barbara Cassin (2004), revient sur le concept d’intraduisibilité, et sur l’opposition entre théorie et pratique, pour plaider in fine (p. 78-79) pour une approche de la traduction comme activisme politique. Le deuxième revient plus en détail sur le soupçon d’intraduisibilité, qu’il s’attache cette fois à démonter à travers quelques proverbes fréquemment colportés, en particulier le célèbre « traduttore/traditore », dont il fait, après d’autres, la généalogie, sous l’invocation de Michel Foucault, tout en revenant sur le rôle même des proverbes dans la constitution de la pensée (ou de la non-pensée) sur la traduction. Le troisième, que l’on pourrait penser avoir été écrit pour The Translator’s Invisibility (Venuti 1995), déplace la problématique dans l’audiovisuel, en posant le problème des sous-titres, dont il critique, là encore, l’idée selon laquelle ils consisteraient à transposer, fût-ce sous une forme écrite et condensée, un invariant (du …
Parties annexes
Bibliographie
- Berman, Antoine (1995) : Pour une critique des traductions : John Donne. Paris : Gallimard.
- Berman, Antoine (1999) : La Traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain. Paris : Seuil.
- Cassin, Barbara, dir. (2004) : Vocabulaire européen des philosophies : Le dictionnaire des intraduisibles. Paris : Le Seuil/Le Robert.
- Froeliger, Nicolas (2017) : Traduction et trahison – Tout est dans le contexte. In : Grégoire, Michaël et Mathios, Bénédicte, dir. Traductions et contextes, contextes de la traduction. Paris : L’Harmattan, 33-52.
- Froeliger, Nicolas (2019) : Pour une réhabilitation de la trahison en traduction. Langues, Cultures et Sociétés. 5(1):44-56.
- Venuti, Lawrence (1995) : The Translator’s Invisibility : A History of Translation. New York : Routledge.