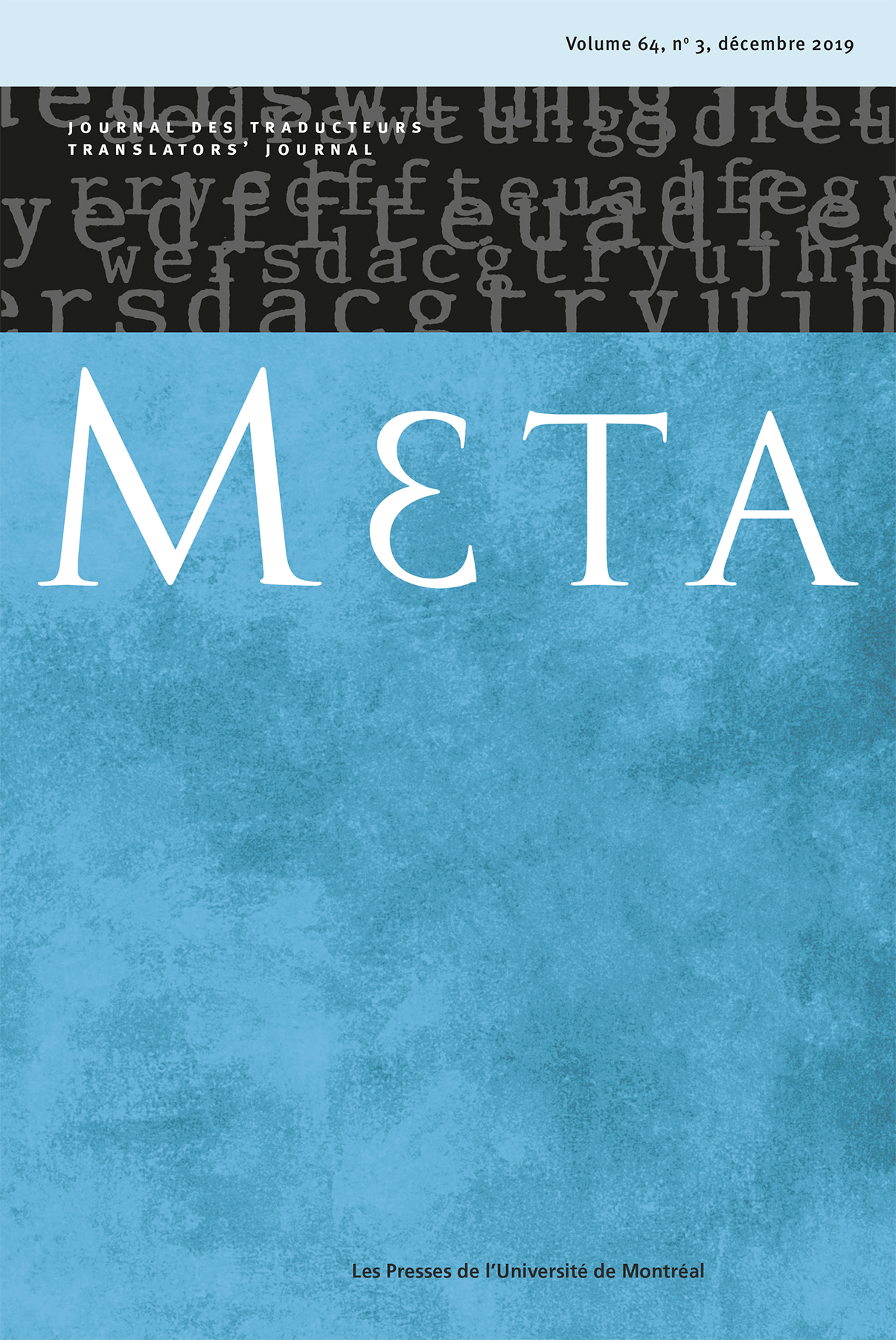Toute création langagière déplace, ne serait-ce qu’imperceptiblement, le regard porté sur les objets de représentation. Étudiée de longue date dans les domaines des arts et des lettres, elle retient depuis un bon demi-siècle l’attention de chercheurs qui s’intéressent aux termes des sciences et des techniques, qu’ils soient officiels (cf. les usages recommandés) ou non (jargons de métiers, argots…). En 2017 paraissait, dans le onzième numéro de la revue Neologica, le texte des interventions de la journée d’étude TOTh tenue l’année précédente et intitulée La néologie en terminologie. Un an plus tard (en 2018), paraît un ouvrage au titre voisin, La néologie terminologique. Malgré l’ordre dicté par la chronologie des évènements, La néologie terminologique est le premier ouvrage qui offre un tour d’horizon détaillé du sujet. Il s’agit d’une somme érudite. L’auteur, John Humbley, oeuvre depuis le début des années 1970 dans les domaines présentés, à la fois comme acteur et comme chercheur mû par la volonté d’allier la théorisation à un travail d’analyse de corpus. Sont exposés et discutés dans ce livre une large sélection d’options théoriques, de résultats de travaux empiriques et de mises en oeuvre pratiques. L’auteur met de plus à l’épreuve des faits trois des modèles qu’il juge les plus pertinents pour appréhender les phénomènes de la néologie en terminologie. Il précise qu’une revue exhaustive des travaux en la matière était impossible, mais ne cache pas l’ambition encyclopédique de son entreprise (p. 395 ; aussi, p. 207 : « présenter autant de travaux que possible »), ce qui ressort de la bibliographie : avec 44 pages et une quinzaine de références par page, environ 700 textes y sont présentés, écrits en français, en allemand, en anglais, en italien, en portugais, en danois… (le cas échéant, l’auteur traduit lui-même les extraits qu’il cite) ; de nombreuses références sont discutées sous divers angles, à différentes étapes du développement. Les lecteurs pourront aussi découvrir l’amorce d’une synthèse instrumentale, puisque l’auteur propose le prototype d’un modèle d’analyse original, multidimensionnel, de la néonymie, à partir duquel il examine, entre autres, des cas de rétronymie, d’éponymie, d’emprunt, de « glissement de sens », de composition, de synonymie. À la suite de Louis Guilbert, Humbley insiste sur l’importance du foisonnement synonymique dans la phase de création terminologique (processus fréquent dans la création d’usages « généraux »). Il présente alors (p. 174-175) les cas inverses, d’une part de différenciation de synonymes (en citant le cas de synchronisation et alignement en traduction automatique), et d’autre part, de neutralisation d’une distinction sémantique (cas de vinyle, utilisé aujourd’hui pour parler – sans doute par rétronymie sémantique – de disques « non compacts », incluant désormais les 78 tours). L’auteur nomme « modèle mixte » le modèle qu’il propose – bien qu’il s’en défende, jugeant « prématuré de proposer un modèle en l’absence de chantier néologique important » (p. 122). Celui-ci combine trois grands types d’approche qui aident à mieux saisir la création de nouveaux termes (approches « incrémentale », « textuelle » et « cognitive »). La multidimensionnalité consistante de ce modèle rend en grande partie compte de la complexité des phénomènes recouverts par le terme néologie terminologique. Comme l’expose l’auteur, cette formule recouvre des phénomènes et des enjeux de natures diverses qu’il serait réducteur de considérer sous un seul angle. Situant son travail dans un mouvement dialectique entre la production d’une vision panoramique – l’objectif étant de mieux comprendre les enjeux et les motivations reliés à la création de nouveaux termes – et l’élaboration d’outils d’analyse dont la fabrication s’appuie sur les résultats de l’examen de cas concrets (des « échantillons …
Parties annexes
Bibliographie
- Boulanger, Jean-Claude (1981) : Compte rendu de 500 mots nouveaux définis et expliqués par Jacques Cellard et Micheline Sommant [1979, Paris/Gembloux : Duculot]. Le français moderne. 49(1):379-382.
- Boulanger, Jean-Claude (1983) : Synonymie, néonymie et normalisation en terminologie. Commentaire d’un exposé d’Alain Rey. In : Diane Duquet-Picard et Marian Bugara-Adshead, dir. Problèmes de la définition et de la synonymie en terminologie. (Colloque international de terminologie, Québec, 23-27 mai 1982). Québec : Girsterm, 311-327.
- Boulanger, Jean-Claude (1989) : L’évolution du concept de néologie de la linguistique aux industries de la langue. In : Caroline De Schaetzen, dir. Terminologie diachronique. (Colloque « Terminologie diachronique, Bruxelles, 25-26 mars 1988). Paris : Conseil international de la langue française/Ministère de la communauté française de Belgique, 193-211.
- Gardin, Bernard (1974) : La néologie, aspects socio-linguistiques. Langages. 36:67-73.
- Guilbert, Louis (1975) : La créativité lexicale. Paris : Larousse.
- Humbley, John (1993) : L’observation de la néologie terminologique. La banque des mots. 5:65-74.
- Humbley, John (2006) : La néologie : interface entre ancien et nouveau. In : Rosalind Greenstein, dir. Langues et cultures : une histoire d’interface. Paris : Publications de la Sorbonne, 93-103.
- Humbley, John (2012) : Retour aux origines de la terminologie : l’acte de dénomination. Langue française. 174:111-129.
- Rey, Alain (1979) : La terminologie. Paris : Presses universitaires de France.
- Quemada, Gabrielle, dir. (1983) : Dictionnaire de termes nouveaux des sciences et des techniques. Paris : Conseil international de la langue française.
- Sablayrolles, Jean-François (2000) : La néologie en français contemporain. Paris : Honoré Champion.