C’est il y a exactement vingt ans que Sara Laviosa dirigeait un numéro de Meta intitulé L’approche basée sur le corpus dans lequel cette approche était présentée comme un nouveau paradigme (Laviosa 1998). Depuis, Meta a publié de nombreux articles dans lesquels l’approche basée sur le corpus est devenue familière à ses lecteurs. En 2011, un deuxième numéro, intitulé Les corpus et la recherche en terminologie et traductologie, et dirigé par Marc Van Campenhoudt et Rita Temmerman, confirmait le changement de paradigme dans les études en traductologie et dans des disciplines liées, comme la terminologie et la lexicologie. C’est donc le troisième numéro en vingt ans que Meta consacre intégralement à la traductologie de corpus. Si Laviosa (1998 : 1) présentait l’approche basée sur le corpus (corpus-based translation studies) comme un domaine prometteur dans les études en traduction, en analyse contrastive et dans la formation des traducteurs, cette approche est aujourd’hui bien installée et a permis de développer des recherches qui se sont grandement élargies à d’autres territoires, tout en tirant parti des progrès rencontrés dans les outils statistiques de traitement de corpus. L’objectif de ce numéro consiste à illustrer la richesse des différents territoires explorés par cette approche, son dynamisme et la solidité du tournant pris il y a une vingtaine d’années avec ce que Van Campenhoudt et Temmerman (2011 : 224) nomment le « bras informatisé de la linguistique descriptive », et donc, aujourd’hui, de la traductologie. À cela, il convient d’ajouter le « bras statistique », en raison du tournant statistique pris en sciences du langage et, simultanément, en traductologie (Oakes et Ji 2012). Le numéro est divisé en trois parties dans lesquelles les différents auteurs abordent à la fois des questions épistémologiques et théoriques et présentent des analyses empiriques et/ou à visée pédagogique. La première partie rassemble des recherches portant sur des textes traduits, la deuxième présente des travaux dans un domaine qui s’est grandement développé ces dernières années, celui de l’interprétation ; elle se clôt par un article qui cherche à montrer que les barrières entre l’interprétation et la traduction tendent à disparaître. Enfin, la troisième partie aborde les corpus en traduction et traductologie comme des outils d’aide à la traduction ou à l’enseignement. Nous cherchons ici à donner un aperçu, non exhaustif, non seulement de la diversité des objets d’étude du domaine, mais aussi à soulever la question de la distinction entre traductologie, traduction, interprétation, enseignement et outils. On peut en effet faire l’hypothèse que l’approche basée sur le corpus a permis de rapprocher de plus en plus ces différentes branches de la traductologie, en fondant les analyses et les résultats sur des attestations authentiques et concrètes, issues d’analyses quantitatives et qualitatives structurées sur le corpus. Le premier article, proposé par Kaibao Hu et Xiaoqian Li, a pour objectif de synthétiser et poser les bases théoriques et méthodologiques de la traductologie critique reposant sur le corpus (corpus-based critical translation studies, ou CCTS). Les auteurs expliquent comment la traductologie descriptive et l’analyse de discours critique (critical discourse analysis ou CDA) ont pu fusionner pour en arriver à une approche critique de l’idéologie dans la traduction. Ils argumentent en faveur de l’approche basée sur le corpus qui permet des analyses approfondies et précises, tirant parti des études sur l’idéologie en corpus. Leur objectif consiste à clarifier l’approche CCTS par rapport à la traductologie descriptive (descriptive translation studies : DTS), à expliciter les domaines de recherche de l’approche CCTS, à évoquer les méthodologies possibles et à délimiter les contributions théoriques et pratiques de cette approche pour la traductologie critique (CTS). Des …
Parties annexes
Bibliographie
- Laviosa, Sara, dir. (1998) : L’approche basée sur le corpus. Meta. 43(4).
- Laviosa, Sara (1998) : The Corpus-based Approach : A New Paradigm in Translation Studies. In : Sara Laviosa, dir. L’approche basée sur le corpus. Meta. 43(4):474-479.
- Oakes Michael P. et Ji, Meng, dir. (2012) : Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies. Amsterdam/Philadelphie : John Benjamins.
- Shlesinger, Miriam (1998) : Corpus-based Interpreting Studies as an Offshoot of Corpus-based Translation Studies. Meta. 43(4):486-493.
- Van Campenhoudt, Marc et Temmerman, Rita (2011) : Les corpus et la recherche en terminologie et en traductologie. In : Marc Van Campenhoudt et Rita Temmerman, dir. Les corpus et la recherche en terminologie et en traductologie. Meta. 56(2):223-225.
- Van Campenhoudt, Marc et Temmerman, Rita, dir. (2011) : Les corpus et la recherche en terminologie et en traductologie. Meta. 56(2).
- Vandevoorde, Lore, Daems, Joke and Defrancq, Bart (à paraître) : New Empirical Perspectives on Translation and Interpreting. Routledge Advances in Translation and Interpreting Studies. Londres/New York : Routledge.

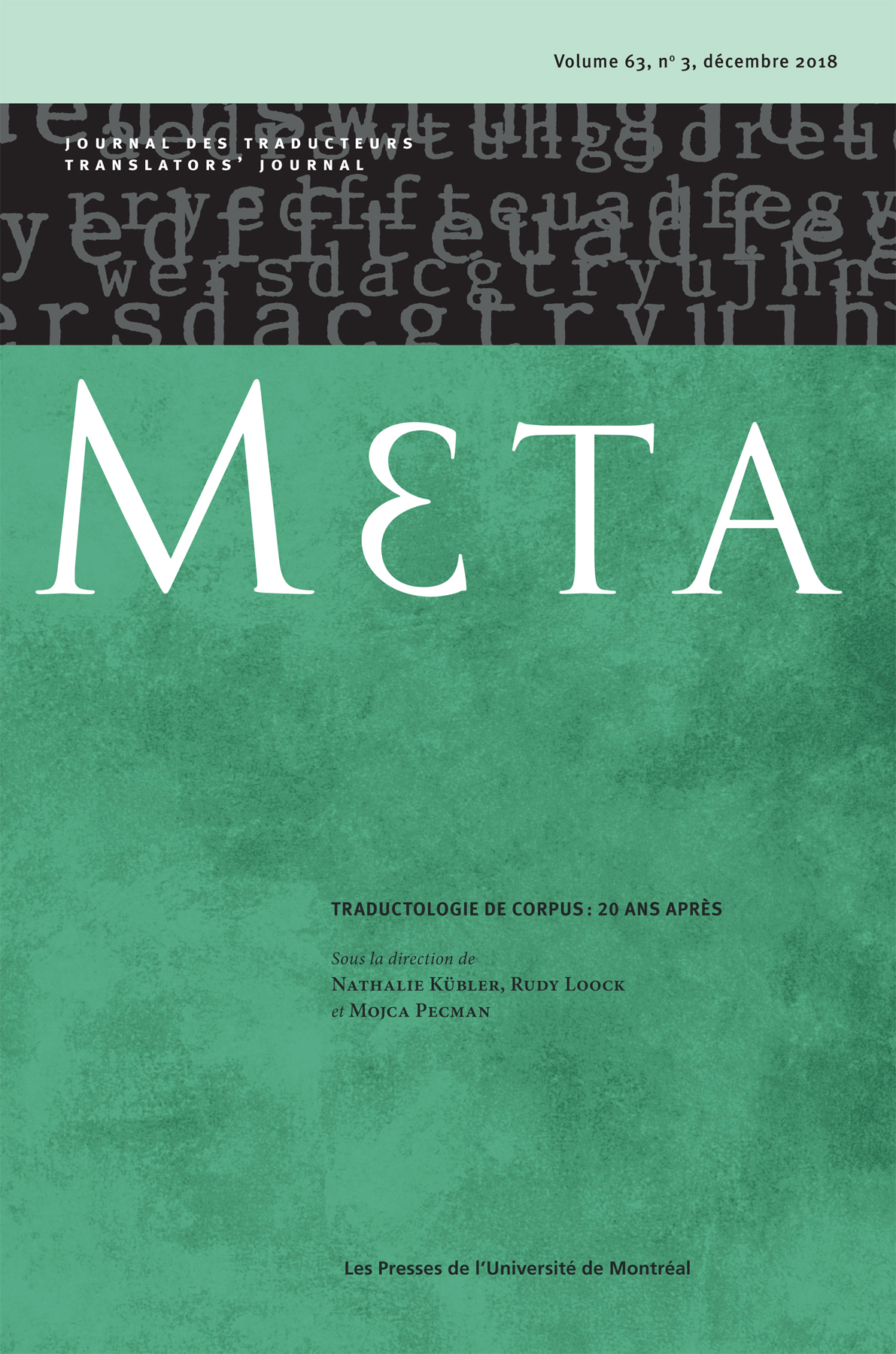
 10.7202/003424ar
10.7202/003424ar