Résumés
Résumé
La lexicographie bilingue grec moderne-français/français-grec moderne reflète la position paradoxale de chaque langue : si l’apprentissage du grec moderne en France ne répond à aucun impératif, en revanche le français est, en Grèce, la seconde langue vivante obligatoire dès le secondaire. Les dictionnaires bilingues sont massivement rédigés et édités en Grèce, et destinés à des apprenants grecs. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure leur conception résulte effectivement de l’observation des données lexicales des langues en présence, et si cette observation n’est pas doublée, filtrée par une pré-appropriation qui apprêterait le matériau à la langue cible pour en faciliter l’apprentissage. Le présent travail vise à ouvrir la réflexion sur les stratégies d’appropriation linguistiques et culturelles à l’oeuvre dans la lexicographie bilingue. Une de ces stratégies consiste à conformer le matériau d’entrée à certaines caractéristiques structurelles de L2. Notre axe d’observation portera sur la dichotomie entre construction synaptique et construction morphologique, qui permet d’opposer les deux langues sur un axe macrostructurel.
Mots-clés/Keywords:
- appropriation,
- figement,
- lexicographie bilingue,
- pragmatique,
- unité lexicale
Abstract
Bilingual Modern Greek/French – French/Modern Greek lexicography is a reflexion of the paradoxical situation of the two languages involved. Whereas there is no pressing need in France to learn Modern Greek, in Greece, French is the second obligatory foreign language taught from secondary school on. There are thus many bilingual dictionaries written and published, aimed at the market of Greek learners. The question arises as to the extent to which these dictionaries have been modelled on the actual observation of the lexical data of the languages involved and whether there is not some pre-appropriation bias seeking to fit the data to the target language in order to facilitate the learning process. This article aims at shedding light on the strategies involved in acquiring language and culture deployed in bilingual lexicography. One of these strategies is to mould the original linguistic data into certain structures which are characteristic of the second language. The focus here is on the dichotomy between synaptic and morphological constructions, inviting a comparison of the two languages from a macrostructural viewpoint.
Parties annexes
Références
- Benveniste, E. (1974a) : « Fondements syntaxiques de la composition nominale », Problèmes de linguistique générale, T.2, Paris, Gallimard.
- Benveniste, E. (1974b) : « Formes nouvelles de la composition nominale », Problèmes de linguistique générale, T.2, Paris, Gallimard.
- Binon, J., Verlinde, S., Selva, T. et G. Petit :Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère et langue seconde (DAFLES), <www.kuleuven.ac.be/dafles>.
- Binon, J., Verlinde, S., Van Dyck, J. et A. Bertels (2000) : Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (DAFA), Paris, Didier, <www.projetdafa.net/>.
- Cadiot, P. et F. Nemo (1997c) : « Propriétés extrinsèques en sémantique lexicale », French Language Studies 7, Cambridge University Press, pp. 127-146.
- Cadiot, P. et F. Lebas (dir.) (2003) : « La constitution extrinsèque du référent », Langages 150, Paris, Larousse.
- Cadiot, P. (1997a) : « Aux sources de la polysémie lexicale », Langue française 113, pp. 3-11.
- Cadiot, P. et F. Nemo (1997b) : « Pour une sémiogenèse du nom », Langue française 113, pp. 24-34.
- Cadiot, P. et F. Nemo (1997d) : « Analytique des doubles caractérisations », Sémiotiques 13, pp. 123-143.
- Cadiot, P. et L. Tracy (1997e) : « On n’a pas toujours sa tête sur les épaules », Sémiotiques 13, pp. 105-121.
- Camus, R. et S. De Vogüé (dir.) (2004) : « Variation sémantique et syntaxique des unités lexicales : étude de six verbes français », Linx 50, Université Paris X, Nanterre.
- Corbin, D. et M. Temple (1994) : « Le monde des mots et des sens construits : catégories sémantiques, catégories référentielles », Cahiers de lexicologie 65, pp. 5-28.
- Corbin, D. (1987) : Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, Niemeyer, Tübingen, Presses du Septentrion, Université de Lille.
- Fradin, B. (2003) : Nouvelles approches en morphologie, Paris, PUF.
- Franckel, J.-J. et D. Lebaud (1990) : Les figures du sujet, Paris, Ophrys.
- Franckel, J.-J., Paillard, D. et E. Saunier (1996) : « Modes de régulation de la variation sémantique d’une unité lexicale : le cas du verbe passer », in Fiala, P., Lafon, P. et M.-F. Piguet (dir.), La locution : entre syntaxe et pragmatique, Klincksieck, Paris.
- Gross, G. (1988) : « Degré de figement des noms composés », Langages 90, pp. 57-72.
- Gross, G. (1996) : Les expressions figées en français, Paris, Ophrys.
- Grossman, F. et A. Tutin (dir.) (2002) : « Lexique : recherches actuelles », Revue française de linguistique appliquée 7-1, Amsterdam-Paris, De Werelt-Université Paris VII.
- Kleiber, G. (1984) : « Dénomination et relations dénominatives », Langages 76, pp. 77-94.
- Mathieu-Colas, M. (1996) : « Typologie de la composition nominale », Cahiers de lexicologie 69, pp. 65-118.
- Mejri, S. (1997) : Le figement lexical, Tunis, Publications de la Faculté des Lettres de la Manouba.
- Mejri, S., Gross, G., Clas, A. et T. Baccouche (dir.) (1998) : Le figement lexical, Actes des Premières Rencontres Linguistiques Méditerranéennes, Tunis, CERES.
- Mejri, S. (2000) : « Figement et dénomination », Meta 45-4, pp. 609-621.
- Mejri, S., Baccouche, T., Clas, A. et G. Gross (dir.) (2000a) : La traduction, théories et pratiques, actes du colloque international Traduction humaine, traduction automatique, interprétation (Tunis 28, 29, 30 septembre 2000), Tunis, Publications de l’ENS.
- Mejri, S., Baccouche, T., Clas, A. et G. Gross (dir.) (2000b) : La traduction : diversité linguistique et pratiques courantes, actes du colloque international Traduction humaine, traduction automatique, interprétation, (Tunis 28, 29, 30 septembre 2000), Tunis, Cahiers du C.E.R.E.S., Série Linguistique 11.
- Mejri, S., Baccouche, T., Clas, A. et G. Gross (dir.) (2003) : Traduire la langue, Traduire la culture, Tunis-Paris, Maisonneuve et Larose, Sud éditions.
- Mejri, S. (dir.) (2004) : L’espace euro-méditerranéen : Une idiomaticité partagée, Actes du colloque international (Hammamet 19, 20, 21 septembre 2003), Tome 2, Tunis, Cahiers du C.E.R.E.S., Série Linguistique 12.
- Petit, G. (1998) : « Remarques sur la structuration sémiotique des locutions familières », in Mejri, S., Gross, G., Clas, A. et T. Baccouche (dir.), Le figement lexical, Actes des Premières Rencontres Linguistiques Méditerranéennes, Tunis, CERES.
- Petit, G. (2003) : « Lemmatisation et figement lexical : les locutions de type SV », Cahiers de lexicologie 82, pp. 127-158.
- Petit, G. (2004) : « L’idiomaticité de l’autre : propositions pour un dictionnaire bilingue d’apprentissage français-grec », in Mejri, S. (dir.), L’espace euro-méditerranéen : Une idiomaticité partagée, Actes du colloque international (Hammamet 19, 20, 21 septembre 2003), Tome 2, Tunis, Cahiers du C.E.R.E.S., Série Linguistique 12.
- Rey, A. (1970) : La lexicologie, Paris, Klincksieck.
- Rey, A. (1976) : Théories du signe et du sens, Paris, Klincksieck.
- Szende, T. (dir.) (2003) : Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues, Paris, Honoré Champion.
- Temple, M. (1996) : Pour une sémantique des mots construits, Lille, Presses universitaires du Septentrion.
- Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Institut d’études néohelléniques, Université Aristote de Thessalonique, 1998.
- [K] Lust, C. et D. Pandelodimos (1996) : Γαλλοελληνικό λεξικό Dictionnaire français grec moderne, Athènes, Librairie Kauffmann.
- [R] Rosgovas, T. (1985) (pour la première édition) : Νέο γαλλοελληνικό λεξικό µε φωνητική, Athènes, Rosgovas.

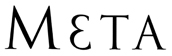
 10.7202/003611ar
10.7202/003611ar