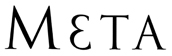L’ouvrage décrit ici s’inscrit dans la collection Benjamins’s Translation Library consacrée à la traduction sous toutes ses formes. Son éditeur, Harold Somers, du University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), est bien connu pour sa vaste expérience de recherche et d’enseignement dans le domaine de la traduction automatique. Pour la réalisation de ce collectif, il s’est entouré de spécialistes du milieu de la recherche et de l’enseignement ainsi que du secteur privé. L’ouvrage est avant tout destiné aux traducteurs, mais tous les langagiers le consulteront avec intérêt. L’objectif de Somers est de clarifier, d’expliquer et d’exemplifier l’influence des ordinateurs sur le travail des langagiers. L’auteur désire aussi permettre aux lecteurs de cerner non seulement ce que la technologie peut apporter comme solutions aux problèmes du traducteur, mais aussi ce qu’elle ne peut pas faire. L’ouvrage aborde autant la traduction automatique (TA) que la traduction assistée par ordinateur (TAO). Le premier chapitre, rédigé par l’éditeur (Harold Somers) fait acte d’introduction. On y trouve un bref historique de la traduction automatique depuis les idées à la base des premières recherches, en passant par la conception des premiers systèmes, jusqu’aux pistes exploitées dans les plus récentes recherches. Somers consacre le chapitre 2 au « poste du traducteur ». La première partie de ce chapitre porte sur l’origine de ce concept et sur les divers outils pouvant s’intégrer au poste. Parmi ceux-ci, on compte l’inévitable traitement de texte (compteur de mots, correcteur orthographique, dictionnaire des synonymes), les technologies en concurrence avec le dictaphone, les outils d’éditique ainsi que les langages de balisage et de structuration des documents électroniques (HTML, SGML). Le lecteur peut ensuite consulter une courte section consacrée aux dictionnaires électroniques et aux banques de terminologie suivie d’une présentation des fonctionnalités les plus courantes des systèmes de TA et de TAO commerciaux. L’utilité des corpus unilingues et bilingues pour le travail du traducteur est aussi soulignée. Issues d’une idée lancée au début des années 1970, les mémoires de traduction constituent fort probablement la technologie d’automatisation de la traduction la plus répandue auprès des traducteurs. Dans le chapitre 3, Harold Somers présente les méthodes d’élaboration des mémoires de traduction, les techniques d’appariements utilisées par les logiciels et les critères d’évaluation de ces logiciels. Le chapitre se termine par une mise en opposition des mémoires de traduction à la traduction automatique fondée sur l’exemple afin de permettre aux lecteurs de bien distinguer les deux concepts. Dans le quatrième chapitre, Lynne Bowker (Université d’Ottawa) s’intéresse à un autre type de logiciel que l’on retrouve de plus en plus fréquemment dans la boîte à outils du traducteur : les systèmes de gestion de la terminologie. Après un bref historique des banques de terminologie et un aperçu des éléments qui composent une fiche terminologique traditionnelle, l’auteure passe en revue les particularités et les avantages des systèmes de gestion terminologique. Une présentation des techniques d’extraction automatique de termes clôt ce chapitre. Le chapitre 5 est consacré au domaine en forte croissance qu’est la localisation. Bert Esselink (Lionbridge – Amsterdam) brosse un tableau très complet de cette sphère d’activités en opposant la localisation à la traduction. Il passe en revue les particularités d’un projet de localisation, la chaîne de travail propre au domaine et les divers intervenants d’un tel projet. Il présente aussi un survol de la technologie mise à contribution et termine sur une présentation de l’industrie de la localisation. Harold Somers aborde, dans le chapitre 6, le sujet du traitement informatique des « langues minoritaires ». Tel que mentionné par l’auteur, ce concept est quelque peu subjectif puisque ces langues, d’un point de vue démographique, sont …
Somers, H. (ed.) (2003) : Computers and Translation : A Translator’s Guide, Amsterdam/Philadelpia, John Benjamins Publishing Company, xv + 351 p.[Notice]
…plus d’informations
Patrick Drouin
Université de Montréal, Montréal, Canada