Résumés
Résumé
Cet article se penche sur la biographie dramatisée de l’écrivain Marivaux composée par Fulgence Charpentier et présentée sur les ondes de Radio-Collège en 1947. L’enregistrement est aujourd’hui perdu, mais le tapuscrit a été conservé dans un fonds d’archives au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes (Université d’Ottawa). Nous montrons que le traitement que réserve Charpentier à la vie de l’auteur français relève de divers processus d’appropriation, à la fois de l’oeuvre marivaudienne et de sa critique. Après avoir reconstitué le corpus qui a pu servir à nourrir cette lecture critique, nous analysons comment Charpentier se l’approprie pour créer un discours biographique cohérent. Or, puisque Marivaux est un dramaturge, la théâtralisation de sa biographie constitue également une forme particulière d’appropriation, dans la mesure où le brouillage de la frontière entre la fiction et le biographique passe, entre autres, par la réécriture et l’adaptation pour la radiodiffusion d’une comédie du xviiie siècle.
Mots-clés :
- Marivaux,
- Fulgence Charpentier,
- biographie,
- radiothéâtre,
- Radio-Collège
Abstract
This article focuses on Fulgence Charpentier’s dramatized biography of the writer Marivaux, which was broadcast in 1947 on Radio-Collège. The recording is now lost, but the transcript has been preserved at the Centre de recherche sur les francophonies canadiennes (University of Ottawa). We argue that Charpentier’s treatment of the French writer’s life is the result of various processes of appropriation, both of Marivaux’s works and of its criticism. After reconstructing the corpus that Charpentier may have used as material, we analyze how he appropriates it to create a coherent biographical discourse. Because Marivaux is a playwright, the dramatization of his biography also offers a particular form of appropriation, since the blurring of the boundary between fiction and biography involves, among other things, the rewriting and adaptation for the radio of an 18th-century comedy.
Keywords:
- Marivaux,
- Fulgence Charpentier,
- biography,
- radio theater,
- Radio-Collège
Corps de l’article
Lorsque Radio-Canada lance la série d’émissions à visée pédagogique Radio-Collège en 1941, une place non négligeable est d’emblée réservée aux arts dramatiques[2]. Si les émissions consacrées à la littérature française – il faudra attendre quelques années avant que le corpus québécois s’impose – sont divisées en segments portant respectivement sur les « poètes français du xixe et xxe siècles » et le « théâtre classique, romantique et contemporain »[3], il faut souligner que des sketchs servent également à illustrer les sujets abordés par le biais des autres disciplines et que les segments en question ont souvent la même durée que le cours qu’ils enrichissent. Selon les saisons, l’histoire et les sciences naturelles auront donc elles aussi droit à des illustrations plus ou moins développées sous la forme de radiothéâtre[4].
Parmi ces émissions, une série se distingue en raison du format inhabituel qu’elle présente : les biographies dramatisées. Sous l’intitulé « De la Renaissance à la Résistance », des sketchs d’une durée de 30 minutes avaient pour but de « faire revivre les romanciers, les poètes, les dramaturges, les penseurs de la France[5] » et étaient présentés de manière autonome lors des saisons 1945-1946 et 1946-1947, avant d’être intégrés à une émission uniquement littéraire jumelant la biographie à une discussion sur l’oeuvre de l’auteur abordé pour les saisons 1947-1948 et 1948-1949, puis de disparaître de la programmation. Au total, 67 biographies ont été jouées par des actrices et acteurs de Radio-Canada et elles ont toutes été rédigées par la même personne, le journaliste Fulgence Charpentier[6]. Les tapuscrits se trouvent aujourd’hui dans un fonds d’archives au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes[7].
Dans la présente étude, nous souhaitons nous pencher plus particulièrement sur un cas précis, celui de l’auteur français Marivaux. Le traitement que lui réserve Charpentier relève en effet de divers processus d’appropriation, à la fois de l’oeuvre marivaudienne et de sa critique[8]. Cette biographie dramatisée permet, dans un premier temps, « de voir de quelle façon certains textes […] à teneur biographique intègrent la critique de l’oeuvre au récit de vie[9] ». Dans le cas qui nous occupe, cela nécessite de reconstituer le corpus qui a pu servir à nourrir cette lecture critique, avant d’analyser comment Charpentier se l’approprie pour créer un discours biographique cohérent. Enfin, puisque Marivaux est un dramaturge, la théâtralisation de sa biographie constitue également une forme particulière d’appropriation, dans la mesure où le brouillage de la frontière entre la fiction et le biographique passe par la réécriture et l’adaptation pour la radiodiffusion d’une comédie du xviiie siècle.
Biographie critique, biographie de critiques
La biographie dramatisée de Marivaux est présentée le 16 novembre 1947, juste avant un forum sur son oeuvre animé par Raymond Tanghe, segment qui n’était apparemment pas scripté et qui est aujourd’hui perdu, et quelques semaines avant une mise en scène radiophonique du Jeu de l’amour et du hasard commentée par Jean-Luc Bonenfant qui fut diffusée en trois volets les 2, 9 et 16 décembre de la même année[10]. Le document de 13 pages dactylographiées qui se trouve dans le fonds Charpentier contient l’entièreté de la biographie dramatisée ainsi que l’introduction et la conclusion servant d’enchaînements et destinés à l’annonceur. Le thème choisi pour cette séance, c’est-à-dire à la fois pour la biographie elle-même et pour la discussion qui la suit, est l’« Importance du rôle des femmes », lieu commun de la réception de Marivaux à l’époque et, comme nous le verrons plus loin, une influence directe du critique français Émile Faguet qui relève de l’appropriation d’un discours critique.
La biographie est divisée en huit parties, dont six sont des épisodes dramatisés de la vie que Fulgence Charpentier crée pour Marivaux, encadrés en amont et en aval par les interventions d’un narrateur. Dans chacun des épisodes, Marivaux discute avec un autre personnage, et une seule fois avec deux : Lamotte (Antoine Houdar de La Motte), Sylvia (Silvia Baletti), Mme de Tencin (Claudine-Alexandrine Guérin, marquise de Tencin), Fontenelle (Bernard de Fontenelle) et Mlle de Saint-Jean (Angélique Gabrielle Anquetin de la Chapelle Saint-Jean)[11]. L’« influence des femmes » se mesure aisément dans la composition du personnel dramatique, d’autant plus que Mme de Tencin apparaît à deux reprises[12]. Ces personnages permettent à Charpentier d’inclure dans ces six segments la plupart des biographèmes qui émaillent les biographies de Marivaux depuis le xviiie siècle[13] : un amour de jeunesse déçu qui serait à la source de son inspiration; la première rencontre avec Silvia, la comédienne qui allait devenir sa muse; la rivalité entre la Comédie-Française et la Comédie-Italienne, vue au prisme des succès et des échecs des pièces de Marivaux; sa relation houleuse avec Voltaire; sa nomination tout aussi houleuse à l’Académie française; ses années de vieillesse[14].
Bien qu’il repose sur des topoï, ce parcours biographique soulève tout de même une question fondamentale : quelles sont les sources qu’utilise Charpentier pour composer sa biographie? Si l’on considère cette biographie comme un hypertexte (ce qu’elle est en grande partie, comme nous le verrons), on constate que Charpentier a très bien pu travailler à partir d’un corpus assez restreint de trois ou quatre ouvrages qui circulaient vers le milieu du xxe siècle et qui, sans faire autorité au sens scientifique et institutionnel du terme, constituaient des références incontournables pour un journaliste qui avait déjà composé la majorité de ses biographies : soulignons que s’il les a rédigées dans l’ordre, la vie de Marivaux serait environ la cinquantième biographie dramatisée qu’il écrit.
Malheureusement, la copie qui se trouve dans le fonds Charpentier est la version finale. Or, pour une partie de la première saison, soit pour les cinq premières biographies, l’auteur a plutôt conservé la « copie corrigée[15] » qui contient deux sections qui n’apparaîtront plus par la suite, à savoir la liste des personnages, avec des blancs à remplir pour nommer les interprètes[16], et la liste des ouvrages consultés. Prenons pour exemple le texte consacré à La Fontaine à la fin duquel Charpentier précise : « Les auteurs consultés sont “La Fontaine” par Georges Lafenestre, “La Fontaine” par Auguste Bailly, et “Les Cinq tentations de La Fontaine” par Giraudoux[17]. » Si on peut sourire aujourd’hui de la présence des Cinq tentations de La Fontaine – quoique, si l’on souhaite dramatiser une biographie, une partie du travail est déjà effectuée! –, Charpentier cite néanmoins des sources très sérieuses et crédibles au moment de la rédaction. Il emploie en outre à chaque fois plusieurs sources : dans chacune de ces cinq premières biographies, la liste des ouvrages consultés contient exactement trois titres. On ne peut reprocher à Charpentier, qui devait rendre l’équivalent d’une biographie par semaine pendant six mois, de ne pas se livrer à un véritable travail de recherche.
Nous ne possédons donc pas la liste de trois titres qui auraient servi à élaborer la biographie dramatisée de Marivaux, et ce, à supposer que Charpentier travaillait encore de la même manière lors de cette troisième saison. Cependant, trois sources nous paraissent avoir été particulièrement utiles et permettent au demeurant de réduire le nombre d’ouvrages de référence parce qu’elles intègrent de nombreux autres textes. Deux des auteurs sont d’ailleurs nommés directement dans le corps de la biographie.
Nous aborderons très rapidement la première de ces sources puisque c’est celle que Charpentier mobilise le moins. Il s’agit de l’Histoire générale illustrée du théâtre de Lucien Dubech :
Grimm écrivit à cette occasion [la mort de Marivaux] : « Le souffle vigoureux de la philosophie a renversé depuis une dixaine [sic] d’années toutes ces réputations étayées sur des roseaux. » Comme le remarque Lucien Dubech, il serait opportun de rappeler à cet adversaire de Marivaux que La Fontaine a écrit une fable là-dessus où le roseau a cependant eu raison[18].
L’ouvrage de Dubech permet à Charpentier d’avoir accès à la fois à un célèbre commentaire de Grimm et à une réponse spirituelle qui fait intervenir un auteur classique bien connu du public[19]. De la même manière, Charpentier puise chez ce critique la rencontre de Silvia et Marivaux telle qu’elle est racontée par Courville[20].
La première intervention du narrateur, qui dépeint Marivaux en précurseur de Musset, pourrait également faire penser au même Dubech[21]. Ce parallèle est plutôt fort probablement tiré de la deuxième source que Charpentier cite dans sa biographie, un incontournable à l’époque : Émile Faguet. Charpentier a certes pu avoir recours à son édition du théâtre de Marivaux[22], qui s’ouvrait par une substantielle introduction, mais c’est vraisemblablement le volume Dix-huitième siècle de la série « Études littéraires » qui est au coeur de cette biographie[23]. C’est ainsi par une citation donnée pour telle que se termine le sketch : « Faguet dit de lui : “Il n’est pas grand, il est considérable”[24]. » Or, la présence de Faguet dépasse le cadre de la simple citation et témoigne d’une réelle appropriation du discours du critique français qui informe l’ensemble de la biographie. D’abord, tout au long de cette dernière, on trouve des références critiques qui ont été empruntées à Faguet plutôt que directement à la source. Lorsque Mme de Tencin fait réaliser à Marivaux qu’il pratique un genre de comédie bien à lui et que sa particularité est de peindre « l’aube de l’amour », on entend René Lavollée et son Marivaux inconnu[25], mais il se trouve que Faguet reprend l’expression sans mentionner son auteur[26]. Ensuite, un même constat se dégage de la préférence que Marivaux aurait eue pour Racine au détriment de Molière, et qui expliquerait pourquoi son théâtre diffère tant de celui de son prédécesseur; on trouve des remarques qui vont en ce sens chez plusieurs critiques, mais Faguet y revient à au moins deux reprises dans son ouvrage, en plus d’en faire le point de départ de son introduction au Théâtre de Marivaux.
Néanmoins, l’influence la plus remarquable, un lecteur familier de Faguet la discerne dès le titre de la séance consacrée à Marivaux que nous avons cité plus haut : l’« Importance du rôle des femmes ». En effet, le thème retenu est celui-là même avec lequel Faguet ouvre sa réflexion :
Ce sera un divertissement de la critique érudite dans quatre ou cinq siècles : on se demandera si Marivaux n’était point une femme d’esprit du xviiie siècle, et si les renseignements biographiques, peu nombreux dès à présent, font alors totalement défaut, il est à croire qu’on mettra son nom, avec honneur, dans la liste des femmes célèbres. Si on se bornait à le lire, on n’aurait aucun doute à cet égard. Il n’y eut jamais d’esprit plus féminin, et par ses défauts et par ses dons. Il est femme, de coeur, d’intelligence, de manière et de style. Il l’était, dit-on, de caractère, par sa sensibilité, sa susceptibilité très vive, une certaine timidité, l’absence d’énergie et de persévérance, une grande bonté et une grande douceur dans une sorte de nonchalance, et après des caprices d’ambition, des retours vers l’ombre et le repos. Ses sentiments religieux, des mouvements de tendresse pour ceux qui souffrent, son goût pour les salons et les relations mondaines, complètent, si l’on veut, l’analogie. Mais c’est par sa tournure d’esprit qu’il semble, surtout, appartenir à ce sexe, qu’il a, souvent, peint avec tant de bonheur. Son nom est fragilité, et coquetterie, et grâce une peu maniérée[27].
Sensibilité, absence d’énergie et de persévérance, douceur de caractère : ces termes qui émaillent les premières lignes de la section consacrée à Marivaux sont également ceux qui semblent avoir servi à construire le personnage éponyme de la biographie composée par Charpentier. Par exemple, la récurrence du personnage de Mme de Tencin trahit cette perspective adoptée par Charpentier et témoigne du rôle que jouent les Salons dans le portrait de l’auteur, notamment parce que c’est elle qui pousse le dramaturge à briguer une place à l’Académie française. Plus significatif encore, voici comment se résout l’épisode :
La campagne fut si activement menée que Marivaux fut choisi à l’unanimité. Voltaire eut beau se remuer comme un diable dans l’eau bénite, il échou[a]. Marivaux, avec sa candeur habituelle, fut très content. À son discours de réception, il y avait d’un côté Mme de Tencin, du Deffand, Geoffrin, du Bocage, et dans la loge réservée aux amis du récipiendaire : Mlle [sic] Sylvia et Flaminia, ses interprètes préférées des Italiens, Mlles Quinault et Dangeville, ses actrices habituelles de la Comédie Française[28].
Passons sur l’écart qui sépare les « préférées » de la Comédie-Italienne des « habituelles » de la Comédie-Française et qui reproduit un autre lieu commun de la réception de Marivaux. Ce qui nous importe davantage, c’est, d’une part, la passivité du dramaturge que la première phrase souligne et, d’autre part, la féminisation de l’espace traditionnellement masculin qu’est l’Académie française. L’entourage de Marivaux est exclusivement composé de femmes ici, alors que Lamotte et Fontenelle, deux académiciens, sont pourtant des personnages actifs de la biographie; lors de cette réception fantasmée de Marivaux, les 39 autres immortels brillent par leur absence, donnant l’impression que la future proposition de 1760 de d’Alembert pour admettre des femmes aurait réussi… Charpentier va plus loin que la simple reprise de citations ou d’informations : il s’approprie le discours critique de Faguet et en souligne à grands traits le principe directeur par le biais d’une mise en scène fictive. En fait, il aurait été difficile de suivre les Études littéraires de plus près, dans la mesure où Charpentier place son personnage au milieu d’une « liste des femmes célèbres », qui contient salonnières et actrices, lors de son ultime triomphe.
La troisième source critique que nous avons pu identifier avec certitude est le Marivaux de Gaston Deschamps paru dans la collection « Les grands écrivains français » chez Hachette à la fin du xixe siècle. Toutefois, avant d’aborder plus précisément les éléments fictionnels que Charpentier élabore à partir de cet ouvrage, il est nécessaire de nous pencher sur les procédés dramatiques qu’il emploie et leur influence directe sur le processus d’appropriation.
Procédés de théâtralisation, procédés d’appropriation
Si les sources sont importantes pour comprendre le contenu et la structure de la biographie dramatisée, les transformations que Charpentier leur fait subir afin d’en tirer une pièce de théâtre radiophonique sont tout aussi essentielles[29]. Soulignons en premier lieu que ces biographies sont des sketchs interprétés par de vrais acteurs et que Charpentier utilise plusieurs des ressources et procédés caractéristiques de l’écriture et du genre théâtraux[30]. Le résultat, en raison de la présence du narrateur et des ellipses, tient en partie de ce qu’on appellera quelques années plus tard les « dramatiques radiophoniques[31] ». Le texte contient par conséquent plusieurs didascalies, dont le contenu va du ton à adopter pour certaines répliques à l’univers sonore qui doit être élaboré par les techniciens. L’attention que Charpentier porte à cette dimension se vérifie lors de la première section, à savoir la conversation avec Lamotte. Les personnages discutent à l’extérieur, dans les champs, et le texte précise à deux endroits : « Bruit : des oiseaux qui chantent » puis « Bruit : […] on entend de nouveau les oiseaux chanter[32] ». L’auteur cerne donc les moments précis où tel ou tel bruit doit être ajouté. Il semble à d’autres endroits avoir des réflexes d’auteur dramatique traditionnel et oublier que sa pièce doit être jouée à la radio et non devant un public. Pendant sa discussion avec Marivaux, l’actrice Sylvia prononce une réplique « en riant », ce qui peut certes s’entendre par le biais d’un poste de radio, mais quelques lignes plus loin on lit la mention « Sylvia sourit[33] ». À moins d’imaginer que Sylvia rit de nouveau à voix haute, ce genre de didascalies ne possède aucune utilité, voire aucun destinataire réel… sauf pour nous, lecteurs d’un texte qui n’était pas destiné à la publication.
Bien que l’enregistrement sonore de la biographie de Marivaux soit perdu, les archives de Radio‑Canada contiennent en revanche certaines biographies sur vinyles qui nous permettent de prendre connaissance du résultat que Charpentier avait en tête en rédigeant son sketch sur Marivaux. On peut par exemple consulter en ligne la biographie de Racine dans laquelle, pendant le deuxième segment dramatique, les personnages discutent, attablés au cabaret La Croix‑de‑Lorraine[34]. L’enregistrement nous fait entendre les discussions, verres et tasses qui tintent, toussotements, etc., qui servent à rendre la mention « Bruit : conversations, brouhaha…[35] » du tapuscrit. Autrement dit, les applaudissements qui marquent la fin du discours de réception de Marivaux à l’Académie française devaient créer un contraste sonore évident pour le public entre ce moment de triomphe et la phrase qui suivait, prononcée par le narrateur : « C’est une consolation tardive, car la vieillesse commençait à s’appesantir sur lui[36]. »
Néanmoins, deux épisodes nous paraissent plus particulièrement intéressants en ce qui a trait aux liens entre théâtralisation et appropriation. Le premier est la réécriture d’un passage du Marivaux de Gaston Deschamps, que nous avons laissé de côté plus haut, et qui concerne la vieillesse de Marivaux. Voici ce qu’on trouve chez le premier biographe :
C’était une vieille fille. Mais quoi! les personnes de cet état ont souvent un charme délicat, je ne sais quel attrait qui vient de leur destinée brisée et de leur rêve inachevé. Quand elles ne tournent pas à la révolte acariâtre, elles sont admirables par leur idéalisme obstiné. Ce sont alors des soeurs délicieuses, des tantes exquises, des amies souhaitables.
[…]
Il la demanda peut-être en mariage. Il était assez honnête pour cela. Elle sentit tout le parti que la moquerie publique pourrait tirer de cette aventure. L’opinion est inclémente aux unions trop tardives. Elle n’aime pas les noces de vieillards. À quoi bon, pensa Mlle de Saint-Jean, à quoi bon se donner en spectacle aux railleries du monde? Nous deux, déjà branlants et chenus, marcher à l’autel comme de jeunes fiancés? Eh, mon Dieu! quelle comédie funèbre! Non, à notre âge, il n’est plus temps de jouer les Dorantes et les Sylvies[37].
Et voici ce qu’en fait Charpentier :
MARI : C’est un bien vilain marché que vous me proposez de conclure, Angélique, pour vous s’entend, et qui fera jaser bien des gens. Si vous y consentiez, nous nous épouserions.
ANGELI : Nous ne sommes plus ni l’un ni l’autre à l’âge du mariage. Et pensez-vous que cela les ferait taire? Mais non, mon cher ami. Vous savez tout le parti que la malignité publique tirerait de cette aventure. L’opinion est inclémente aux noces trop tardives.
MARI : Ce serait, en effet, une comédie funèbre.
ANGELI : Vous entendez, n’est-ce pas, les railleries qui salueraient des noces de vieillards? Marcher à l’autel comme deux jeunes fiancés, fi donc!
MARI : J’oubliais qu’il n’est plus temps de jouer les Dorantes ou les Sylvies.
[…]
Je m’appuierai sur votre bras et je vous dirai que vous êtes admirable dans votre idéalisme obstiné[38].
Une partie de la réécriture va de soi. Le style indirect introduit par « pensa Mlle de Saint-Jean » chez Deschamps permet à Charpentier de transposer très simplement et sans trop de modifications les pensées de la biographie narrative dans un échange dialogué de la biographie dramatisée. Notons toutefois que lors de la transposition, les expressions les plus frappantes passent de la tête de Mlle de Saint-Jean à la bouche de Marivaux : c’est le cas de « comédie funèbre » et de « il n’est plus temps de jouer les Dorantes et les Sylvies ». L’appropriation est en outre considérable, puisque tout ce passage s’ouvre chez Deschamps sur une hypothétique demande en mariage qui amène habilement le discours biographique à construire la réaction silencieuse et tout aussi hypothétique de Mlle de Saint-Jean, alors que Charpentier, en théâtralisant les mêmes éléments par le biais d’un dialogue, actualise la demande et donne à son personnage de Marivaux un rôle plus actif. On peut également en saisir l’ampleur dans le commentaire misogyne de Deschamps à propos des vieilles filles : l’opposition caricaturale « quand elles ne tournent pas à la révolte acariâtre, elles sont admirables par leur idéalisme obstiné » disparaît peut-être chez Charpentier, mais c’est tout de même son Marivaux qui prend en charge l’énoncé « je vous dirai que vous êtes admirable dans votre idéalisme obstiné ». Aussi n’est-ce plus seulement la fiction biographique qui passe d’un auteur à un autre, voire d’un public à un autre, mais encore le jugement de valeur.
Le second épisode de transposition est encore plus significatif, si l’on tient compte du fait que Marivaux est principalement présenté par Charpentier comme un dramaturge, et que le reste de son oeuvre est à peine évoqué. Il s’agit de la première scène dialoguée, dans laquelle un Marivaux mélancolique conte à Lamotte une aventure de jeunesse qui serait à l’origine de son inspiration. Pour créer sa scène, Charpentier réécrit et lie ensemble deux oeuvres de Marivaux. Il ne va pas aussi loin que de faire évoluer le dramaturge dans son propre univers imaginaire et dialoguer avec ses personnages, mais dans une tradition biographique qui remonte à l’Antiquité[39], il inclut dans le récit biographique certains éléments inspirés de l’oeuvre de l’auteur. Voici le début de la scène en question :
LAMOTTE : Le temps est sombre aujourd’hui, n’est-ce pas?
MARIVAUX : Il est aussi mélancolique que nous.
LAMO : Tu as quelque chose qui te chagrine?
MARI : Non.
LAMO : Alors tu n’as pas de tristesse?
MARI : Si fait[40].
Un lecteur de Marivaux aura reconnu sans trop de peine le début de La surprise de l’amour, plus précisément la deuxième scène du premier acte que Charpentier réécrit sur plus d’une page et demie :
LÉLIO. Le temps est sombre aujourd’hui.
ARLEQUIN. Ma foi oui, il est aussi mélancolique que nous.
LÉLIO. Oh, on n’est pas toujours dans la même disposition, l’esprit aussi bien que le temps est sujet à des nuages.
ARLEQUIN. Pour moi, quand mon esprit va bien, je ne m’embarrasse guère du brouillard.
LÉLIO. Tout le monde en est assez de même.
ARLEQUIN. Mais je trouve toujours le temps vilain, quand je suis triste.
LÉLIO. C’est que tu as quelque chose qui te chagrine.
ARLEQUIN. Non.
LÉLIO. Tu n’as donc point de tristesse.
ARLEQUIN. Si fait[41].
En réalité, il n’est nul besoin de reconnaître la pièce, car certaines expressions – aujourd’hui, tout comme dans le contexte culturel du Québec du milieu du xxe siècle – trahissent leur origine, telles que « si fait » ou « pardi ». Charpentier en retire pourtant d’autres, peut-être trop flagrantes encore : « eh mon cher enfant » devient « eh mon ami », ce qui s’explique par la relation sociale hiérarchique entre le valet et son maître qui n’a plus raison d’être dans la transposition biographique. Charpentier supprime quelques passages pour abréger la scène, revoit certaines transitions, et plus loin il inverse même l’ordre des répliques, notamment pour placer quelques réflexions de Lélio/Lamotte dans la bouche d’Arlequin/Marivaux. On constate que l’appropriation de l’oeuvre au service de la biographie d’écrivain forge une clé de lecture parfaitement tautologique pour le jeune public qui n’était pas familier avec le corpus marivaudien et qui allait par la suite écouter une discussion portant justement sur l’interprétation des pièces de théâtre : les comédies de Marivaux sont analysées au prisme d’éléments biographiques façonnés à même les pièces en question.
Au reste, Charpentier pousse ce procédé plus loin encore. Plutôt que de terminer sa scène par le renoncement aux femmes exprimé par Arlequin dans La surprise de l’amour, accompagné d’un lazzi qui souligne le goût du personnage pour les plaisirs de la bouteille et qui cadrait difficilement avec le discours biographique, il se tourne vers un autre texte de Marivaux :
LAMO : Que tu étais simple à ce moment-là!
MARI : Quel plaisir, me disais-je en moi-même, si je pouvais me faire aimer d’une fille qui est belle sans y prendre garde. Un jour que je venais de la quitter un gant que j’avais oublié me fit retourner sur mes pas. J’aperçus la belle de loin qui se regardait dans son miroir. Elle étudiait ses jeux de physionomie, et ces airs que j’avais crus naïfs n’étaient, à les bien nommer, que des tours de gibecière. […] mon amour cessa tout d’un coup […].
Cette fois, Charpentier reprend le long passage qui clôt la première feuille du Spectateur français[42]. Afin de poursuivre le dialogue entre Lamotte et Marivaux, il réécrit quelques transitions et abrège le passage pour le rendre plus théâtral. Le « Que j’étois simple dans ce temps-là[43] » passe à la deuxième personne grammaticale dans la bouche de Lamotte et crée une réplique qui fractionne ce qui aurait pris les allures d’une tirade beaucoup trop longue. La jeune demoiselle du Spectateur français devient la Margot d’Arlequin/Marivaux, ce qui permet à Charpentier de construire encore une fois un discours biographique à partir de deux topoï bien connus : l’amour de jeunesse et les illusions perdues, qui deviendront selon lui le moteur des comédies de Marivaux. Le texte source invitait certes à une telle lecture : « c’est de cette avanture que naquit en moi cette misantropie qui ne m’a point quittée [sic][44]. » Charpentier reformule cette affirmation à quelques mots près, la place dans un nouveau contexte d’énonciation fictif, avant de faire dire à son narrateur un peu plus loin : « Cette scène, il devait souvent la faire jouer dans ses pièces[45]. » De nouveau, biographie et critique vont de pair, ainsi que l’illustre l’emploi polysémique du terme « scène » qui glisse insensiblement du sens figuré au sens technique.
***
Ce passage composé d’un montage d’extraits de La surprise de l’amour et du Spectateur français constitue le premier segment dialogué de la biographie dramatisée que Charpentier propose en 1947. L’événement fondateur de la carrière d’écrivain de Marivaux dans cette vie fictive est ainsi doublement tiré des oeuvres composées par l’auteur français. Si on prend en considération le fait qu’il emprunte et réécrit par la suite des passages entiers de plusieurs critiques qui, dans certains cas, s’inspiraient eux-mêmes d’éléments biographiques pour commenter les textes de Marivaux, il appert que Charpentier a ainsi créé une sorte de boucle herméneutique préparant son public de collégiens québécois à lire et comprendre le corpus marivaudien de manière fort tautologique. Dans cette lecture appropriante, « la référence au réel s’effrite et s’effondre sous le poids des significations[46] ». Certes, il s’agit de l’un des reproches adressés à la biographie d’écrivain, et de l’un des écueils à éviter sur le plan historiographique[47]; il serait injuste de reprocher à ces sketchs d’appartenir à leur époque. En effet, Charpentier a créé des pièces à la frontière de la fiction et de la biographie proprement dite, rédigées et jouées pendant l’âge d’or du théâtre radiophonique, en s’appropriant à la fois oeuvres et critiques. Il a ainsi proposé des oeuvres qui s’inscrivaient dans le corpus des genres dramatiques de la radio québécoise tout en bouleversant leurs frontières[48].
Parties annexes
Note biographique
Nicholas Dion est professeur à l’Université de Sherbrooke. Outre la version remaniée de sa thèse, Entre les larmes et l’effroi. La tragédie classique française, 1677-1726 (Paris, Classiques Garnier, 2012; Prix jeune chercheur 2013 de l’Académie Montesquieu), il a publié des articles sur le théâtre et sur l’élégie aux xviie et xviiie siècles (dans Littératures classiques, xviie siècle, Revue d’histoire littéraire de la France, Études littéraires, Le Fablier, etc.), et il a dirigé et codirigé plus d’une dizaine de collectifs sur la littérature de la première modernité, dont Histoire de l’édition. Enjeux et usages des partages disciplinaires (xvie-xviiie siècle), Paris, Classiques Garnier, 2023 (avec Sophie Abdela et Maxime Cartron), et « Voltaire et les Lumières au Québec : perspectives historiques et lectures actuelles », Revue Voltaire, no 24, à paraître (avec Pierre Hébert). Il a participé à l’édition de Tarquinio Galluzzi, De elegia commentarius/Commentaire sur l’élégie (Paris, Les Belles Lettres, coll. « Classiques de l’humanisme », 2023), et il prépare avec Patrick Snyder une édition critique du Traité sur les apparitions et sur les vampires d’Augustin Calmet.
Notes
-
[1]
Une version préliminaire de cette recherche a été présentée lors du « Séminaire Marivaux 2023-2024 », le 15 mai 2024.
-
[2]
Sur Radio-Collège, les deux études incontournables sont Pierre Pagé, Radiodiffusion et culture savante au Québec. 1930-1960, Montréal, Maxime, 1993, et Kim Petit, « Le projet pédagogique de Radio-Collège dans la décennie 1940. La conservation des institutions scolaires traditionnelles et la promotion des sciences », mémoire de maîtrise (histoire), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2008. On consultera également Pierre Pagé, Histoire de la radio au Québec : information, éducation, culture, Montréal, Fides, 2007.
-
[3]
Sur le théâtre à la radio dans les années 1940-1950 au Québec et son évolution, voir notamment Pierre Pagé, « Le théâtre de répertoire international à Radio-Collège (1941-1946) », L’annuaire théâtral, no 12, 1992, p. 53-87, et Madeleine Greffard, « Le théâtre à la radio : un facteur de légitimation et de redéfinition », L’annuaire théâtral, no 23, 1998, p. 53-73. Il s’agit d’un phénomène mondial. Dans le cadre d’un article, nous n’aurons pas le temps de replacer le travail de Charpentier dans un tel contexte; pour la perspective française, voir Marion Chénetier-Alev, « Les archives radiophoniques du théâtre. Du théâtre pour les aveugles à un théâtre de sourds? », Revue Sciences/Lettres, no 6, 2019, en ligne : « Durant cette période [années 1950], les relations entre théâtre et radio sont placées sous le signe de la diffusion des grandes oeuvres dramatiques et poétiques de la culture classique française, pour servir une visée explicitement pédagogique. Les émissions éducatives sont nombreuses et durables. Elles accordent une place majeure au théâtre. »
-
[4]
Elles font partie d’une stratégie pédagogique plus générale analysée dans Kim Petit, « Le projet pédagogique de Radio-Collège dans la décennie 1940. La conservation des institutions scolaires traditionnelles et la promotion des sciences », mémoire de maîtrise (histoire), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2008, p. 44 et suivantes.
-
[5]
Société Radio-Canada, Radio-Collège, cinquième année, s. l., s. d., p. 35.
-
[6]
Exception faite des reprises. Lors de la dernière série d’émissions, en 1948-1949, le programme ne propose que six textes originaux sur les vingt biographies qui sont jouées, probablement en raison du départ pour Paris de Fulgence Charpentier, qui devient conseiller aux affaires culturelles et à l’information pour l’ambassadeur du Canada en France. Selon Denyse Garneau et François-Xavier Simard, Fulgence Charpentier, 1897-2001. La mémoire du xxe siècle, Ottawa, Vermillon, 2006, p. 279, note 335, « André Chénier est le thème de sa dernière biographie dramatisée », mais il s’agit vraisemblablement d’une reprise du sketch du 6 décembre 1945. Dans tous les cas, l’absence des six biographies en question dans le fonds Fulgence Charpentier laisse supposer que quelqu’un d’autre aurait pu prendre la relève pour cette ultime saison.
-
[7]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 1 à 5.
-
[8]
Ces processus sont d’autant plus significatifs qu’ils prennent place dans le cadre d’une saison de Radio-Collège entièrement consacrée au xviiie siècle, dont la programmation met en évidence le caractère délicat que ce siècle représentait au milieu du xxe siècle. Pour preuve, Radio-Collège se montre très prudent en 1945 en évitant les auteurs trop « philosophes » : les représentants du xviiie siècle français qui sont retenus pour cette première saison sont Julie de l’Espinasse et André Chénier. En tout respect pour leurs oeuvres respectives, il ne s’agit peut-être pas des figures les plus illustres… Cette évolution mériterait d’être analysée plus en détail, car une telle étude compléterait le tableau brossé dans Marie-Thérèse Lefebvre, « Radio-Collège (1941-1956) : un incubateur de la Révolution tranquille », Les cahiers des dix, no 60, 2006, p. 233-275.
-
[9]
Robert Dion, « Fonction critique de la biographie d’écrivain (Puech, Oster) », dans Robert Dion et Frédéric Regard (dir.), Les nouvelles écritures biographiques, Lyon, ENS Éditions, 2013, en ligne. On consultera également les réflexions de Marina Girardin dans la première partie de Flaubert : critique biographique, biographie critique, Paris, Champion, 2017.
-
[10]
Nous avons pu consulter une copie numérisée des archives conservées sur disques vinyles; Archives de Radio‑Canada, Voûte, supports DIS-000983, 001083, 001126, 001484 et 001242. Il s’agit très certainement de la plus ancienne captation d’une pièce de Marivaux en sol québécois, et qui se compare aux autres mises en scène conservées sur disques consultables dans la médiathèque de la Bibliothèque nationale de France, telles que celles avec Maurice Escande, Henri Doublier, Jean-Louis Barrault, etc.
-
[11]
Dans la suite de notre article, nous conserverons l’orthographe utilisée par Charpentier afin de distinguer les personnages de la biographie des personnes historiques.
-
[12]
C’est aussi le cas de Lamotte, mais sa seconde apparition sert avant tout à introduire Marivaux auprès de Sylvia.
-
[13]
Précisons, comme le font tous les critiques et biographes de Marivaux, que nous connaissons très peu de choses de sa vie personnelle; voir Franck Salaün, Marivaux, Paris, Gallimard, coll. « Folio Biographies », 2021.
-
[14]
Cette structure résout le problème de la chronologie. Charpentier semble avoir suivi une voie que le théâtre biographique moderne emprunte encore, selon Lucie Robert : « La solution la plus efficace consiste, semble-t-il, à emprunter à l’esthétique de Brecht son découpage de l’action en “tableaux”, représentant chacun un moment singulier et significatif de la vie du personnage, au risque de perdre de vue la complexité d’une existence, notamment le lien étroit qui fait que l’oeuvre se nourrit de la vie, et vice versa » (« L’art du vivant. Réflexions sur le “théâtre biographique” », dans Robert Dion et Frédéric Regard (dir.), Les nouvelles écritures biographiques, Lyon, ENS Éditions, 2013 [en ligne]).
-
[15]
C’est la mention manuscrite qui se trouve sur la première page des cinq documents en question.
-
[16]
Nous ne savons pas pour le moment si ces listes ont été lues à l’antenne à l’époque.
-
[17]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 4, 12, « La Fontaine », fo 14. Les ouvrages cités sont Georges Lafenestre, La Fontaine, Paris, Hachette, 1895 [réédité quatre fois jusqu’en 1919]; Auguste Bailly, La Fontaine, Paris, Fayard, 1937; Jean Giraudoux, Les cinq tentations de La Fontaine, Paris, Grasset, 1938.
-
[18]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 12-13.
-
[19]
Lucien Dubech, Histoire générale illustrée du théâtre, Paris, Librairie de France, 1931-1933, t. IV, p. 91. La citation de Grimm est tirée d’une lettre datée du 15 février 1763, soit trois jours après la mort de Marivaux, publiée dans la Correspondance littéraire.
-
[20]
Lucien Dubech, Histoire générale illustrée du théâtre, Paris, Librairie de France, 1931-1933, t. IV, p. 86-88; le passage est tiré du Théâtre de Marivaux, éd. X. de Courville, Paris, À la cité des livres, 1929-1930, 5 vol., qui lui‑même reprend une anecdote célèbre tirée de l’« Éloge de Marivaux » de d’Alembert.
-
[21]
Il publie au moins deux articles, « Marivaux et Musset à la Comédie-Française », La revue universelle, 15 septembre 1926, p. 761-763 et « Nouvelles réflexions sur Marivaux et Musset », La revue universelle, 1er octobre 1926, p. 124‑127, dans lesquels il en appelle à un livre sur le rapprochement entre ces deux auteurs.
-
[22]
Marivaux, Théâtre en deux volumes. Introduction par Émile Faguet de l’Académie française, Paris, Nelson éditeurs, s. d.
-
[23]
Qui plus est, c’est également la source qui sert de soubassement à la biographie de Voltaire ainsi qu’à celles d’autres auteurs. Il semblerait que lors de cette saison portant uniquement sur le xviiie siècle, Charpentier se soit simplifié la vie en ayant recours, même si ce n’était pas de manière exclusive, à cette source qui lui fournissait des informations sur la majorité des figures qui l’intéressaient.
-
[24]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 13; voir Émile Faguet, Dix-huitième siècle. Études littéraires, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1890, p. 136 : « Tel qu’il est, il n’est pas grand, mais il est considérable. »
-
[25]
René Lavollée, Marivaux inconnu, Paris, Imprimerie de la Société anonyme de publications périodiques, 1880, p. 38; publié à l’origine dans La revue de France.
-
[26]
Émile Faguet, Dix-huitième siècle. Études littéraires, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1890, p. 125 : « On a dit qu’il n’avait jamais peint que “l’aube de l’amour”, l’amour en ses commencements incertains […]. »
-
[27]
Émile Faguet, Dix-huitième siècle. Études littéraires, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1890, p. 85-86.
-
[28]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 11.
-
[29]
Plusieurs années avant que ce courant ne prenne une véritable ampleur, les biographies dramatisées de Charpentier en laissent entrevoir les contours; voir Frances Fortier, Caroline Dupont et Robin Servant, « Quand la biographie se “dramatise”. Le biographique d’écrivain transposé en texte théâtral », Voix et images, vol. 30, no 2, 2005, p. 79‑104; Robert Dion et Frances Fortier, Écrire l’écrivain. Formes contemporaines de la vie d’auteur, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010.
-
[30]
Cela n’est guère surprenant : Charpentier avait quelques années auparavant composé et fait représenter plusieurs oeuvres théâtrales, dont les plus importantes sont certainement Les Patriotes (1938) et Le déserteur (1939). Voir Denyse Garneau et François-Xavier Simard, Fulgence Charpentier, 1897-2001. La mémoire du xxe siècle, Ottawa, Vermillon, 2006, p. 279-290.
-
[31]
Voir Jean-Noël Jeanneney (dir.), L’écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France, Paris, Hachette, 1999. Une étude générique des biographies de Charpentier, qui tiendrait compte de l’évolution de sa pratique au cours des saisons, reste à faire; nous utiliserons donc indifféremment « dramatique radiophonique » et « théâtre radiophonique », dans la mesure où l’axe biographie/fiction brouille davantage les frontières.
-
[32]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 2.
-
[33]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 5.
-
[34]
« De la Renaissance à la Résistance : Jean Racine ». https://curio.ca/fr/catalog/8afbb3dc-37c6-4087-96e9-e43636cbc674.
-
[35]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 3, « Jean Racine », fo 4. Les différents bruitages indiqués dans les biographies dramatisées de Charpentier sont à replacer dans le contexte plus général de l’univers sonore de la radio de l’époque; voir Renée Legris, Histoires des genres dramatiques à la radio québécoise. Sketch, radioroman, radiothéâtre, 1923-2008, Québec, Septentrion, 2011, « Troisième partie. L’univers sonore des dramatiques à la radio québécoise », p. 174-261.
-
[36]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 11-12.
-
[37]
Gaston Deschamps, Marivaux, Paris, Hachette, 1897, p. 81-82.
-
[38]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 12.
-
[39]
On peut penser aux figures d’Homère ou d’Ésope; voir Gérard Lambin, Le roman d’Homère. Comment naît un poète, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, ou Vie d’Ésope, éd. et trad. Corinne Jouanno, Paris, Les Belles Lettres, 2006. Pour la littérature française de la première modernité, le cas de La vie de M. de Molière par Grimarest a récemment été étudié par Georges Forestier dans le cadre de ses propres travaux biographiques : Molière, Paris, Gallimard, 2018. Cette tension demeure un enjeu, notamment pour les formes dramatiques, comme le note Lucie Robert : « La contrainte du dialogue qui fonde le théâtre entraîne nécessairement une entorse à la stricte vérité historique, mais la contrainte du réel qui fonde le biographique incite le dramaturge à avoir recours à la citation, tirée de l’oeuvre du biographié » (« L’art du vivant. Réflexions sur le “théâtre biographique” », dans Robert Dion et Frédéric Regard (dir.), Les nouvelles écritures biographiques, Lyon, ENS Éditions, 2013, [en ligne]).
-
[40]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 2.
-
[41]
Marivaux, La surprise de l’amour, I, 2. Nous soulignons.
-
[42]
Marivaux, Le spectateur françois par Mr de Marivaux. Ou Recueil de tout ce qui a paru imprimé sous ce titre, Paris, Prault, 1728, p. 10-13.
-
[43]
Marivaux, Le spectateur françois par Mr de Marivaux. Ou Recueil de tout ce qui a paru imprimé sous ce titre, Paris, Prault, 1728, p. 10.
-
[44]
Marivaux, Le spectateur françois par Mr de Marivaux. Ou Recueil de tout ce qui a paru imprimé sous ce titre, Paris, Prault, 1728, p. 13. Cet épisode était déjà repris et donné pour véridique dans l’« Éloge de Marivaux » de d’Alembert, mais il est résumé et il n’y est pas présenté comme une source d’inspiration; voir D’Alembert, Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires, Paris, Jean-François Bastien, 1805, t. 10, p. 242. Nous remercions Clémence Aznavour d’avoir porté cet élément à notre attention.
-
[45]
Université d’Ottawa, CRCCF, fonds Fulgence Charpentier, P358, 5, 8, « Pierre de Marivaux », fo 4.
-
[46]
Daniel Madelénat, La biographie, Paris, Presses universitaires de France, 1984, p. 192.
-
[47]
Nous pensons ici à Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 62‑63, 1986, p. 69-72, mais le sujet a fait couler beaucoup d’encre depuis; voir, entre autres, Laurent Avezou, « La biographie. Mise au point méthodologique et historiographique », Hypothèses, no 4, 2001, p. 13-24.
-
[48]
Voir Renée Legris, Histoires des genres dramatiques à la radio québécoise. Sketch, radioroman, radiothéâtre, 1923‑2008, Québec, Septentrion, 2011, « Lexique », p. 478-486; Pierre Pagé, Renée Legris et Louise Blouin, Répertoire des oeuvres de la littérature radiophonique québécoise. 1930-1970, Montréal, Fides, 1975, p. 73-79. Les biographies dramatisées de Charpentier n’apparaissent pas dans le Répertoire parce que les auteurs précisent : « Nous n’avons […] pas dépouillé les nombreuses émissions dites “culturelles”, consacrées aux arts et aux lettres, à la chronique, ou aux interviews » (p. 79). Or, les textes de Charpentier s’apparentent fort à la définition de la « dramatisation historique » (p. 75).
Bibliographie
- Alembert, D’, Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires, Paris, Jean-François Bastien, 1805, t. 10.
- Fonds Fulgence Charpentier, Université d’Ottawa, CRCCF, P358, 1-5.
- Marivaux, La surprise de l’amour suivi de La seconde surprise de l’amour, éd. F. Rubellin, Paris, Librairie générale française, 1991.
- Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard, Archives de Radio-Canada, Voûte, supports DIS‑000983, 001083, 001126, 001484 et 001242.
- Marivaux, Le spectateur françois par Mr de Marivaux. Ou Recueil de tout ce qui a paru imprimé sous ce titre, Paris, Prault, 1728.
- Marivaux, Théâtre en deux volumes. Introduction par Émile Faguet de l’Académie française, Paris, Nelson éditeurs, s. d.
- Société Radio-Canada, Radio-Collège, cinquième année, s. l., s. d.
- Laurent Avezou, « La biographie. Mise au point méthodologique et historiographique », Hypothèses, no 4, 2001, p. 13-24.
- Auguste Bailly, La Fontaine, Paris, Fayard, 1937.
- Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 62-63, 1986, p. 69-72.
- Marion Chénetier-Alev, « Les archives radiophoniques du théâtre. Du théâtre pour les aveugles à un théâtre de sourds? », Revue Sciences/Lettres, no 6, 2019. https://doi.org/10.4000/rsl.1843.
- Gaston Deschamps, Marivaux, Paris, Hachette, 1897.
- Robert Dion et Frances Fortier, Écrire l’écrivain. Formes contemporaines de la vie d’auteur, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010.
- Robert Dion, « Fonction critique de la biographie d’écrivain (Puech, Oster) », dans Robert Dion et Frédéric Regard (dir.), Les nouvelles écritures biographiques, Lyon, ENS Éditions, 2013. https://doi.org/10.4000/books.enseditions.4517.
- Lucien Dubech, Histoire générale illustrée du théâtre, Paris, Librairie de France, 1931-1933.
- Lucien Dubech, « Marivaux et Musset à la Comédie-Française », La revue universelle, 15 septembre 1926, p. 761-763.
- Lucien Dubech, « Nouvelles réflexions sur Marivaux et Musset », La revue universelle, 1er octobre 1926, p. 124-127.
- Émile Faguet, Dix-huitième siècle. Études littéraires, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1890.
- Georges Forestier, Molière, Paris, Gallimard, 2018.
- Frances Fortier, Caroline Dupont et Robin Servant, « Quand la biographie se “dramatise”. Le biographique d’écrivain transposé en texte théâtral », Voix et images, vol. 30, no 2, 2005, p. 79-104.
- Denyse Garneau et François-Xavier Simard, Fulgence Charpentier, 1897-2001. La mémoire du xxe siècle, Ottawa, Vermillon, 2006.
- Marina Girardin, Flaubert : critique biographique, biographie critique, Paris, Champion, 2017.
- Jean Giraudoux, Les cinq tentations de La Fontaine, Paris, Grasset, 1938.
- Madeleine Greffard, « Le théâtre à la radio : un facteur de légitimation et de redéfinition », L’annuaire théâtral, no 23, 1998, p. 53-73.
- Jean-Noël Jeanneney (dir.), L’écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France, Paris, Hachette, 1999.
- Georges Lafenestre, La Fontaine, Paris, Hachette, 1895.
- Gérard Lambin, Le roman d’Homère. Comment naît un poète, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016
- René Lavollée, Marivaux inconnu, Paris, Imprimerie de la Société anonyme de publications périodiques, 1880.
- Marie-Thérèse Lefebvre, « Radio-Collège (1941-1956) : un incubateur de la Révolution tranquille », Les cahiers des dix, no 60, 2006, p. 233-275.
- Renée Legris, Histoires des genres dramatiques à la radio québécoise. Sketch, radioroman, radiothéâtre, 1923-2008, Québec, Septentrion, 2011.
- Daniel Madelénat, La biographie, Paris, Presses universitaires de France, 1984.
- Pierre Pagé, Histoire de la radio au Québec : information, éducation, culture, Montréal, Fides, 2007.
- Pierre Pagé, « Le théâtre de répertoire international à Radio-Collège (1941-1946) », L’annuaire théâtral, no 12, 1992, p. 53-87.
- Pierre Pagé, Radiodiffusion et culture savante au Québec. 1930-1960, Montréal, Maxime, 1993.
- Pierre Pagé, Renée Legris et Louise Blouin, Répertoire des oeuvres de la littérature radiophonique québécoise. 1930-1970, Montréal, Fides, 1975.
- Kim Petit, « Le projet pédagogique de Radio-Collège dans la décennie 1940. La conservation des institutions scolaires traditionnelles et la promotion des sciences », mémoire de maîtrise (histoire), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2008.
- Lucie Robert, « L’art du vivant. Réflexions sur le “théâtre biographique” », dans Robert Dion et Frédéric Regard (dir.), Les nouvelles écritures biographiques, Lyon, ENS Éditions, 2013. https://doi.org/10.4000/books.enseditions.4504.
- Franck Salaün, Marivaux, Paris, Gallimard, coll. « Folio Biographies », 2021.
- Vie d’Ésope, éd. et trad. Corinne Jouanno, Paris, Les Belles Lettres, 2006.

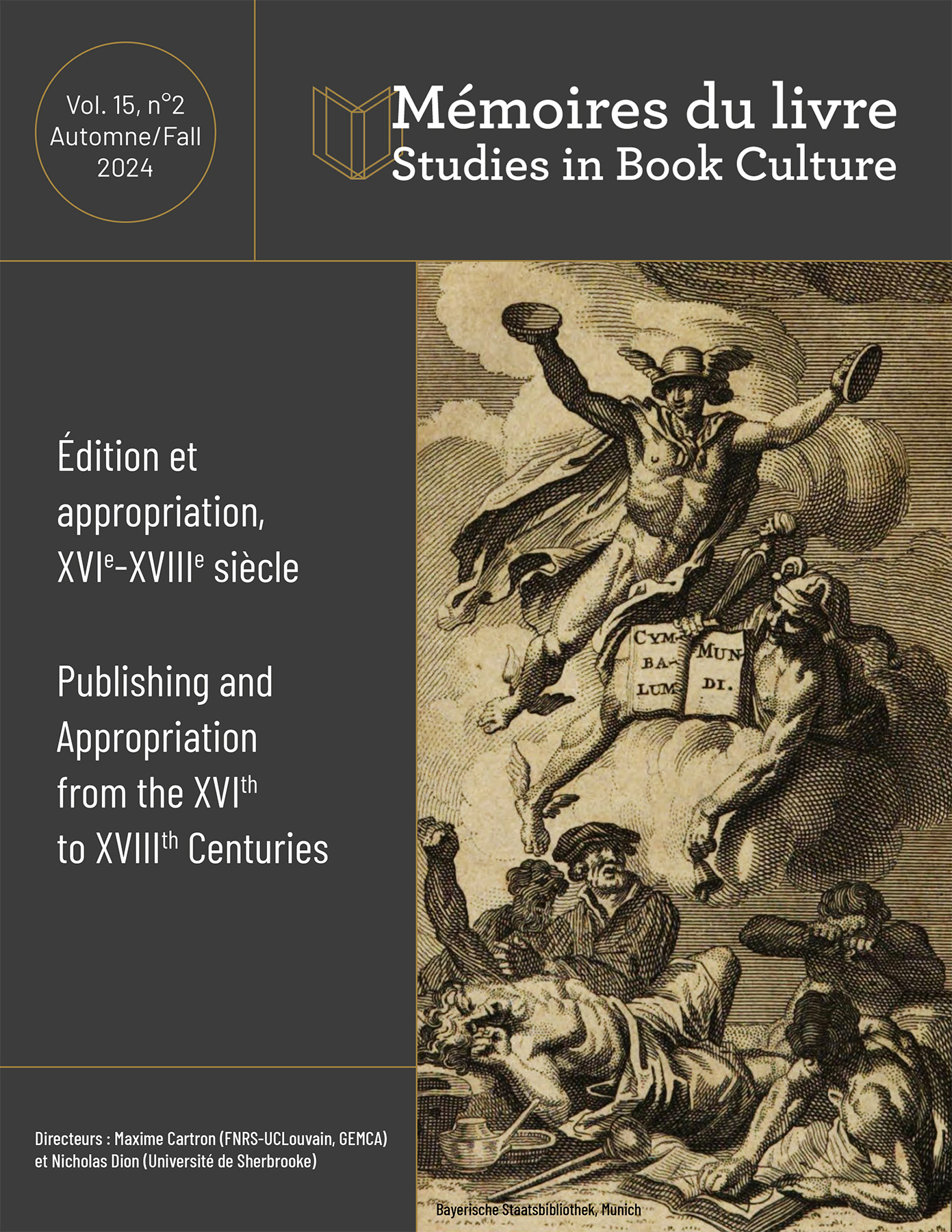

 10.7202/011245ar
10.7202/011245ar