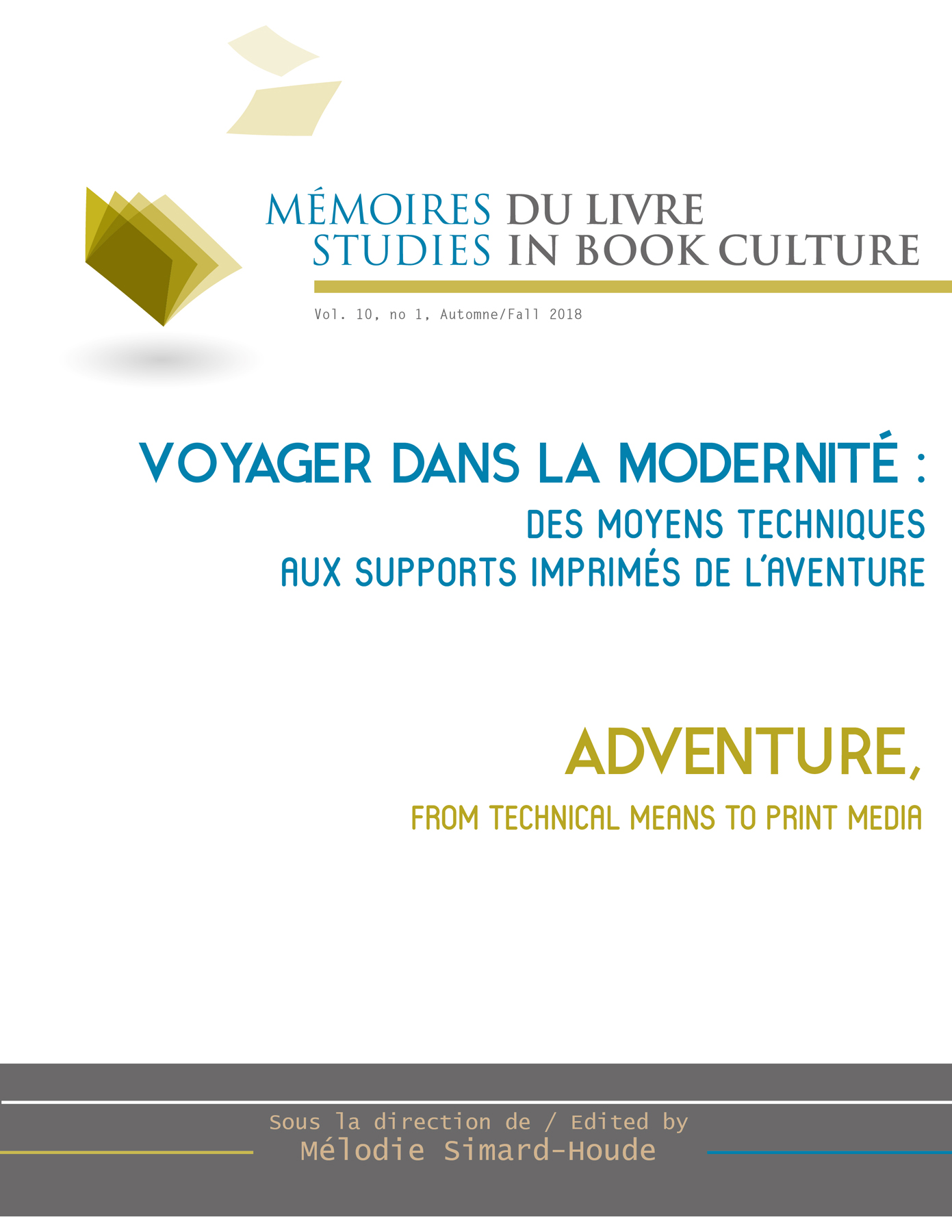Résumés
Résumé
Quelles sont les modalités qui permettent au lectorat de l’époque coloniale d’entrer, littérairement parlant, dans l’empire colonial français? Sous la Troisième République, la question est importante pour des raisons politiques et idéologiques : on verra ici, à travers trois cas particuliers, comment les entrées dans les textes engagent différemment l’expérience d’une lecture exotique. Comparer ces premières lignes issues du livre ou des périodiques permet de mettre en évidence les variations de l’aventure coloniale et de sa modernité par le biais de la vitesse narrative : un récit de voyage, un roman d’aventure de Jules Verne et un reportage d’Albert Londres trouveront ainsi des points communs qui éclairent l’entreprise coloniale. Selon que les récits ont été publiés dans des journaux ou dans des livres, la vitesse de lecture n’est pas la même, le support jouant un rôle considérable dans la perception de l’aventure elle-même.
Abstract
How can readers of the colonial era enter the French colonial empire through literature? Under the Third Republic, this question matters for political and ideological reasons. This article aims to examine, through three particular case studies, how the first lines of a text engage the experience of an exotic reading differently. Comparing the first lines of a book or of magazines makes it possible to highlight variations in the colonial adventure, and in its modernity, through the speed of the narrative: a travel narrative, a Jules Verne adventure novel, a report by Albert Londres, all possess similarities which shed light on the “colonial adventure.” Depending on whether the travel narratives were published in newspapers or in books, the speed of reading is not the same, the medium playing a significant role in the perception of the adventure itself.
Parties annexes
Bibliographie
- Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1952.
- Alphonse Daudet, Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, Paris, Dentu, 1872.
- Arthur Delteil, Voyage chez les indiens Galibis de la Guyane, Nantes, Mellinet, 1886.
- Arthur Delteil, « Voyage chez les Indiens de la Guyane », La Feuille de la Guyane française, du 27 mai au 17 juin 1871.
- Albert Londres, Terre d’ébène (La traite des noirs), Paris, Albin Michel, 1929.
- Albert Londres, « Quatre mois parmi nos noirs d’Afrique », Le Petit Parisien, du 12 octobre au 11 novembre 1928.
- Laurent Mauvignier, Autour du monde, Paris, Minuit, 2014.
- Jules Verne, Clovis Dardentor, Paris, Hetzel, 1896.
- Jules Verne, Face au drapeau, Paris, Hetzel, 1896.
- Paul Aron, « Entre journalisme et littérature, l’institution du reportage », COnTEXTES, n° 11, 2012. http://contextes.revues.org/5355.
- Romain Bertrand, « Les sciences sociales et le “moment colonial” : de la problématique de la domination coloniale à celle de l’hégémonie impériale », Questions de recherche / Research in Question, n° 18, 2006. https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01065637/document.
- Myriam Boucharenc, L’écrivain-reporter au coeur des années trente, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004.
- Myriam Boucharenc, « Choses vues, choses lues : le reportage à l’épreuve de l’intertexte », Cahiers de Narratologie, n° 13, 2006. http://narratologie.revues.org/320 (26 septembre 2018).
- Sophie Desmoulin, « “Quatre mois parmi nos Noirs d’Afrique” à la une du Petit Parisien : représentations de l’Afrique et de l’Africain à la fin des années 1920 », Le Temps des médias, n° 26, 2016, pp. 57-74.
- Lionel Dupuy, « Les Voyages extraordinaires de Jules Verne ou le roman géographique au xixe siècle », Annales de géographie, n° 690, 2013, pp. 131-150.
- Jean-François Durand et Jean-Marie Seillan (dir.), Cahiers de la SIELEC. L’aventure coloniale, Paris, Kailash, 2011.
- Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972.
- François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil, 2008 [2003].
- Frédéric Lambert, « Esthésie de la dénonciation. Albert Londres en Terre d’ébène », Le Temps des médias, n° 26, 2016, pp. 75-92.
- Edward Ousselin, « De Nemo à Dakkar. La représentation paradoxale du colonialisme chez Jules Verne », Nineteenth-Century French Studies, vol. 42, n° 1-2, 2013-2014, pp. 88-102.
- Guillaume Pinson, « Irkoutsk ne répond plus. Jules Verne, les médias de masse et l’imaginaire de la rupture de communication », Romantisme, vol. 4, n° 158, 2012, pp. 83-96.
- Mélodie Simard-Houde, « Les avatars du “Je”. Roman et reportage dans l’entre-deux-guerres », Études françaises, vol. 52, n° 2, 2016, pp. 161-180.
- Mélodie Simard-Houde, Le reporter et ses fictions. Poétique historique d’un imaginaire, Limoges, PULIM, coll. « Médiatextes », 2017.
- Mélodie Simard-Houde, « Le reporter, médiateur, écrivain et héros. Un répertoire culturel (1870-1939) », thèse de doctorat, Québec, Université Laval, Département de littérature, théâtre et cinéma, 2015.
- Marie-Ève Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au xixe siècle, Paris, Seuil, 2007.
- Sylvain Venayre, « Le voyage, le journal et les journalistes au xixe siècle », Le Temps des médias, n° 8, 2007, pp. 46-56.