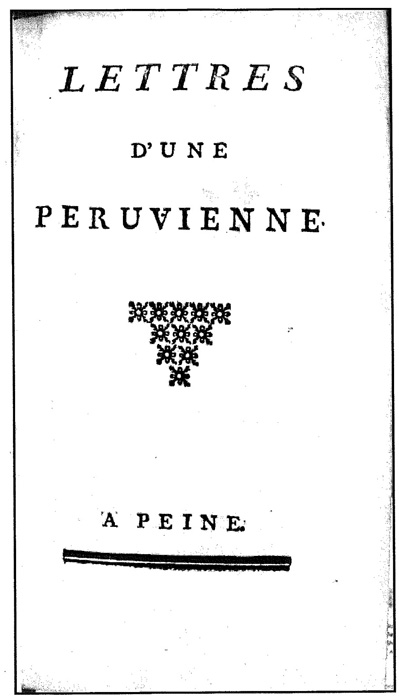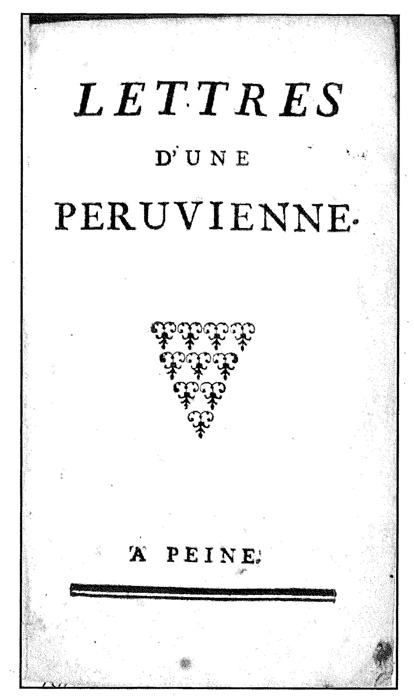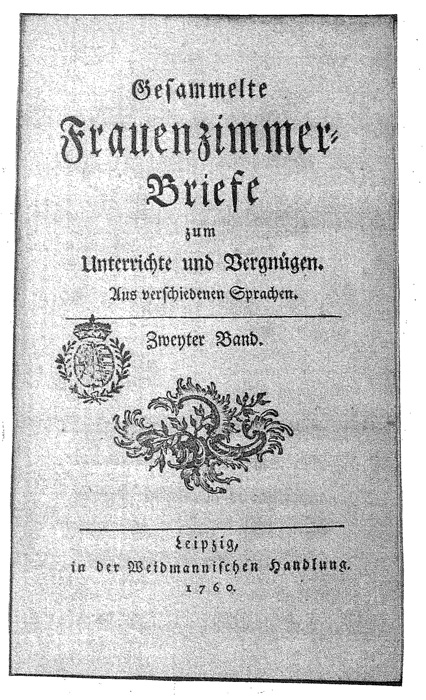Corps de l’article
Dans son ouvrage pionnier intitulé Seuils, Gérard Genette établit trois catégories de paratexte[1]. Lui-même n’examine que le paratexte littéraire, laissant à d’autres la tâche d’étudier les illustrations et ce qu’il appelle la bibliologie. Dans le cas de Mme de Graffigny, le paratexte littéraire des Lettres d’une Péruvienne a déjà fait l’objet des travaux d’Aurora Wolfgang[2] et de Sylvie Romanowski[3], et les illustrations de la Péruvienne sont le domaine d’élection de Christina Ionescu[4]. Ayant consacré plus de trente ans à préparer une bibliographie matérielle des oeuvres de Mme de Graffigny, c’est surtout le paratexte bibliographique que je propose d’examiner ici. Il s’agit d’un ensemble hétéroclite d’aspects, tels que reliure, ex-libris, page de titre, dédicace, etc., qui ne sont pas dénués d’intérêt, même pour ceux qui ne sont pas bibliographes. Le plan de cet article est simple : je passe du dehors au dedans du livre.
Reliure. La première chose qu’on voit lorsqu’on examine un livre est la reliure. Au xviiie siècle, le livre qu’on achetait n’était pas relié ; il était vendu en cahiers imprimés, avec parfois une couverture en papier. On faisait relier son exemplaire soi-même, selon ses moyens et son goût. Sergueï Korolev de la Bibliothèque nationale de Russie a réussi à identifier par leur reliure un certain nombre de livres ayant appartenu à Diderot, lesquels, contrairement à ceux de la bibliothèque de Voltaire, sont dispersés dans la collection générale[5]. Le libraire Hubert-Martin Cazin est une exception à la règle : il vendait ses éditions richement reliées, si l’acheteur le désirait. Le relieur collait souvent son étiquette à la reliure : Allô, Bozerian, Derome, Simier, pour ne mentionner que quatre des plus célèbres. Un jour, je suis tombé sur une étiquette mystérieuse, « Thymol ‘77 » ; j’ai fini par comprendre qu’il ne s’agissait pas d’un relieur, mais d’une huile anti-bactérienne avec la date de son application !
Pour les exemplaires d’hommage, on les faisait relier avec les armoiries du destinataire. Fin 1750, Mme de Graffigny a expédié des exemplaires reliés de Cénie aux membres de la famille royale, y compris à Mme de Pompadour. Ils n’en ont pas accusé réception : « On y est muet comme les poissons[6]. » Certains de ces exemplaires royaux, confisqués à la Révolution, sont conservés actuellement dans des bibliothèques publiques. Graffigny a également envoyé un exemplaire à Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et ex-roi de Pologne, mais le relieur a malheureusement fait l’erreur d’y graver les armoiries du roi régnant de Pologne, Auguste II, Électeur de Saxe[7]. Je n’ai pas retrouvé ces deux exemplaires, non plus que les livres ayant appartenu à Mme de Graffigny. Son inventaire après décès comporte une liste partielle de ses livres[8], qui ont été légués à son ami La Touche, auteur de la célèbre tragédie Iphigénie en Tauride, mais ils ont disparu.
Ex-libris. Les ex-libris et les signatures apposés par les acheteurs révèlent les noms de ceux qui ont possédé l’ouvrage en question. Dans le cas de Graffigny, j’ai trouvé, par exemple, les noms du cardinal de Bernis, de Maria Edgeworth, d’Adam Smith et de Horace Walpole. Certains lecteurs ont inscrit, dans le texte, corrections, notes et commentaires, qui ont leur valeur pour l’étude de la réception. Ainsi, les annotations manuscrites de Voltaire dans ses livres remplissent plus de cinq volumes, mais malheureusement sa bibliothèque n’inclut plus rien de Mme de Graffigny, même si ses lettres indiquent qu’il a lu ses ouvrages. On trouve parfois dans une édition française le nom d’un traducteur. Par exemple, Frau Gottsched, traductrice de Cénie, a inscrit son nom dans C.6[9], ce qui indique probablement le texte qu’elle a dû utiliser. Parfois l’acheteur d’un exemplaire y inscrivait le prix, la date et le lieu de son achat, indications aussi rares qu’utiles. Parmi les noms de propriétaires figurent des collectionneurs célèbres : le duc d’Aumale, Brotherton, Cicongne, Douce, Mitchell, Schiff et Max von Waldberg. En vertu des lois anti-juives, ce dernier fut licencié par les Nazis en 1933 de son poste de professeur d’études françaises à l’Université de Heidelberg, où Josef Goebbels avait été son élève et où l’on conserve quatre de ses éditions de Graffigny. Il mourut en 1938 dans des circonstances mystérieuses, et son épouse se suicida en 1942 pour éviter d’être déportée à Theresienstadt. Ce drame écoeurant m’était inconnu au moment où je maniais ces livres.
Faux-titre. De façon générale, le faux-titre était une version réduite du titre. Dans le cas de Graffigny, les titres sont eux-mêmes courts, de sorte que le faux-titre est souvent identique au titre. Dans plusieurs des premières éditions de la Péruvienne, on l’a tout simplement omis comme redondant.
Colophon. Au verso du faux-titre on trouve parfois un colophon. Celui d’une des émissions de l’édition Bleuet-Didot de 1797 (P.79) comporte une indication du tirage : « Il n’a été tiré que cent exemplaires de cette édition sur ce format grand in-18o ». Cette indication est précieuse, car on ne connaît que rarement le tirage d’un ouvrage du xviiie siècle, même pour les ouvrages célèbres.
Page de titre. En général la page de titre était imprimée, mais celle de l’édition originale de Cénie (C.1) est gravée.
Normalement on peut identifier une édition à partir de sa page de titre, mais pas toujours : la Bibliothèque nationale de France (BnF) conserve un exemplaire de la seconde édition de la Péruvienne, qui comporte la page de titre de l’édition originale (v. planches 1 et 2). De toute évidence, les deux éditions sortaient de la même imprimerie, et elles ont dû y être mélangées.
À partir de la page de titre, un oeil expérimenté peut souvent identifier le pays d’origine d’une édition clandestine. Par exemple, les pages de titre anglaises sont relativement encombrées ; les hollandaises sont souvent en rouge et noir. Les imprimeurs rouennais n’hésitaient pas à employer des pages de titre bicolores pour leurs contrefaçons, mais leur rouge est souvent plutôt orange[10].
On trouve parfois la page de titre de la série dans laquelle figure l’ouvrage – par exemple, The Novelist’s Magazine (P.61A ; v. planche 3) ou Cooke’s Pocket Edition of Select Novels (P.80). La première traduction allemande, Briefe einer Peruanerin, fait partie de la série Gesammelte Frauenzimmerbriefe zum Unterrichte und Vergnügen[11] (P.33, v. planche 4). C’est en vain qu’on la recherche dans le catalogue de la BnF sous le nom de l’auteur, de sorte que cette traduction m’a longtemps échappé.
Titre de l’ouvrage. Tous les titres de Graffigny sont courts et simples, à l’exception de ceux des deux contes qui ont un long titre secondaire explicatif et moraliste : Nouvelle espagnole ou Le mauvais exemple produit autant de vertus que de vices ; et La princesse Azerolle, ou L’excès de la constance. Conte. Sauf pour son premier conte, tous les titres de Graffigny comportent le nom d’une femme : Azerolle, une Péruvienne, Cénie, Phaza, Zenise et La fille d’Aristide. En abrégeant le titre des Lettres d’une Péruvienne en Lettres péruviennes (P.59), par analogie avec les Lettres persanes, portugaises, juives, chinoises, etc., Didot l’aîné a caché le fait que la narratrice est une femme. Les titres employés pour ses oeuvres par Graffigny dans ses lettres à Devaux sont différents, parfois même après la publication de l’ouvrage : Alphonse, Zilia ou Zilie et La gouvernante. Elle emploie quatre titres successifs pour sa dernière pièce, dont la genèse a été assez prolongée : La brioche, Les effets de la prévention, Théonise, ou L’abus de la philosophie et La fille d’Aristide[12]. Les titres sont souvent changés dans les traductions, notamment dans les adaptations étrangères de Cénie qui devient Celia, Cenia, Eugenia, L’inganno amoroso, Lucinda, El marido de su hija, ou encore Cenia oder die Grossmuth im Unglücke. Il ne faut pas toujours se fier aux indications qu’on ajoute au titre. Une édition de la Péruvienne de 1748 (P.11) se dit « seconde édition, revue et corrigée » ; elle n’est pourtant ni seconde, ni revue, ni corrigée ! Un peu comme l’avocat général du Parlement, Omer Joly de Fleury, qui n’était, selon Voltaire, ni Homère, ni joli, ni fleuri.
1
2
3
4
Nom de l’auteur. Aucune des éditions originales d’oeuvres de Graffigny ne porte son nom, ce qui n’a rien d’anormal : pendant l’Ancien Régime, il était considéré immodeste, inopportun et roturier de s’identifier, a fortiori pour une femme. Mme de Lafayette, dans l’« Avis du libraire » de La princesse de Clèves, explique : « L’auteur n’a pas signé de crainte que sa médiocre réputation ne nuise à ce livre. » C’est pourquoi l’identité de l’auteur de La princesse Azerolle n’a été découverte qu’en 1977, lorsque English Showalter a lu la correspondance de Graffigny de l’année 1745[13]. L’anonymat était parfois motivé par la crainte de la persécution, ce qui n’est pas le cas pour Graffigny, même si la Péruvienne est mise à l’Index en 1765 et condamnée par l’Inquisition espagnole en 1794. C’est surtout en tant que femme auteure que Graffigny désirait l’anonymat. Plutôt conservatrice que féministe[14], elle croyait qu’une femme devrait écrire en prose et faire présenter une pièce aux comédiens par un homme. En fait, tout le monde savait d’avance que Graffigny était l’auteure de ses trois ouvrages principaux. Le nom de Graffigny est mentionné dans l’édition révisée de la Péruvienne de 1752 (P.22), non sur la page de titre, mais dans le privilège. Son nom ne figurera sur la page de titre de la Péruvienne (P.29A) et de Cénie (C.19) qu’après sa mort, quoique les traductions commencent à le mentionner dès 1752. Sur la page de titre d’une Péruvienne de 1773 (P.46), on déclare que Graffigny est « membre de l’Académie de Florence »[15]. On n’est pas obligé de le croire, d’autant plus qu’on n’indique pas laquelle des trois académies de Florence l’aurait admise dans son sein. Le nom du traducteur figure le plus souvent dans les traductions, notamment celui de Deodati pour les Lettere d’una Peruviana, mais celui de Graffigny en est souvent absent (v., par exemple, P.28B).
L’adresse. Comme chacun sait, l’adresse est souvent fausse. Le Recueil de ces Messieurs (Conte 1), qui contient la Nouvelle espagnole, porte « Amsterdam, chez les frères Westein ». Il existait bien à Amsterdam un libraire du nom de Wetstein (avec deux t), qui savait sans doute l’orthographe de son nom, mais il est certain que l’on a publié le Recueil en France. Treize éditions de la Péruvienne portent l’adresse amusante « A PEINE »[16]. La veuve Pissot n’osait apposer son nom à l’édition originale en raison de l’interdiction des romans ; les contrefacteurs ont naturellement utilisé la même adresse. L’édition originale de Cénie porte le nom de Cailleau, mais le contrat de Graffigny est avec Duchesne ; c’est que Duchesne était le gendre de Cailleau et gérait sa maison d’édition. Une dizaine d’éditions de la Péruvienne portent l’adresse « Amsterdam, Aux dépens du délaissé » ; leur filigrane et leurs ornements indiquent qu’elles ne sont pas d’origine hollandaise mais rouennaise. Mais qui est ce libraire qui se dit « délaissé » et qui n’adopte ce surnom pour aucun autre ouvrage ? Une édition de la Péruvienne de 1801 (P.86) porte l’adresse de « Paris », mais un seul exemplaire porte une autre page de titre avec l’adresse « Paris, Joachim ». Or, à Paris aucun libraire ne portait ce nom ; il s’agit en fait de Gottfried Andreas Joachim, de Leipzig.
Date. La date n’est pas indiquée dans l’édition originale de la Péruvienne, et l’on ne sait pas si sa parution date de décembre 1747 ou de janvier 1748. En effet, François-Antoine Devaux, le correspondant principal de Mme de Graffigny, se trouvait à Paris à l’époque et n’échangeait donc pas de lettres avec son amie.
Comme les voitures modernes, un ouvrage est souvent daté de l’année suivante. Cénie, par exemple, est publiée en novembre 1750, mais porte la date de 1751.
Dédicace. Les dédicaces sont de deux sortes. D’abord, la dédicace officielle qui se trouve généralement dans tous les exemplaires. Cénie est dédiée par l’auteur au comte de Clermont, son « prince protecteur ». L’épître dédicatoire de La fille d’Aristide est adressée à Marie-Thérèse d’Autriche, qui avait épousé l’ancien duc François de Lorraine. Selon Genette, les dédicaces, en plus d’être une expression de gratitude, relèvent de l’ostentation, puisqu’elles affichent une relation avec un personnage haut placé. Elles pouvaient aussi être une source de revenus : Marie-Thérèse a récompensé Mme de Graffigny à raison de 2 100 livres[17]. Marie-Thérèse avait insisté pour voir au préalable le texte de celle d’Aristide et l’avait trouvé trop élogieux[18]. Les dédicaces tendent à disparaître après l’édition originale. Évidemment les traductions ont souvent d’autres dédicataires.
La seconde sorte de dédicace est écrite à la main dans les exemplaires d’hommage. On sait, grâce à la Correspondance, l’identité de beaucoup des dédicataires de Cénie, mais, parce que Mme de Graffigny inscrivait ou faisait inscrire sa dédicace sur une feuille à part, ces exemplaires restent inconnus. La seule exception est un exemplaire dédicacé de sa main à Voisenon ; conservé à Nancy, cet exemplaire porte au verso du frontispice : « A Monsieur / l’abbé de Vois[e]non / de la part de sa / très humble et très / obéissante servante / l’auteur[19]. » Un exemplaire de l’édition révisée de la Péruvienne (P.22A), portant une dédicace au prince Charles-Alexandre de Lorraine, a été vendu chez Sotheby en 2009.
Format. Les éditions originales de la Péruvienne et de Cénie sont in-12, le format le plus populaire. Celle de La fille d’Aristide a deux émissions, l’une in-8 et l’autre in-12, sans doute en vue de publics différents ; elles ont des vignettes différentes sur la page de titre pour permettre au libraire de distinguer entre elles dans son stock.
La fin du siècle est l’époque des petits formats in-18, notamment ceux de Cazin, assez luxueux. On lui a attribué deux éditions des Oeuvres (O.3 et O.4) et une Péruvienne (P.55), mais le grand spécialiste des Cazins les traite de « faux[20] ».
Signatures. Les signatures en bas de page permettent de déterminer l’origine géographique d’une édition. Par exemple, les Hollandais employaient un astérisque pour les signatures des cahiers liminaires ; le texte des éditions anglaises commence avec la signature B ; l’emploi de la lettre U et non V prouve qu’une édition n’est pas française. Un astérisque qui accompagne une signature indique soit un papier de qualité, soit un carton.
L’édition originale de la Péruvienne (P.1) se termine avec 2F1 (planche 5), c’est-à-dire que l’imprimeur n’a utilisé que le premier feuillet du cahier final, ce qui constituait un inconvénient pour le relieur et surtout un gaspillage de papier à une époque où le papier, relativement à la situation actuelle, coûtait plus cher que la main-d’oeuvre. Au début, la tendance des contrefacteurs était de suivre de très près les caractéristiques de l’édition originale pour laquelle ils cherchaient à faire passer leur édition ; ils ont donc conservé ce feuillet 2F1. Cependant, avec le passage du temps, ils tendaient à économiser du papier et à produire des éditions comportant moins de pages ; ils éliminaient donc ce dernier feuillet en serrant un peu les caractères des feuillets précédents.
Dans une des premières éditions de la Péruvienne (P.4), le feuillet N10, qui normalement n’est pas signé, porte la signature 2A2. C’est que le compositeur a bêtement reproduit la signature de l’édition qu’il utilisait comme texte de base ; son édition est en cahiers de 12 feuillets, son modèle est en cahiers de 8 et de 4. Cette édition ne peut donc pas être l’originale.
Chiffres de pressier. Ils sont utilisés exclusivement en Grande-Bretagne. Une des premières éditions de la Péruvienne (P.6) en comporte et ne peut donc pas être l’originale qui est parisienne.
5
6
Réclames. Au milieu du siècle, les réclames sont placées en fin de cahier en France, en fin de page en Hollande.
La réclame SUITE figurant à la fin de la Péruvienne dans deux des premières éditions (P.10 et P.11) indique que la première Suite a été imprimée en même temps que le roman, ce qui prouve que ni l’une ni l’autre de ces éditions de la Péruvienne n’est l’originale (planche 6).
Faute d’espace, je remets à une autre occasion mes remarques sur les ornements, les estampilles, le papier, l’approbation, le privilège, la distribution des rôles, l’errata, les catalogues, les préfaces et les traductions. Je reprends pourtant mes remarques sur les Suites. En 1748, deux Suites ont paru, la première en sept lettres est probablement due au chevalier de Mouhy, l’auteur de la seconde en trente-cinq lettres est un certain Hugary de Lamarche-Courmont. Elles ont dû être assez populaires, car Duchesne a remplacé Cénie par la seconde Suite, lorsqu’il a republié la Péruvienne en 1760 (P.29A) ; on se demande si les amis de Graffigny ont approuvé cette décision. Dans une Suite ultérieure, Mme Morel de Vindé finit par marier Zilia à Déterville (P.79). On a beaucoup écrit sur les Suites, mais sans mentionner que dans l’épilogue de la traduction danoise de 1855 (P.131) Zilia, à l’imitation de La dame aux camélias ou de La traviata, meurt de la tuberculose causée par son amour éternel pour Aza.
Sur ce ton sépulcral, il convient de terminer mes observations disparates, qui n’ont ni thèse, ni fil conducteur, ni conclusion. Dans ce survol de certains aspects bibliographiques intéressants, j’espère pourtant avoir démontré à quel point le paratexte chez Mme de Graffigny peut éclairer les circonstances de la composition, de la transmission et de la réception de son oeuvre[21].
Parties annexes
Notes
-
[1]
Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p. 7 et 20.
-
[2]
Aurora Wolfgang, « Words and worlds of difference : Graffigny’s Lettres d’une Péruvienne », dans Gender and Voice in the French Novel 1730-1782, Aldershot, Ashgate, 2004, chap. 3.
-
[3]
Sylvie Romanowski, « Graffigny’s Lettres d’une Péruvienne : Giving (and) Reading », dans Through Strangers’ Eyes. Fictional Foreigners in Old Regime France, West Lafayette, Purdue University Press, 2005, chap. 6.
-
[4]
Christina Ionescu, « La série illustrative dessinée par Le Barbier l’aîné pour les Lettres d’une Péruvienne de Mme de Graffigny », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 2004, 12, p. 229-245 ; « L’invasion espagnole du Temple du Soleil : la configuration visuelle d’un topos imaginaire dans les éditions illustrées des Lettres d’une Péruvienne de Mme de Graffigny », dans Geographiae imaginariae : dresser le cadastre des mondes inconnus dans la fiction narrative de l’Ancien Régime, éd. Marie-Christine Pioffet, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 214-247 ; « Les éditions illustrées des Lettres d’une Péruvienne : le parcours visuel d’un succès de librairie européen », dans Pierre Mouriau de Meulenacker et al., Françoise de Graffigny rentre à Lunéville, Lunéville, Musée du Château de Lunéville, 2012, p. 68-81 ; et « De la clôture textuelle à la clôture iconographique : reflets fragmentaires et écarts sémantiques dans des suites gravées du second dix-huitième siècle », Cahiers du GADGES, 12, 2014, p. 233-285.
-
[5]
Sergueï V. Korolev, La bibliothèque de Diderot : vers une reconstruction, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle, 2014.
-
[6]
Françoise de Graffigny, Correspondance, éd. J. Alan Dainard et English Showalter, Oxford, Voltaire Foundation, 1985-2016, vol. XI, p. 264.
-
[7]
Ibid., vol. XI, p. 271.
-
[8]
Archives nationales, Minutier central, XCII, 620, 9 janvier 1759, p. 29-30.
-
[9]
Je me réfère dans le texte aux sigles que portent les différentes éditions dans ma Bibliographie des oeuvres de Mme de Graffigny (1745-1755), Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du xviiie siècle, 2016.
-
[10]
Roger Laufer, « Les espaces du livre », dans Henri-Jean Martin et Roger Chartier (éd.), Histoire de l’édition française, Paris, Promodis, 1984, vol. II, p. 131-132 ; et François Moureau, « Le libraire imaginaire et les fausses adresses », Corps écrit, 33, 1990, p. 45-46.
-
[11]
C’est-à-dire Lettres complètes de femmes pour plaire et instruire.
-
[12]
Voir Christina Ionescu, « Dans les coulisses de La Fille d’Aristide : le manuscrit théâtral et les Graffigny Papers sous l’oeil de la critique génétique », Genesis, 34, 2012, p. 83-95.
-
[13]
English Showalter, « The beginnings of Madame de Graffigny’s literary career : a study in the social history of literature », dans Essays on the Age of Enlightenment in Honor of Ira O. Wade, éd. Jean Macary, Genève, Droz, 1977, p. 293-304 (301).
-
[14]
Voir mon article « Les relations de Mme de Graffigny avec les femmes », dans Françoise de Graffigny, femme des Lumières. Actes du colloque de Lunéville, 2014, à paraître prochainement (Garnier, 2017).
-
[15]
En 1790, une traduction anglaise (P.68) répète, dans le titre de sa Life, qu’elle est « member of the Academy of Florence ».
-
[16]
Pour une reproduction de ces pages de titre, voir Pierre Mouriau de Meulenacker et al., op. cit., p. 29-31.
-
[17]
Graffigny, Correspondance, op. cit., vol. XV, p. 323.
-
[18]
Ibid., vol. XV, p. 374.
-
[19]
Bibliothèque municipale de Nancy, 312.278b.
-
[20]
Jean-Paul Fontaine, Cazin, l’éponyme galvaudé, Paris, Hexaèdre, 2012, p. 24, 151 et 207.
-
[21]
Je remercie de leurs observations Dorothy P. Arthur, Christina Ionescu, English Showalter, Charlotte Simonin et mes évaluateurs anonymes.
Liste des figures
1
2
3
4
5
6