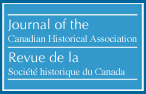Résumés
Abstract
Charles de Gaulle’s cry of “Vive le Québec libre!” during his 1967 visit to Montreal was the product of the convergence of Canadian, Quebecois and Gaullist nationalist reactions to preponderant US influence and globalization’s rise after 1945. The dynamic was especially pronounced in the cultural sphere. Consistent with the trend towards increased transnational exchanges, cultural relations grew in the Canada-Quebec-France triangle in the fifteen years after the Second World War. Quebec neo-nationalism’s rise was accompanied by a greater appreciation of France as an ally as Quebec strove to preserve its francophone identity. Such preoccupations corresponded to French apprehensions about the ramifications on France at home and abroad of American cultural ‘imperialism.’ In addition to nationalist concerns in France and Quebec, English Canadian nationalists were preoccupied with American influences on the Canadian identity. If these three interacting nationalist reactions shared a preoccupation about American cultural power and Americanization that encouraged a growing state involvement in culture and promoted greater exchanges, the differences between them also helped set the stage for the tempestuous triangular relationship of the 1960s.
Résumé
Le « Vive le Québec libre! » lancé par Charles de Gaulle lors de sa visite de 1967 à Montréal est le produit de la convergence de réactions nationalistes canadiennes, québécoises et gaullistes face à la montée de l’influence des États-Unis et de la mondialisation après 1945. Cette dynamique fut particulièrement prononcée dans la sphère culturelle. Dans la foulée de la hausse des échanges transnationaux, les relations culturelles s’étaient intensifiées dans le triangle Canada–Québec–France au cours des quinze années suivant la Seconde Guerre mondiale. La montée du néonationalisme québécois s’était accompagnée d’une meilleure appréciation de la France à titre d’alliée, au moment même où le Québec tentait de préserver son identité francophone. Ce genre de préoccupations rejoignait les appréhensions françaises quant aux ramifications, à la fois en France, sur le continent et à l’étranger, de « l’impérialisme » culturel américain. Les nationalistes canadiens-anglais s’ajoutaient aux Français et aux Québécois, qui se souciaient pour leur part des influences américaines sur l’identité canadienne. Ces trois courants nationalistes partageaient un malaise par rapport à l’hégémonie culturelle américaine et à l’américanisation et demandèrent, parfois en interaction, l’intervention croissante de l’État et l’intensification de leurs échanges mutuels. Cependant, les différences entre ces courants ont aussi préparé le terrain aux relations triangulaires tumultueuses des années 1960.