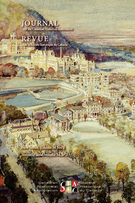
Journal of the Canadian Historical Association
Revue de la Société historique du Canada
Volume 19, numéro 1, 2008
Sommaire (13 articles)
Vancouver 2008
-
Webs of Affection and Obligation: Glimpse into Families and Nineteenth Century Transatlantic Communities
Elizabeth Jane Errington
p. 1–26
RésuméEN :
This paper explores the networks of affection, of frustration, and of obligation that continued to tie families and friends divided by the Atlantic in the first half of the nineteenth century as seen through the correspondence of two men — John Gemmill, who with his wife and 7 children emigrated to Upper Canada in the 1820s, and John Turner, who stayed home in England after his younger brother resettled in St. Andrews, New Brunswick in the 1830s. A close reading of this correspondence illustrates how kith and kin divided by the Atlantic continued to assert their place around family firesides, despite the difficulties presented by the gulf of time and space. Through their letters, correspondents on both sides of the Atlantic also negotiated often highly contested relationships that changed over time. At the same time, this link offered emigrants some reassurance of who they were and their place in the world as they negotiated new identities.
FR :
Cette étude explore les réseaux d’affection, de frustration et d’obligation qui ont continué de lier les familles et amis séparés par l’océan Atlantique dans la première moitié du XIXe siècle, comme le révèle la correspondance de deux hommes — John Gemmill qui, avec sa femme et ses sept enfants, a immigré au Haut-Canada dans les années 1820, et John Turner, qui est resté en Angleterre après l’installation de son jeune frère à St. Andrews (N.-B.) dans les années 1830. Une lecture attentive de cette correspondance illustre comment amis et parents de part et d’autre de l’océan ont continué à affirmer leur place à la table familiale malgré l’éloignement physique et temporel. Dans leurs échanges, les correspondants des deux côtés de l’Atlantique ont aussi négocié des relations changeantes et souvent très contestées au fil des années. Par la même occasion, ces échanges procuraient aux émigrants une certaine assurance au sujet de leur identité et de leur place dans le monde à mesure qu’ils se forgeaient une nouvelle identité sociale.
-
British Travellers, Nova Scotia’s Black Communities and the Problem of Freedom to 1860
Jeffrey L. McNairn
p. 27–56
RésuméEN :
British travellers commented frequently on those of African descent they encountered in colonial Nova Scotia, especially their material conditions and prospects. Those who published accounts at the peak of the campaign to abolish slavery in the British Empire intervened directly in debates about whether former slaves would prosper under conditions of colonial freedom. They cast themselves as objective imperial observers and Nova Scotia’s black communities as experiments in free labour. Attending to how most crafted and reworked their observations to argue against emancipation in the West Indies situates Nova Scotia and travel texts in intellectual histories of the production of colonial knowledge, debates about slavery, and the nature of nineteenth-century liberalism.
FR :
Les voyageurs britanniques de l’époque coloniale discutaient souvent des personnes d’ascendance africaine qu’ils rencontraient en Nouvelle-Écosse, en particulier de leurs conditions de vie matérielles et de leurs perspectives d’avenir. Ceux dont les récits furent publiés à l’apogée de la campagne d’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique sont intervenus directement dans le débat au sujet des possibilités de réussite des anciens esclaves devenus libres. Ces auteurs, qui se posaient en observateurs objectifs, présentaient les collectivités noires de Nouvelle-Écosse comme des expériences en matière de liberté de la main-d’oeuvre. L’étude de la façon dont la plupart de ces auteurs choisirent leurs mots et remanièrent leurs observations pour plaider contre l’émancipation des esclaves des Antilles aide à situer la Nouvelle-Écosse et les récits de voyage dans les historiographies intellectuelles de la production des savoirs coloniaux, des débats sur l’esclavage et de la nature du libéralisme au XIXe siècle.
-
Location, Location, Location: David Ross McCord and the Makings of Canadian History
Kathryn Harvey
p. 57–82
RésuméEN :
This study of the McCord National Museum in Montreal examines the role of place in the creation of personal and public memory. The founder, David Ross McCord, sought to promote a version of Canadian history in which family and personal myth were conflated with that of nation. McCord’s highly personal narrative of Canadian origins was conceived in the private space of the home and was made manifest through the repetitive act of remembering.
FR :
Cette étude du musée national McCord de Montréal examine le rôle de l’emplacement dans la création de la mémoire personnelle et publique. Son fondateur, David Ross McCord, a cherché à mettre en valeur une version de l’histoire du Canada dans laquelle les mythes familiaux et personnels se fondaient avec celui de la nation. Le récit très personnel de McCord sur les origines du Canada a été conçu dans l’enceinte privée de sa demeure et se manifeste à travers l’acte répétitif de la remémoration.
-
Advancing the Liberal Order in British Columbia: The Role Played by Lieutenant-Governor Sir Hector-Gustave Joly de Lotbinière, 1900–1906
J. I. Little
p. 83–113
RésuméEN :
This essay focuses on the role of Lieutenant-Governor Hector-Gustave Joly de Lotbinière in bringing political stability to British Columbia after the turn of the twentieth century. As well as ensuring that the composition of the executive council was based on federal party lines, he worked to ease federal-provincial tensions and exercised a significant influence on the McBride government’s highly effective economic reform programme. Joly has been largely ignored by historians, aside from his short term as Quebec premier, but his socially conservative liberalism made him an ideal promoter of Canada’s liberal order on the west coast.
FR :
La présente étude porte sur le rôle du lieutenant-gouverneur Hector-Gustave Joly de Lotbinière dans l’avènement de la stabilité politique en Colombie-Britannique après le tournant du XXe siècle. En plus de veiller à ce que la composition du Conseil exécutif respecte les lignes de partis fédérales, il a cherché à atténuer les tensions fédérales-provinciales et a exercé une influence significative sur le programme très réussi de réforme économique du gouvernement McBride. À l'exception de sa courte période à titre de premier ministre au Québec, les historiens ont tendance à ignorer les activités de Joly, mais son libéralisme empreint de conservatisme social en a fait un agent idéal de l’ordre libéral canadien sur la côte Ouest.
-
Geographies of sexual commerce and the production of prostitutional space: Victoria, British Columbia, 1860–1914
Patrick A. Dunae
p. 115–142
RésuméEN :
The essay considers the geography and economic significance of the sex trade in Victoria, British Columbia, a city that has historically associated itself with notions of gentility and images of English country gardens. The essay problematizes that image. Influenced by the spatial turn in the Humanities and informed by Henri Lefebvre’s ideas on the production of space, the production of prostitutional space is the focus of this piece. The essay discusses how and why space was demarked by local authorities for what Foucault called “illegitimate sexualities.” It delineates geographies of sexual commerce in Victoria and invites questions about sexuality in other Canadian and American cities, as well as other British colonial cities. This piece is a tentative step towards mapping moral geographies in nineteenth century cities and placing them within a broader temporal, societal, spatial, and theoretical framework.
FR :
La présente étude explore la géographie et l’importance économique du commerce sexuel à Victoria (Colombie-Britannique), ville qui s’est traditionnellement proclamée bourgeoise, à l’image de ses parfaits jardins anglais. Cette étude remet en question cette image. Influencé par le « tournant spatial » en sciences humaines, et inspiré par les idées d’Henri Lefebvre sur la production de l’espace, nous nous intéressons à la production de l’espace « prostitutionnel ». En particulier, nous nous demandons comment et pourquoi un espace a été démarqué par les autorités locales pour ce que Foucault a qualifié de « sexualités illégitimes ». Nous délimitons les aires du commerce sexuel à Victoria et nous nous questionnons sur la sexualité dans d’autres villes canadiennes et américaines, ainsi que d’autres villes coloniales britanniques. Cette étude se veut une tentative de cartographie des géographies morales dans les villes du XIXe siècle pour les replacer dans un cadre temporel, sociétal, spatial et théorique plus vaste.
-
Provincial Solidarities: The Early Years of the New Brunswick Federation of Labour, 1913–1929
David Frank
p. 143–169
RésuméEN :
This study draws attention to the importance of the early provincial federations of labour as a distinct form of labour organization in early 20th-century Canada. One of the first of these was the New Brunswick Federation of Labour, which attempted to strengthen local bonds of solidarity and represent workers at the level of the provincial state. The Federation originated with and was dominated by male workers in the skilled trades in the largest cities and by 1921 attracted almost 100 delegates from nine population centres, including a small number of women and Acadians. Its agenda included campaigns for the enactment of workers' compensation, the protection of women workers and the election of labour candidates, but a more thoroughgoing Reconstruction Programme (1919) was less successful, especially in the context of regional economic crisis in the 1920s. The study confirms the existence of a progressive movement within provincial society while identifying the limited scope of its ambitions and achievements. This study uses social history methods to explore an institutional narrative and to analyze a distinct chapter in the history of organized labour at the provincial level.
FR :
Cette étude met en relief l’importance des premières fédérations provinciales du travail à titre de syndicats ouvriers distincts dans le Canada du début du XXe siècle. Parmi celles-ci, la Fédération du travail du Nouveau-Brunswick a essayé de solidifier les liens de solidarité locaux et de représenter les travailleurs à l’échelle de la province. Cette fédération a été créée, et était dominée, par des hommes travaillant dans les métiers spécialisés des villes les plus larges de la province. En 1921, elle attirait près d’une centaine de délégués venus de neuf agglomérations, y compris un petit nombre de femmes et d’Acadiens. Son action s’est manifestée par des campagnes en faveur de l’indemnisation des accidents du travail, de la protection des femmes ouvrières et de l’élection de candidats travaillistes, mais son programme exhaustif de reconstruction, le « Reconstruction Programme » élaboré en 1919, a connu moins de succès, en particulier dans le contexte de la crise économique régionale des années 1920. L’étude confirme l’existence d’un mouvement progressiste au sein de la société de la province, tout en soulignant l’étendue limitée de ses ambitions et de ses réalisations. Ce travail repose sur des méthodes d’histoire sociale pour explorer le discours institutionnel et analyser un chapitre distinct de l’histoire du mouvement syndical au niveau provincial.
-
Anti-heroes of the Canadian Expeditionary Force
Tim Cook
p. 171–193
RésuméEN :
The civilian-soldiers that formed the ranks of the Canadian Corps created a unique soldiers’ culture composed of songs, poetry, doggerel, cartoons, and newspapers during the course of the war to cope with the strain of service. This unique soldiers’ culture offers keen insight into soldiers’ experience. The antihero was one of the most important themes running through soldiers’ culture. In a war where soldiers were elevated to heroes by civilians, the soldiers in turn often chose instead to emphasis the antiheroic in their cultural products. There were several antihero archetypes in Canadian soldiers’ culture, and this essay will examine three: British cartoonist Bruce Bairnsfather’s Old Bill, “old soldiers,” and malingers. While these archetypes were separate, with identifiable qualities, they also bled into one another, creating a rich tapestry of anti-heroic cultural products and icons. These antiheroes provided a voice to the soldiers, even at times a language by which the soldiers could make sense of their war experience. The antiheroes were not always emulated, but their unheroic actions resonated with the trench warriors.
FR :
Tout au long de la guerre, pour alléger la rigueur du service, les soldats civils qui composaient le Corps expéditionnaire canadien ont façonné une culture soldatesque unique faite de chansons, de poésie, de vers de mirliton, de bandes dessinées et de journaux. L’étude de cette culture ouvre une fenêtre inédite sur l’expérience de la vie de soldat. L’antihéros est l’un des thèmes les plus importants véhiculés par cette culture. Si en période de guerre les soldats étaient élevés au rang de héros par les civils, les soldats eux-mêmes préféraient l’antihéroïque dans leurs produits culturels. La présente étude porte sur trois des nombreux archétypes d’antihéros qui existaient dans la culture soldatesque canadienne : Old Bill, le personnage créé par le caricaturiste Bruce Bairnsfather; les « vieux soldats »; et les fainéants qui se faisaient passer pour malades. Bien que séparés, ces archétypes aux qualités propres, pouvaient aussi être mélangés, pour donner lieu à une riche mosaïque de produits culturels et d’idoles antihéroïques. Ces antihéros prêtaient leur voix aux soldats, offrant même par moment un langage grâce auquel les soldats arrivaient à assimiler leur expérience de la guerre. Ces personnages ne servaient pas nécessairement d’inspiration, mais leurs actions non héroïques trouvaient un écho chez les combattants des tranchées.
-
Visual Interpretations, Cartoons, and Caricatures of Student and Youth Cultures in University Yearbooks, 1898–1930
E. Lisa Panayotidis et Paul Stortz
p. 195–227
RésuméEN :
Students have always been integral in the development of the university in Canada. Driven by personal, professional, and political agendas, student experiences, understandings, and narratives helped construct the academic and intellectual cultures of universities. In their relationships with professors, administrators, and the spaces they inhabit, students crucially contributed to the university as a historically vibrant idea and social institution. As cast by the students, the university was clearly expressed in variant and creative ways through the annual yearbook. In particular, within the yearbook, the practice of parody in cartoons and caricatures was powerful in depicting the imagined worlds of academe as seen through the students’ eyes, and importantly how the students saw themselves and their life on campus. Using yearbooks from three universities — Toronto, Alberta, and British Columbia – visual images are studied that reveal underlying intentions to comment, marginalize, ridicule, and esteem groups of students according to both ascribed and self-imposed socialized hierarchical structures and codes of expectations and behaviour. Among the universities, the visual satire was consistent in tone and image, exposing the historic place and activities of students in the early university and in society, the contingent formation of student identities, and the nature of the pursuit of academic knowledge and credentials by youth in early-twentieth Century Canada.
FR :
Les étudiants ont toujours joué un rôle important dans l’histoire des universités au Canada. Lourds de leurs ambitions personnelles, professionnelles et politiques, l’expérience des étudiants, leurs connaissances et leurs récits ont tous contribué à la construction des cultures intellectuelles et académiques des universités. Par leurs relations avec leurs professeurs, les administrateurs et les espaces qu’ils occupaient, les étudiants ont profondément aidé à façonner l’université, à la fois comme idée vibrante et comme institution sociale. Les pages des albums de finissants recèlent plusieurs expressions des ces idées, exprimées dans des formes aussi diverses que créatives . En particulier, le recours à la parodie des bandes dessinées et des caricatures offrait un puissant outil d’illustration à la fois des imaginaires académiques, des façons dont les étudiants concevaient leur vie sur le campus et des façons dont ils se percevaient eux-mêmes. À l’aide de tels livres-souvenir, provenant de trois universités (Toronto, Alberta et Colombie-Britannique), nous étudions des représentations visuelles qui révèlent des intentions sous-jacentes de commenter, de marginaliser, de ridiculiser ou de mettre en valeur des groupes d’étudiants en fonction de structures hiérarchiques imposées ou autogènes, ou encore de codes d’attentes et de comportements. D’un établissement à l’autre, la satire visuelle est homogène au niveau du ton et de l’image, exposant à la fois le rôle historique des activités des étudiants dans la jeune université et dans la société, la formation concomitante d’identités étudiantes et la nature de la poursuite des connaissances et des diplômes chez les jeunes Canadiens du début du XXe siècle.
-
The Promise of a More Abundant Life: Consumer society and the rise of the managerial state
Bettina Liverant
p. 229–251
RésuméEN :
In the decades following the turn of the century, the rising cost of living was a subject of controversy in Canada and throughout the industrialized world. No other topic, observers often noted, commanded more attention. Rising prices exacerbated wage disputes, and intensified tensions between traditional producer values and the acceptance of new patterns of purchasing. This article explores the bond formed between Canadian consumers and the managerial state by the investigation of changes in the cost of living. In order to measure changes in the prices of goods and services, it is necessary to examine the consumption practices of Canadians. This process of data collection and collation helped to normalize new consumer behaviours, and embedded the category of the Canadian citizen as a wage spender, as well as a wage earner, in the workings of government. By engaging with consumption, that is by representing, by measuring, and by categorizing the changing purchasing practices of its citizens, the state expanded its mandate and helped to shape the way Canadians came to see themselves as consumers.
FR :
Dans les premières décennies suivant le tournant du siècle, l’augmentation du coût de la vie a fait l’objet d’une controverse au Canada et partout dans les pays industrialisés. Selon les observateurs, aucun autre sujet n’a davantage retenu l’attention. La hausse des prix a eu pour effet d’exacerber les conflits salariaux de même que la tension entre les valeurs liées aux formes traditionelles de la production et l’acceptation de nouveaux comportements d’achat. Le présent article explore le lien qui s’est formé entre les consommateurs canadiens et l’État managérial autour des enquêtes sur les transformations du coût de la vie. Afin de mesurer les fluctuations du prix des biens et services, il est devenu nécessaire d’examiner les habitudes de consommation de la population canadienne. Ce processus de collecte et d’exploitation statistique de données a aidé à fixer de nouvelles normes de consommation et à établir, dans le vocabulaire de l’administration publique, la catégorie du citoyen canadien comme débourseur — et non plus seulement comme receveur — d’un salaire. En se penchant sur la consommation, c’est-à-dire en représentant, en mesurant et en classant les habitudes d’achat changeantes de ses citoyens, l’État a élargi son mandat et aidé à façonner l’identité naissante des Canadiens à titre de consommateurs.
-
The Refugee ritual: Sopron students in Canada
Laura Madokoro
p. 253–278
RésuméEN :
In the power politics of international migration, the relationship between migrants and the states that receive them are inherently uneven. This is particularly true of the international refugee regime and the manner in which refugees have been identified and resettled in the postwar period. This paper traces the journey of 200 student refugees from Sopron University in Hungary to the University of British Columbia in 1956, following the failure of the Hungarian Revolution. It argues that the manner in which the Sopron students were selected and then settled in Canada assumed ritualistic characteristics with which the federal government attempted to shape their identity and normalize their entry into Canadian society. Tracing the Sopron students’ refugee experience beginning with their flight from Hungary to their graduation from the University of British Columbia, this paper identifies four components to the refugee ritual: selection, movement, settlement and commemoration and argues that because the Sopron forestry students migrated as a group, they experienced the ritual experience to a far greater degree than other student refugees in Canada.
FR :
Dans le jeu de puissance des migrations internationales, la relation entre migrants et pays d’accueil est par définition inégale. Cela s’applique en particulier au régime international des réfugiés et à la façon dont les réfugiées ont été identifiés et réinstallés dans la période d’après-guerre. Le présent article relate le parcours de 200 étudiants réfugiés de l’Université de Sopron en Hongrie jusqu’à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), en 1956, suite à l’échec de la révolution hongroise. La façon dont les étudiants de Sopron ont été choisis et ont pu s’établir au Canada peut être analysée comme un processus aux caractéristiques rituelles, au moyens desquelles le gouvernement fédéral a cherché à façonner l’identité des ces nouveaux venus, et à normaliser leur entrée dans la société canadienne. Cette étude retrace l’expérience des étudiants de Sopron comme réfugiés, depuis leur fuite de Hongrie jusqu’à l’obtention de leur diplôme de l’UBC, selon quatre composantes rituelles attachées à l’étude des réfugiés (sélection, mouvement, installation et commémoration). Il avance qu’étant donné que les étudiants en sciences forestières de Sopron ont émigré en groupe, ils ont vécu cette expérience rituelle bien plus intensément que les autres étudiant réfugiés au Canada.
-
“Plus que jamais nécessaires”: Cultural Relations, Nationalism and the State in the Canada-Québec-France Triangle, 1945–1960
David Meren
p. 279–305
RésuméEN :
Charles de Gaulle’s cry of “Vive le Québec libre!” during his 1967 visit to Montreal was the product of the convergence of Canadian, Quebecois and Gaullist nationalist reactions to preponderant US influence and globalization’s rise after 1945. The dynamic was especially pronounced in the cultural sphere. Consistent with the trend towards increased transnational exchanges, cultural relations grew in the Canada-Quebec-France triangle in the fifteen years after the Second World War. Quebec neo-nationalism’s rise was accompanied by a greater appreciation of France as an ally as Quebec strove to preserve its francophone identity. Such preoccupations corresponded to French apprehensions about the ramifications on France at home and abroad of American cultural ‘imperialism.’ In addition to nationalist concerns in France and Quebec, English Canadian nationalists were preoccupied with American influences on the Canadian identity. If these three interacting nationalist reactions shared a preoccupation about American cultural power and Americanization that encouraged a growing state involvement in culture and promoted greater exchanges, the differences between them also helped set the stage for the tempestuous triangular relationship of the 1960s.
FR :
Le « Vive le Québec libre! » lancé par Charles de Gaulle lors de sa visite de 1967 à Montréal est le produit de la convergence de réactions nationalistes canadiennes, québécoises et gaullistes face à la montée de l’influence des États-Unis et de la mondialisation après 1945. Cette dynamique fut particulièrement prononcée dans la sphère culturelle. Dans la foulée de la hausse des échanges transnationaux, les relations culturelles s’étaient intensifiées dans le triangle Canada–Québec–France au cours des quinze années suivant la Seconde Guerre mondiale. La montée du néonationalisme québécois s’était accompagnée d’une meilleure appréciation de la France à titre d’alliée, au moment même où le Québec tentait de préserver son identité francophone. Ce genre de préoccupations rejoignait les appréhensions françaises quant aux ramifications, à la fois en France, sur le continent et à l’étranger, de « l’impérialisme » culturel américain. Les nationalistes canadiens-anglais s’ajoutaient aux Français et aux Québécois, qui se souciaient pour leur part des influences américaines sur l’identité canadienne. Ces trois courants nationalistes partageaient un malaise par rapport à l’hégémonie culturelle américaine et à l’américanisation et demandèrent, parfois en interaction, l’intervention croissante de l’État et l’intensification de leurs échanges mutuels. Cependant, les différences entre ces courants ont aussi préparé le terrain aux relations triangulaires tumultueuses des années 1960.
-
Maverick Mothers and Mercy Flights: Canada’s Controversial Introduction to International Adoption
Tarah Brookfield
p. 307–330
RésuméEN :
In the 1970s, two private adoption agencies faced state and public scrutiny over their ‘rescue’ of orphans from Bangladesh, Vietnam and Cambodia. The organizations were run by four Canadian mothers who themselves adopted over fifty children and placed hundreds more with other Canadian families. Inspired by a sense of maternal internationalism, these ‘maverick mothers’ were convinced that removing the children from their war torn nations and bringing them to Canada was in each child’s best interest. According to professional social workers and diplomats, a strong commitment to maternalism and internationalism were not valid enough to trust the complicated operation of international adoption to amateur humanitarians. The mothers’ lack of professional accreditation, their bleeding heart mentality, and examples of radical behavior at home and abroad were seen to threaten international adoption as a legitimate form of child saving. Yet concurrently, the authority and respect granted by the women’s identity as mothers marinated their cause with a certain creditability or at least admiration for their efforts, which gave them a sense of empowerment to challenge and for most of them, to ultimately cooperate with their critics.
FR :
Au cours des années 1970, deux agences d’adoption privées ont attiré l’attention du public lorsqu’elles ont commencé à « secourir » des orphelins du Bangladesh, du Vietnam et du Cambodge. Ces organisations étaient dirigées par quatre mères canadiennes, qui avaient adopté plus de cinquante enfants entre elles, et en avaient placé des centaines d’autres dans des familles canadiennes. Mues par une sorte d’internationalisme maternel, ces femmes non conformistes étaient persuadées qu’il y allait de l’intérêt de chacun de ces enfants de les retirer d’un pays d’origine déchiré par la guerre pour les amener au Canada. Des travailleurs sociaux professionnels et des diplomates contemporains les critiquèrent, qui croyaient que leur seul engagement maternel et internationaliste, malgré son intensité, ne préparait pas ces humanitaires en herbe à assumer la responsabilité du mécanisme complexe de l’adoption internationale. À leurs yeux, le manque d’accréditation professionnelle de ces mères, leur sentimentalisme, et certaines instances de comportements radicaux de leur part, au pays et à l’étranger, menaçaient la légitimité même de l’adoption internationale comme forme de secours. Pourtant, en parallèle, l’autorité et le respect attribués à ces femmes en tant que mères donnaient crédibilité à leurs efforts, et provoquaient une certaine admiration à leur égard. Ces encouragements les habilitèrent à revendiquer la capacité d’intervenir dans le processus d’adoption. En conséquence, la plupart d’entre d’elles finirent par coopérer avec leurs détracteurs.
-
To Visit and to Cut Down: Tourism, Forestry, and the Social Construction of Nature in Twentieth-Century Northeastern Ontario
Jocelyn Thorpe
p. 331–357
RésuméEN :
This paper relies on the insights of social nature scholarship to trace the historical forest conservationist and tourism discourses through which Temagami, Ontario, became famous as a site of wild forest nature. The discursive practices associated with Temagami tourism and forest conservation in the early twentieth century did not merely reflect a self-evident wilderness, but rather constituted the region as a wild place for non-Native people both to visit and to extract for profit. The social construction of Temagami wilderness came to appear natural through the erasure of the Teme-Augama Anishnabai’s claim to the Temagami region, an erasure that persisted in environmentalists’ struggle to “save” the Temagami wilderness in the late 1980s. Revealing the histories and power relationships embedded in wilderness is part of the struggle toward greater justice.
FR :
Cet article reprend les propositions des chercheurs qui plaident pour une compréhension sociale de la nature en vue de cerner les discours reliés au tourisme et à la protection de la forêt grâce auxquels Temagami (Ontario) est devenu un site renommé pour sa forêt à l’état sauvage. Le langage associé au tourisme et à la conservation forestière à Temagami au début du XXe siècle ne représentait pas le simple écho d’une nature évidemment sauvage. Il constituait plutôt la région comme un endroit sauvage, que les non Autochtones pouvaient à la fois visiter et exploiter pour des raisons commerciales. La construction sociale de la nature de Temagami en est venue à sembler naturelle grâce à la négation de la revendication de la communauté Teme-Augama Anishnabai sur la région de Temagami, une suppression qui a perduré jusqu’à la lutte des écologistes pour « sauver » le milieu sauvage de Temagami à la fin des années 1980. Le fait de dévoiler l’histoire et les relations de pouvoir inscrites dans la nature s’inscrit ainsi dans la quête d’une plus grande justice.



