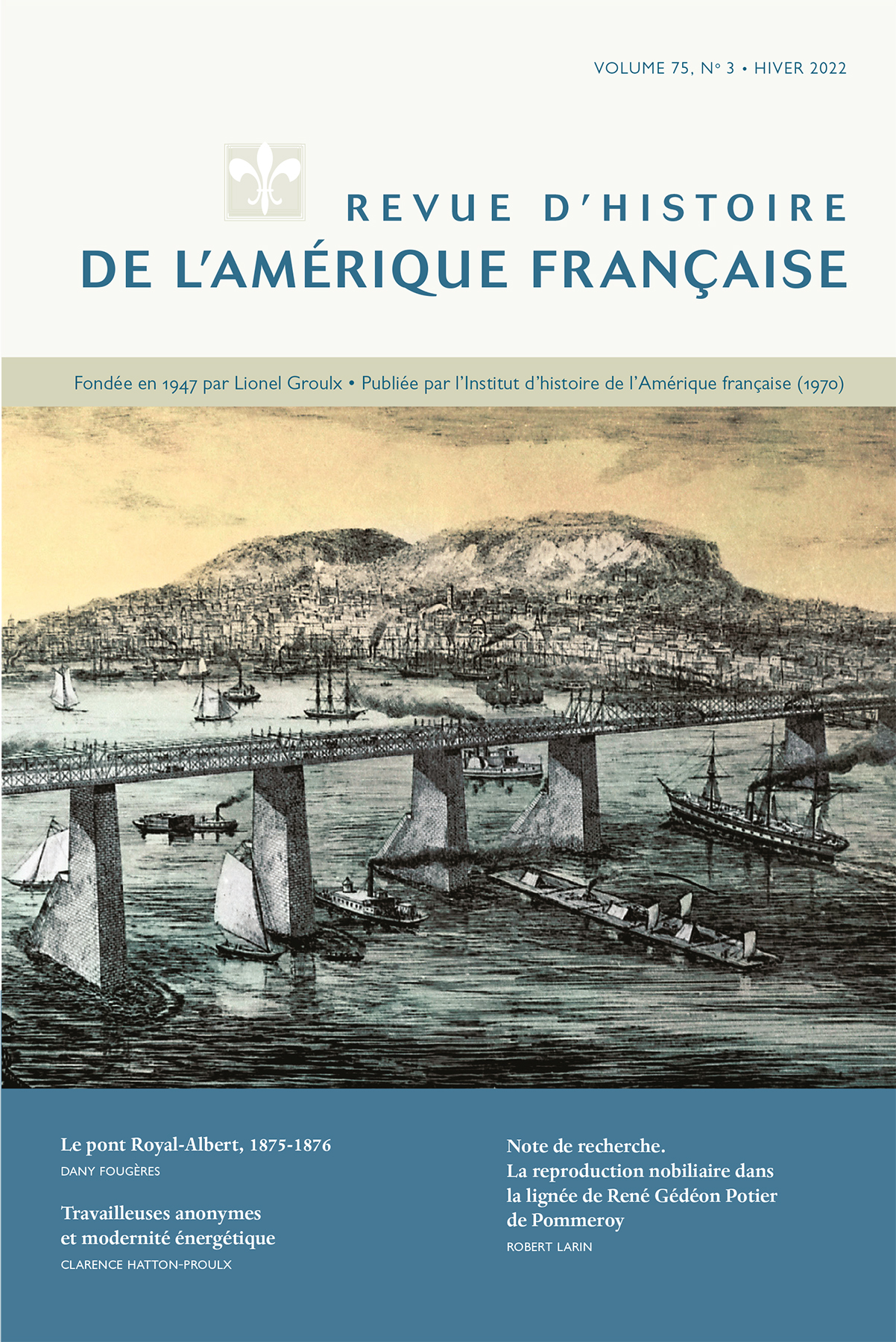Près de trente ans après la monographie de Marcel Moussette sur le sujet, le site du palais de l’intendant à Québec continue de révéler des aspects inédits. Les recherches sur ce site n’ont jamais cessé et ce livre abondamment illustré en propose un nouveau bilan, signé par l’archéologue spécialiste de la culture matérielle Camille Lapointe et deux professeurs de l’Université Laval, Allison Bain et Réginald Auger, qui ont succédé à Moussette dans la direction des fouilles. Situé entre l’embouchure de la rivière Saint-Charles, sur le Saint-Laurent, et les voies d’accès à la haute ville de Québec, le site du palais de l’intendant occupe un lieu stratégique dans les schèmes d’occupation du territoire depuis la préhistoire. En témoigne une herminette en pierre polie trouvée sur place qui signale que les Autochtones y travaillaient le bois. Jean Talon choisit ce lieu à la rencontre des voies navigables et carrossables pour établir le siège des intendants de la Nouvelle-France et implanter les industries nécessaires à l’essor de la capitale qu’étaient les fours à chaux, une fabrique de potasse et un moulin. Il y ajoute une brasserie pour avitailler les navires au long cours. La redoute Saint-Nicolas et le chantier maritime royal complètent les infrastructures névralgiques de cette « deuxième basse ville » durant le Régime français. Les archéologues ont mis au jour maints vestiges matériels associés aux personnages historiques ayant vécu au palais mais aussi aux innombrables femmes et hommes qui y firent vivre le projet colonial. Les copeaux de bois parfaitement conservés témoignent du travail d’équarrissage des charpentiers de navire et les pieux de la palissade d’urgence de 1690 permettent de connaître, grâce à la dendrochronologie, la saison même où les bûcherons ont abattu les cèdres. Les archéologues se sont invités à la table des intendants en suivant la trace des restes alimentaires, de la vaisselle en verre et en terre cuite et des chantepleures des tonneaux de vin. Ils et elles ont reconstitué chaque geste des convives découpant les cuisses de dinde et laissant les restes à leurs caniches. Habiles, les archéologues ont isolé les carapaces des insectes ayant proliféré dans les latrines, dans la réserve des farines et dans le malt de la brasserie. Se faufilant à travers les étripe-chats, ils et elles se sont introduits dans les cellules des prisonniers croupissant dans les caves du palais. Les pierres maçonnées de ce lieu d’incarcération sont hantées par la plume retrouvée du notaire et concierge des prisons François Genaple et par les soupirs de la condamnée post-mortem pour le crime de suicide Marie-Anne Lespérance, dix-sept ans, « couturière et vagabonde » détenue sur accusation de vol. La densité du récit, nourri du regard vif et butinant des archéologues, redonne au palais tout son sens au sein de la construction du pays. Tel un pivot, la section centrale du livre présente les boulets de canon, les artefacts calcinés et autres témoins de la bataille décisive de la guerre de Sept ans en 1759. Sur plusieurs sites du Vieux-Québec, une couche similaire sépare les strates française et britannique. En la fouillant, les archéologues font revivre la violence de la Conquête et la transformation du cadre de vie qu’elle entraîna. Pendant l’occupation militaire britannique, le palais de l’intendant servit de caserne et, là encore, les archéologues ont reconstitué la table des soldats : ceux-ci étaient payés avec des pennies à l’effigie de leur roi et portaient des boutons identifiant leur nom et leur régiment. (Ici, on relève une erreur : la devise du 100th Prince Regent’s County of Dublin Regiment, Ich dien (« Je sers »), n’est pas en gallois mais en allemand.) …
Lapointe, Camille, Allison Bain et Réginald Auger. Le site archéologique du palais de l’intendant à Québec. Plus de 35 années de découvertes. Québec, Septentrion, 2019, 186 p.[Notice]
…plus d’informations
Brad Loewen
Université de Montréal