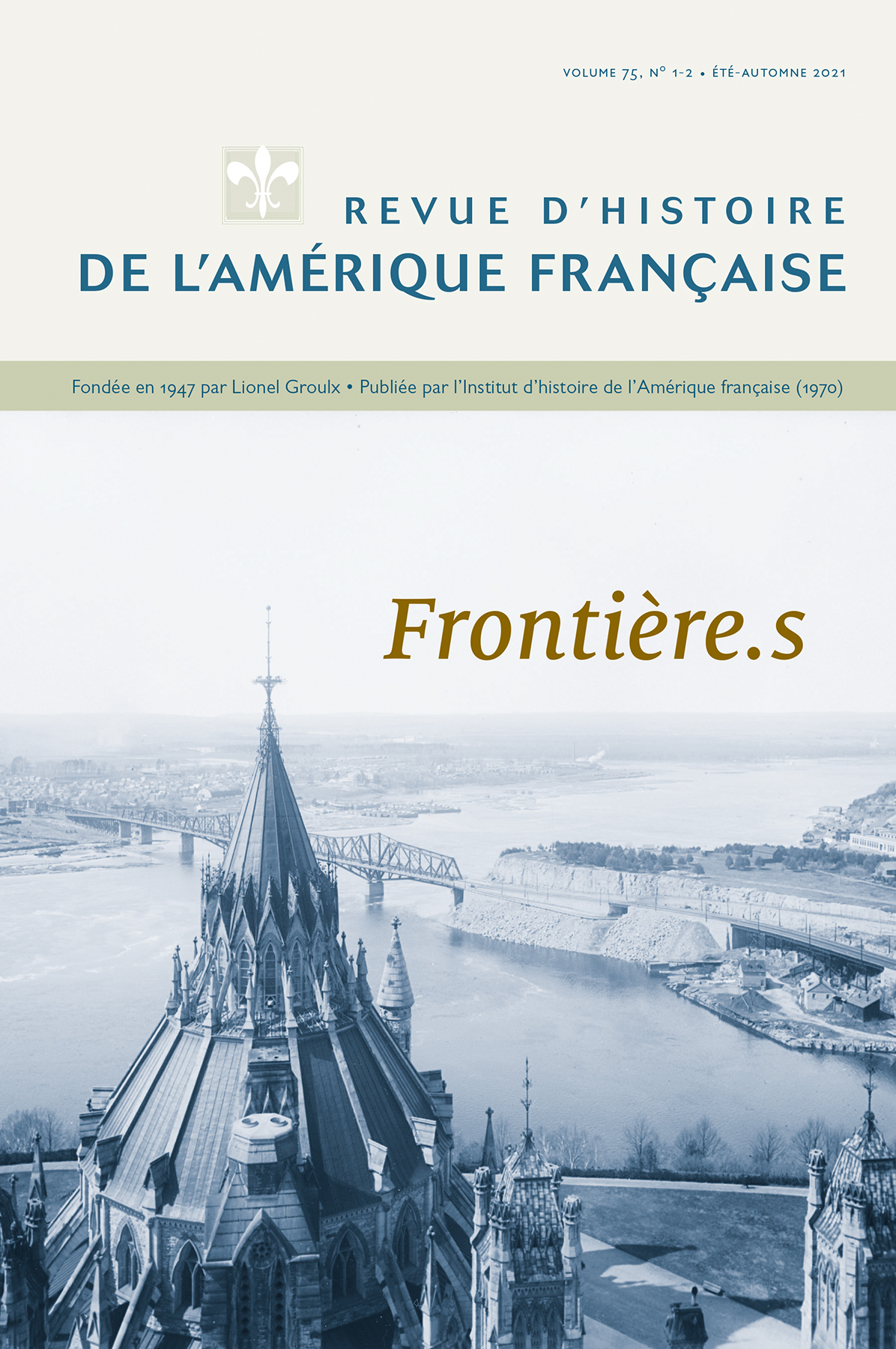Quelques décennies après la Révolution tranquille, bien des Québécois croyaient en avoir fini avec la religion ; or voilà qu’à la faveur d’une immigration récente, elle resurgit au début du 21e siècle dans le contexte d’une « crise des accommodements raisonnables ». D’une pauvreté affligeante, les débats sur la laïcité qui ont suivi polarisèrent beaucoup les Québécois. Le paradigme libéral étant hégémonique, les défenseurs de la laïcité, plutôt que de situer les principes qui les animaient dans une histoire longue, ont constamment dû répondre aux accusations d’intolérance et de fermeture à la diversité qui pesaient sur eux. Au Canada anglais, ces accusations ont été particulièrement virulentes. Comme si elle souhaitait offrir au public anglophone une autre clef de lecture pour comprendre cette question sensible, la sociologue Geneviève Zubrzycki publiait en 2016 un ouvrage en anglais sur l’évolution du nationalisme québécois et ses rapports complexes avec l’héritage religieux. Quatre ans plus tard, les éditions du Boréal ont eu l’excellente idée d’offrir au public de langue française une traduction de cet ouvrage, signée Nicolas Calvé. La thèse de Zubrzycki est que ce débat sur la laïcité témoignerait d’un lent processus de sécularisation qui serait loin d’être terminé. Ce retour imprévu du religieux forcerait les Québécois à réfléchir à leur identité nationale. L’ouvrage de cette professeure américaine d’origine québécoise est divisé en deux parties et en quatre chapitres d’égales longueurs, lesquels sont entrecoupés de « lieux communs », courts encarts assez sommaires consacrés à la famille, au sol, au mouton et au drapeau. La première partie de l’ouvrage est historique, plus descriptive et moins originale, du moins pour un lectorat québécois un peu averti, alors que la seconde est contemporaine et plus analytique. L’approche, le cadre théorique et les méthodes sont celles d’une sociologue de la culture qui entend comprendre l’évolution du nationalisme québécois à partir de symboles emblématiques et des nombreux défilés du 24 juin, censés illustrer une représentation de soi. Geneviève Zubrzycki reste convaincue que, malgré la Révolution tranquille et la baisse de la pratique religieuse, le Québec continue d’être travaillé par son passé religieux, que le nationalisme des Québécois ne saurait être confondu à une « religion des temps modernes » (p. 29), comme si le processus de sécularisation de la société québécoise était complété. La démonstration de la sociologue se fonde sur les manifestations religieuses à travers le temps, notamment à l’icône de saint Jean-Baptiste, une « condensation symbolique » (p. 34) très riche selon elle, dont l’évolution illustre la transformation de l’identité québécoise et y contribue. Elle insiste d’ailleurs beaucoup sur le caractère dynamique des symboles et autres « pratiques esthétiques » (p. 29) qui transforment le regard qu’une communauté porte sur elle-même. Les deux premiers chapitres proposent une lecture assez convenue de l’évolution du nationalisme québécois. La sociologue décrit, dans le premier chapitre, les contours d’un nationalisme ethnoreligieux très affirmé à partir du milieu du 19e siècle, nourri par un récit messianique rétrospectif qui allait attribuer à la nation canadienne-française une vocation particulière en Amérique. À l’image de saint Jean-Baptiste, les premiers Français sont des « précurseurs » qui auraient « ouvert le chemin » (p. 64) de la civilisation et du christianisme en Amérique. Les thèmes traditionnels des défilés de la Saint-Jean sont présentés dans l’annexe B de l’ouvrage. Le survol est un peu rapide et superficiel ; on aurait souhaité comprendre l’argumentaire de ceux qui convaincront Rome de faire de saint Jean-Baptiste le patron des Canadiens français en 1908. Le deuxième chapitre porte sur la « révolution esthétique » des années fastes de la Révolution tranquille. Dès 1961, rappelle-t-elle, le mouton — kidnappé …
Zubrzycki, Geneviève. Jean-Baptiste décapité. Nationalisme, religion et sécularisme au Québec, trad. Nicolas Calvé. Montréal, Boréal, 2020, 292 p.[Notice]
…plus d’informations
Éric Bédard
Université TÉLUQ