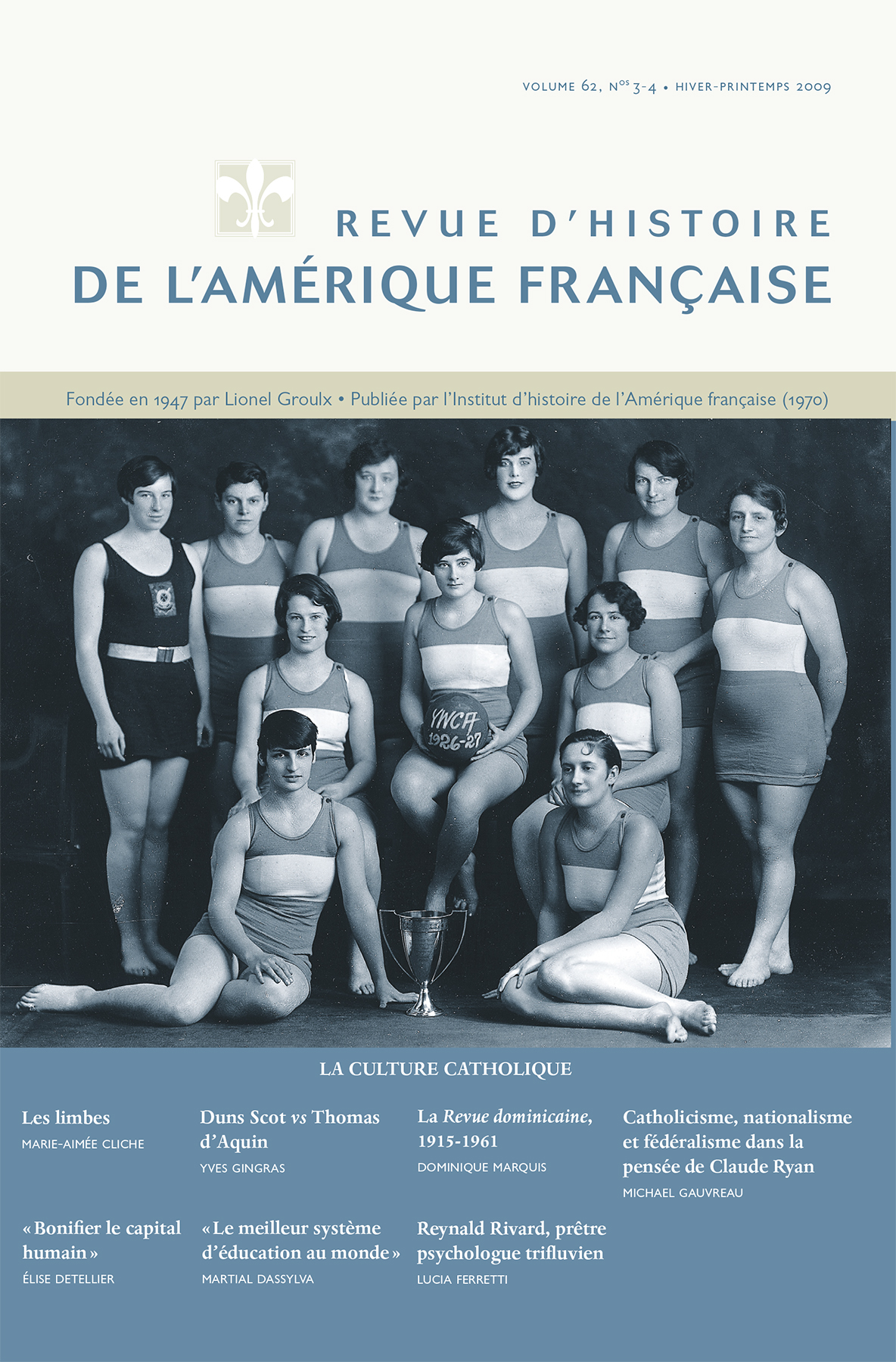Corps de l’article
Yves Lever est un de ces chercheurs qui ne cesse de faire mentir ce préjugé voulant que le titre d’historien n’appartienne qu’aux universitaires issus des départements d’histoire. Théologien de formation – il se spécialise d’abord et avant tout dans le rapport qu’a entretenu l’Église catholique avec le cinéma au Québec – Lever est devenu, au fil du temps, un spécialiste en histoire du cinéma québécois, mais surtout, un réel historien du cinéma.
Depuis quelques années, il s’intéresse à l’histoire de la censure cinématographique. Or, dans le cas du Québec, on ne peut faire l’histoire de la censure au cinéma sans passer par l’histoire de l’Église catholique. Après s’être joint à Pierre Hébert et Kenneth Landry pour la rédaction du très impressionnant Dictionnaire de la censure au Québec : littérature et cinéma (Fides, 2006) – il a naturellement dirigé le volet cinéma – il renchérit avec Anastasie ou la censure du cinéma au Québec, qui se veut un complément, voire un prolongement de ce premier travail.
Alors que le Dictionnaire de la censure est principalement descriptif, constitué de petits articles dressant un portrait global, mais synthétique des cas de censure littéraire et cinématographique au Québec, des principaux événements ou documents qui leur sont rattachés, des personnes qui l’ont exercée et des institutions ou organismes impliqués, Anastasie est une monographie historique à travers laquelle son auteur raconte l’histoire de la censure du cinéma au Québec, explorant son contexte de matérialisation aux différentes époques depuis son apparition. D’autres travaux ont déjà été publiés sur la censure cinématographique, comme le livre de Telesforo Tajuelo et Nicole Boisvert (Libre Expression, 2006), mais celui de Lever se démarque par sa démarche historienne qui se veut, autant que possible, impartiale.
Dans Anastasie, Lever a cherché à connaître les multiples conditions ayant permis ou empêché le public québécois d’avoir accès aux films depuis les premières projections au milieu des années 1890. Il a voulu savoir quelles furent les raisons invoquées, les personnes y ayant contribué et l’état des transformations qu’ont dû subir les films par l’action de la censure. D’emblée, il soutient que c’est par une action concertée entre le pouvoir de l’État et le pouvoir religieux que la censure cinématographique s’est affirmée puis confirmée, surtout jusqu’au début des années 1930. Cette « structure totalitaire », comme le mentionne Lever, qui s’incarne véritablement à travers le Bureau de censure des vues animées de la province de Québec, s’est maintenue en grande forme, puis raffermie pendant le règne de l’Union nationale de Maurice Duplessis, pour finalement s’effondrer à la suite de l’arrivée des libéraux de Jean Lesage en 1960.
Pour cet ouvrage richement illustré, qui jouit d’ailleurs d’un superbe travail d’édition, Lever s’est évertué à dépouiller plusieurs journaux et revues (La Presse, La Patrie, Ciné-orientations, Le monde ouvrier…), les débats parlementaires de l’Assemblée législative, l’ensemble des procès-verbaux du Bureau de censure ainsi que plusieurs rapports gouvernementaux. Le travail de recherche est colossal et très bien mené. On sent la parfaite maîtrise des sources chez l’auteur. Au surplus, ces sources sont abondamment utilisées et identifiées.
Lever divise son ouvrage en sept chapitres qui offrent un parcours chronologique de l’histoire de la censure cinématographique au Québec, de 1896 à 2007. Cette segmentation suit à la fois les grandes lignes de l’histoire politique québécoise contemporaine et l’histoire du Bureau de la censure des vues animées, créé en 1913, qui devient le Bureau de surveillance du cinéma en 1967, puis la Régie du cinéma du Québec en 1983. L’auteur explore le contexte de mise en place de la censure, du côté de l’Église catholique et du gouvernement québécois. Il donne également une voix aux mouvements de contestation, aux différentes époques, montrant que la censure du cinéma ne faisait certes pas l’unanimité, surtout chez les exploitants et les distributeurs.
Léo-Ernest Ouimet, par exemple, pionnier de l’exploitation du cinéma à Montréal, engagea une chaude lutte contre la loi provinciale interdisant l’ouverture des salles le dimanche, au début du xxe siècle. La revue L’Ordre, fondée par le journaliste Olivar Asselin en 1934, mais qui ne paraît pas tout à fait une année durant, s’attaquera aussi au « problème » de la censure. Tout comme cet autre journaliste, Louis Francoeur (1895-1941), qui publie dans la Revue moderne en 1939, un article très sévère contre la censure du cinéma. Évidemment, ces contestations demeurent marginales avant 1960.
La publication du « rapport Régis » en février 1962, du nom d’un des membres du Comité provisoire pour l’étude de la censure du cinéma dans la province de Québec créé en juillet 1961, le dominicain Louis-Marie Régis, est l’événement qui changea radicalement la donne. Les membres du Comité y suggèrent, entre autres, d’abolir le Bureau de censure ou de procéder à son renouvellement complet ainsi que de favoriser la politique de libre circulation des oeuvres et des idées. Ce rapport a l’effet d’une bombe et génère de grands questionnements au sein du gouvernement et des intellectuels. À partir de 1963, André Guérin, nouveau président du Bureau de censure, beaucoup plus libéral que ses prédécesseurs, assouplit les mesures censoriales en proposant une véritable révolution copernicienne, pour employer l’expression de Lever. Plutôt que d’orienter les critères d’évaluation en fonction de l’autorité religieuse et politique, il place l’homme au centre de la question. Il appartient donc à l’homme d’exprimer le consensus social. Dans les années 1970 et 1980, différents projets de loi viendront réviser et changer la loi sur le cinéma, pour assouplir de plus en plus les critères de censure.
Un des nombreux mérites de cet ouvrage est d’être à la jonction entre une synthèse passablement complète de l’histoire de la censure cinématographique au Québec et une monographie historique à saveur politique et culturelle. Lever passe effectivement en revue l’évolution des politiques censoriales sur plus d’un siècle, mais il offre aussi une fine analyse des discours catholiques, gouvernementaux et professionnels justifiant, d’une part, les besoins de censure au cinéma, et d’autre part, les malaises et les protestations. L’excellente qualité d’écriture de l’auteur, comme toujours, force la lecture et fait oublier la structure parfois redondante qui compose chacun des chapitres. Cette structure homogène en fait cependant un ouvrage de référence idéal ; il est possible de consulter un seul chapitre sans avoir à lire l’ensemble du livre, un peu comme un article. Les images sont aussi très pertinentes et bien intégrées au texte. Employant un ton assez neutre, Lever ne tombe pas non plus dans le piège de la critique, même si l’on peut sentir quelques pointes discrètement dirigées à l’endroit de l’Église catholique et du feu premier ministre québécois Maurice Duplessis. À tout le moins, il ne se gêne pas pour affirmer son point de vue et annonce ouvertement ses couleurs.
Loin de ce que l’on pourrait penser, l’histoire de la censure cinématographique (et télévisuelle) au Québec n’est pas terminée. Le terme n’est certes plus employé, mais la réalité demeure. On trouve toujours, par exemple, une classification des films par catégorie d’âge. Autres cas : les grands propriétaires de salles de cinéma, comme Guzzo ou Cinéplex Odéon, qui refusent souvent le cinéma d’auteur et préfèrent projeter des superproductions ; les films érotiques et pornographiques qui ne sont jamais présentés à travers ces réseaux et que l’on classe à part du reste de la production cinématographique.
La censure « proscriptive » (c’est-à-dire qui proscrit le visionnement ou la distribution d’une oeuvre) n’existe peut-être plus, mais peut-on en dire autant de la censure prescriptive ? L’Église ne s’en charge certes plus (quoiqu’à l’occasion, on peut lire que le Vatican condamne certains films jugés contraires à l’esprit catholique, comme Da Vinci Code ou The Golden Compass), mais notre société conserve tout de même des mécanismes prescriptifs à l’égard du cinéma. La critique des journalistes culturels en est un bon exemple. L’ouvrage de Lever ne ferme donc pas le débat, toujours d’actualité. Mais il nous permet toutefois d’appréhender les nouveaux visages de la censure du cinéma avec un oeil plus critique.