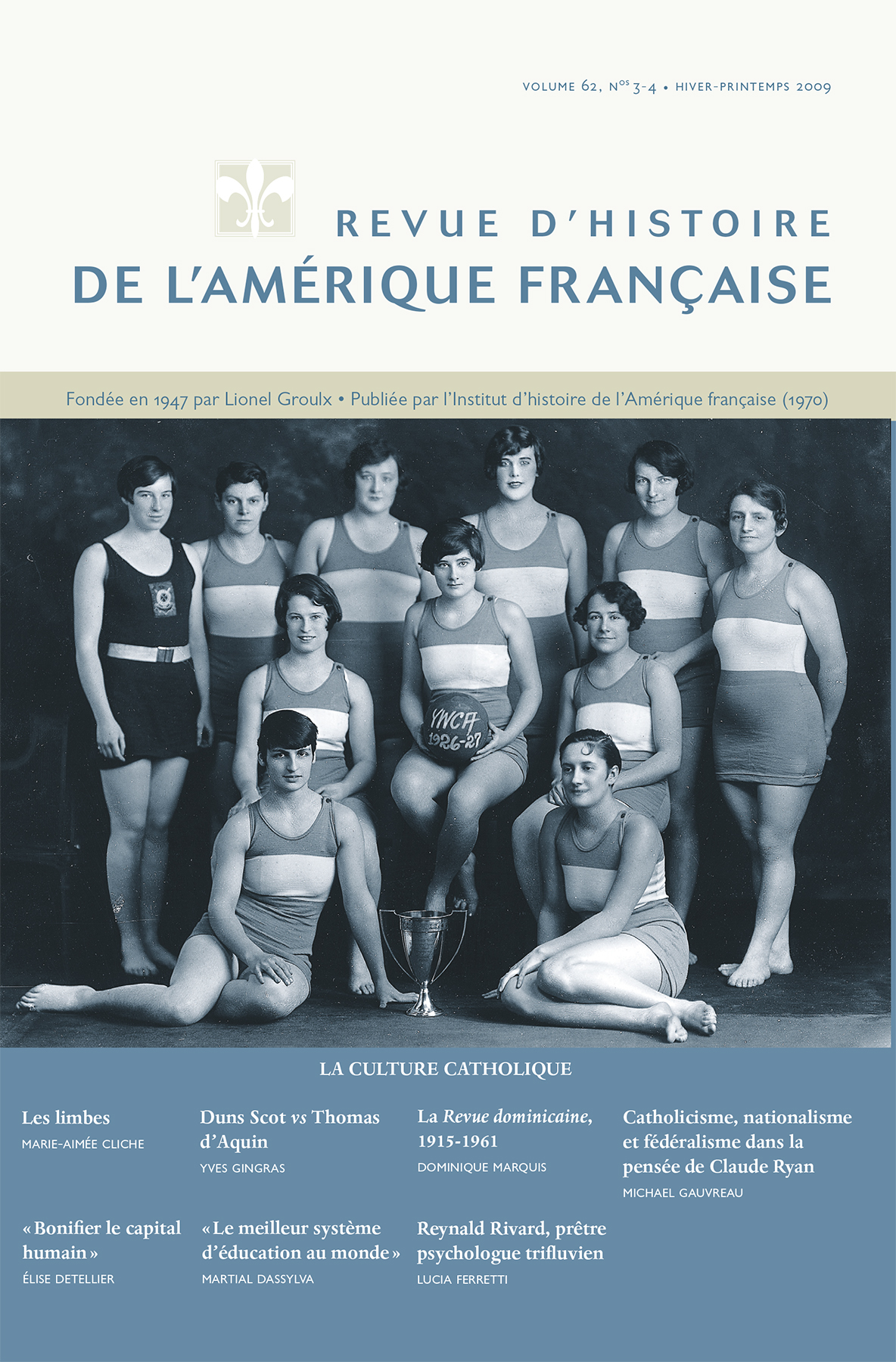Résumés
Résumé
L’hypothèse de l’existence des limbes pour les enfants morts sans baptême a été élaborée au Moyen Âge. Cependant, le dépouillement de tous les catéchismes publiés au Québec, de 1702 à 1952, révèle que c’est en 1895 seulement que ces limbes commencent à être mentionnés dans les manuels des maîtres, et en 1951 dans les petits catéchismes destinés aux enfants. D’autres raisons que la peur des limbes incitaient donc les parents à faire baptiser leurs enfants le plus tôt possible après leur naissance, notamment le désir de les faire enterrer dans le cimetière paroissial et l’espoir de les retrouver dans le ciel.
Abstract
The idea of limbo as a destination for the souls of unbaptised children was first developed in the Middle Ages. However, an examination of catechisms published in Quebec between 1702 and 1952 reveals that it was not until 1895 that limbo began to be mentioned in teachers’ manuals, and it did not figure in the shorter catechisms written for students until 1951. Thus, it was for reasons other than the fear of limbo that parents baptized their children as soon as possible after birth, notably the desire to have them buried in the parish cemetery and the hope of meeting them in heaven.
Corps de l’article
En avril 2007, les théologiens du Vatican, en accord avec le pape Benoît XVI, ont convenu que les limbes n’existent pas et que les enfants morts sans baptême vont directement au paradis. Au Québec, cette nouvelle a sombré dans l’indifférence générale, soulignée par les commentaires ironiques de quelques journalistes[2]. On a peine à croire que des générations de parents ont pu se tourmenter (ou être tourmentés par le clergé) à ce sujet.
Mais en fait, la peur des limbes était-elle vraiment ancrée dans les moeurs des Québécois comme certains historiens le laissent entendre[3] ? En quoi consistait exactement l’enseignement de l’Église à ce sujet ? A-t-il évolué ? Et comment la population y répondait-elle ? Pour analyser cet aspect du « prescrit et du vécu », selon l’expression de Jean Delumeau, il faut remonter aux écrits des Pères de l’Église et des auteurs du Moyen Âge qui ont élaboré cette « hypothèse théologique[4] », puis examiner les écrits des évêques et théologiens des différents diocèses du Québec. Notre source la plus importante sera constituée par les catéchismes que nous regroupons grosso modo en trois catégories : les petits catéchismes connus, en principe, de tous les catholiques québécois puisque les enfants devaient le mémoriser afin d’être admis à la première communion ; les grands catéchismes et manuels destinés aux curés et aux enseignants ; enfin tous les ouvrages complémentaires mais non obligatoires portant le nom de « catéchisme[5] ». À cela, s’ajoutent les mandements, lettres pastorales et les recueils concernant la discipline des diocèses du Québec. Nous compléterons notre documentation avec les ouvrages français du même type et les recueils de sermons possiblement utilisés dans notre province. Le comportement et les croyances de la population peuvent être reconstitués grâce aux registres paroissiaux qui contiennent les actes de baptêmes, aux récits de vie[6] et à des témoignages oraux recueillis par des ethnologues et des historiens. Cette analyse devrait permettre de faire le point sur un aspect imparfaitement connu de la vie religieuse de nos ancêtres et surtout de découvrir comment se manifestait, à travers la question des limbes, une certaine forme d’amour des enfants.
L’enseignement de l’Église
Dès les premiers siècles du christianisme, les Pères de l’Église (parmi lesquels figurait saint Augustin) affirmèrent l’absolue nécessité du baptême pour effacer la tache du péché originel et ouvrir les portes du ciel. Ils s’appuyaient sur un passage de l’Évangile : « Personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jean, 3,5). La question du salut des enfants morts avant d’avoir reçu ce sacrement ne prit cependant toute son acuité qu’au début du ve siècle, lorsque Pélage nia l’existence du péché originel chez les enfants[7]. Les Pélagiens faisaient une distinction entre le royaume des cieux et la vie éternelle : selon eux, les enfants morts sans baptême n’entraient pas dans le premier, mais ils jouissaient de la seconde[8]. Devant ce qu’il considérait comme une hérésie, saint Augustin durcit sa position et précisa que « les enfants qui n’ont pas reçu le baptême subiront les effets de la sentence prononcée “contre ceux qui n’auront pas cru et qui seront condamnés”[9] ». Ces enfants étaient donc rejetés dans un enfer éternel. Même si l’évêque d’Hippone affirmait que la peine dont ils souffraient était mitissima, c’est-à-dire la plus légère possible, cette perspective demeurait inquiétante et difficilement compatible avec l’idée d’un Dieu d’amour.
Cela amena les théologiens du Moyen Âge, notamment Abélard et Thomas d’Aquin, à effectuer une distinction entre la peine des sens, punition des péchés actuels commis par les humains, et la peine du dam ou privation de la vue de Dieu, que l’âme seule ressent et qui est la conséquence du péché originel.
L’idée des limbes s’ensuivit, conçus comme deux lieux différents. Dans le premier, appelé aussi « les enfers », avaient séjourné les âmes des justes avant que le Christ leur ouvre les portes du ciel. Le second lieu accueillait les nouveau-nés non baptisés, privés éternellement de la vue de Dieu, mais sans aucune souffrance supplémentaire[10]. Thomas d’Aquin exprima même l’opinion qu’« ils possèdent sans douleur leurs biens naturels[11] ». Cet auteur situa le limbe des enfants au-dessous du limbe des Patriarches et au-dessus du purgatoire[12].
Les limbes des enfants, même s’ils sont mentionnés dans la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, n’ont jamais fait l’objet d’un dogme de foi, ce qui explique les divergences d’opinion qui en découlent. Au xvie siècle, en Lorraine, catholiques et réformés s’affrontent sur la question[13]. Parmi les écrits catholiques, le catéchisme du Concile de Trente et celui du diocèse de Meaux parlent seulement des limbes des Patriarches, même si Bossuet a traité ailleurs de la question des limbes des enfants[14]. Le cardinal Bellarmin, qui situe l’enfer au centre de la terre, le divise en quatre parties : la plus profonde est pour les démons et les damnés, la deuxième pour les âmes du purgatoire, « en la troisième sont les ames des petits enfans, qui sont morts sans baptême, lesquels ne souffrent pas des tourmens de feu, mais sont privés à perpétuité de la félicité éternelle » ; la quatrième, appelée limbe ou « le sein d’Abraham », est pour les saints Pères[15]. Le Catéchisme historique de l’abbé Fleury, très connu au Québec[16], ceux des diocèses d’Angers et de Nantes[17] ne mentionnent pas du tout les limbes des enfants. Quant au Compendiosae Institutiones Theologicae[18] de 1778, il se contente de souligner la multiplicité des opinions des théologiens, sans employer explicitement le mot « limbus », ni prendre position sur ce sujet.
En 1786, lors du synode de Pistoie, les Jansénistes provoquèrent une controverse en niant l’existence des limbes qu’ils qualifièrent de « fable pélagienne ». À la suite des protestations de deux évêques français, dont Mgr Languet, évêque de Sens, le pape Pie VI prit position en 1794 dans la bulle Auctorem Fidei qui a été diversement interprétée. Selon Jacques Le Goff et A. Michel, elle signifie « qu’il est légitime de croire à l’existence d’un limbe des enfants dans lequel les âmes de ceux qui meurent avec le seul péché originel sont punies de la peine du dam sans la peine du feu[19] ». George Dyer, par contre, estime que la bulle a condamné uniquement la doctrine « qui rejetait les limbes comme une fable pélagienne », sans reprocher aux Jansénistes de nier l’existence des limbes, puisque cela demeure une question d’opinion[20].
Au cours des années suivantes, des interprétations variées continuent à apparaître dans les catéchismes et ouvrages doctrinaux français. Parmi ceux que l’on retrouve au Québec, certains auteurs optent pour la prudence. En 1790, l’abbé Bergier signale que « quelques théologiens pensent que les enfans morts sans baptême sont dans les limbes », mais sans savoir si ce lieu diffère de celui des Patriarches[21]. À la question : « Que deviennent les enfants morts sans baptême ? », l’abbé Gridel répond en 1861 : « On n’en sait rien », et l’abbé d’Hauterive, en 1874 : « C’est un secret pour nous[22]. » En 1927 encore, le père Deharbe écrit : « Dieu ne nous a pas révélé ce qui arrive aux enfants qui meurent sans baptême[23]. » Et dans le Catéchisme en images de 1908, on peut voir « l’âme d’un enfant mort sans baptême se diriger vers une région inconnue, où elle sera privée à jamais du bonheur céleste[24] ». Est-il besoin de préciser que cet « inconnu » était beaucoup plus inquiétant pour les parents que les limbes, dont on connaissait au moins l’emplacement, et que cette incertitude risquait d’entretenir l’idée d’« errance des âmes entre Ciel et Terre » et la crainte qu’elles reviennent hanter les vivants[25] ?
Figure
Un enfant qui meurt aussitôt après avoir été baptisé va de suite au ciel. C’est ce que représente ce tableau, en haut, à droite, où nous voyons l’âme d’un enfant mort après le Baptême portée au ciel par les anges.
Le Baptême est si nécessaire au salut, que les enfants eux-mêmes ne peuvent entrer dans le ciel s’ils ne sont baptisés. Voilà pourquoi nous voyons sur ce tableau, en haut à gauche, l’âme d’un enfant mort sans Baptême se diriger vers une région inconnue, où elle sera privée à jamais du bonheur céleste.
Quelques auteurs, dans la tradition augustinienne, décrivent sous des couleurs très sombres la condition de ces enfants. Au xviie siècle, Pascal avait écrit : « Ceux qui naissent encore aujourd’hui sans en être retirés (du péché originel) par le baptême sont damnés et privés éternellement de la vision béatifique[26]. » Au siècle suivant, Chevassu renonce au sinistre terme « damné », mais il confirme « que la privation de Dieu qu’ils souffriront éternellement est pour eux une peine très sensible[27] ». En 1823, Mgr de Chabancy va dans le même sens : « Ce qui est certain, c’est que ces enfans ne sont point heureux, comme les pélagiens le prétendaient ; en quoi ils ont été fortement réfutés par saint Augustin, avoué en cela par l’église [sic][28]. » En 1899, enfin, l’abbé Mouzerde réaffirme que leur sort sera « malheureux, sans doute, mais probablement pas pire que le néant[29] ». D’autres se montrent plus optimistes. En 1790, l’abbé Bergier conclut son article par ces mots : « Peu importe dans quel lieu soient ces enfans, pourvu qu’ils n’endurent pas les supplices des réprouvés[30]. » Couturier écrit en 1855 qu’« il n’est pas décidé qu’ils soient positivement malheureux », et l’abbé Gridel rappelle en 1861 que de « grands docteurs croient qu’ils jouissent d’un certain bonheur naturel[31] ».
Au cours du xixe siècle, le courant optimiste prend le dessus, et l’existence des limbes des enfants est affirmée avec de plus en plus d’autorité. En 1864, l’abbé Poussin décrit les limbes comme un asile où « étaient conduits par leur ange gardien tous ceux qui, quoique souillés de la tache originelle […] n’avaient pas personnellement péché, comme les enfants avant l’âge de raison[32] ». En 1875, Mgr Gaume s’inspire des classifications de Thomas d’Aquin et de Bellarmin et signale l’existence, dans les enfers, d’un « lieu où se trouvent les âmes des petits enfants morts sans baptême[33] ». En 1909, l’abbé Duplessy parle des limbes où les âmes des enfants non baptisés peuvent jouir d’un certain bonheur naturel[34]. À partir de 1930, enfin, la totalité des catéchismes que nous avons consultés mentionnent dans ces termes optimistes l’existence des limbes des enfants.
Il existe cependant un autre point sur lequel l’unanimité règne depuis le Concile de Trente : la nécessité de faire baptiser les enfants le plus tôt possible, et ce, à cause du risque de mortalité infantile dont tous étaient conscients. Plusieurs auteurs considèrent comme un crime ou un péché mortel le fait de priver un enfant du bonheur éternel, par pure négligence. L’opinion de l’abbé Gridel est particulièrement claire :
— Q. Ce n’est donc pas un grand péché que de ne pas donner le baptême aux enfants, puisqu’ils ne souffrent pas comme les damnés proprement dits ?
— R. Tous ceux qui sont cause que des enfants meurent sans baptême commettent un très grand crime, parce que Dieu leur a commandé de donner le baptême aux enfants, et en négligeant ce devoir, ils privent ces enfants du plus grand de tous les biens[35].
À travers ces propos, on devine la crainte qu’une perception trop favorable des limbes incitât les parents à retarder le baptême de leur enfant, au risque de l’empêcher d’entrer au paradis.
Dans la province de Québec, il est facile de connaître l’enseignement de l’Église catholique relatif au baptême, grâce aux écrits produits par le magistère. Dans un premier ouvrage rédigé au xviie siècle et qui sera plus tard considéré comme un catéchisme, l’Ursuline Marie de l’Incarnation stipule que « tous les enfants d’Adam sont obligés de recevoir le baptême […] sans quoi ils ne peuvent éviter d’être damnés éternellement[36] ». Dans son Rituel édité au siècle suivant et destiné aux prêtres de son diocèse, le deuxième évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier, met en garde lui aussi contre le « danger de la damnation éternelle, qui est toujours à craindre pour ceux qui ne sont pas baptisés[37] ». Au début des années 1840, quand un « prétendu docteur » laisse entendre que les enfants morts sans baptême sont sauvés aussi bien que les autres, l’évêque rappelle aussitôt qu’ils « ne verront jamais Dieu[38] ». Ces trois auteurs se réfèrent implicitement à la peine du « dam », c’est-à-dire la privation de la vue de Dieu, différente de la peine des sens, mais on peut se demander, avec l’historien Jacques Gélis, si cette subtilité théologique était pleinement comprise des parents[39].
Pour prévenir un tel malheur, tous les évêques du Québec insistent sur le devoir de faire baptiser les enfants dans les plus brefs délais. Mgr de Laval l’exige dès 1664 et, en 1677, il renforce cette objurgation par la menace d’interdiction et même d’excommunication contre les parents négligents[40]. Son successeur précise dans son Rituel que les enfants doivent être présentés à l’église trois ou quatre jours au plus tard après leur naissance. Ces directives, assorties de la recommandation d’ondoyer les nouveau-nés à domicile s’ils semblent en danger de mort, quitte à les amener ensuite à l’église pour compléter la cérémonie du baptême, sont réitérées dans de nombreux catéchismes et autres documents officiels[41].
Pour bien montrer que les enfants morts sans baptême ne font pas partie de l’Église catholique, Mgr de Saint-Vallier, comme les autres évêques français de l’époque, interdit de mettre leur corps en terre sainte. « On les placera dans des endroits honnêtes », mais sans prêtre et sans prières, puisqu’elles sont inutiles pour eux[42]. Le principe de séparation est confirmé par Mgr Lartigue en 1827 : il faudra aménager, pour les enfants morts sans baptême, un autre enclos, « jouxtant le cimetière des fidèles mais séparé de celui-ci[43] ». Mais les parents acceptent mal cette séparation physique : ils veulent « que leur petit partage le même enclos que tous les autres[44] ». Un compromis finit par être trouvé, déjà suggéré par Mgr de Pontbriand, en 1751 : « le terrain destiné aux enfants morts sans baptême peut être situé en dedans du cimetière, mais à condition d’être séparé par une clôture ou un fossé. Naturellement, il ne sera pas béni[45]. » Ces directives, systématiquement reprises par les administrateurs diocésains[46], montrent à quel point les évêques tiennent à souligner la différence entre les enfants baptisés, membres de l’Église catholique, et les non-baptisés qui en sont exclus.
Quant à l’hypothèse des limbes, elle n’a pas suscité au Québec de controverse semblable à celle du synode de Pistoie, et l’enseignement de l’Église à ce sujet peut être reconstitué, encore une fois, principalement au moyen des catéchismes. Dans le premier, édité en 1702, Mgr de Saint-Vallier mentionne uniquement les « lymbes où étaient renfermées les âmes des patriarches et des prophètes », et pas du tout les limbes des nouveau-nés[47]. La même information figure dans les autres catéchismes officiels publiés de 1815 à 1952. Même dans le catéchisme de Sens, par Mgr Languet, réédité plus d’une fois dans le diocèse de Québec entre 1765 et 1863, il n’est pas question des limbes des enfants, ce qui pourrait étonner, compte tenu de la polémique qui avait opposé l’auteur aux Jansénistes. Il dit simplement que Jésus-Christ descendit aux enfers, « lieu où étaient détenues les âmes des justes morts dans la grâce de Dieu depuis la création du monde[48] ». Un Manuel du chrétien, imprimé à Québec en 1813 et qui reproduit un ouvrage déjà édité à Toulouse, mentionne brièvement « les limbes des enfans » qui diffèrent des « limbes des saints Pères[49] », mais ce n’est qu’à la fin du xixe siècle que les auteurs québécois se prononcent sur cette question.
C’est dans les livres destinés aux enseignants que l’on commence à traiter ce sujet. En 1881, l’auteur du Questionnaire explicatif du petit catéchisme fait preuve d’autant de prudence que certains auteurs français de l’époque. À la question : « Que savons-nous des enfants morts avec le péché originel ? », il répond : « La foi nous apprend qu’ils sont privés de la vue de Dieu et ne nous dit rien de plus[50]. » Puis, en 1895, dans son Code catholique, l’abbé Gosselin se décide, non sans moultes précautions, à aborder ce problème. Après avoir décrit les limbes comme « un lieu de repos où les âmes des justes attendaient l’arrivée de Jésus-Christ », il ajoute : « Les limbes n’existent plus maintenant, ou, s’ils existent encore, c’est seulement pour les enfants qui n’ont pas commis le péché actuel et qui sont morts sans baptême[51]. »
L’année suivante, dans l’Explication du catéchisme de Québec, Montréal et Ottawa, l’abbé Lasfargues se montre plus catégorique : « Les enfants qui meurent sans avoir reçu le baptême vont dans un lieu que l’on nomme les limbes. Ils ne souffrent pas, mais ils ne jouissent pas du bonheur surnaturel de voir et d’aimer Dieu[52]. » L’abbé Luche réitère les mêmes propos dans les Notes d’un catéchiste[53] en 1897. Ces trois auteurs reprennent donc la distinction effectuée par Thomas d’Aquin entre les limbes des justes et ceux des enfants morts sans baptême.
À partir de 1930, cette opinion se répand sans rencontrer d’opposition. On la rencontre notamment dans le Cours de religion pour les adultes et dans la « Page des lecteurs » des Annales de la Bonne Sainte Anne[54]. Dans des ouvrages destinés au grand public, l’abbé Victorin Germain émet des propos aussi optimistes que possible, inspirés du Docteur angélique : « Ceux qui vont dans les limbes ne sont pas punis », précise-t-il, et ils jouissent d’un bonheur naturel qui les satisfait, même s’il n’égale pas le bonheur surnaturel des baptisés. Il fait entrer dans cette catégorie les foetus avortés qu’il considère comme des êtres humains, des « ébauches d’enfants[55] ».
Ces prêtres (ainsi que d’autres auteurs québécois[56]) se prononcent donc sans hésitation en faveur de l’existence des limbes des enfants, mais en ayant garde de sous-estimer l’importance prioritaire qu’il faut accorder au baptême. À l’instar de ses confrères français, l’abbé Gosselin considère comme un « crime horrible de laisser volontairement mourir quelqu’un sans le baptême », d’abord parce qu’il ne verra jamais Dieu, mais aussi parce qu’il sera éternellement séparé de ses parents et des membres de sa famille qui eux ont été baptisés[57]. En 1951, le Catéchisme catholique (premier, parmi les manuels destinés aux écoliers, à mentionner les limbes des enfants non baptisés) exprime le même regret :
Q. Où vont les âmes des enfants morts sans avoir reçu le baptême ?
R. Dans les limbes.
Q. Pourquoi devons-nous regretter qu’un enfant meure sans avoir reçu le baptême ?
R. Parce que cet enfant n’entrera jamais dans le ciel[58].
Jusqu’en 1895, au Québec, la mention des limbes des nouveau-nés est donc absente non seulement des catéchismes et des livres destinés aux enseignants, mais aussi du Catéchisme de la Sainte Famille[59], répandu sous le Régime français, du Manuel des parents chrétiens[60], dans lequel l’abbé Mailloux consacre pourtant quatre chapitres au baptême, et des sermons des prédicateurs de Montréal au début du xixe siècle[61]. Sans doute, les prêtres les plus érudits pouvaient puiser des informations à ce sujet dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin ou d’autres ouvrages, et en parler dans leurs sermons. Mais ce n’était visiblement pas une priorité pour le clergé québécois.
On peut se demander pourquoi le magistère catholique a tant tardé à traiter ce problème théologique. La réponse la plus évidente est que, l’existence des limbes n’étant pas un dogme de foi, cette mention n’avait pas sa place dans un petit catéchisme destiné à faire connaître l’essentiel de la doctrine catholique. D’autant plus que dans le contexte de l’après-Conquête, le clergé se souciait plutôt de défendre les dogmes catholiques contre les protestants. C’est pourquoi les ouvrages de controverse traitaient du purgatoire, des indulgences et du culte des saints, mais pas des limbes[62].
Par ailleurs, l’historien Alain Croix exprime l’avis, en parlant de la Bretagne du xvie et du xviie siècles, que « la notion des limbes est sans doute difficilement accessible à des fidèles qui en sont encore trop souvent à ânonner leur Credo[63] ». On pourrait en dire autant du diocèse de Québec au début du xixe siècle où, constatait Mgr Plessis, « il est de fait qu’un tiers, pour ne pas dire la moitié des fidèles n’entendent ni l’oraison dominicale (le Pater Noster), ni le symbole (le Credo)[64] ». Dans de telles conditions, il était logique que le clergé consacre ses efforts à convaincre les parents de la nécessité du baptême précoce, sans y ajouter l’hypothétique question des limbes.
Comment expliquer alors le changement d’attitude des théologiens québécois à la fin du xixe siècle ? L’historien Jacques Le Goff estime qu’au Moyen Âge, les théologiens ont élaboré la doctrine des limbes dans le but de réconforter les parents. Il voit un lien entre « cet adoucissement du sort des enfants morts sans baptême » et « la plus grande attention portée aux enfants par la société chrétienne aux xiie et xiiie siècles[65] ».
Cette explication peut être transposée au Québec de la fin du xixe siècle. On relève à cette époque de nombreux indices d’une préoccupation nouvelle pour le bien-être des enfants. En 1876 et 1880, des médecins publient les premiers livres sur la façon de soigner les enfants[66]. L’année 1882 voit la fondation, à Montréal, de la première société pour la protection des femmes et des enfants. D’une façon plus générale, au tournant du siècle, les médecins et les élites sociales entreprennent de lutter contre la mortalité infantile, en améliorant la qualité des soins aux nourrissons, et les mères collaborent avec empressement à ce mouvement[67].
Cela ne signifie pas, bien sûr, que l’amour parental fait son apparition au Québec à cette époque seulement. Depuis le début de la colonie, il pouvait se manifester de bien d’autres façons, notamment par le désir d’assurer le bonheur éternel des enfants en les faisant baptiser. C’est pourquoi il importe de savoir non seulement comment étaient observées les directives de l’Église, mais aussi de chercher les coutumes et les croyances relatives aux limbes et à la survie de l’âme qui, même quand elles s’écartent des règles canoniques, n’en expriment pas moins un souci réel du bien-être de l’enfant.
L’observance des règles canoniques
Pour savoir dans quelle mesure les parents obéissaient à l’impérieuse consigne de faire baptiser leurs enfants au plus tôt, il faut utiliser les registres paroissiaux qui permettent de connaître la date de la naissance des enfants et celle de leur baptême. Grâce aux ressources de l’informatique, les démographes ont étudié, pour le xviie siècle, 17 726 actes dont plus de 75 % contiennent ces deux dates. Hubert Charbonneau a constaté que l’intervalle moyen entre les deux événements s’établit à 4,7 jours, ce qu’il trouve élevé en comparaison de la situation qui prévalait alors en France[68]. Néanmoins, les deux tiers des nouveau-nés canadiens recevaient le baptême le jour de leur naissance ou le lendemain.
Une analyse plus poussée lui a révélé que les baptêmes étaient plus retardés à l’origine du pays, entre 1620 et 1659, « quand le peuplement était plus dispersé, les communications plus difficiles et l’organisation paroissiale peu développée[69] ». La géographie influençait naturellement le délai entre la naissance et le baptême : « Les intervalles moyens et médians sont les plus élevés dans les paroisses qui desservaient par voie de mission des localités privées de prêtres. » Par contre, la médiane se révèle plus courte en milieu urbain[70].
L’influence du climat se fait également sentir : « Presque deux fois plus grand en janvier qu’en juillet, l’âge moyen au baptême diminue au coeur de l’hiver, quand les traîneaux circulent assez bien sur la neige », remonte ensuite lors de la fonte printanière, puis à l’automne, peut-être à cause des travaux saisonniers[71]. Enfin, la journée de la naissance revêt une certaine importance. Lorsque l’enfant voit le jour le vendredi ou le samedi, les parents ont tendance à retarder le baptême jusqu’au dimanche suivant. Par contre, s’il naît du lundi au jeudi, on le fait baptiser sans délai[72].
L’historien Marcel Trudel aboutit à des conclusions semblables après avoir traité 756 actes de baptême répartis entre 1627 et 1663. À Montréal, où les habitations se regroupaient toutes dans le voisinage immédiat de l’église, l’intervalle entre la naissance et le baptême est le plus court, tandis que la moyenne la plus élevée s’observe à la Pointe-Lévy, sur la rive du Saint-Laurent opposée à Québec, qui constituait le milieu de peuplement le plus excentrique, à cause du fleuve et de la faible fréquence des visites du missionnaire[73]. Compte tenu des difficultés inhérentes à un pays de colonisation, on peut donc dire qu’au xviie siècle, les parents faisaient baptiser leurs enfants aussi vite qu’ils le pouvaient.
Pour le xixe siècle, une étude statistique effectuée par Christine Hudon portant sur le diocèse de Saint-Hyacinthe permet de constater là aussi des écarts régionaux. Dans la zone seigneuriale, la plus anciennement occupée, où la population jouit depuis longtemps des services d’un curé résident, la quasi-totalité des baptêmes sont effectués dans un délai de trois jours, malgré la négligence de quelques notables[74]. Par contre, les délais s’allongent dans les unités pastorales des Cantons de l’Est, colonisés plus tardivement. En raison d’un peuplement dispersé, de l’absence de prêtres, d’un enseignement catéchistique déficient et des nombreux contacts avec les protestants, la doctrine religieuse était probablement moins intériorisée, estime l’auteure, au point que « le délai de trois jours pour faire baptiser les enfants n’était guère significatif pour ces catholiques[75] ».
Pour la première moitié du xxe siècle, historiens et ethnologues ont constaté la coutume du baptême précoce. Le risque élevé de mortalité infantile, ainsi que l’opinion de l’entourage qui aurait blâmé sévèrement les parents si, par leur faute, un enfant était mort sans baptême, concouraient à hâter la cérémonie[76]. Certains auteurs soulignent qu’on n’hésitait pas à exposer un bébé fragile aux intempéries du climat, au risque de le rendre malade, malgré la possibilité de l’ondoyer à domicile, car pour ces parents catholiques, « la vie de l’âme prévalait sur celle du corps[77] ». Lorsque le bébé était gros et vigoureux, et manifestait « une bonne envie de vivre », il arrivait qu’on remette la cérémonie à plus tard[78]. Mais il s’agissait de cas minoritaires. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, dans la région du Saguenay tout au moins, la proportion d’enfants baptisés dans les 48 heures qui suivaient leur naissance était supérieure à 80 %[79].
La mentalité religieuse de l’époque s’exprimait aussi dans une coutume généralisée aussi bien en France, notamment en Bretagne, qu’au Québec : la mère attendait que son enfant soit baptisé pour lui donner son premier baiser, car avant la cérémonie, il était censé être sous l’emprise du démon[80].
Vers le milieu du xxe siècle, le délai entre la naissance et le baptême s’allonge, du moins dans une paroisse d’une petite ville minière de l’Abitibi, où une étude a été effectuée pour l’année 1958. Sur un total de 256 baptêmes, Louis-Edmond Hamelin constate que 7,4 % seulement ont lieu avant le sixième jour après la naissance, 64,4 % à partir du sixième jour mais avant le douzième, et 28 % à partir du douzième jour jusqu’à une quarantaine[81]. La conclusion s’impose : les baptêmes ne se font pas immédiatement après les naissances. Cela découle du fait que 97,5 % des naissances se produisent à l’hôpital, et que 90 % des baptêmes se déroulent le dimanche. Comme l’hospitalisation dure environ une semaine, l’enfant est baptisé le premier dimanche suivant sa sortie de l’hôpital. Cela entraîne un délai moyen de neuf jours, soit le double de celui observé au xviie siècle, malgré le fait que les services paroissiaux sont beaucoup mieux organisés à Rouyn que dans la vallée du Saint-Laurent en période de colonisation.
Pour expliquer cet état de chose, l’auteur évoque la possibilité que ces baptêmes tardifs soient un indice de la tiédeur religieuse des parents. Mais celle-ci est toute relative. À Marseille, la même année, moins de 10 % des enfants sont baptisés pendant les 15 jours qui suivent leur naissance[82]. Dans la mesure où l’on peut comparer deux villes aussi différentes, les habitants de Rouyn apparaissent comme des catholiques fort empressés.
L’autre explication formulée par l’auteur nous semble plus plausible : grâce aux progrès de la médecine, les bébés sont de moins en moins exposés à mourir durant les premiers jours[83]. C’est à cause de ce risque que les auteurs du Catéchisme du Concile de Trente et leurs successeurs, depuis Mgr de Laval en 1664 jusqu’à l’abbé van Agt en 1948, pressaient les parents de faire baptiser leurs enfants aussitôt après la naissance[84]. Mais en 1958, comme ce risque diminue, le baptême peut paraître moins urgent. L’auteur conclut qu’à Rouyn, « c’est l’hôpital qui a imposé l’espace moyen de 9 jours[85] ». Certaines personnes particulièrement pieuses déploraient cependant un tel délai, craignant que le diable laisse sa marque dans l’âme d’un enfant qu’il avait occupée aussi longtemps[86].
Paradoxalement, l’importance accordée au baptême se manifeste même dans les cas d’infanticide de nouveau-nés, et ce, jusqu’au début du xxe siècle. On sait que l’édit de 1556 du roi Henri II, en vigueur en Nouvelle-France, considérait comme une circonstance aggravante le fait de supprimer des nouveau-nés « sans leur avoir fait impartir le saint sacrement de baptesme » et en « les privans de la sépulture coustumière des chrestiens[87] ». On ne s’étonnera donc pas de constater qu’au Québec comme en France, des mères infanticides aient affirmé avoir baptisé leur enfant avant de le tuer ou de le laisser mourir[88]. En 1726, par exemple, le lieutenant général de la prévôté de Québec demande à une accusée si elle avait ondoyé son enfant. Celle-ci répond que « oui, elle a pris de l’eau dans sa bouche, la jetté [sic] dessus cet enfant et fait le signe de la croix dessus[89] ». Deux siècles plus tard, une autre femme déclare avoir ondoyé de la même façon son enfant illégitime avant de faire disparaître son cadavre. De leur côté, des médecins appelés au chevet de ces mères, en 1906 et 1910, déplorent que l’enfant soit mort sans baptême, car « il sera privé de la présence de Dieu durant toute l’éternité[90] ». Il est possible que des femmes sur qui pesait une accusation criminelle aient voulu atténuer la gravité de leur geste en prétendant faussement avoir baptisé leur enfant. Mais les propos tenus par les médecins et les hommes de loi montrent bien que, même dans des situations aussi tragiques, le salut éternel des nouveau-nés préoccupait ces catholiques[91].
Compte tenu de ces cas exceptionnels et des écarts mentionnés plus haut, on constate que les catholiques du Québec demeurèrent longtemps fidèles à la coutume du baptême précoce. L’Église avait donc réussi à imposer ses rites, mais non sans difficulté au début. Il en fut de même pour la consigne de faire enterrer les enfants morts sans baptême à un endroit distinct des baptisés, comme l’a expliqué l’historien Ollivier Hubert. Mais là encore, le clergé parvint à faire respecter ses volontés comme le prouvent des témoignages datant du début du xxe siècle[92]. Reste à savoir si cet empressement à faire baptiser les enfants était bien motivé par la peur des limbes ou par d’autres croyances.
Pratiques et croyance populaires
Si les efforts du clergé québécois ont été couronnés de succès dans l’implantation du baptême précoce, c’est peut-être parce que le peuple comprenait assez facilement l’idée de purification de l’âme, d’élimination de la tache originelle par le symbole de l’eau baptismale[93]. L’importance reconnue au baptême est exprimée dans une vieille chanson française retrouvée au Québec : Marianson. Un mari, croyant sa femme infidèle, la tue ainsi que son enfant. Avant d’expirer, elle le convainc de son innocence. Il implore alors son pardon et obtient comme réponse : « Pour ma mort je vous la pardonne, mais non pas celle du nouveau-né. C’est à Dieu à la pardonner. Ah ! Il est mort pas baptisé[94]. » Cet enfant non baptisé n’entrera jamais au ciel : c’est cela le crime impardonnable aux yeux des catholiques.
Mais la population saisissait-elle aussi bien des notions plus abstraites comme le baptême de sang ou le baptême de désir ? Et à l’époque où l’existence des limbes n’était pas encore enseignée dans le catéchisme, comment réagissait-elle devant la perspective de la « damnation éternelle » qui menaçait les enfants non baptisés ?
En dépit de l’empressement de l’entourage, il était inévitable que des enfants meurent sans baptême. En France, certains parents désolés apportaient alors le petit cadavre devant un autel de la Vierge, d’un saint ou d’une personne réputée telle, et ils l’imploraient de rendre la vie à l’enfant juste assez longtemps pour qu’on puisse le baptiser[95]. L’attitude de l’Église face à cette pratique n’a pas toujours été la même, comme l’expliquent Jacques Gélis et Didier Lett. Jusqu’au début du xviiie siècle, les évêques français entérinèrent ces récits de miracles qui confirmaient la toute-puissance de Dieu et le pouvoir d’intercession des saints, surtout dans le contexte de lutte contre les protestants[96]. Mais à partir des années 1730, les autorités commencèrent à faire preuve de plus de réticences envers ces « manifestations populaires toujours proches des superstitions[97] ». Néanmoins, on retrouve des histoires édifiantes de résurrection de nouveau-nés dans certains catéchismes jusqu’en 1950[98].
Au Québec, les « sanctuaires à répit », analysés par Jacques Gélis[99], brillent par leur absence, phénomène que nous avons d’abord attribué à la vigilance du clergé post-tridentin, moins tolérant que le clergé médiéval à l’endroit de ces formes de piété populaire. L’étude la plus récente de cet auteur permet d’avancer d’autres explications. Celui-ci a bien montré que les chapelles à répit existaient surtout dans l’est de la France et qu’on en retrouve très peu de traces dans l’ouest[100]. Or, c’est justement des provinces de l’ouest que sont venus la plupart des immigrants français[101] qui, par conséquent, ignoraient probablement cette pratique. De plus, comme Gélis l’a également expliqué, les miracles de « répit » étaient utilisés par le clergé français pour confondre les hérétiques[102]. Au Canada, comme les protestants étaient peu nombreux sous le Régime français, de tels récits miraculeux devenaient inutiles, même si, à l’occasion, on recourait aux reliques des saints pour obtenir une conversion[103].
Est-ce à dire que sur les rives du Saint-Laurent, toutes les pratiques et croyances relatives au baptême et aux limbes étaient parfaitement orthodoxes ? Pour la période du Régime français, les sources à ce sujet sont rarissimes, mais une Américaine de passage dans la colonie en 1754 a laissé un témoignage unique en son genre. Enlevée par des Indiens dans un village du New Hampshire, Susanna Johnson fut vendue à la famille Duquesne, de Montréal, avec son enfant née en captivité. Mais ce bébé tomba malade, ce qui inquiéta fort les Montréalais : « The superstitious people were convinced that she would either die, or be carried off by the Devil, unless baptized. I yielded to their wishes, and they prepared for the ceremony, with all the appendages annexed to their religion. Mr. Duquesne was godfather[104]. »
Ce bref récit contient deux informations précieuses. D’abord, il n’est pas question des limbes des enfants, ce qui ne surprend pas pour l’époque. Et la famille Duquesne craint plutôt que la fillette soit emportée par le diable, ce qui correspond à une croyance répandue en Bretagne : le démon essaie de faire mourir les nouveau-nés avant leur baptême pour s’emparer de leur âme qu’il considère comme sa propriété[105].
Une telle crainte apparaît aussi dans la chanson « L’enfant vendu au diable », retrouvée en 1962. Poussé par la pauvreté, un homme vend au démon l’enfant dont sa femme est enceinte. Au moment de l’accouchement, lorsque le diable entre dans la chambre, la mère demande l’aide de Jésus et de la Vierge. Cette dernière, brandissant une étole (comme un prêtre), fait reculer l’intrus en disant : « Auras-tu le droit sur ces pauvres petits enfants, qui sont teints mais du sang de mon Enfant[106] ? » On peut voir dans cette chanson à la fois un reste d’inquiétude à l’égard des puissances infernales et la sécurité que procurent la confiance en la protection de la Vierge et la rédemption effectuée par le Christ. Mais était-ce la peur du diable ou la peur des limbes qui incitait les parents à faire baptiser leurs enfants ?
La croyance aux limbes commence à se manifester au Québec au début du xxe siècle. Le témoin le plus prolixe à ce sujet est Benoît Lacroix qui a décrit les croyances et coutumes de la région rurale de Saint-Michel-de-Bellechasse, où il est né en 1915, et surtout les opinions de son père né en 1882. (« J’ai pour mon dire… »). Il ne précise pas toujours s’il cite des propos entendus dans son enfance ou des conversations tenues avec son père jusqu’à la veille de sa mort en 1969. On ne peut savoir non plus si les idées de ce dernier ont évolué au cours de sa vie, et dans quelle mesure il a pu être influencé par le Concile Vatican II ou simplement par le savoir de son fils, dominicain. Ainsi, Caïus Lacroix n’acceptait pas que l’on refuse d’enterrer en terre sainte les enfants morts sans baptême. Il désapprouvait aussi la voisine qui avait refusé d’embrasser sa petite avant qu’elle soit baptisée : « Un enfant, ça pèche pas, c’est un ange. Un petit bec, ça chasse le diable[107] ! »
Benoît Lacroix présente la croyance aux limbes comme la cause déterminante de l’empressement au baptême :
Les parents ne veulent pas attendre. Il faudrait une grosse tempête pour les empêcher, aussitôt l’enfant né, d’aller le faire baptiser. Toujours la hantise des limbes, ce territoire hors ciel voisin du purgatoire ; rien qu’à penser qu’un bébé malade serait né inutilement, sans aller au ciel, c’est la panique ! Laura Blais, notre voisine, vient d’accoucher, un 5 février. L’enfant est fragile, il va mourir. Cela veut dire que s’il n’est pas baptisé tout de suite, Laura ne le reverra pas, ni au ciel ni ailleurs : « J’ai toujours eu pour mon dire qu’il ne faut jamais prendre de chance. Les prêtres nous permettent d’attendre la fin des tempêtes, mais je sais que si tu n’es pas baptisé, t’es pas chrétien ; pas chrétien, tu vas aux limbes[108] !
On pourrait soupçonner Benoît Lacroix d’interpréter le comportement des habitants de son village à travers le prisme de sa formation théologique. Mais le résultat d’une enquête menée auprès de personnes de la même génération confirme ses propos. Dans le cadre d’une étude sur les coutumes entourant la naissance au Saguenay, de 1900 à 1950, Josée Gauthier a rencontré des femmes nées avant 1915 et qui ont eu leur dernier enfant entre 1922 et 1952. Interrogées sur le sort des enfants non baptisés, 11 informatrices sur 15 ont répondu qu’ils séjournaient dans les limbes, privés à tout jamais de la vue de Dieu[109].
L’enseignement sur les limbes, que le clergé commence à donner au tournant du siècle, atteint donc une bonne partie de la population, sinon toute. Mais cela ne va pas sans une certaine confusion entre les différents concepts théologiques. L’Église enseigne que l’ondoiement est la partie essentielle du sacrement de baptême, complétée par une cérémonie incluant les exorcismes, le sel sur la langue, etc. Les adultes qui veulent entrer dans l’Église catholique peuvent suppléer à ce baptême d’eau par le baptême de désir, soit « le désir de le recevoir quand on pourra, avec le regret sincère des fautes qu’on a commises », ou le baptême de sang, qui est « le martyre enduré pour la foi de Jésus-Christ[110] ».
Mais le public a visiblement du mal à s’y retrouver parmi ces définitions pourtant contenues dans le petit catéchisme. Au cours de la décennie 1930, dans les Annales de la Bonne Sainte Anne, un lecteur demande si un bébé qui meurt après avoir été baptisé passe par le purgatoire. Un deuxième veut savoir si un bébé mort sans être ondoyé peut aller au ciel, étant donné que sa mère avait vivement désiré son baptême. Un troisième enfin se demande si les protestants iront dans les limbes[111]. Et parmi les femmes interrogées par Josée Gauthier, l’une croit que l’ondoiement correspond au baptême de désir, tandis qu’une autre explique que le baptême de sang signifie que la mère est morte en couches afin d’épargner son enfant[112].
Cette confusion dans les notions théologiques a suscité la pratique suivante dans la région de Charlevoix, durant la première moitié du xxe siècle. Lorsque le nouveau-né était faible, infirme ou mort, la sage-femme procédait à cette cérémonie : laver un pied ou une main de l’enfant, puis avec un peu de sang de la mère, faire un signe de croix en prononçant ces paroles : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » L’ethnologue Jean-Philippe Gagnon y voit un « baptême sous condition, appelé baptême de sang », ce qui s’écarte fort des définitions qui figurent dans les catéchismes à partir de 1888[113] ». L’historien Jacques Gélis qualifie cette façon d’agir de « pratique de substitution[114] », soit une pratique semblable à celle des chapelles à répit, qui vise à procurer à l’enfant le bonheur éternel.
Visiblement, le clergé du diocèse de Québec réussissait plus facilement à surveiller les lieux de culte publics comme les chapelles rurales (et à prévenir l’implantation des chapelles à répit) qu’à contrôler les pratiques qui se déroulaient dans l’intimité des foyers. Mais au-delà de la stricte orthodoxie, on voit s’affirmer la volonté populaire de procurer à l’enfant le bonheur du ciel, d’une façon ou d’une autre.
Il faut se garder d’oublier aussi que l’espoir d’être réunies dans l’au-delà avec un enfant disparu trop tôt a aidé bien des mères catholiques à faire leur deuil. L’auteure de ces lignes se souvient de deux d’entre elles qui avaient perdu chacune un enfant en bas âge durant la décennie 1940. Profondément affligées, elles trouvaient un réconfort dans la pensée que cet enfant les attendait au ciel. L’une le disait même sur son lit de mort. Les dogmes catholiques, si rigides fussent-ils, comportaient donc un aspect consolant que la population avait intégré.
Conclusion
Les articles de Jacques Le Goff et de Didier Lett laissent l’impression que la théorie des limbes des enfants, élaborée par des théologiens du Moyen Âge, s’est immédiatement répandue parmi la population. Le second surtout écrit qu’« il est clair qu’à cette époque (le xiiie siècle) le mot, l’état et le lieu existent dans la mentalité de l’homme médiéval[115] ». Plus prudent, Jacques Gélis pense qu’il s’agit d’une « catégorie intellectuelle certainement mal perçue par le mental collectif ». En outre, ce lieu est rarement représenté dans l’iconographie. « Le limbe des enfants n’est pas un thème populaire. Il a une existence théologique, mais on ne le montre pas[116]. »
La représentation picturale des limbes des enfants est également absente des ouvrages que nous avons parcourus, qu’ils soient français ou québécois. En fait, au Québec, on constate que l’énoncé de cette hypothèse se limite d’abord aux livres de théologie destinés aux prêtres et aux séminaristes, puis elle s’étend aux manuels des maîtres de catéchisme, passe par les ouvrages de vulgarisation et atteint enfin le petit catéchisme, ce qui correspond à une reconnaissance officielle par le magistère. Visiblement, pendant tout le Régime français et le siècle qui a suivi la Conquête, la priorité du clergé était d’inculquer à la population la coutume du baptême précoce ainsi que les notions de base de la doctrine catholique, sans s’attarder à discuter une question qui ne faisait même pas l’unanimité au sein de l’Église.
Chaque étape dans l’évolution des prises de position du clergé québécois à ce sujet coïncide avec un changement d’attitude de la société vis-à-vis des enfants. L’abbé Gosselin commence à parler des limbes à la fin du xixe siècle, au moment où s’amorce la lutte contre la mortalité infantile. Puis l’existence de ce lieu est confirmée dans le Catéchisme catholique en 1951, c’est-à-dire à l’époque du baby boom, alors que les parents veulent jouir sans arrière-pensée de la prospérité économique de l’après-guerre et en faire profiter leurs enfants. Mais ces changements ne doivent pas masquer la continuité de l’enseignement ecclésial : le bonheur parfait se trouve dans le ciel, et les limbes ne sont qu’un pis-aller.
Du ve au xxie siècle, les hommes d’Église ont donc toujours recherché ce qu’ils considéraient comme l’intérêt supérieur de l’enfant, mais leur discours s’est adouci avec le temps, accordant une place grandissante aux sentiments des parents. C’est ainsi qu’ils sont passés de la position de saint Augustin, qui nous semble très dure, à celle de saint Thomas d’Aquin, plus humaine à nos yeux, puis à une théorie énoncée au milieu du xxe siècle : le ciel et les limbes seraient non pas des lieux mais des états différents, et les mères chrétiennes pouvaient entretenir l’espoir de retrouver dans l’au-delà un enfant non baptisé pour jouir ensemble, elle, d’un bonheur surnaturel, et lui, d’un bonheur naturel[117]. La décision récente de Benoît XVI a mis fin à ces spéculations. Franchissant un dernier pas, il s’est adapté à la sensibilité contemporaine en présentant le bonheur éternel comme un droit pour tous les enfants, et non un privilège réservé à quelques-uns.
Dans la longue durée, la réaction des catholiques québécois à l’enseignement de l’Église concernant le baptême est connue par les travaux des démographes et des ethnologues. On sait que le clergé a réussi à faire respecter la règle du baptême précoce et de l’enterrement des enfants non baptisés dans un lieu séparé, mais non sans difficulté au début. D’ailleurs, comme Christine Hudon l’a démontré, seul un travail d’encadrement sans relâche garantissait l’observance de ces rites. Il faudrait se garder toutefois d’établir un lien trop étroit entre le délai au baptême, le degré de ferveur religieuse et l’intensité de l’amour des parents. Bien des facteurs pouvaient influencer le comportement de ces derniers : les contraintes géographiques en tout premier lieu, le désir de protéger la santé d’un nouveau-né en le gardant à l’abri des intempéries, sans oublier la possibilité de l’ondoyer à domicile. En paraphrasant Jean-Louis Flandrin, on peut dire que la piété et l’amour parental ne s’expriment pas facilement en statistiques.
Quant au rôle que jouait la croyance aux limbes dans l’empressement au baptême, il a varié selon les époques. Établie pour le xxe siècle, grâce au témoignage de personnes âgées, cette influence semble avoir été inopérante sous le Régime français. À une époque où le clergé n’enseignait pas encore l’existence des limbes des enfants, c’est plutôt la crainte du diable qui se manifeste dans le témoignage de Susanna Johnson et dans une vieille chanson conservée jusque dans la décennie 1960. Dans quelle mesure et jusqu’à quelle époque la peur du diable a-t-elle rivalisé avec la peur des limbes dans l’imaginaire des Québécois ? La réponse se trouve peut-être dans les archives de folklore, notamment celles de l’Université Laval. Après avoir étudié les contes et légendes qui relient le diable à la danse, à l’avarice, à la construction de ponts et d’églises[118], on pourrait chercher ceux qui entourent la naissance et le baptême.
La mémorisation textuelle du Petit catéchisme n’impliquait pas forcément la compréhension des concepts théologiques qu’il véhiculait. Ces erreurs d’interprétation ont entraîné l’existence, au Québec, de pratiques de substitution au baptême qui jouaient le même rôle que les chapelles à répit en France. Tolérées ou blâmées par le clergé, toutes ces pratiques servaient à entretenir chez les parents l’espoir que leur enfant serait heureux dans un au-delà où ils le retrouveraient un jour. Selon les époques, cette recherche du bonheur éternel a été stimulée par la peur du diable, la peur des limbes ou simplement la peur de l’inconnu. Aujourd’hui encore, notre société laïcisée n’éprouve-t-elle pas le besoin de surmonter son désarroi, face à la mort d’un enfant, en se disant que « Dieu avait peut-être besoin d’un ange[119] » ?
Parties annexes
Note sur l'auteure
Marie-Aimée Cliche est chargée de cours au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal. Elle a d’abord fait éditer sa thèse de doctorat sous le titre Les pratiques de dévotion en Nouvelle-France. Comportements populaires et encadrement ecclésial dans le gouvernement de Québec (Les Presses de l’Université Laval, 1988). Puis elle s’est consacrée à l’étude de l’histoire des femmes et de la famille au Québec, et a publié plusieurs articles, notamment dans la RHAF, sur le féminisme chrétien, l’infanticide, les mères célibataires, les procès en séparation de corps, l’inceste et la violence en éducation. Son dernier livre, Maltraiter ou punir? La violence envers les enfants dans les familles québécoises, 1850-1969 (Boréal, 2007), a reçu le Prix Jean-Charles-Falardeau, 2006-2007. Elle prépare actuellement un ouvrage qui s’intitulera Fous, ivres ou cruels? Les parents filicides au Québec, 1775-1965. Le présent article sur les limbes lui permet une fois de plus de mettre en évidence, dans la longue durée, le lien entre l’histoire religieuse et l’histoire de la famille au Québec.
Notes
-
[1]
Cet article a d’abord fait l’objet d’une communication lors d’un colloque organisé par la Société historique et archéologique de Langres, en mai 2006, intitulé « Soins des corps, soins des âmes. Médecine et assistance en France et en Nouvelle-France au xviie siècle », dont les Actes doivent être publiés. Je remercie les professeurs Raymond Brodeur de l’Université Laval et Louis Rousseau de l’Université du Québec à Montréal, qui ont lu et commenté une première version de ce texte, ainsi que Philippe Martin, de l’Université de Nancy, et les évaluateurs de la Revue d’histoire de l’Amérique française qui m’ont aidée de leurs conseils.
-
[2]
Martine Nouaille, « Le Vatican abolit les limbes », Le Devoir, 21-22 avril 2007, B8 ; Robert Fleury, « Les limbes, Sam Hamad et les BS », Le Soleil, 29 avril 2007, 24 ; et « En hausse, en baisse. Les limbes », La Presse, 22 avril 2007, 6 Plus ; Jean-Marc Salvet, « Au diable les limbes ! », Le Soleil, 24 avril 2007, 20.
-
[3]
Christine Hudon, Prêtres et fidèles dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, 1820-1875 (Sillery, Septentrion, 1996), 365 et 377 ; Serge Gagnon, Quand le Québec manquait de prêtres. La charge pastorale au Bas-Canada (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006), 71, et Mourir hier et aujourd’hui. De la mort chrétienne dans la campagne québécoise au xixe siècle à la mort technicisée dans la cité sans Dieu (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987), 22.
-
[4]
L. G., « Les limbes à la poubelle ? », L’Actualité, 1er mars 2006, 19.
-
[5]
Pour les besoins de ce travail, nous avons employé une classification plus sommaire que celle de Raymond Brodeur dans Les catéchismes au Québec, 1702-1763 (Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1990). Nous avons utilisé les ouvrages disponibles à la bibliothèque de l’Université du Québec à Montréal et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
-
[6]
Nous avons parcouru les récits de vie mentionnés dans le livre de Denise Lemieux et Lucie Mercier, Les femmes au tournant du siècle, 1880-1940. Âges de la vie, maternité et quotidien (Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1989.
-
[7]
Jacques Gélis, Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne (Paris, Audibert, 2006), 171.
-
[8]
Jacques Le Goff, « Les Limbes », dans Un autre Moyen Âge (Paris, Gallimard, 1999 (1986)), 1245.
-
[9]
Cité par J. Gélis, Les enfants des limbes…, op. cit., 171.
-
[10]
J. Bellamy, « Baptême (Sort des enfants morts sans) », Dictionnaire de théologie catholique (Paris, Letouzey et Ané, 1905), 2 : 364-378 ; A. Gaudel, « Limbes », Dictionnaire de théologie catholique (1926) : 9 : 760-772 ; J. de Mahuet, « Limbes », Catholicisme, Hier, aujourd’hui, demain (Paris, Letouzey et Ané, 1975), 7 : 792-800.
-
[11]
Thomas d’Aquin, Somme théologique. L’Au-delà, Suppl., Questions 69-74, traduction française par J. D. Folghera, notes et appendices par J. Wébert (Paris, Desclée & Cie, 1951), 328.
-
[12]
J. Gélis, Les enfants des limbes…, op. cit., 177-178.
-
[13]
Philippe Martin, Figures de la mort en Lorraine, xvie-xixe siècle (Metz, Éditions Serpenoise, 2007), 102.
-
[14]
Catéchisme du Concile de Trente, latin-français (Mons, Gaspard Migeot, 1685), I : 136 ; Bossuet, Catéchisme de Meaux, dans Oeuvres complètes (Paris, Beaucé-Rusand, 1826), 28 : 94. Dans sa « Défense de la tradition et des saints pères », Bossuet traite des erreurs de Pélage au sujet des enfants qui meurent avant le baptême. Op. cit., 26 : 228-231.
-
[15]
Bellarmin, Catéchisme ou Ample Déclaration de la doctrine chrétienne et du symbole des apôtres (Hugues Denoual, 1681), 51.
-
[16]
Fleury, Catéchisme historique contenant en abrégé l’histoire sainte et la doctrine chrétienne (Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, 1786). Ce catéchisme a été utilisé par Mgr de Saint-Vallier. Voir Raymond Brodeur, Catéchisme et identité culturelle dans le diocèse de Québec de 1815 (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1998), 54.
-
[17]
François Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles. Essai de démographie et de psychologie historiques (Paris, Mouton, 1971), 472 ; Beauvau et Mesnard, Catéchisme du diocèse de Nantes (Nantes, Nicolas Verger, 1723). Alain Croix, Culture et religion en Bretagne aux 16e et 17e siècles (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1995), 105, et « Catéchiser les Sauvages en Bretagne au xviie siècle : de la conversion à l’instruction », dans Raymond Brodeur et Brigitte Caulier, dir., Enseigner le catéchisme. Autorités et institutions, xvie-xxe siècles (Québec/Paris, Les Presses de l’Université Laval/Cerf, 1997), 73-86.
-
[18]
Joanne-Ludovico de La Marthonie de Caussade, Compendiosae Institutiones Theologicae, ad usum Seminarii Pictaviensis, Pictavii (Typis, J.-F. Faulcon, 1778), 3 : 71-72. Cet ouvrage fut utilisé dans les séminaires du Québec. Lucien Lemieux, Histoire du catholicisme québécois. Les xviiie et xixe siècles. Les années difficiles (1760-1839) (Montréal, Boréal, 1989), 111.
-
[19]
J. Le Goff, loc. cit., 1256 et A. Michel, Les fins dernières (Paris, Bloud et Gay, 1929), 154.
-
[20]
George J. Dyer, Limbo. Unsettled Question (New York, Sheed and Ward, 1964), 87, et The Denial of Limbo and the Jansenist Controversy (Mundelein, Saint Mary of the Lake Seminary, 1955).
-
[21]
Bergier, Dictionnaire de théologie, extrait de l’Encyclopédie méthodique (Liège, Société typographique, 1790), 4 : 601-602.
-
[22]
Abbé Gridel, Explication du catéchisme par des comparaisons et des exemples (Lyon, Girard et Josserand, 1861), I : 303, 3e édition. P. d’Hauterive, Grand catéchisme de la persévérance chrétienne (Paris, Hippolyte Walzer, 1874), 8 : 168.
-
[23]
Joseph Deharbe, Grand catéchisme ou Exposé de la doctrine chrétienne à l’usage des écoles et des familles chrétiennes (Imprimerie de Montligeon, 1927), 236.
-
[24]
Catéchisme en images (Paris, Maison de la bonne presse, 1908), image no 19.
-
[25]
Jacques Gélis, « La mort du nouveau-né et l’amour des parents : quelques réflexions à propos des pratiques de “répit” », Annales de démographie historique (1983) : 26 ; Didier Lett, « Faire le deuil d’un enfant mort sans baptême au Moyen Âge : la naissance du limbe pour enfants aux xiie-xiiie siècles », Devenir, 7,1 (1995) : 108-109.
-
[26]
Pascal, Oeuvres complètes (Paris, La Pléiade, 1991), 952, cité par P. Martin, op. cit., 102.
-
[27]
M. Chevassu, Conférences sur le symbole des apôtres, sur les sacrements et sur les commandements de Dieu et de l’Église (Rouen, Chez la Veuve Dumesnil, 1784), 3 : 250.
-
[28]
Instructions générales en forme de catéchisme, par ordre de messire Georges-Lazare Berger de Chabancy, évêque de Montpellier (Paris, Librairie ecclésiastique, 1823), 3 : 40.
-
[29]
Abbé Mouzerde, Grand album d’images en couleurs pour l’explication du catéchisme (Paris, Tolra, 1899), 2 : image 58.
-
[30]
Bergier, op. cit., 601.
-
[31]
Jean Couturier, Catéchisme dogmatique et moral, ouvrage utile aux peuples, aux enfants et à ceux qui sont chargés de les instruire (Paris, Lagny Frères, 1855), 2 : 491, 9e édition ; Gridel, op. cit., 303.
-
[32]
C. Poussin, Catéchisme tout en histoires ou Le Catéchisme du Concile de Trente expliqué par des faits puisés dans l’histoire du passé et dans les récits contemporains (Paris, Nouvelle librairie catholique, 1864), 1 : 313, 3e édition.
-
[33]
Mgr Gaume, Catéchisme de persévérance (Paris, Gaume et Cie, 1875), 3 : 299, 11e édition.
-
[34]
Abbé E. Duplessy, Le Pain des Petits. Explication dialoguée du catéchisme (Paris, Téqui, 1909), 246.
-
[35]
Gridel, op. cit., 303-304.
-
[36]
Catéchisme de la vénérable mère Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec ou Explication familière de la doctrine chrétienne (Tournai, Casterman, 1878), 287, 3e édition. Pour connaître les circonstances de rédaction et d’édition de cet ouvrage, voir Raymond Brodeur, « Le catéchisme de Marie de l’Incarnation : la Parole qui fait écho », dans Raymond Brodeur, dir., Femme, mystique et missionnaire. Marie Guyart de l’Incarnation (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2001), 353-366.
-
[37]
Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, Rituel du diocèse de Québec (Paris, 1703), 14.
-
[38]
Cité par S. Gagnon, Mourir autrefois, op. cit., 21-22.
-
[39]
J. Gélis, Les enfants des limbes, op. cit., 177, et Didier Lett, « De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance du limbus puerporum aux xiie-xiiie siècles », dans R. Fossier, dir., La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne (Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1997), 81.
-
[40]
Mgr de Laval, « Ordonnance sur l’administration du sacrement de baptême », 29 mars 1664 et 5 février 1677, dans Mgr H. Têtu et l’abbé C.-O. Gagnon, Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec (Québec, 1887), I : 100-101 et 161-162.
-
[41]
Mgr de Saint-Vallier, Rituel, 14 ; Catéchisme du diocèse de Québec, 1702 (Montréal, Éditions franciscaines, 1958), 242-243, avec présentation, notes explicatives et commentaires par Fernand Porter. Les mêmes directives apparaissent dans le Rituel du diocèse de Paris. Voir Jeanne Ferté, La vie religieuse dans les campagnes parisiennes, 1622-1695 (Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1962), 294 et 300. Voir aussi : Appendice au Compendium du Rituel romain à l’usage des diocèses de la province ecclésiastique de Québec (Québec, Côté, 1853), 125 ; Recueil d’ordonnances synodales et épiscopales du diocèse de Québec (Québec, Brousseau, 1859), 6 ; C.-N. Gariépy, Nouveau code de droit canonique et théologie morale (Québec, L’Action sociale, 1920), 38 ; Discipline diocésaine publiée par l’autorité de S. Ém. Le cardinal Villeneuve (Québec, L’Action catholique, 1937), 41 ; Premier synode du diocèse de Sherbrooke célébré par Mgr Desranleau (Évêché de Sherbrooke, 1942), 208 ; Actes et décrets du deuxième synode de Trois-Rivièrespromulgués par Mgr Pelletier (Trois-Rivières, Chancellerie de l’Évêché, 1950), 116.
-
[42]
Saint-Vallier, Rituel, 18 et 307 ; P. Martin, op. cit., 101, 282, 323, 331 ; F. Lebrun, op. cit., 471 ; Christian Desplat, « La protection de l’enfance en Gascogne à l’époque moderne », dans Naissance, enfance et éducation dans la France méridionale du xvie au xxe siècles, Hommage à Mireille Laget (Université de Montpellier III, 2000), 239 ; Régis Bertrand, « Les enfants “qui remplissent le ciel”. Obsèques et sépulture des enfants en Provence aux xviie-xviiie siècles », dans Hommage à Mireille Laget, 194.
-
[43]
Ollivier Hubert, Sur la terre comme au ciel. La gestion des rites par l’Église catholique du Québec (fin xviie-mi-xixe siècle) (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2000), 236.
-
[44]
Ibid.
-
[45]
Registre de l’Ancienne Lorette, 16 juillet 1751, folio 18, 59, cité par Richard Lalou, Des enfants pour le paradis. La mortalité des nouveau-nés en Nouvelle-France, thèse de doctorat (démographie), Université de Montréal, 1990, 52.
-
[46]
Voir note 41 et S. Gagnon, Mourir autrefois, 87-88.
-
[47]
Mgr de Saint-Vallier, Catéchisme, op. cit., 89.
-
[48]
Jean-Joseph Languet, Catéchisme du diocèse de Sens (Québec, Brown et Gilmore, 1765), 28. Lire à ce sujet : Élisabeth Germain, « Le catéchisme “Sens-Québec”. Histoire et enjeux d’une controverse », dans Raymond Brodeur et Jean-Paul Rouleau, dir., Une inconnue de l’histoire de la culture. La production des catéchismes en Amérique française (Sainte-Foy, Éd. Anne Sigier, 1986), 144-169 ; Élisabeth Lacelle, « Le catéchisme de Sens-Québec : « Aux origines catéchétiques d’un peuple à double allégeance », ibid., 171-178 ; Raymond Lemieux, « Fidélité et rupture : des enjeux paradoxaux dans l’histoire canadienne du Catéchisme de Sens », ibid., 179-182 ; Nelson-Martin Dawson, Le Catéchisme de Sens en France et au Québec (Québec, Nota Bene, 2000) ; R. Brodeur, Catéchisme et identité culturelle, op. cit., 56-60.
-
[49]
Manuel du chrétien : où l’on trouve tout ce qui est nécessaire pour s’instruire de sa religion et se sanctifier (Québec, Nouvelle imprimerie, 1813), 131. Première édition faite à Québec sur celle de Toulouse de l’année 1793.
-
[50]
Questionnaire explicatif du Petit Catéchisme de la province ecclésiastique de Québec, suivi d’un petit questionnaire pour les jeunes enfants (Montréal, Chapleau & Fils, 1881), 59.
-
[51]
David Gosselin, Le Code catholique ou Commentaire du catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa (Montréal, Beauchemin, 1895), 188. Précisons que dans un autre ouvrage publié précédemment, l’abbé Gosselin parlait uniquement des limbes où étaient détenues les âmes des justes. Le Catéchisme des commençants (Sainte-Anne de la Pocatière, Firmin Proulx, 1886), 25.
-
[52]
Édouard Lasfargues, Explication du Catéchisme de Québec, Montréal et Ottawa (Québec, s.é., 1896), 83. Voir Jean Morin, « Un livre du maître devenu catéchisme. “Le Catéchisme Lasfargues” 1896 », dans R. Brodeur et J.-P. Rouleau, dir., op. cit., 361-378 ; G. Laperrière, « L’arrière-plan français du “catéchisme Lasfargues” », ibid., 379-382 ; J. Racine, « Lasfargues et la question sociale », ibid., 383-388.
-
[53]
A. Luche, Notes d’un catéchiste ou Court commentaire littéral sur le catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal, Ottawa, par un prêtre du diocèse de Montréal (Montréal, Cadieux et Derome, 1897), 182 et 288.
-
[54]
Cours de religion pour les adultes. Extraits du Catéchisme catholique du Cardinal Gasparri (Québec, Librairie de l’Action catholique, 1944), 153. L’imprimatur est de 1937 ; « Page des Lecteurs », Annales de la Bonne Sainte Anne, 65,4 (avril 1937).
-
[55]
Victorin Germain, Catéchisme pittoresque à l’usage des commençants, de leurs parents et de leurs maîtres (Québec, chez l’auteur, 1952 (1931)), 104, et « Une ébauche d’enfant », 31 décembre 1934, reproduit dans Les Chroniques de la Crèche (Québec, chez l’auteur, 1943), 50.
-
[56]
Mgr Cauly, Résumé de catéchisme à l’usage des élèves de 7e année (Laprairie, Frères de l’Instruction chrétienne, 1935), 16 ; Abbé Joseph Carrier, Synopsis du catéchisme de Québec, Montréal et Ottawa (Québec, Librairie de l’Action catholique, 1939), 27 ; Lucien Pagé, Catéchisme (Montréal, Clercs de Saint-Viateur, 1945), 261.
-
[57]
D. Gosselin, Code catholique, op. cit., 282.
-
[58]
Le Catéchisme catholique. Édition canadienne (1951), 175.
-
[59]
La Solide Dévotion à la très sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, avec un catéchisme qui enseigne à pratiquer leurs vertus (Paris, Florentin Lambert, 1675).
-
[60]
Alexis Mailloux, Le Manuel des parents chrétiens (Québec, L’Action sociale, 1909 (1851)).
-
[61]
Communication personnelle de Louis Rousseau, auteur de La Prédication à Montréal de 1800 à 1830. Approche religiologique (Montréal, Fides, 1976).
-
[62]
Voir J. Mannock, Manuel abrégé de controverse : ou Controverse des pauvres (Québec, Nouvelle imprimerie, 1806), 169 p. ; Abrégé des vérités catholiques sous la forme de profession de foi pour l’instruction des fidèles, vu et approuvé par H. Hudon, administrateur du diocèse, 1841, 12 p. ; Alexis Mailloux, Le petit arsenal du catholique ou Traité élémentaire de controverse (Mile-End, Imprimerie de l’Institution des sourds-muets, 1885), 412 p., 2e édition.
-
[63]
A. Croix, op. cit., 105.
-
[64]
Cité par R. Brodeur, Catéchisme et identité culturelle, op. cit., 103.
-
[65]
J. Le Goff, loc. cit., 1246.
-
[66]
Hubert La Rue, De la manière d’élever les jeunes enfants au Canada ou Entretiens de madame Genest à ses filles (Québec, Darveau, 1876) ; Séverin Lachapelle, La Santé pour tous. Petit Guide de la mère auprès de son enfant malade (Montréal, Compagnie d’imprimerie canadienne, 1880).
-
[67]
Denyse Baillargeon, Un Québec en mal d’enfants. La médicalisation de la maternité, 1910-1970 (Montréal, Éditions du remue-Ménage, 2004).
-
[68]
Hubert Charbonneau, « Colonisation, climat et âge au baptême des Canadiens au xviie siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, 38,3 (hiver 1985) : 342-343.
-
[69]
Ibid., 345.
-
[70]
Ibid., 347-348.
-
[71]
Ibid., 351.
-
[72]
Ibid., 348, et Raymond Roy, Yves Landry et Hubert Charbonneau, « Quelques comportements des Canadiens au xviie siècle d’après les registres paroissiaux », Revue d’histoire de l’Amérique française, 31,1 (juin 1977) : 64.
-
[73]
Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France. III : La Seigneurie des Cent-Associés. La Société (Montréal, Fides, 1983), 463-465.
-
[74]
C. Hudon, op. cit., 366-368.
-
[75]
Ibid., 375-377.
-
[76]
Lemieux et Mercier, op. cit., 200 ; Anne-Marie-Desdouits, Le monde de l’enfance. Traditions du pays de Caux et du Québec (Paris/Québec, CNRS/Les Presses de l’Université Laval, 1990), 49 ; Jean-Philippe Gagnon, Rites et croyances de la naissance à Charlevoix (Ottawa, Leméac, 1979), 102.
-
[77]
Lemieux et Mercier, op. cit., 200-201.
-
[78]
Jeannette Vekeman Masson, Grand-maman raconte la Grosse-Île (Éditions La liberté, 1981), 152. L’événement se situe en 1916. Josée Gauthier, Évolution des pratiques coutumières entourant la naissance au Saguenay et dans Charlevoix (1900-1950), mémoire de maîtrise (études régionales), Université du Québec à Chicoutimi, 1991, 232.
-
[79]
J. Gauthier, op. cit., 233.
-
[80]
Agnès Larin, D’où viens-tu, Agnès ? (Montréal, Éd. Bergeron, 1980), 41-42 ; Benoît Lacroix, La foi de ma mère. La religion de mon père (Montréal, Bellarmin, 2002), 191 ; Lemieux et Mercier, op. cit., 200 ; J. Gauthier, op. cit., 194 ; Arnold Van Gennep, Manuel de folklore français contemporain (Paris, Picard, 1982 (1943)), 1 : 143 ; Paul-Yves Sébillot, LeFolklore de la Bretagne (Paris, Maisonneuve et Larose, 1968), 1 : 9.
-
[81]
Louis-Edmond Hamelin, « Nombre de jours entre la naissance et le baptême dans une paroisse de Rouyn », Ad Usum Sacerdotum, 14,3 (mars 1959) : 74.
-
[82]
Fernand Charpin, Pratique religieuse et formation d’une grande ville. Le geste du baptême et sa signification en sociologie religieuse. Marseille, 1806-1958 (Paris, Centurion, 1964), 42 et 178.
-
[83]
L.-E. Hamelin, loc. cit., 75.
-
[84]
Catéchisme du Concile de Trente (1685), 389 ; Mgr de Laval, « Ordonnance du 29 mars 1664 », MEQ, I : 162 ; Saint-Vallier, Rituel, 14 ; A. Mailloux, Manuel des parents chrétiens, 23 ; J. Couturier, op. cit., 2 : 493 ; Mgr Gaume, op. cit., 3 : 39 ; abbé Mouzerde, op. cit., image 58 ; Catéchisme du Concile de Trente (Paris, Roger et Chernoviz, 1900), I : 257 ; Abbé J. van Agt, Mon catéchisme expliqué (Paris, Lethielleux, 1948), 139.
-
[85]
L.-E. Hamelin, loc. cit., 76.
-
[86]
Propos tenus par une religieuse enseignante, à Rouyn, en 1961 ou 1962.
-
[87]
« Édit contre le recel de grossesse et d’accouchement », dans François-André Isambert, Recueil des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 (Paris, 1827-1829, 13), 472.
-
[88]
Y.-B. Brissaud, « L’infanticide à la fin du Moyen Âge, ses motivations psychologiques et sa répression », Revue historique de droit français et étranger, 50 (1972) : 240-241 ; Annick Tillier, Des Criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne, 1825-1865 (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001), 195-196 ; P. Martin, op. cit., 137.
-
[89]
Archives nationales du Québec à Québec, Collection de pièces judiciaires et notariales, no 730 et 739, janvier 1726, procès contre Geneviève Gaudereau.
-
[90]
Cas cités dans notre article « L’infanticide dans la région de Québec, 1660-1969 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 44,1 (été 1990) : 45-46.
-
[91]
En 1956, un prêtre français agit de même : il tua sa maîtresse, l’éventra et tua l’enfant après l’avoir baptisé, dans le but d’éviter un scandale pour lui et son Église. Cité par M. Schachter, « Vue d’ensemble sur le problème de l’infanticide », Aggiornamento Pediatrico, IX,6 (juin 1958) : 299.
-
[92]
J. Gauthier, op. cit., 205 ; Lorenzo Proteau, Grand-mère Toinette m’a raconté… (Éd. Priorités, 1981), 49.
-
[93]
Brigitte Caulier, L’eau et le sacré. Les cultes thérapeutiques autour des fontaines en France du Moyen Âge à nos jours (Québec/Paris, Les Presses de l’Université Laval/Beauchesne, 1990), 10 et 82.
-
[94]
Marius Barbeau, Le Rossignol y Chante. Première partie du répertoire de la chanson folklorique française au Canada (Ottawa, Musée national du Canada, 1962), 133-138.
-
[95]
L’un de ces « répits » fut attribué aux prières de Jeanne d’Arc en 1430. Extrait du procès de Jeanne d’Arc, cité par Régine Pernoud, Jeanne d’Arc par elle-même et par ses témoins (Paris, Seuil, 1962), 174 ; et Colette Beaune, Jeanne d’Arc (Paris, Perrin, 2004), 289-292.
-
[96]
Voir de tels récits dans Danièle Alexandre-Bidon et Didier Lett, Les Enfants au Moyen Âge, ve-xve siècles (Paris, Hachette, 1997), 53-54, et C. Poussin, op. cit., 2 : 66-68.
-
[97]
D. Lett, « Faire le deuil… », loc. cit., 107, et Jacques Gélis, L’arbre et le fruit. La naissance dans l’Occident moderne, xvie-xixe siècle (Paris, Fayard, 1984), 516 ; Les enfants des limbes, op. cit., 10.
-
[98]
C. Poussin, op. cit., 2 : 66-68 ; Hauterive, op. cit., 8 : 292-294 ; François Spirago, Catéchisme catholique populaire (Paris/Montréal, Lethielleux/Éditions Apostolicum, 1950), 470.
-
[99]
Jacques Gélis, « La mort et le salut spirituel du nouveau-né. Essai d’analyse et d’interprétation du “sanctuaire à répit”, xve-xixe s. », Revue d’histoire moderne et contemporaine, xxxi (juillet-septembre 1984) : 361-376, et L’arbre et le fruit, op. cit., 509-520.
-
[100]
J. Gélis, Les enfants des limbes, op. cit., 12-13.
-
[101]
Hubert Charbonneau, Vie et mort de nos ancêtres. Étude démographique (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1975), 38.
-
[102]
J. Gélis, Les enfants des limbes, op. cit., 229-232.
-
[103]
Marie-Aimée Cliche, Les pratiques de dévotion en Nouvelle-France. Comportements populaires et encadrement ecclésial dans le gouvernement de Québec (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1988), 48.
-
[104]
Susanna Johnson, A Narrative of the Captivity of Mrs Johnson Containing an Account of her Sufferings, During Four Years, With the Indians and French (Windsor (Vt), A. Spooner, 1807), 88-89, 2e édition, revue et augmentée.
-
[105]
Dominique Besançon, Sorcelleries et diableries de Bretagne. Traditions populaires et croyances religieuses (Terre de Brume Éditions, 2004), 236-237 ; Paul Sébillot, Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne (Paris, Maisonneuve et Larose, 1967 (1882)), 184-187 ; F.-M. Luzel, Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne (Paris, Maisonneuve et Larose, 1967 (1881)), 174.
-
[106]
Conrad Laforte et Carmen Roberge, Chansons folkloriques à sujet religieux (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1988), 304-306.
-
[107]
B. Lacroix, op. cit., 191-192, 236.
-
[108]
B. Lacroix, op. cit., 192.
-
[109]
J. Gauthier, op. cit., 204.
-
[110]
Catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal, Ottawa, approuvé le 20 avril 1888 (Québec, Imprimerie générale Côté, s.d.), 30.
-
[111]
« Page des Lecteurs », Annales de la Bonne Sainte Anne, 65,4 (avril 1937) ; 63,3 (mars 1935).
-
[112]
J. Gauthier, op. cit., 103. Ajoutons que l’auteure elle-même s’écarte de la définition du Petit Catéchisme lorsqu’elle écrit que « le baptême de désir correspondait à la volonté des parents de faire baptiser leur enfant après sa naissance ».
-
[113]
J.-P. Gagnon, op. cit., 87, et Catéchisme de1888, 30.
-
[114]
Communication personnelle de l’historien Jacques Gélis.
-
[115]
D. Lett, « Faire le deuil d’un enfant… », loc. cit., 105.
-
[116]
J. Gélis, « De la mort à la vie. Les sanctuaires à répit », Ethnologie française, XI,3 (1981) : 222, cité par B. Caulier, op. cit., 63, et Les enfants des limbes, op. cit., 178.
-
[117]
Théorie du jésuite anglais Bernard Leeming, citée par Dyer, Limbo. Unsettled Question, 4.
-
[118]
Jean Du Berger, Le Diable à la danse (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006) ; Eugène Achard, « L’avare et le diable », dans Ce que raconte le vent du soir (Montréal, Librairie générale canadienne, 1943), 57-66 ; Daniel Mativat, Le Personnage du diable dans le conte littéraire québécois au xixe siècle. Étude « socio-textuelle », mémoire de maîtrise (études littéraires), Université du Québec à Montréal, juin 1979.
-
[119]
« Drame à l’île Perrot », La Presse, 2 novembre 2007, A3.
Liste des figures
Figure
Un enfant qui meurt aussitôt après avoir été baptisé va de suite au ciel. C’est ce que représente ce tableau, en haut, à droite, où nous voyons l’âme d’un enfant mort après le Baptême portée au ciel par les anges.
Le Baptême est si nécessaire au salut, que les enfants eux-mêmes ne peuvent entrer dans le ciel s’ils ne sont baptisés. Voilà pourquoi nous voyons sur ce tableau, en haut à gauche, l’âme d’un enfant mort sans Baptême se diriger vers une région inconnue, où elle sera privée à jamais du bonheur céleste.