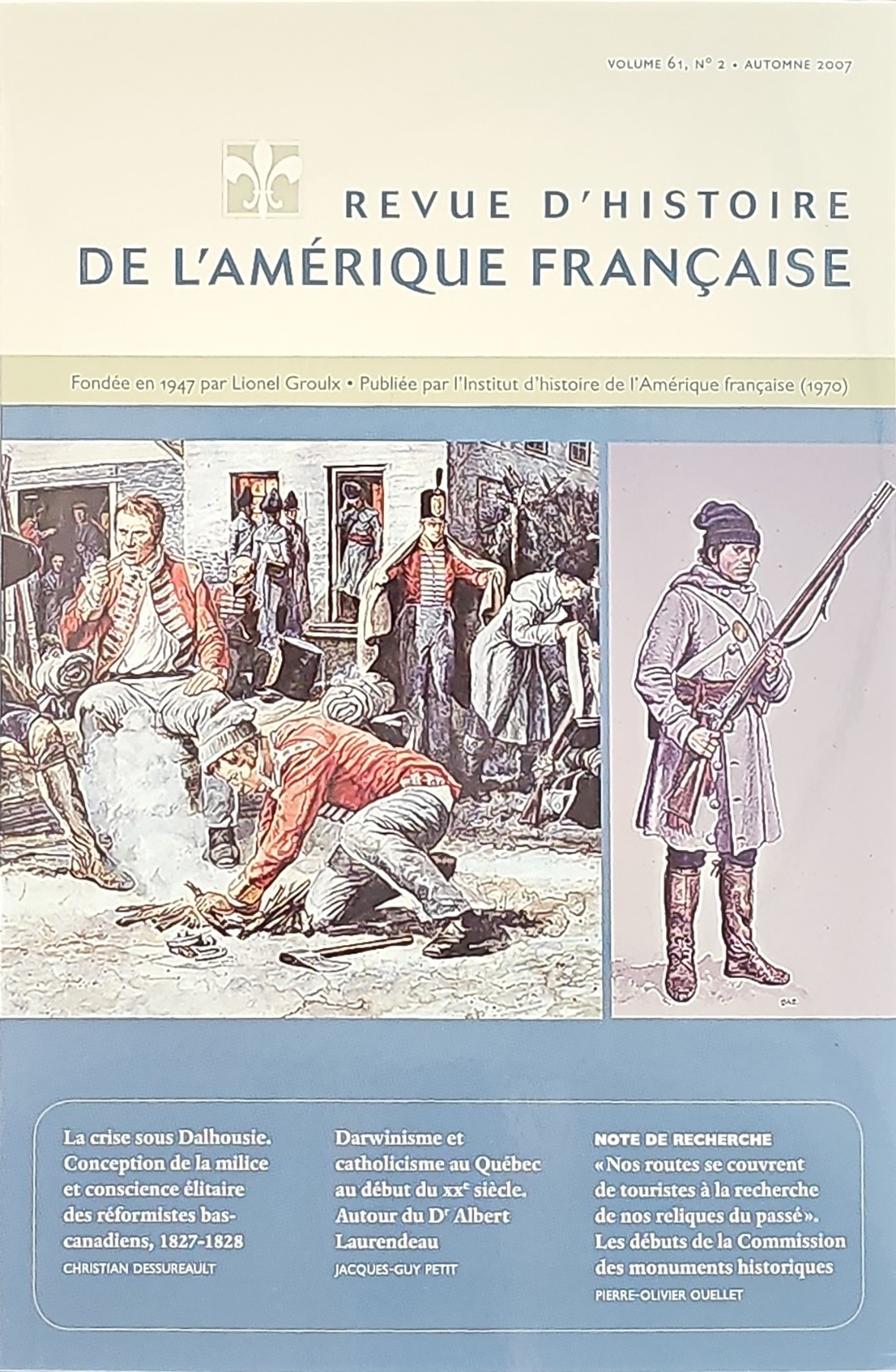Corps de l’article
Voici deux ouvrages qui abordent une question à la mode depuis la fin des années 1990 : les relations entre mémoire, histoire et éducation. Les historiens étant souvent des éponges qui absorbent le discours ambiant et le transforment tant bien que mal en discours savant, ils sont nombreux depuis quelques années à réfléchir sur la place de l’histoire dans l’enseignement secondaire et les relations entre histoire et mémoire, appliquant parfois leurs méthodes aux pratiques de commémoration (anciennes ou récentes) de façon à mieux saisir la dynamique des usages sociaux de l’histoire. Ce mouvement, qui donne lieu à des travaux éclairants, génère aussi son lot de banalités (ouverture, identités multiples et fragmentées, ignorance de l’histoire, etc.).
Le volume publié sous la direction de Ruth Sandwell résulte d’une série d’interventions diffusées en 2002 et 2003 à l’émission Ideas sur les ondes anglaises de Radio-Canada. On y retrouve les complaintes habituelles sur le fossé qui sépare les historiens universitaires des enseignants du secondaire ; on déplore le fait que les uns ignorent comment les pratiques des autres ont changé depuis vingt ans et vice versa. On insiste aussi sur l’importance d’enseigner l’histoire pour développer un esprit critique. On y parle de l’enseignement de l’histoire au Canada comme si cette histoire formait une entité homogène ; le vieux rêve Canadian d’une « national history teachers organization » y trouve aussi place. Bien sûr, le Québec n’est pas totalement oublié et un professeur de l’Université Laval, Jocelyn Létourneau, y présente quelques résultats d’une enquête sur la mémoire des élèves/étudiants québécois de fin secondaire, cégep et premier cycle universitaire. Cet article est en fait basé sur un texte antérieur paru dans la Canadian Historical Review en 2004 et alors cosigné avec Sabrina Moisan. Ce texte, que les auteurs disent avoir révisé, est d’ailleurs traduit en anglais dans l’ouvrage dirigé par Peter Seixas également recensé ici.
Si l’ouvrage de Sandwell contient plusieurs affirmations péremptoires, prises comme allant de soi mais jamais vraiment établies, et quelques discours performatifs qui prennent leurs désirs pour la réalité, celui dirigé par Peter Seixas, qui porte sur la conscience historique, est plus solide et donc plus utile, bien que l’absence d’index ne facilite pas sa consultation. On y retrouve les contributions d’auteurs de plusieurs pays qui présentent soit des enquêtes sur la conception de l’histoire et de la mémoire en Angleterre, en Australie et au Québec, soit des réflexions théoriques qui tentent de mieux saisir les différences entre mémoire, histoire, conscience historique et représentations sociales.
Il est impossible de résumer ici les douze contributions. Je me bornerai à glisser un mot sur celle de Létourneau et Moisan qui intéressera peut-être davantage les lecteurs de la RHAF. Étant donné que les auteurs classent certains discours des étudiants sous la catégorie « victimization narratives », on peut se demander sur quelle méthode d’analyse syntaxique ou sémantique repose leur catégorisation. Parmi neuf exemples regroupés en annexe, les auteurs citent l’extrait suivant : « The people of Quebec have often resisted being assimilated into Anglophone culture. This gave rise to a separatist movement leading up to several events ; the Patriotes, the October Crisis, the two Referendums… ». J’ai beau le lire et le relire, je ne vois rien de victimaire dans cet extrait qui n’est qu’un énoncé factuel : c’est un fait que des membres de la société québécoise ont résisté à l’assimilation et qu’ils ont pensé (à tort ou à raison) que la souveraineté pouvait servir de rempart contre un tel danger. Ce n’est pas juger de ce fait en bien ou en mal que de le constater. Comme l’analyse des deux auteurs repose sur la classification de contenus de textes, cet exemple peut faire douter de la validité de leurs classements. Ce serait faciliter la critique des sources que de les rendre accessibles – sur un site Internet par exemple – aux chercheurs intéressés.
Ce qui me frappe dans les textes de ces deux volumes, comme dans la plupart des interventions sur l’enseignement de l’histoire, c’est l’absence totale d’une idée qui me paraît pourtant essentielle : proposer une lecture ethnographique de l’histoire qui décrit de façon distanciée et détachée les grandes étapes du déroulement de l’histoire mondiale des origines de l’homo sapiens en Afrique à sa dispersion sur le reste de la planète (dont le Québec) et la vie des diverses sociétés qui se sont formées et ensuite attaquées, pillées, parfois fusionnées, etc. Tout comme il est possible aux éthologistes de décrire les luttes entre fourmis rouges et fourmis noires et d’analyser les comportements esclavagistes de certaines espèces, sans crier au scandale ou créer une « Association pour la défense des fourmis noires », les historiens devraient s’habituer à prendre plus de distance face aux événements qu’ils étudient. Cela faciliterait grandement les discussions et éviterait surtout le moralisme facile qui fait souvent déraper les débats sur l’enseignement de l’histoire.