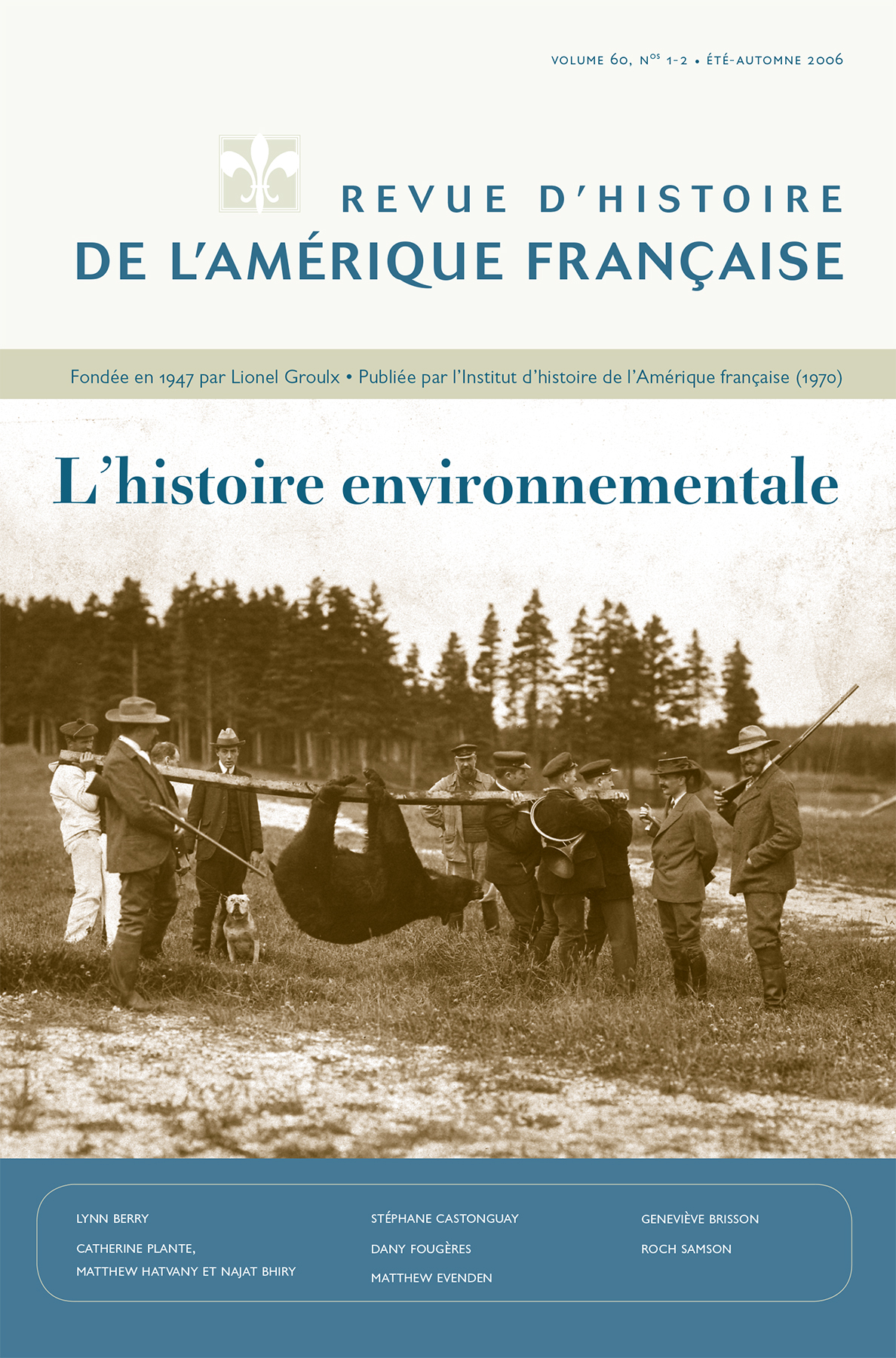Résumés
Résumé
Le grand tremblement de terre de 1663 frappa des centres de peuplement de la vallée du Saint-Laurent, en Nouvelle-France, durant les exubérants derniers jours du carnaval, un festival bruyant que le clergé désapprouvait en raison de la frivolité due à l’ivresse et de l’indifférence face aux rites solennels précédant le carême. La débauche du carnaval annuel constituait un rappel désagréable des excès causés durant toute l’année par le commerce de l’eau-de-vie, autorisé par l’administration coloniale malgré l’opposition de l’Église. Pour les observateurs missionnaires, ce bouleversement géologique si dramatique apparut comme un message divin d’avertissement et de soutien à leur condamnation des citoyens dissolus, des marchands sans scrupules et des administrateurs arrogants. Cet article tient compte de tous les témoignages publiés de témoins oculaires du tremblement de terre de 1663 et les compare aux recherches sismologiques récentes dans le but d’analyser la construction sociale de cet événement géophysique.
Abstract
The great earthquake of 1663 struck St Lawrence Valley settlements of New France during the riotous last days of carnival, a raucous festival frowned upon by the clergy for its drunken frivolity and disregard for solemn pre-Lenten ritual. The excesses of the annual carnival were an unpleasant reminder of the excesses caused year-round by the brandy trade, a trade sanctioned by the colonial administration despite opposition by the Church. For missionary observers, the arrival of such a calamitous geological upheaval appeared to be a divine message of warning and of support for their stand against unbridled citizens, unscrupulous traders, and arrogant officials. This article considers all of the published eyewitness accounts of the earthquake of 1663 alongside recent seismological research in order to analyse the social construction of this geophysical event.
Corps de l’article
Traduction : Estelle Cano
Traduction préliminaire : Wayne Berry et Gina Létourneau
Le 5 février 1663, à 17h30, un grand tremblement de terre secoua les centres de peuplement de la Nouvelle-France dans la vallée du Saint-Laurent. Il s’accompagna de vastes glissements de terrain le long de plusieurs cours d’eau gelés, qui entraînèrent l’effondrement de berges et le déracinement de forêts. Des bâtiments dans les trois avant-postes coloniaux français de Québec, Montréal et Trois-Rivières furent secoués et des cheminées s’écroulèrent. On se rendit compte plus tard que des secousses avaient été ressenties, à divers degrés, de Montréal jusqu’en Acadie et plus au sud en Nouvelle-Angleterre. Aujourd’hui, les sismologues sont d’avis que le tremblement de terre fut parmi les plus importants jamais enregistrés dans le nord-est de l’Amérique du Nord.
Parmi les habitants de la région de la Nouvelle-France touchée par le tremblement de terre, on compte plusieurs populations iroquoiennes et algonquiennes, et environ 3000 colons français qui s’étaient établis le long du Saint-Laurent[2]. Cet énorme bouleversement ne tua personne, mais la magnitude du tremblement de terre et ses nombreuses répliques sismiques terrorisèrent la population pendant des mois. Les jésuites, qui administraient les missions de la région, ainsi que les ursulines et les augustines laissèrent plusieurs comptes rendus détaillés de cet événement dramatique. Tous attribuaient ce violent tremblement de terre à l’oeuvre de Dieu. En examinant de plus près les sources documentaires, on constate que ces prêtres et religieuses étaient convaincus que le tremblement de terre avait été déclenché à ce moment et à cet endroit précis afin de corriger certaines transgressions commises par la société coloniale. Du point de vue des missionnaires, il ne s’agissait pas d’une catastrophe, mais d’un appui à leur cause.
Bien que ce tremblement de terre ait constitué un événement environnemental majeur dans l’histoire de la Nouvelle-France, il n’a pas encore fait l’objet d’études par les historiens de l’environnement. En fait, une grande partie de l’histoire de la Nouvelle-France reste à écrire dans une perspective écologique[3]. Ce remarquable épisode tectonique a pourtant attiré l’attention de deux historiens de la littérature il y a plus de vingt ans. Michel Bideaux a analysé les implications théologiques et psychologiques du récit d’un témoin oculaire de l’événement, le jésuite Jérôme Lalemant. Pierre Berthiaume, quant à lui, a examiné le compte rendu du tremblement de terre écrit quatre-vingts ans plus tard par l’historien jésuite François-Xavier de Charlevoix[4]. Dans une perspective littéraire, les deux chercheurs se sont penchés sur la composition des textes plutôt que sur le phénomène environnemental du tremblement de terre — phénomène qui revêt une importance qui lui est propre. Le contexte naturel n’a servi que de toile de fond à l’histoire.
L’interprétation des tremblements de terre, qui diffère selon les époques et les localisations, est devenue l’une des branches principales des recherches, de plus en plus nombreuses, sur l’histoire des catastrophes naturelles[5]. Les travaux les plus récents délaissent désormais quelque peu les dommages aux personnes et aux biens causés par les catastrophes naturelles au profit de la compréhension de leurs dimensions culturelles. Les événements catastrophiques sont de plus en plus considérés comme « un dialogue entre un système social et un écosystème[6] ».
L’étude de ce dialogue se concentre généralement sur la construction sociale des catastrophes. Les effets physiques des séismes, éruptions volcaniques ou inondations sont en eux-mêmes neutres. S’ils frappent une région inhabitée sans avoir le moindre impact néfaste sur l’homme, par exemple, ils ne sont pas considérés comme des catastrophes. Mais s’ils s’abattent dans un contexte humanisé, ces événements naturels sont qualifiés de calamiteux. Pour cette raison, parmi tant d’autres, la signification d’une « catastrophe » est un produit de la culture.
De toutes les perturbations naturelles, les tremblements de terre ont toujours présenté un intérêt tout particulier pour les historiens en raison de l’impact plus profond que peuvent avoir ces événements géophysiques imprévisibles sur les sociétés. C’est Grégory Quenet qui a réalisé l’étude la plus approfondie à ce jour de la perception et de la représentation des tremblements de terre au début de l’ère moderne[7]. Il allie l’analyse narrative d’un historien à l’analyse scientifique d’un sismologue pour présenter une description physique de divers tremblements de terre et étudier la manière dont ils ont été interprétés par divers groupes des populations françaises de l’Ancien Régime.
Quenet et d’autres experts en ce domaine reconnaissent que les catastrophes naturelles peuvent considérablement perturber, voire menacer, l’ordre social, devenant le point central des débats existants sur la gouvernance, le pouvoir et la légitimité dans une société[8]. La subjectivité des témoins oculaires dans leur interprétation de l’événement se comprend donc mieux si l’on tient compte de la situation sociale et politique d’une population avant, pendant et après un tremblement de terre. À l’aube de l’ère moderne, le rôle des convictions religieuses est également au coeur de l’interprétation des séismes comme des « actes de Dieu[9] ».
Du point de vue des missionnaires de la région du Saint-Laurent, le tremblement de terre de 1663 était une bénédiction et n’a pas une seule fois été qualifié de « catastrophe ». Les comptes rendus publiés de l’événement révèlent comment et pourquoi le clergé a conservé cette perspective providentielle, que nous pouvons brièvement comparer à l’interprétation du grand tremblement de terre par les autres colons français et les Amérindiens de la région.
Témoignages oculaires
Des récits de témoins oculaires du tremblement de terre de 1663 nous sont parvenus de partout en Nouvelle-France et de certaines parties de la Nouvelle-Angleterre. Ensemble, ils brossent le tableau d’un bouleversement géologique ayant touché une vaste région avec plus ou moins d’intensité. À Montréal, soeur Marguerite Bourgeoys de la Congrégation de Notre-Dame décrivit la première secousse comme étant si forte que la cloche de la porte d’entrée sonna comme si quelqu’un la frappait à coups rapides[10]. À l’Hôtel-Dieu de Montréal, soeur Marie Morin vit les édifices trembler comme des châteaux de cartes et sentit le sol se soulever et s’affaisser sous ses pieds[11]. À Trois-Rivières, le gouverneur de la région, Pierre Boucher, rapporta avoir senti les secousses du tremblement de terre « dont je n’avois rien veu de semblable, depuis environ trente ans qu’il y a que je suis dans ce Pays icy[12] ». Beaucoup plus loin à l’est, sur l’île du Cap-Breton, Nicolas Denys rapporta trois secousses de faible intensité qui firent s’entrechoquer sa vaisselle[13]. Au moins six des treize colonies de la Nouvelle-Angleterre ressentirent aussi le séisme. À Boston et dans d’autres endroits de la Baie du Massachusetts, par exemple, les maisons tremblèrent, des cheminées s’écroulèrent et les gens se précipitèrent dans les rues[14].
Les récits les plus détaillés du tremblement de terre ont été écrits par des observateurs de Québec. Parmi eux, on retrouve les témoignages des jésuites Charles Simon et Jérôme Lalemant, de l’ursuline Marie de l’Incarnation et des augustines hospitalières Marie-Catherine de Saint-Augustin et Jeanne-Françoise de Saint-Ignace[15]. Les récits missionnaires bien documentés des jésuites nous fournissent les détails essentiels du tremblement de terre et des événements qui ont suivi. Leurs relations ont été utilisées par plusieurs autres, y compris Marie de l’Incarnation, pour compléter les détails de leurs propres comptes rendus. C’est grâce à leurs écrits que la connaissance de ce séisme parvint à Paris et à Rome[16].
Jérôme Lalemant, 69 ans, supérieur de longue date de la mission jésuite au Canada, était connu dans la colonie pour sa discrétion, ses compétences en administration et son dévouement à promouvoir les missions de la Nouvelle-France[17]. Son récit du tremblement de terre constitua une part importante de la Relation qu’il envoya en France cette année-là. Charles Simon, 43 ans, passa moins d’un an dans la colonie, étant arrivé environ trois mois avant le séisme et reparti en France en septembre suivant[18]. Le tremblement de terre de février fut sans aucun doute le fait saillant de son séjour en Nouvelle-France et son compte rendu de l’événement fit une forte impression sur François Ragueneau, recteur à Bourges. Ragueneau le traduisit du français au latin et l’envoya au général des jésuites à Rome, dans l’espoir que le pape Alexandre VII lui-même puisse lire à propos du « Terraemotus stupendi » qui avait eu lieu au Canada[19].
À partir des récits de Charles Simon et Jérôme Lalemant, il est possible d’assembler les éléments fondamentaux du grand phénomène sismique tel qu’ils le relatèrent pour la ville de Québec. La secousse initiale se produisit à 17h30 le 5 février 1663, tout juste après le coucher du soleil, en un début de soirée du milieu de l’hiver. Un grand bruit se fit d’abord entendre, un roulement lointain qui s’amplifia jusqu’à devenir un grondement assourdissant venant de sous la terre. La terre projeta ensuite une pluie de roches qui démolit les toits des maisons et des granges et répandit des nuages et des colonnes de poussière dans l’air. Les clochers des églises oscillèrent et les cloches se mirent à sonner d’elles-mêmes. Les portes des maisons s’ouvrirent ou se fermèrent à la volée, les meubles se brisèrent, les murs se lézardèrent et les pierres et poutres s’effondrèrent, tandis que dehors, les animaux de ferme se mettaient à hurler et à mugir ou à s’enfuir. Les enfants fondirent en larmes dans les rues et les hommes et les femmes se précipitèrent dans tous les sens, pris de panique et d’incertitude. Certains se mirent à l’abri dans leurs maisons, tandis que d’autres s’enfuirent d’édifices qui menaçaient de s’écrouler, s’agenouillant dans la neige pour prier ou s’agrippant aux arbres qui se balançaient et se soulevaient. La grande majorité finit par trouver refuge dans les églises, « comme si la fin du monde était arrivée[20] ».
Le temps que Lalemant finisse de réciter son second miserere, la première secousse principale était terminée. Elle avait duré près de cinq minutes[21]. Une autre se fit sentir tard cette même nuit. Au cours des sept mois qui suivirent, il y eut une série de secousses et de tremblements, certains fréquents et d’intensité moyenne, d’autres plus violents quoique moins nombreux. Ceux-ci s’accompagnaient, déclara Simon, de grondements sourds semblables au tonnerre ou de soudaines détonations semblables à des coups de canon provenant de sous la terre, ainsi que de « torches et de globes de feu » émanant du sol et semblant disparaître dans l’air[22].
Tout au long de ces événements extraordinaires, les habitants demeurèrent nerveux, s’attendant à un autre tremblement de terre ou à une autre secousse à tout moment du jour et de la nuit. Tous, concluait Simon, étaient dans un état d’anxiété constant, se demandant ce que « serait le dernier acte de cette tragédie » et quand il se produirait[23].
À mesure que d’autres récits arrivèrent au cours des semaines suivantes et du printemps, il devint évident que les séries de forts tremblements et de faibles secousses avaient causé des dommages considérables. La glace recouvrant le fleuve Saint-Laurent, d’une épaisseur de cinq à six pieds, s’était cassée en morceaux, projetant des jets de boue et de sable dans les airs. Le fleuve lui-même, de Québec à Tadoussac, prit la couleur du soufre et demeura trouble pendant plusieurs mois. On rapporta de vastes glissements de terrains à Trois-Rivières et à Batiscan, à Baie-Saint-Paul et à Tadoussac, où de grandes sections de forêt avaient glissé dans les rivières voisines, causant l’effondrement des berges, détournant le cours de rivières comme le Saint-Maurice et créant de nouvelles îles et de nouvelles anses[24]. Sept mois après le tremblement de terre, Charles Simon voyagea de Québec à Tadoussac et vit, pendant toute la durée de son voyage, les deux rives du fleuve Saint-Laurent jonchées d’arbres déracinés[25].
Analyse des scientifiques de la Terre
Les comptes rendus dramatiques des jésuites et des autres témoins oculaires pourraient paraître quelque peu exagérés. Depuis le xixe siècle, plusieurs savants ont remis en question la véracité de ces témoignages. L’historien Alphonse Gagnon et le géologue J. C. K. Laflamme pensaient tous les deux que la peur pouvait avoir contribué à l’embellissement des descriptions du tremblement de terre. P.-G. Roy a qualifié les Relations d’« abracadabrantes ». Plus récemment, le géophysicien Robert Kovach a suggéré que des phénomènes tels que les glissements de pans de montagne ou l’entrechoquement des arbres n’étaient que des exagérations de la part d’observateurs effrayés n’ayant aucune expérience des tremblements de terre[26].
Il est vrai que « l’épouvante est une mauvaise disposition d’esprit pour faire de bonnes observations scientifiques[27] ». Rien ne laisse penser que les auteurs des comptes rendus du tremblement de terre de 1663 avaient déjà été témoins d’un séisme de cette envergure. Nous ne pouvons non plus réfuter la possibilité d’erreurs ou d’exagérations dans ces récits qui, après tout, n’étaient pas censés être des observations scientifiques objectives. Mais il n’en reste pas moins que la science a récemment confirmé plusieurs des observations les plus ahurissantes attestées dans ces comptes rendus du séisme[28]. La qualité et la quantité des recherches menées par les sismologues et géophysiciens depuis une vingtaine d’années font même de ce tremblement de terre un événement exceptionnel dans l’histoire des catastrophes naturelles du début de l’ère moderne.
Tous les savants s’entendent pour dire que le tremblement de terre de 1663 fut très puissant. Certains suggèrent même qu’il pourrait s’agir du plus gros séisme jamais attesté dans l’est de l’Amérique du Nord[29]. Les sismologues ont étudié les effets du tremblement de terre à la surface, sur les hommes et les bâtiments, et évalué son intensité à IX ou X sur l’échelle Mercalli qui compte 12 graduations et qui est utilisée en sismologie historique[30]. La magnitude équivalente a été estimée à 7 sur l’échelle de Richter qui va de 1 à 9, ce qui en fait officiellement un grand tremblement de terre[31].
Les recherches les plus récentes indiquent que l’épicentre du séisme était probablement situé à 200 kilomètres au nord-est de Québec, dans le bassin supérieur du fjord du Saguenay, peut-être dans la région de la Baie des Ha ! Ha ![32]. Le fjord du Saguenay est à proximité de la zone sismique de Charlevoix, la plus active de l’est du Canada, avec en moyenne un séisme tous les jours et demi détecté par les sismographes[33]. En supposant que le fjord du Saguenay ait été l’épicentre du grand tremblement de terre de 1663, certains sismologues parlent désormais d’un réseau régional de failles Québec-Charlevoix-Saguenay. Six séismes de magnitude 6 ou plus sur l’échelle de Richter ont frappé cette région ; mais seul le tremblement de terre de 1663 a atteint une magnitude estimée de 7 sur l’échelle de Richter[34].
Grâce à la datation au radiocarbone de débris de glissements de terrain, à la dendrochronologie et à l’analyse sédimentaire des lacs et fjords, les géophysiciens ont confirmé l’occurrence d’importants glissements de terrain dans l’argile à Leda sensible de la région[35]. De nouveaux glissements de terrain non attestés dans les écrits de l’époque ont également été découverts. Les plus importants sont les vastes glissements sous-marins et subaériens détectés dans le fjord du Saguenay lui-même, le plus grand d’entre eux ayant déposé un total de plus de 200 millions de mètres cube d’argile, de vase et de sable dans la rivière Saguenay[36].
La recherche sismologique confirme également certains des aspects les plus incroyables des récits de Simon, Lalemant et autres. Des sections entières de forêt furent effectivement déracinées, renversées ou enfouies dans la boue en divers endroits. L’analyse des anneaux de troncs d’arbres enfouis dans les sédiments d’un lac de la vallée de la rivière du Gouffre, par exemple, indique qu’ils ont été déposés à cet endroit par deux glissements de terrain causés par le tremblement de terre de 1663[37]. Les projections de débris de la glace du Saint-Laurent décrites par Lalemant ont peut-être été provoquées par des geysers d’eau ou de sable liquéfié, qui peuvent jaillir dans les sédiments saturés sous la pression d’un tremblement de terre[38]. Les « picques et [les] lances de feu » voltigeant dans les airs étaient peut-être des « feux » sismiques, un phénomène de luminosités inhabituelles observé dans le ciel nocturne pendant les séismes modérés à puissants qui n’est sérieusement étudié que depuis les années 1960[39]. Dans leur ensemble, les études sismologiques du tremblement de terre de 1663 semblent indiquer que les remarquables récits de témoins oculaires contiennent des informations très crédibles sur l’événement physique.
Interprétation des missionnaires
Les documents historiques et études sismologiques concordent suffisamment pour pouvoir affirmer que le tremblement de terre de 1663 fut un événement naturel exceptionnel. Aux quatre coins de la colonie, les missionnaires réagirent unanimement et rapidement à cette occasion extraordinaire. Aucun d’entre eux ne semblait particulièrement intéressé par les origines physiques du tremblement de terre, en dépit de l’intérêt porté aux sciences de la terre par certains savants ecclésiastiques de l’époque[40]. Charles Simon mentionne brièvement des feux souterrains qui, selon lui, auraient été à l’origine du bouleversement, et Marie de l’Incarnation parle d’exhalations brûlantes jaillissant de la terre, deux croyances très répandues trouvant leur origine dans la philosophie naturelle de la Grèce antique, mais personne n’alla plus loin[41]. Leur préoccupation, ainsi que celle des autres religieux, était d’un tout autre ordre : donner une signification plus large au séisme et faire passer ce message à la population.
Les missionnaires étaient convaincus que Dieu était la cause ultime de cet événement naturel, de ce « prodige » aux effets « prodigieux », pour reprendre les termes employés par Lalemant, Simon, mère Saint-Ignace et Marie de l’Incarnation. Un « prodige » était une chose merveilleuse, mais contraire au cours ordinaire de la nature, et donc une sorte de présage. « Les grands évenements sont quelquefois precedez par des prodiges », expliquait le Dictionnaire de l’Académie française en 1694[42]. Cela fait écho à la pensée de Pierre Boaistuau, fondateur du genre littéraire de « l’histoire prodigieuse », populaire durant la deuxième moitié du xvie siècle, mais encore influent de nombreuses décennies plus tard[43]. « Nul terre tremble sans signifiance », déclarait simplement Boaistuau. Cette signification était céleste[44]. Boaistuau et d’autres commentateurs du début de l’ère moderne ne niaient pas que les tremblements de terre étaient le résultat de forces naturelles, mais leur rareté et leur intensité les plaçaient dans la catégorie spéciale des événements naturels inhabituels dont la cause principale était Dieu. Il était généralement accepté par toutes les couches sociales du début de l’ère moderne qu’un tremblement de terre était soit un signe de la colère de Dieu contre le comportement des hommes et d’autres malheurs à venir, soit un châtiment direct pour leurs péchés, soit même l’annonce de la fin du monde[45].
Après plusieurs mois de secousses et de tremblements, le séisme de 1663 fut déclaré « prodigieux » par les jésuites et les religieuses. À l’appui de leur théorie selon laquelle l’événement représentait une réprimande claire et catégorique de Dieu, ils avançaient trois arguments : il n’avait fait aucune victime, en dépit de sa puissance et de sa durée ; il avait été précédé de mystérieux phénomènes aériens et de prémonitions par des membres vertueux de la communauté ; et il avait entraîné une amélioration du comportement des colons et des Amérindiens.
Dans les mois qui suivirent les secousses principales, on comprit que le tremblement de terre n’avait fait aucune victime dans la colonie, en dépit de l’énorme dévastation de la région et du fait que les secousses s’étaient poursuivies pendant au moins sept mois. Pour tous les missionnaires, ce bilan inattendu était la preuve du statut privilégié de la colonie et de sa protection divine. « Mais ce qui est admirable, écrivit Marie de l’Incarnation, parmi des débris si étranges et si universels, nul n’a péri, ni même été blessé. C’est une marque toute visible de la protection de Dieu sur son peuple[46]. » Elle n’était pas la seule à être aussi stupéfaite dans la colonie. Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières, trouva admirable que « Dieu nous a tellement conservé, que pas une seule personne n’en a receu la moindre incommodité[47] ». Il n’est pas surprenant que personne n’ait employé le mot « désastre » pour décrire l’événement. Il ne s’agissait pas d’un « accident funeste » : il n’avait apporté aucun vrai malheur, et ne pouvait donc être « né sous une mauvaise étoile[48] ».
Aujourd’hui, nous comprenons que la destruction causée par un séisme varie en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques de la région touchée[49]. L’absence de victimes lors du tremblement de terre de 1663 n’étonne guère, si l’on considère la faible densité de population dans la région et le fait que l’épicentre du séisme était à 200 kilomètres de Québec, dans la région du fjord du Saguenay. Les centres de peuplement principaux, Québec, Trois-Rivières et Montréal, n’étaient donc pas dans la zone la plus touchée. Mais pour les missionnaires de l’époque, l’absence de victimes après un bouleversement si considérable n’était rien moins qu’extraordinaire. Dieu, disaient-ils, s’était servi du tremblement de terre pour effrayer Son peuple plutôt que le détruire, et lui offrir le salut par le repentir ou la conversion[50]. Il s’agissait clairement là d’un soulagement pour les missionnaires aussi bien que pour les colons, qui, pendant les secousses initiales, avaient sûrement pensé que la fin du monde était venue[51].
Les observateurs missionnaires se penchèrent également sur les incidents précurseurs du tremblement de terre, et réfléchirent à nouveau aux phénomènes célestes attestés dans les semaines et les mois précédents. Le météore observé en automne 1662 et deux apparitions mystérieuses de trois soleils en janvier 1663 étaient maintenant interprétés comme des « voix de l’air muettes et brillantes » présageant les convulsions de février[52]. Ces signes de colère divine servirent désormais à interpréter le tremblement de terre comme le point culminant d’une série d’incidents symboliques[53].
Les observateurs révélèrent également qu’il y avait eu plusieurs prédictions de tremblement de terre juste avant la secousse principale. Deux jours auparavant, une jeune chrétienne algonquine avait par deux fois entendu une voix l’avertissant d’un séisme imminent. Une autre chrétienne algonquine de seize ans fit également une déposition aux jésuites selon laquelle, elle avait eu, la nuit précédente, une apparition présageant l’arrivée du tremblement de terre[54]. Marie-Catherine de Saint-Augustin, l’une des religieuses augustines les plus pieuses du Québec, ressentit quant à elle que le tremblement de terre allait être un châtiment : elle eut un profond pressentiment le 5 février, juste avant le tremblement de terre. Tous les comptes rendus du tremblement de terre par des missionnaires font état de la prémonition de mère de Saint-Augustin, à savoir que Dieu allait punir la colonie pour son outrage à l’Église[55].
Le journal de mère de Saint-Augustin n’examinait pas cet outrage en détail, mais on trouve des indices des méfaits des colons dans la grande joie éprouvée par les jésuites et les religieuses face aux comportements des colons français immédiatement après le séisme. Les missionnaires parlent de citoyens se précipitant à l’église pour se confesser ou communier les 6 et 7 février. Dans les jours qui suivirent, alors que des secousses continuaient de se faire sentir, ils prièrent, jeûnèrent et prirent part à des pèlerinages et processions avec une immense ferveur. À en croire les sources missionnaires, même les trafiquants d’eau-de-vie de la colonie, craignant une forme de jugement divin, semblaient se repentir. Marie de l’Incarnation était certaine que tous les habitants de la colonie s’étaient confessés au moins une fois, et parfois même plus de deux fois. Ces démonstrations d’extrême piété durèrent au moins jusqu’à la mi-mars[56].
Les récits des missionnaires relatèrent également la réaction de certains Amérindiens au tremblement de terre, bien que sans grande objectivité ni consensus. Ils déclarent que, lors du tremblement de terre, ils se mirent à hurler et tirer des coups de fusil en l’air pour chasser ce qu’ils décrivent tour à tour comme des démons volants, des âmes défuntes ou une armée d’ancêtres venue reconquérir leurs terres[57]. Si l’on considère les fréquentes références, dans les Relations, à la tension et la détresse causées, au sein des populations autochtones, par le délaissement des coutumes ancestrales, il n’est pas surprenant que certains Amérindiens aient interprété le tremblement de terre comme le retour des âmes d’ancêtres en colère. Pour les missionnaires, de telles croyances étaient ridicules. Par contraste, c’est avec beaucoup de joie qu’ils annoncèrent que les chrétiens algonquiens de la région de Sillery avaient organisé des processions jusqu’à la croix de Saint-Michel, avaient jeûné et prié, ou récitaient leur chapelet dans l’église de Sillery après chaque grosse secousse. Les prêtres de Tadoussac parlent d’Autochtones parcourant de longues distances pour se convertir dans les mois suivant la secousse principale. Pour Lalemant, leurs actions prouvaient que « nos Sauvages, qui pour estre Barbares ne sont pas insensibles aux touches du Ciel[58] ». Cela les mettait sur un pied d’égalité avec les vertueuses femmes algonquines qui étaient allées voir les jésuites avec leurs prédictions du tremblement de terre. Leurs actions étaient approuvées et applaudies par l’Église car elles confirmaient le caractère moral de ce grand événement naturel.
Pendant cette période initiale de violentes secousses, la plupart des colons (même les trafiquants d’eau-de-vie récalcitrants) et de nombreux Amérindiens semblaient avoir accepté l’interprétation des missionnaires, à savoir que la catastrophe était la faute de ceux qui avaient enfreint les prescriptions de l’Église[59]. Leurs actions semblent indiquer qu’ils avaient accepté que la meilleure et unique manière de réagir à un tel tremblement de terre était de prendre part à des cérémonies de contrition. Mais cet apparent consensus était-il provisoire ?
Carnaval, commerce de l’eau-de-vie et autorité de l’Église
Les missionnaires étaient certains que les prémonitions, l’absence de victimes et l’apparente piété de fraîche date des Autochtones aussi bien que des Français étaient une claire indication que le tremblement de terre n’était pas un phénomène naturel ordinaire, mais un événement causé par Dieu pour remettre une colonie dévoyée dans le droit chemin. Jérôme Lalemant maintenait que le tremblement de terre avait causé peu de dégâts aux bâtiments, mais avait fait « un grand bien pour les ames[60] ».
De même, les missionnaires de la Nouvelle-France considéraient les maladies, les attaques d’Iroquois et les hivers extrêmement rudes comme des fléaux, des tests divins de la détermination d’une jeune colonie chrétienne française dans un pays non civilisé[61]. Ils auraient tous pu citer en exemple, dans les Ancien et Nouveau Testaments, plusieurs tremblements de terre manifestant la colère de Dieu contre tous ceux qui avaient enfreint le droit divin[62].
L’interprétation du tremblement de terre comme une calamité destinée à punir la Nouvelle-France n’était pas uniquement la réaction typique des religieux à un événement imprévisible et catastrophique. Les missionnaires considéraient le tremblement de terre de 1663 comme un avertissement de Dieu donné à un moment précis du développement de la colonie. L’analyse de certains aspects du contexte social et politique des récits du séisme va nous aider à mieux comprendre l’enthousiasme tout particulier des missionnaires pour cette interprétation.
L’une des pistes dans l’interprétation du grand tremblement de terre réside dans la date de la secousse principale. Elle s’est produite le 5 février, qui, en 1663, était lundi gras, l’avant-dernier jour du carnaval. Traditionnellement, en Europe, le carnaval était une période festivalière bruyante qui précédait le carême. Il tirait ses racines des temps médiévaux et donnait lieu à des fêtes qui pouvaient durer jusqu’à un mois, fêtes dont certains disaient qu’elles avaient des origines païennes plus anciennes. Durant le carnaval régnait une atmosphère de liberté de parole et de comportement exceptionnelle. Sous prétexte de dépeindre les inégalités de la société, les pauvres se moquaient des riches et puissants, les femmes se promenaient habillées en hommes et les jeunes se déguisaient en animaux pour se venger de leurs maîtres. Les autorités ecclésiastiques de l’époque de la Contre-Réforme s’inquiétaient de plus en plus des mascarades, des beuveries et des festivités auxquelles s’adonnait la populace avant d’entrer dans la période plus solennelle et frugale du carême[63].
L’importation du carnaval était un sujet de préoccupation des missionnaires depuis plusieurs décennies en Nouvelle-France. Le jésuite Paul Le Jeune, dans un écrit de 1635, mit les autorités françaises au défi de profiter de la période de formation de la nouvelle colonie et de « bannir les méchantes coustumes de quelques endroits de l’ancienne France ». Le Jeune signifiait clairement que « les yvrongneries, les jeux et les dissolutions du Carneval » étaient en tête de son répertoire des vices dont la colonie devait être à l’abri[64]. Malgré les mises en garde de Le Jeune, les coutumes du carnaval traversèrent bel et bien l’océan.
Le Journal des Jésuites cite des exemples de danses, de violentes bagarres et d’incidents de blasphème et d’ivresse durant les jours gras des années 1640 et 1650[65]. Aux environs de la même époque, plusieurs missionnaires virent une similitude troublante entre les pires excès de la tradition française du carnaval et les festivals d’hiver des peuples iroquoiens. Les pères jésuites Jean de Brébeuf et François Du Peron affirmèrent que les célébrations hivernales des Hurons étaient le même genre de mascarades honteuses et de perversités qui défiaient l’Église en France. « Le diable est icy déchaisné aussi bien qu’en France », écrivit Du Peron à son frère, ajoutant que les pères de la mission avaient réagi avec 40 heures de prières spéciales[66]. Claude Dablon, parmi les Onondaga dans les années 1650, déclara le festival mi-hivernal iroquois Honnonouaroria aussi diabolique que le carnaval français, qui se déroulait à la même époque de l’année. Selon Dablon, il s’agissait de trois jours et trois nuits de pagaille, se distinguant des célébrations des Français en ce que nombre de participants iroquois couraient çà et là presque nus dans le froid glacial[67].
Quelques années plus tard, le missionnaire Vachon de Belmont décrivit l’essence du festival iroquoien (dans lequel il voyait des similarités avec le carnaval) et illustra involontairement en quoi l’Église considérait ces deux événements comme une menace à l’ordre établi. Les participants, déclara Belmont, étaient normalement réservés et posés dans la vie quotidienne, mais, à l’occasion de ces festivités, ils se comportaient comme s’ils étaient possédés par des forces extérieures, faisant ce que bon leur semblait avec impunité, prenant ce qu’ils désiraient, disant ou faisant des choses imprévisibles et se sentant admirés par les autres participants pour leur comportement[68].
Le carnaval de 1663 semblait destiné à provoquer le même désordre que les années précédentes, culminant en mardi gras le 6 février. Cette année-là, Charles Simon décrivit les premiers jours du carnaval comme une débauche d’alcool, de ripaille, de danse et d’autres choses qu’il se garda de révéler de crainte d’offenser ses lecteurs[69]. Les religieuses augustines de l’Hôtel-Dieu à Québec, choquées par ce qu’elles percevaient comme de flagrantes insultes à Dieu par les fêtards, cherchèrent à racheter les péchés des colons par leurs propres mortifications tout au long des trois semaines précédant le Carême[70].
Mais si l’Église coloniale espérait contenir l’apparent mépris pour l’autorité ecclésiastique se manifestant pendant la période annuelle du carnaval, elle était encore plus préoccupée par le trafic d’alcool tout aussi effréné qui avait lieu toute l’année entre Miscou et Montréal. Les années précédant le tremblement de terre de 1663 furent particulièrement problématiques à cet égard.
Vin et eau-de-vie étaient depuis longtemps importés en Nouvelle-France parmi les provisions destinées aux bateaux pêchant la morue sur la côte atlantique ou aux colons. Les marins ou pêcheurs de passage ou les traiteurs de fourrures de la région ne tardèrent pas à offrir de l’alcool aux Amérindiens contre les peaux de castor qui étaient devenues le moteur de l’économie de la colonie[71]. De nombreux historiens insistent désormais sur les choix rationnels que firent les Amérindiens pour ou contre l’acceptation d’alcool dans leurs sociétés[72]. Les missionnaires de Nouvelle-France considéraient les Amérindiens comme les cibles innocentes de traiteurs de fourrures sans scrupule ou les victimes volontaires de ce qu’ils percevaient comme une propension dangereuse à l’ivrognerie.
Mais si leurs récits sur la honte de l’ivrognerie chez les Français étaient candides, ils critiquaient avec véhémence la consommation d’alcool chez les Amérindiens[73]. Pour les missionnaires, un Français ivre était honteux ; mais un Amérindien ivre était choquant. Ils étaient outrés par ce qu’ils considéraient comme une atteinte directe à la discipline et au contrôle de soi qu’ils attendaient des chrétiens amérindiens et des convertis potentiels. Les Relations et d’autres publications du même type contenaient une foule d’exemples de nouveaux chrétiens dévoyés par l’alcool, ou de chefs de tribus demandant la prohibition du vin et de l’eau-de-vie dans leurs communautés[74]. La plupart des missionnaires souhaitaient sincèrement mettre un terme à ce trafic, mais avaient de bonnes raisons d’être sceptiques quant à leurs chances de réussite.
Les administrateurs coloniaux avaient pris un certain nombre de mesures pour contrôler la traite d’alcool depuis les premiers jours de la colonie. Champlain interdit aux Français de trafiquer du vin et de l’eau-de-vie en 1633 ou même plus tôt, sous peine d’amende ou de punition corporelle[75]. Les gouverneurs Montmagny et d’Ailleboust imposèrent des arrêts du même type. En 1657, Louis XIV confirma la prohibition de la traite d’alcool en place depuis l’époque de Champlain. Mais, tout comme la plupart des marchands et négociants de fourrures, les dirigeants politiques tendaient à penser que le commerce de l’eau-de-vie était bénéfique à la traite de fourrures en plein essor et à la prospérité économique de la colonie. Il servait également d’outil diplomatique pour conserver des alliés autochtones. Par conséquent, les administrateurs n’étaient pas universellement enclins à promouvoir et à appliquer la prohibition totale d’un commerce lucratif[76]. La plupart d’entre eux prirent des mesures pour le contrôler, mais avec des degrés divers d’enthousiasme et de réussite. Généralement, il était très aisé de se procurer de l’alcool dans la colonie.
Au début des années 1660, les missionnaires, qui luttaient toujours pour imposer une prohibition totale du commerce de l’eau-de-vie, se trouvèrent un allié en la personne de François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France. Laval, issu de l’une des plus nobles familles de France et diplômé prometteur du collège jésuite de Clermont, avait été promu à ce poste grâce à ses relations jésuites à la cour du roi de France et à Rome, en dépit de l’opposition de l’archevêque de Rouen[77]. Dès les premiers mois qui suivirent son arrivée dans la colonie en 1659, Laval, soucieux d’imposer son autorité, créa un tribunal ecclésiastique. Cet apparent affront au tribunal civil de Québec marqua le début d’une série de disputes juridictionnelles entre l’évêque et divers gouverneurs coloniaux. Si Laval reconnaissait qu’il n’était pas encore totalement accepté dans la colonie, il ne douta jamais de son autorité morale, comme le prouve sa lettre au général de la Compagnie de Jésus à Rome : « Ce n’est pas que tout le monde m’ait approuvé également ; vous avez ici des envieux ou des ennemis qui s’indignent contre vous et contre moi ; mais ce sont de mauvais juges qui se réjouissent du mal et n’aiment point les triomphes de la vérité[78]. »
Dès son arrivée en Nouvelle-France, Laval se joignit aux jésuites pour dénoncer l’alcool comme l’ennemi de l’évangélisation. Lorsque l’arrêt royal de 1657 s’avéra inefficace, l’évêque défendit, sous peine d’excommunication, de donner des boissons enivrantes aux Amérindiens. Le gouverneur Davaugour renforça l’arrêt de Laval en septembre 1661, interdisant la traite de l’eau-de-vie sous peine de fortes punitions. Dans le mois qui suivit, un trafiquant impénitent fut fouetté sur la place publique et deux autres furent fusillés[79].
La lutte contre la traite de l’eau-de-vie connut un rebondissement en janvier 1662, lorsqu’une femme ayant enfreint la prohibition fut jetée en prison. Sous la pression de sa famille, Jérôme Lalemant demanda à Davaugour de revenir sur sa décision. Se refusant à tolérer la moindre exception risquant de saper l’autorité coloniale, le gouverneur irrité abolit immédiatement toutes les restrictions sur le commerce de l’eau-de-vie. Laval réagit en réitérant sa menace d’excommunication, mettant ainsi le clergé en opposition marquée avec les autorités civiles dans le domaine du commerce de l’eau-de-vie[80].
Pour Laval et ses collègues missionnaires, la poursuite du commerce dans de telles conditions constituait un affront à l’autorité morale et politique de l’Église dans la colonie. Depuis des années, ils avaient insisté sur ses maux et ses dangers pour la société amérindienne et les efforts de la mission, mais leurs tentatives pour mettre un terme au trafic avaient été déjouées. Marie de l’Incarnation déplora le fait que les trafiquants ignoraient désormais la menace renouvelée d’excommunication. « Ils n’en ont tenu comte » écrivit-elle à son fils en août 1662, « disant que l’Église n’a point de pouvoir sur les affaires de cette nature[81] ». Les autorités civiles affichaient peu d’enthousiasme pour la croisade des missionnaires ; de nombreux traiteurs continuaient de troquer de l’eau-de-vie et du vin avec leurs partenaires commerciaux autochtones ; et les Amérindiens qui le désiraient pouvaient se procurer de l’alcool et le consommer à proximité des villages et des comptoirs commerciaux, défiant ainsi les autorités civiles et religieuses tout en affirmant leur indépendance[82]. Cette résistance des colons et des Amérindiens exaspérait les missionnaires, pour qui le Canada était « une oeuvre de Dieu » et la conversion des Amérindiens, le motif principal de l’établissement de la colonie. Lalemant exprima le profond ressentiment des missionnaires envers le trafic de l’eau-de-vie : « Je ne veux pas descrire les mal-heurs que ces desordres ont causé à cette Eglise naissante. Mon ancre n’est pas assez noire pour les dépeindre de leurs couleurs, il faudroit du fiel de dragons pour coucher icy les amertumes que nous en avons ressenty : C’est tout dire que nous perdons en un mois les sueurs et les travaux de dix et vingt années[83] ».
Laval, déterminé à s’assurer le soutien et l’aide puissante de Louis XIV dans sa lutte contre le trafic de l’eau-de-vie, s’embarqua pour la France en août 1662. Il était encore en France lorsque le tremblement de terre frappa. À Québec, Jérôme Lalemant vit un rapport évident entre les vaines tentatives préalables d’interdire le scandale du commerce de l’alcool et l’arrivée du séisme : « Le mespris de l’Excommunication des boissons continüant, on la renouvela, et s’en estant suivi peu d’amendement, Dieu parut vouloir parer ses Injures[84] ».
Tandis que le clergé demeurait convaincu que le tremblement de terre était une intervention divine en défense de son autorité, de sa mission auprès des Amérindiens et de son opposition à la traite de l’eau-de-vie, comment les responsables politiques de la colonie réagirent-ils ? Une réponse complète nécessiterait une étude approfondie des sources manuscrites de l’époque. Mais un document particulier nous est d’une grande utilité. Le gouverneur Dubois Davaugour, si souvent en conflit avec les jésuites et l’évêque, voyait dans l’ensemble les choses du même oeil, à savoir que la terreur engendrée par un tremblement de terre pouvait être exploitée en faveur d’un ordre du jour plus large. Davaugour pensait que les actes de contrition étaient une réaction adéquate des chrétiens après un tel événement. Il espérait également que les grandes secousses allaient l’aider à atteindre un de ses objectifs : subjuguer les Iroquois, qu’il appelle « Américains » dans cet extrait :
Le cinquième de février, nous avons eu un tremblement de terre qui a duré près d’un demi quart d’heure, assez fort pour nous engager à un bon acte de contrition. Il a continué de temps en temps durant neuf jours et a paru jusqu’au dernier du mois mais toujours en diminuant. Et comme ces choses non communes rangent parfaitement les Chrétiens à leur service, il est à croire que dans le coeur des autres elles y portent puissamment la terreur et la crainte particulièrement parmi cette canaille d’Américains habitués de sacrifier au démon pour savoir l’avenir[85].
Alors que les répliques du tremblement de terre perdurèrent de l’hiver jusqu’au printemps, des membres de la communauté affirmèrent avoir eu des visions sur le trafic de boissons. Le père Jean de Brébeuf, élevé au statut de martyr après son meurtre aux mains des Iroquois en 1649, serait fréquemment apparu et aurait expressément déclaré que les tremblements de terre étaient en partie causés par la conduite des Français ayant défié les peines imposées par l’Église contre le commerce. D’autres déclarèrent avoir vu l’image de trafiquants de vin et d’eau-de-vie appelés au jugement divin pour avoir ignoré la peine d’excommunication[86]. De telles révélations étaient jugées acceptables par les missionnaires, surtout lorsque les visionnaires étaient particulièrement pieux. Les prédictions de châtiments encore plus sévères propagées par certains citoyens étaient cependant considérées comme inventées de toutes pièces pour profiter de la situation en cette période troublée. Des missionnaires tels Charles Simon réservaient à l’Église le droit d’interpréter de tels événements avec précision, déclarant que « personne ne peut présager ni prédire, sauf sur l’ordre de Dieu[87] ».
Conclusion
Du point de vue des missionnaires, le tremblement de terre de 1663 ne pouvait tomber plus à pic dans les affaires coloniales. Dans un contexte de rivalités de longue date entre l’autorité de l’Église et l’autorité civile, et d’opposition aux traiteurs, il leur donna l’occasion de réaffirmer leur supériorité spirituelle, leur influence sociale et leur pouvoir politique. Ils s’appuyèrent pour cela sur des traditions culturelles et religieuses bien ancrées et qualifièrent le grand tremblement de terre de « prodige », de message très énergique de Dieu. Dans les semaines empreintes de terreur qui suivirent l’événement, les Français et de nombreux Amérindiens semblent avoir recherché et accepté leurs conseils avec avidité. Les missionnaires furent enchantés de voir les participants tapageurs au carnaval et les trafiquants d’eau-de-vie rebelles passer leurs journées dans le deuil, la contrition et les pleurs. Dans les mois qui suivirent, ils firent également de leur mieux pour contrôler les discours de prophétie dans la colonie et guider le processus visant à faire du tremblement de terre un allié divin dans les objectifs de leur mission.
À longue échéance, le tremblement de terre n’eut cependant pas l’impact profond sur la moralité et la politique de la colonie qu’avaient espéré Laval, les jésuites et les religieuses. Simon en conclut que le repentir des traiteurs avait été feint[88]. Le trafic d’alcool se poursuivit, en dépit d’une série d’arrêts tentant de l’interdire[89]. Le carnaval continua également, tout comme le conflit entre l’Église et l’État sur l’autorité morale et politique dans la colonie. En 1667, quatre ans seulement après le séisme, le Conseil souverain défendit même les festivités du carnaval contre les tentatives de censure de Laval à l’encontre des membres d’une confrérie ayant assisté à des danses[90].
Jérôme Lalemant regretta la fin des bouleversements géologiques, qui se poursuivirent pendant de nombreux mois après le grand tremblement de terre. En août 1663, une fois les pires secousses passées, il se lamenta sur le fait que le repentir et les conversions parmi les Français et les Amérindiens s’étaient avérés de bien courte durée. Dans une lettre adressée au Général de la Compagnie de Jésus à Rome, Lalemant déclara que lui et ses collègues souhaitaient le retour du grand tremblement de terre[91]. Le séisme de 1663 sema la terreur parmi la population d’une grande partie de la Nouvelle-France, mais cette terreur avait précisément été son plus gros avantage, et de nombreux missionnaires déplorèrent la disparition de cet allié puissant et divin de leur mission coloniale.
Parties annexes
Note biographique
Lynn Berry
Elle enseigne l’histoire des sciences à la Open University, au Royaume-Uni, en tant qu’Associate Lecturer. Ses travaux sur la façon dont les tremblements de terre sont perçus s’inscrivent dans une étude plus large des attitudes envers le monde naturel dans la Nouvelle-France du xviie siècle.
Notes
-
[1]
Je remercie les deux évaluateurs anonymes de cet article, ainsi que la rédactrice et le rédacteur invité de ce numéro, pour leurs suggestions et commentaires, qui m’ont été très utiles. Mes remerciements également à Estelle Cano pour la traduction de cet article et à Wayne Berry et à Gina Létourneau pour leur traduction préliminaire.
-
[2]
Marcel Trudel, La population du Canada en 1663 (Montréal, Fides, 1973), 368 p.
-
[3]
En 1990, Ramsay Cook a lancé un appel en faveur de l’écriture d’une histoire écologique du Canada dans « Cabbages Not Kings : Towards an Ecological Interpretation of Early Canadian History », Revue d’études canadiennes, 25,3 (hiver 1990) : 5-16. Il y a eu peu de réponses dans les quinze ans qui ont suivi, et rien de comparable à Changes in the Land : Indians, Colonists and the Ecology of New England (New York, Hill and Wang, 1983), 241 p. de William Cronon.
-
[4]
Michel Bideaux, « Le Discours de l’Ordre et le Séisme de 1663 », University of Ottawa Quarterly, 48,1-2 (1978) : 62-83. Pierre Berthiaume, « Le tremblement de terre de 1663 : les convulsions du verbe ou la mystification du logos chez Charlevoix », Revue d’histoire de l’Amérique française, 36,3 (décembre 1982) : 375-387.
-
[5]
Parmi les récents travaux sur la période médiévale et le début de l’ère moderne, citons Bartolomé Bennassar, dir., Les catastrophes naturelles dans l’Europe médiévale et moderne (Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1996), 272 p. ; Jacques Berlioz, Catastrophes naturelles et calamités au Moyen Age (Sismel, Edizioni del Galluzzo, 1998), 243 p. ; Alessa Johns, Dreadful Visitations. Confronting Natural Catastrophe in the Age of the Enlightenment (London, Routledge, 1999), 198 p. et une édition spéciale du journal européen, Environment and History, 9,2 (May 2003).
-
[6]
S. Briffaud, « Vers une nouvelle histoire des catastrophes », Histoire des catastrophes naturelles. Paysages-Environnement, Rencontres de Toulouse, 15 juin 1991, Sources. Travaux historiques, 33 (1993) : 4.
-
[7]
Grégory Quenet, Les tremblements de terre aux xviie et xviiie siècles : la naissance d’un risque (Seyssel, Éditions Champ Vallon, 2005), 586 p. Voir aussi Emanuela Guidoboni et Jean-Paul Poirier, Quand la terre tremblait (Paris, Odile Jacob, 2004), 220 p.
-
[8]
Russell R. Dynes, « The Dialogue Between Voltaire and Rousseau on the Lisbon Earthquake : The Emergence of a Social Science View », International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18 (2000) : 98. G. Quenet, Les tremblements…, op. cit., 160-165.
-
[9]
Voir, par exemple, Jussi Hanska, Strategies of Sanity and Survival. Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages (Helsinki, Finnish Literature Society, 2002), 220 p. Pour des exemples des 250 dernières années, voir Ted Steinberg, Acts of God : The Unnatural History of Natural Disaster in America (Oxford, Oxford University Press, 2000), 294 p.
-
[10]
Marguerite Bourgeoys, Les écrits de Mère Bourgeoys : autobiographie et testament spirituel (Montréal, [Congrégation de Notre Dame], 1964), 43.
-
[11]
Esther Lefebvre, Marie Morin, premier historien canadien de Villemarie (Montréal, Fides, 1959), 43-45.
-
[12]
Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle des moeurs & productions du pays de la Nouvelle France, vulgairement dite La Nouvelle-France (Paris, Florentin Lambert, 1664), Avant-propos, s.p.
-
[13]
Nicolas Denys [1672], The Description and Natural History of the Coasts of North America (Acadia) (Toronto, Champlain Society, 1908), 580.
-
[14]
Nathaniel Morton [1669], New-Englands Memoriall... (Boston, Congregational Board of Boston, 1855), 189. William T. Brigham, « Volcanic Manifestations in New England Being an Enumeration of the Principal Earthquakes from 1638 to 1869 », Memoirs of the Boston Society of Natural History (Boston 1871), II : 4. U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior, « Historical United States Earthquakes – Earthquake History » dans Earthquake Hazards Program, [en ligne], http://neic.usgs.gov/neis/states/, (consulté le 10 avril 2005).
-
[15]
Charles Simon, « Account of the Earthquake in New France, 1663 », Reuben Gold Thwaites, dir., The Jesuit Relations and Allied Documents (Cleveland, Burrows Bros., 1896-1901), XLVIII : 183-223. Dorénavant Jes. Rel. Il s’agit là de la traduction anglaise, par Thwaites, du texte original en latin écrit par Simon, « Relatio Terraemotus in Nova Francia, 1663 ». Jérôme Lalemant, « Relation de ce qui s’est passé en la Mission des Peres de la Compagnie de Jesus, au païs de la Nouvelle France, depuis l’Esté de l’année 1662 jusques à l’Esté de l’année 1663 », Jes. Rel., XLVIII : 36-72. Marie de l’Incarnation, Correspondance, Dom Guy Oury, dir., (Solesmes, Abbaye Saint-Pierre, 1969), 686-706 ; 710-720. Paul Ragueneau, La vie de la mere Catherine de Saint Augustin : religieuse hospitaliere de la misericorde de Quebec en la Nouvelle-France (Paris, Florentin Lambert, 1671), 236-240. Mère St-Ignace, Mère Ste-Hélène, Histoirede l’Hôtel-Dieu de Québec (Montauban, J. Légier, 1751), 138-149.
-
[16]
La liste ci-dessus, de Marie Morin à Jérôme Lalemant, représente une formidable variété de témoins oculaires de ce phénomène naturel, mais pas un inventaire exhaustif. Une analyse complète nécessiterait une recherche dans les sources manuscrites des archives coloniales.
-
[17]
Léon Pouliot, « Lalemant, Jérôme », Dictionnaire biographique du Canada [en ligne], www.biographi.ca (consulté le 5 avril 2005). Dorénavant DBC.
-
[18]
Jes. Rel., XLVII : 319 ; LXXI : 149.
-
[19]
Charles Simon, « Relatio Terraemotus in Nova Francia, 1663 », Jes. Rel., XLVIII : 182.
-
[20]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 193.
-
[21]
Le miserere, ou Psaume 50 dans la Vulgate latine, peut être récité deux fois en moins de cinq minutes. Le gouverneur Pierre Dubois Davaugour dit que la première secousse avait duré près d’un quart d’heure, ou environ sept minutes. Pierre Dubois Davaugour, « Lettre de M. le baron Dubois-Davaugour contenant un mémoire sur les colonies établies à Québec, Plaisance, Gaspé et Cap-Breton, 4 août 1663 », Bulletin des recherches historiques, XXXVI (1930) : 18.
-
[22]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 197.
-
[23]
Ibid.
-
[24]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 201-205 ; 213-217. J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 43-49. Voir aussi M. de l’Incarnation, Lettre CCIV, août-septembre 1663, Correspondance…, loc. cit., 694-698.
-
[25]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 223.
-
[26]
Alphonse Gagnon, « Le tremblement de terre de 1663 dans la Nouvelle-France », Mémoires de la Société royale du Canada, 9,1 (1891) : 41, 48. Pierre-Georges Roy, « Le premier grand tremblement de terre au Canada », Bulletin des recherches historiques, 31 (1925) : 138. J. C. K. Laflamme cité dans P.-G. Roy, Ibid., 145. Robert L. Kovach, Early Earthquakes of the Americas (Cambridge, Cambridge University Press, 2004), 170-172. Kovach n’a apparemment pas consulté la récente littérature sismologique sur le tremblement de terre de 1663.
-
[27]
J. C. K. Laflamme cité dans P.-G. Roy, « Le premier grand tremblement… », loc. cit., 145.
-
[28]
Quenet insiste sur la nécessité d’une telle collaboration entre les sismologues et les historiens pour l’étude des désastres naturels. G. Quenet, Les tremblements de terre…, op. cit., 61-64.
-
[29]
J. P. M. Syvitski et C. T. Schafer, « Evidence for an Earthquake-Triggered Basin Collapse in Saguenay Fjord, Canada », Sedimentary Geology, 104,1-4 (1996) : 127.
-
[30]
J. P. M. Syvitski et C. T. Schafer, « Evidence for an Earthquake-Triggered Basin Collapse… », loc. cit., 133.
-
[31]
Ibid., 128. Certains auteurs suggèrent une magnitude de 7 ou 8 sur l’échelle de Richter. Jacques Locat, « Evidences for a Post-Glacial Fault, Baie des Ha ! Ha !, Saguenay Fjord, Québec, Canada », EOS Transactions (Abstracts), American Geophysical Meeting, (San Francisco, 1999).
-
[32]
R. Urgeles et al., « The Saguenay Fjord, Québec, Canada : Integrating Marine Geotechnical and Geophysical Data for Spatial Seismic Slope Stability and Hazard Assessment », Marine Geology, 185 (2002) : 332. Jacques Locat et al., « Submarine Mass Movements in the Upper Saguenay Fjord (Québec – Canada), Triggered by the 1663 Earthquake », Geophysical Research Abstracts (2003), 5 : 04440.
-
[33]
Seule une petite proportion de ces tremblements de terre a dépassé une magnitude de 3 sur l’échelle de Richter, et la plupart sont indétectables sans instrument. Maurice Lamontagne, « The Charlevoix-Kamouraska Seismic Zone », (2003), Earthquakes Canada, Natural Resources Canada, [en ligne], www.seismo.nrcan.gc.ca/historic_eq/charpage_e.php (consulté le 1er février 2004).
-
[34]
Pascal Locat et al., « Caractérisation préliminaire du glissement sous-marin de la Pointe-du-Fort, Fjord du Saguenay, Québec, Canada », Compte-rendu de la 54e conférence canadienne de géotechnique (Calgary, 2001), 752. M. Lamontagne et al., « Characterizing Potentially Seismogenic Faults in the Quebec City-Charlevoix-Saguenay Region », Seismological Society of America Annual Meeting, April 17-19 2002, Victoria, British Columbia.
-
[35]
S. G. Evans, « The Record of Disastrous Landslides and Geotechnical Failures in Canada 1840-1999. Implications for Risk Management », dans Réjean Couture, Stephen G. Evans, dir., Canadian Workshop on Geotechnique and Natural Hazards, 53rd Canadian Geotechnical Conference, 15-18 October, 2000, Montreal, Proceedings (Ottawa, Minister of Public Works and Government Services, 2001), 20.
-
[36]
Jacques Locat et Richard Sanfaçon, « Multibeam Surveys : A Major Tool for Geosciences », dans Comptes rendus de la Conférence hydrographique du Canada/Proceedings of the Canadian Hydrographics Conference (Montréal, 2000), 6-7.
-
[37]
Louise Filion et al., « A Chronology of Landslide Activity in the Valley of Rivière du Gouffre, Charlevoix, Quebec », Canadian Journal of Earth Sciences, 28,2 (1991) : 250-256.
-
[38]
Harold G. Reading, « Mud and Sand Volcanoes », dans Paul Hancock, Brian J. Skinner, dir., The Oxford Companion to the Earth (Oxford, Oxford University Press, 2000). Par ce procédé, un volcan de sable aurait pu se former dans la vallée de la rivière du Gouffre pendant le tremblement de terre de 1663. Voir aussi Maurice Lamontagne, « Geotechnical Impact of Eastern Canadian Earthquakes », dans R. Couture, S. G. Evans, dir., Canadian Workshop on Geotechnique and Natural Hazards, op. cit., 41.
-
[39]
J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 44. France St-Laurent, « The Saguenay, Quebec, Earthquake Lights of November 1988 – January 1989 », Seismological Research Letters, 71,2 (2000) : 160-174.
-
[40]
José de Acosta, un jésuite d’Amérique espagnole du xvie siècle, popularisa la théorie d’Aristote, selon laquelle les tremblements de terre étaient causés par des gaz chauds jaillissant des entrailles de la terre. José de Acosta, Histoire naturelle et morale des Indes tant occidentales qu’orientales (Paris, Marc Orry, 1598), 124 verso-126 verso. Athanasius Kircher, un jésuite allemand, suggéra dans Mundus subterraneus, publié à Amsterdam en 1664-1665, que les tremblements de terre et les volcans étaient causés par un feu souterrain central relié à des foyers intermédiaires de soufre et charbon en fusion.
-
[41]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 193. M. de l’Incarnation, Lettre CCIV, août-septembre 1663, Correspondance…, loc. cit., 698.
-
[42]
Dictionnaire de l’Académie française (Paris, Chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard, 1694), 330.
-
[43]
L’oeuvre de Boaistuau a été rééditée, adaptée ou traduite jusqu’au xviiie siècle. Voir, par exemple, l’édition de l’abbé Lenglet du Fresnoy : Pierre Boaistuau, « Visions prodigieuses avec plusieurs histoires mémorables des spectres, phantosmes, figures, & illusions… Tirées des Histoires prodigieuses de Boiestuaux » dans Lenglet Du Fresnoy, Recueil de dissertations, anciennes et nouvelles, sur les apparitions, etc., t. 1, pt. 1 (Avignon ; Paris, Le Loup, 1751).
-
[44]
Pierre Boaistuau, Histoires prodigieuses et mémorables : extraictes de plusieurs fameux autheurs grecs & latins, sacrez & profanes (Paris, la veuve de Gabriel Buon, 1598), 816.
-
[45]
José de Acosta attribua des causes physiques aux tremblements de terre du Pérou, par exemple, mais remarqua également qu’ils étaient « les herauts de la divine Justice, afin de craindre Dieu. » J. de Acosta, Histoire naturelle et morale…, op. cit., 125 verso. Pour en savoir davantage sur les tremblements de terre comme « prodiges », et sur les tremblements de terre comme signe de la fin du monde, voir G. Quenet, Les tremblements de terre…, op. cit., 142-154. La colère divine comme explication des tremblements de terre persista dans le discours scientifique jusqu’au xviiie siècle. Duncan C. Agnew, « History of Seismology », International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology (San Diego, Academic Press, 2002), 3-13.
-
[46]
M. de l’Incarnation, Lettre CCIV, août-septembre 1663, Correspondance…, loc. cit., 699.
-
[47]
Pierre Boucher, Histoire véritable…, op. cit., Avant-propos, s.p.
-
[48]
Dictionnaire de L’Académie française, op. cit., 61.
-
[49]
L’analyse de la sismicité historique de l’Italie, par exemple, a indiqué que les effets des tremblements de terre étaient influencés par la densité de la population, la diversité géographique et les types de bâtiments. E. Guidoboni, G. Ferrari, « Historical Variables of Seismic Effects : Economic Levels, Demographic Scales and Building Techniques », Annales of Geophysics, 43,4 (août 2000) : 687-705.
-
[50]
J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 27, 51-53 ; C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 209.
-
[51]
Ibid., 193. J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 59-61. M. de l’Incarnation, Lettre CCIII, 12 juillet 1663, Correspondance…, loc. cit., 686 ; Lettre CCIV, août-septembre 1663, Correspondance…, loc. cit., 690. Mère St-Ignace, Mère Ste-Hélène, Histoire de l’Hôtel-Dieu…, op. cit., 144, 148. Une abondance de prédictions apocalyptiques circulait à l’époque. Voir Eugen Weber, Apocalypses. Prophecies, Cults, and Millennial Beliefs Through the Ages (Cambridge, Harvard University Press, 2000) ; G. Quenet, Les tremblements…, op. cit., 150-158.
-
[52]
J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 36. Le phénomène des trois soleils est causé par la réfraction de la lumière du soleil dans les cristaux de glace, généralement dans les cirrostratus. Les parhélies, ou faux soleils ou « sun dogs », apparaissent par paires de chaque côté du soleil. Storm Dunlop, A Dictionary of Weather (Oxford, Oxford University Press, 2001), 296 p.
-
[53]
Pour en savoir davantage sur les phénomènes aériens présageant de futures catastrophes, voir Sara Schechner Genuth, Comets, Popular Culture and the Birth of Modern Cosmology (Princeton, Princeton University Press, 1997), 365 p.
-
[54]
J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 53-57. C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 187.
-
[55]
P. Ragueneau, La vie de la mère Catherine de Saint Augustin…, op. cit., 238-239.
-
[56]
Jérôme Lalemant, « Journal des Pères Jésuites, és années 1662 et 1663 », Jes. Rel., XLVII : 296-298. C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 207. M. de l’Incarnation, Lettre CCVII, septembre-octobre 1663, Correspondance…, loc. cit., 711-712.
-
[57]
M. de l’Incarnation, Lettre CCIV, août-septembre 1663, Correspondance…, loc. cit., 697 ; C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 195 ; 205-207 ; Mère St-Ignace, Mère Ste-Hélène, Histoire de l’Hôtel-Dieu…, op. cit., 147.
-
[58]
J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 60-64, 70. C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 207.
-
[59]
Hanska montre comment un tel message est plus facilement perçu en période de détresse causée par des catastrophes naturelles. J. Hanska, Strategies of Sanity…, op. cit., 143.
-
[60]
J. Lalemant, « Journal des Pères Jésuites… », loc. cit., 296-298.
-
[61]
M. de l’Incarnation, Lettre CXCVI, septembre 1661, Correspondance…, loc. cit., 668.
-
[62]
Dans les Nombres 16, par exemple, Korah et ses disciples sont engloutis par la terre après s’être insurgés contre Moïse et avoir ainsi « provoqué le Seigneur ». Parmi les nombreuses autres références aux tremblements de terre en tant que châtiment divin, voir également 2 Samuel 22 et plusieurs autres références dans Esaïe et Jérémie.
-
[63]
Robert Mandrou, Introduction to Modern France 1500-1640. An Essay in Historical Psychology (London, 1975), 133-136. Emmanuel Le Roy Ladurie, Carnival in Romans (New York, George Braziller, 1980), 305-324.
-
[64]
Paul Le Jeune, « Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France, en l’année 1635 », Jes. Rel., VII : 272.
-
[65]
Jes. Rel., XXVIII : 167-169 ; XXX : 159 ; XLIII : 27-29.
-
[66]
Jean de Brébeuf, « Relation de ce qui s’est passé dans le Pays des Hurons en l’année 1636 », Jes. Rel., X : 200-202. François Du Peron, « Lettre au P. Joseph-Imbert du Peron, Ossossané, 27 avril, 1639 », Jes. Rel., XV : 176. Une forme spéciale de la prière de quarante heures a été créée au xvie siècle. Elle était utilisée à l’époque du Carnaval afin d’éloigner les gens du péché tout en se faisant pardonner pour les excès commis. Herbert Thurston, « Shrovetide », dans C. G. Herbermann et al., dir., The Catholic Encyclopedia (New York, Robert Appleton Company, 1912), xiii.
-
[67]
Claude Dablon, « Voyage du Père Joseph Chaumont, & du Père Claude Dablon, à Onontagué… » dans « Relation de… 1655 & 1656 », Jes. Rel., XLII : 154-168.
-
[68]
François Vachon de Belmont [c1705], Histoire de l’eau-de-vie en Canada (Société littéraire et historique de Québec, 1840), 3.
-
[69]
Jes. Rel., XLVIII : 193.
-
[70]
Mère St-Ignace, Mère Ste-Hélène, Histoirede l’Hôtel-Dieu…, op. cit., 139.
-
[71]
Jes. Rel., III : 107 ; V : 231 ; XXI : 97-99 ; XXII : 239-241. M. de l’Incarnation, Lettre LXXX, 26 août 1644, Correspondance…, loc. cit., 221.
-
[72]
Voir, par exemple, Peter Mancall, Deadly Medicine : Indians and Alcohol in Early America (Ithaca, N.Y., 1995) 268 p. ; Claude Gélinas, « Une perspective historique sur l’utilité de l’alcool dans les sociétés amérindiennes de la région subarctique », Drogues, santé et société, 4,1 (2005) : 53-83 ; John A. Dickinson, « “C’est l’eau-de-vie qui a commis ce meurtre” : Alcool et criminalité amérindienne à Montréal sous le régime français », Études canadiennes/Canadian Studies, 35 (1993) : 83–94.
-
[73]
Jes. Rel., XI : 73-5 ; XXVII : 119 ; XXX : 187-189 ; XXXIV : 39.
-
[74]
Pour l’évaluation des dommages causés par l’alcool dans les communautés de la mission par Jérôme Lalemant, voir « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 61-63. Voir aussi M. de l’Incarnation, Lettre CCI, 10 août 1662, Correspondance…, loc. cit., 681-682.
-
[75]
The Mercure François (1633) : 19, 841, cité dans Jes. Rel., VI : 328-329.
-
[76]
C. Gélinas, « Une perspective historique… », loc. cit., 57, 62. Desmond H. Brown, « They Do Not Submit Themselves to the King’s Law. Amerindians and Criminal Justice During the French Regime », Manitoba Law Journal, 28,3 (2004) : 75-110. J. A. Dickinson, « “C’est l’eau-de-vie…” », loc. cit., 88-89.
-
[77]
« Laval, François de », DBC, II. Luca Codignola, « Competing Networks : Roman Catholic Ecclesiastics in French North America, 1610-58 », Canadian Historical Review, 80,4 (décembre 1999) : 566-568.
-
[78]
François de Laval, « Lettre de Monseigneur François de Laval-Montmorency, Évêque de Pétrée, Vicaire Apostolique au Canada, au T. R. P. Goswin Nickel, Général de la Compagnie de Jésus, à Rome, août 1659 », Jes. Rel., XLV : 23.
-
[79]
André Vachon, « Vuil, Daniel », DBC, I. Jes. Rel., XLVI : 165, 187.
-
[80]
W. J. Eccles, « Dubois Davaugour, Pierre », DBC, I.
-
[81]
M. de l’Incarnation, Lettre CCI, 10 août 1662, Correspondance…, loc. cit., 682.
-
[82]
J. A. Dickinson, « “C’est l’eau-de-vie…” », loc. cit., 89.
-
[83]
J. Lalemant, « Relation de… [1662-1663] », loc. cit., 62.
-
[84]
J. Lalemant, « Journal des Pères Jésuites… », loc. cit., 296.
-
[85]
P. Dubois Davaugour, « Lettre de M. le baron Dubois-Davaugour… », loc. cit., 18.
-
[86]
C. Simon, « Certain Extracts from the Letters of Father Charles Simon, Written to his Sister at Bourges… December 1663 », Jes. Rel., XLVIII : 221-223.
-
[87]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 209. Pour lutter contre la superstition, l’Église enquêtait généralement sur les cas de rêves prémonitoires et tentait de les décourager. Marie-Aimée Cliche, Les pratiques de dévotion en Nouvelle-France (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1988), 73.
-
[88]
C. Simon, « Account of the Earthquake… », loc. cit., 219-221.
-
[89]
Le Conseil souverain de Québec publia presque chaque année des arrêts interdisant la traite ou la vente de boissons enivrantes aux Amérindiens dans les quelques années qui suivirent. Voir, par exemple, Archives nationales du Canada (ANC), MG1-Série C11A, Fonds des Colonies, bob. no. F-2, « Arrêt du Conseil souverain de Québec portant défense de traiter ou donner des boissons enivrantes aux Indiens, 1663, septembre 28, fol. 50-50v » ; « Arrêt du Conseil souverain portant défense de traiter ou donner des boissons enivrantes aux Indiens, 1664, avril 17, fol. 92-92v » ; « Arrêt du Conseil souverain portant défense de traiter ou donner des boissons enivrantes aux Indiens, 1665, avril 29, fol. 171-171v » ; « Arrêt du Conseil souverain de Québec portant défense de vendre, traiter ou donner des boissons enivrantes aux Indiens, 1667, janvier 5, fol. 332-332v ».
-
[90]
Pour de plus amples renseignements sur « L’affaire des Dames de la Sainte-Famille », voir Pierre-Georges Roy, La ville de Québec sous le régime français (Québec, Rédempti Paradis, 1930), I : 359-360.
-
[91]
Jérôme Lalemant, « Lettre de Jérôme Lalemant au Très Révérend Père Gian Paolo Oliva, 18 août, 1663 », Jes. Rel., XLVII : 255-257.