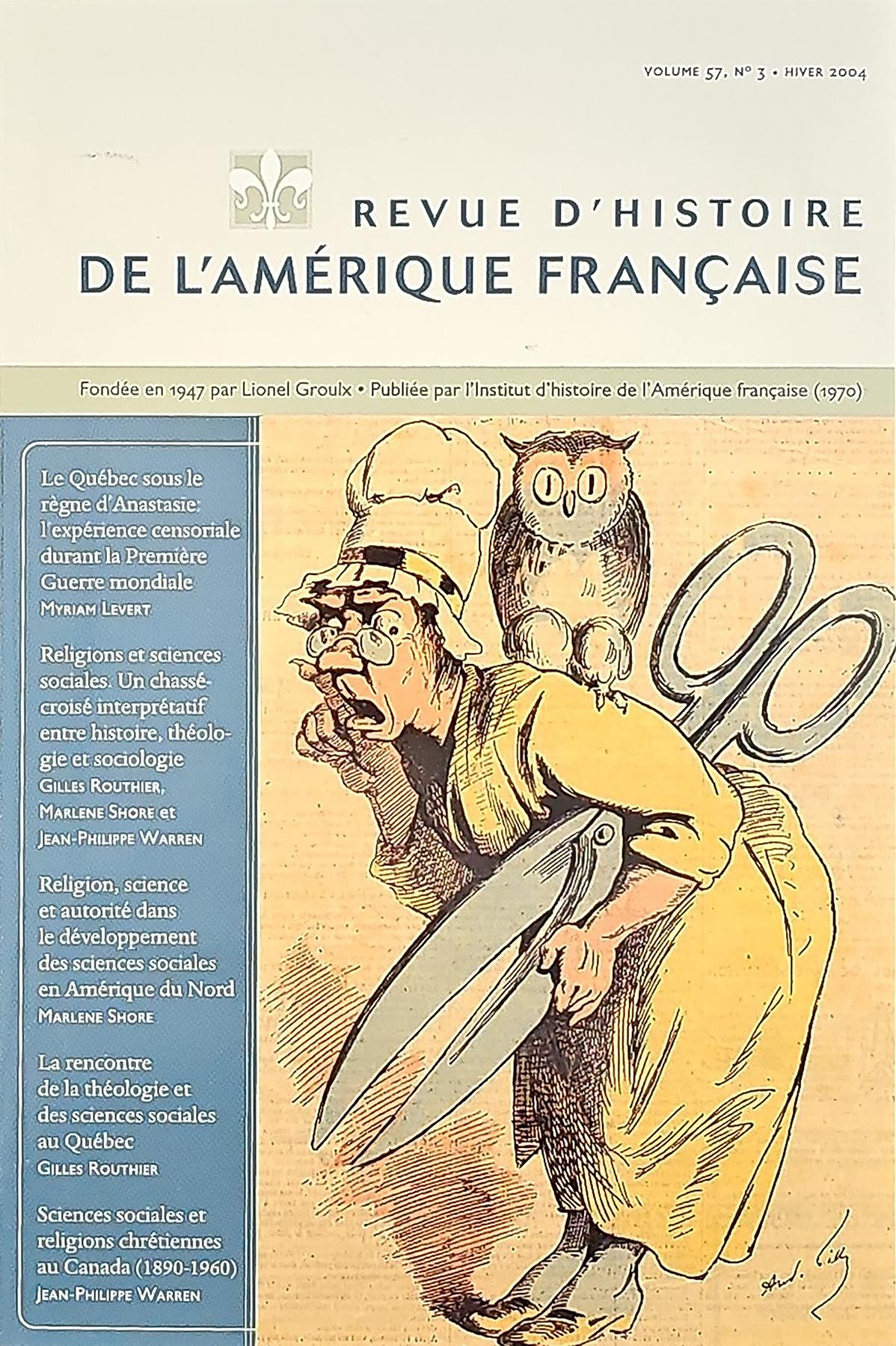Corps de l’article
La plupart des historiens canadiens, tant anglophones que francophones, ayant tenté de comprendre la genèse et le développement des disciplines regroupées sous le chapeau des sciences sociales (que ce soit l’économie politique, la sociologie, la science politique ou le service social) ont insisté, à juste titre, sur leurs divers démêlés avec les autorités ecclésiales et pastorales, les sciences sociales étant naturellement, de par leur essence critique, disait-on, une menace directe et explicite à un ordre établi qui reposait, il n’y a pas si longtemps, sur une cosmologie et une référence religieuses. Ainsi s’expliquait-on les réticences et les craintes exprimées par maints penseurs conservateurs — dont le Canada a fourni plusieurs types, de Mgr Louis-Adolphe Paquet au philosophe George Grant — devant la montée d’une gestion technocratique du « social » en remplacement de l’ancienne autorité morale instituée en partie par l’Église catholique et les sectes protestantes. Au Québec francophone, davantage encore qu’au Canada anglais, ce jugement semblait reprendre, dans ses grandes lignes, les catégories élaborées par les penseurs voltairiens du xixe siècle pour saisir le surgissement de l’esprit scientifique d’entre les limbes de la conscience chrétienne. La dénonciation du mythe de la « Grande Noirceur », de cette tentative, portée par la vague générationnelle de l’après-guerre, de ravaler cent ans du passé canadien-français dans quelque obscurantisme moyenâgeux, étant devenue le nouveau poncif de l’historiographie québécoise récente, il semble inutile d’énumérer ici les nombreux exemples de cette volonté d’égaler science et progrès, et, réciproquement, religion et réaction. Qu’il suffise de rappeler que, de l’avis de plusieurs, les sciences sociales sont, en tant que telles, par un mouvement spontané et irrépressible, un scandale pour les pouvoirs institués et une gêne constante pour les idéologies traditionnelles. Elles participent à l’édification, par la médiation d’un savoir technologique sans frontières comme sans confession, d’une société moderne, rationnelle et fonctionnelle, la religion étant, derechef, refoulée tout entière dans le monde de la contingence et du mystère insondable.
À propos de la sociologie, ce jugement s’avère toutefois trompeur, tant du point de vue de l’essor de la discipline elle-même que du point de vue de la mission éthique assignée à la science sociale. La sociologie a, en effet, emprunté ses méthodes et ses idéaux pendant un moment de la civilisation occidentale dont la structure et la dynamique épousaient les formes traditionnelles de la religion, alors même que ce moment laïcisait et désenchantait radicalement la société. Quand Michael Behiels, par exemple, affirme que l’établissement, en 1938, de l’École des sciences sociales à l’Université Laval a servi la promotion d’une élite scientifique vouée à la laïcisation de la société québécoise au nom de valeurs libérales et positivistes, il plaque sur un moment charnière de l’évolution des sciences sociales canadiennes un schéma d’interprétation pensé pour d’autres temps et d’autres lieux.
Au Canada comme ailleurs, ce schéma se révèle d’une grande pauvreté analytique, puisque le développement historique des sciences sociales, et de la sociologie en particulier, s’est fait non point dans un contexte d’abolition ou d’assimilation, mais dans un contexte de mutation de la conscience religieuse sur fond de transformation globale de l’ancien ordre social. Le discours religieux de légitimité s’est trouvé en quelque sorte sublimé dans le discours sociologique, la théorie scientifique ne pouvant remplacer la doctrine théologique que par un artifice positiviste qui tâchait d’évacuer toute intentionnalité du domaine humain pour la remplacer par la nécessité de la loi et du fait. C’est sur cette illusion de l’objectivité pure que la science sociologique, surtout dans la tradition française — et, par conséquent, catholique — a pu répudier le discours religieux et prétendre occuper la place laissée vide par la mort des dieux. Auguste Comte est un parfait exemple de cette ambition de fonder une nouvelle Église, positiviste celle-là, en remplacement de l’ancienne, Église investie d’une mission organisatrice et apostolique dont elle est allée trouver le modèle auprès des théologiens de l’Église catholique et dont le petit cercle des sociologues constituait la nouvelle cléricature, aussi ésotérique que celle qu’il jugeait utile de remplacer, aussi animée que celle-ci par un certain dessein providentiel.
Au Canada, on trouvera une ambition semblable dans les années 1960, la sociologie canadienne-française affrontant alors la religion catholique sur son terrain propre, terme à terme pour ainsi dire, la dogmatique et la hiérarchie de l’une ne pouvant que souffrir d’une reconnaissance de la vérité et de l’autorité de l’autre. La toge du professeur remplaçait la robe du prêtre, les recueils de textes remplaçaient les catéchismes, les universités remplaçaient les églises, la téléologie moderniste s’assimilait à la providence divine et, de même, une conscience de soi laïque et socialiste prenait le pas sur une conscience de soi traditionaliste et catholique, mais c’était en définitive une même structure à l’oeuvre et, parfois, une même rhétorique.
Le développement [...] et la planification, écrivait Gérald Fortin, [...] posent un problème fondamental à la sociologie. Pour autant que le sociologue ne veut pas être ou demeurer le subordonné du technicien [...], il veut participer activement à la définition des objectifs de la nouvelle société [...]. Pour réaliser cette aspiration, le sociologue doit accepter de jouer un rôle normatif qu’il a ordinairement refusé dans le passé. Il doit aussi se donner une théorie dynamique du changement social et de la société comme un tout. [...] Il doit être capable de prédire l’évolution de la société [...] et d’orienter les programmes d’action[2].
Il semble maintenant reconnu que l’histoire de la sociologie européenne classique est intimement liée à l’essor du courant romantique, d’une part, par la reconnaissance de l’antériorité de la société sur les individus qui la composent et, d’autre part, par une insistance renouvelée sur la nécessité de l’autorité. C’est ce qui ressort de la lecture de l’ouvrage magistral de Robert Nisbet, La tradition sociologique, dans lequel la variété des théories, des approches ainsi que des méthodes des sociologues classiques, est ramenée à cinq thèmes fondamentaux (statut, autorité, communauté, sacré, aliénation) qui convergent tous vers cette idée que l’individu n’est pas uniquement un être de raison, mais un produit des cultures et des circonstances, et que, ce faisant, il doit obéir à une volonté qui le dépasse infiniment[3]. Aussi, sans s’associer, sauf exception, directement aux contre-révolutionnaires, les sociologues classiques ont élaboré des réflexions recoupant très souvent celles des conservateurs, tout en leur faisant suivre des routes politiques et réformistes divergentes. Certes, l’ordre est certainement une des notions clés des sociologues de cette époque, ce qui explique l’organicisme des ouvrages du xixe siècle et l’insistance qu’on y retrouve sur la division de la société en classes fonctionnellement intégrées. Mais plusieurs autres notions, tirées du répertoire des conservateurs, ont représenté des centres de gravité autour desquels a évolué la sociologie classique dans son entreprise de démonter les rouages de l’horlogerie humaine. Il faudra un jour s’intéresser au vocabulaire des sociologues canadiens de la première moitié du xxe siècle afin d’exhumer, à la manière de Robert Nisbet, le dictionnaire de leurs certitudes.
Cependant, cet article s’intéresse au mouvement inverse, celui par lequel les esprits religieux du xixe siècle, réconciliés avec la visée et les méthodes de la sociologie naissante, recyclaient les idées de progrès et de science dans leur projet éthique et apostolique. En ce sens, cet article vise moins à jeter un regard neuf sur la progressive institution des sciences sociales — et en particulier de la sociologie — dans le dernier siècle qu’à effectuer une sorte de synthèse dont l’originalité consiste d’abord à lier ensemble le développement des traditions francophones et anglophones. Il est en effet surprenant de constater que l’existence des deux solitudes, dont la réalité est impossible à nier, tant les sociologues francophones et anglophones du dernier siècle ont pris plaisir à s’ignorer les uns les autres, n’a guère empêché un certain parallélisme des parcours institutionnels, doctrinaux et théoriques. Cela ne revient pas à dire que la tradition sociologique canadienne soit unique, sinon univoque, mais à montrer que les clivages et les oppositions dont elle fut le théâtre ne respectent pas une simple division linguistique, ce qui est encore plus vrai si, à cette idée préconçue d’une fracture linguistique, on ajoute la thèse du « retard » de la sociologie canadienne-française par rapport à la sociologie anglo-saxonne. Il s’agit donc de reprendre à nouveau le procès connu du développement des sciences sociales mais en procédant à un double recentrement : d’une part, en refusant de faire équivaloir capacité d’institutionnalisation (et, en corollaire, de spécialisation disciplinaire) et progrès scientifique ; et, d’autre part, en acceptant comme un moment de la science l’engagement normatif, moral et philosophique de la sociologie dans la société, plutôt que de percevoir ce moment comme un déni du pouvoir d’objectivité positive dont les sciences sociales seraient les dépositaires.
Richard Allen a été le premier historien canadien à souligner le rôle central joué par le social gospel, aux racines principalement américaines, dans l’institutionnalisation de la science sociale. Alors que les années qui mènent au xxe siècle ont été davantage influencées par une éthique protestante fondée sur la liberté individuelle, celles qui mènent à la Première Guerre mondiale ont été témoin d’une progressive reconnaissance de la nécessité de réformes sociales au niveau le plus fondamental de l’organisation sociale. Les trois grandes Églises — méthodiste, presbytérienne et, quoique dans une moindre mesure, anglicane — ont tenté de traduire le dogme de la rédemption dans les termes de l’Incarnation, du prophétisme et du salut collectif, ce qui les amenait à reconnaître peu à peu l’importance d’une administration globale et rationnelle de la société dont les praticiens des sciences sociales donnaient l’exemple[4]. Il s’ensuivit une confusion croissante entre le social gospel comme idéologie et la sociologie comme discipline scientifique. De même que l’on peut dire que le social gospel opérait une sécularisation de la religion (en faisant passer le message chrétien de l’absolue transcendance divine à l’immanence historique par la promesse du royaume terrestre), il est possible d’affirmer que la sociologie tendait à rendre scientifique la rhétorique évangélique, par la traduction des grands thèmes de la Providence, du salut, du péché, de la fraternité, etc., dans le langage de la science nouvelle. C’est ainsi que, dans une conférence donnée en octobre 1893, après avoir dénoncé en termes violents les ratés du système capitaliste et avoir rappelé la pauvreté infamante dans laquelle étaient contraints de vivre des milliers de travailleurs, le pasteur J. B. Silcox finissait sa diatribe par ses mots : « Christians [should not hide themselves] from the facts. If they refuse to look at the sufferings of their fellowmen, they are utterly devoided of Christianity. Social science must be learned. The time has come when sociology [should] be the most important chair in a well equipped university[5]. » Il est possible, en ces temps de crise économique, politique et sociale, de recueillir plusieurs citations de cette eau, mêlant réformisme social, confiance en la science et sentiments chrétiens[6].
Pendant l’entre-deux-guerres, au Québec francophone et au Canada anglophone, les chrétiens ont milité pour la promotion de multiples réformes sociales, efforts qui ont mené éventuellement à la mise en place d’un filet de sécurité sociale par l’État. Des auteurs ont récemment critiqué l’idée répandue selon laquelle les années 1930 et 1940 auraient correspondu à un déclin de l’autorité des Églises chrétiennes sur la société canadienne-anglaise, affirmant au contraire que l’entre-deux-guerres représente une sorte d’apogée du leadership religieux dans le domaine social, étant donné que les enquêtes sociologiques et les politiques sociales tombaient sous la juridiction explicite ou implicite du militantisme protestant et catholique. En fait, l’interventionnisme gouvernemental a autant été un objet de critique qu’un sujet de contentement pour les milieux religieux. En effet, certains acceptaient mal l’envahissement progressif des diverses sphères de la vie privée, et donc de la conscience individuelle et morale, par une bureaucratie anonyme et rationnelle, tandis que d’autres groupes, tout aussi religieux, reconnaissaient dans les politiques publiques, fédérales ou provinciales, une simple universalisation de la charité traditionnelle. « Protestant clergymen were instrumental in utilizing the most up-to-date methods of social investigation to pave the way for the application of expert knowledge to the formulation of social legislation, thereby helping transform the scope and responsibilities of the modern state[7]. » Au Canada anglais, la discipline du travail social a certainement été la première à céder à la tentation de l’interventionnisme étatique et le Social Service Council of Canada peut ainsi servir d’indicateur de cette tendance nouvelle, exprimée au sein des Églises chrétiennes, à faire de l’État l’instrument de l’égalité des personnes et de la préservation de leur dignité promises dans le discours évangélique. Au Québec, pour des raisons évidentes, les réticences ont été plus nombreuses mais, là aussi, le discours de la charité a fini par adopter les thèmes de l’efficacité et de l’adaptation fonctionnelle propre à l’approche technocratique de résolution des problèmes sociaux[8]. En reprenant sur des bases plus rationnelles l’oeuvre des institutions traditionnelles, le service social se présentait comme un « apostolat plus compétent ». La science ne supplantait pas les institutions anciennes, disait-on, elle en accroissait seulement l’efficacité en instruisant la charité des lois de la psychologie ou de l’organisation sociale afin de répondre aux besoins de plus en plus nombreux et pressants de la population canadienne de langue française. Dans l’aménagement de la cité terrestre, affirmait le père Georges-Henri Lévesque, le praticien des sciences sociales « est encore l’homme qui ne cesse pas de continuer avec des techniques nouvelles l’oeuvre de charité que le Christ lui a confiée[9] ». La formation qu’il reçoit, la technique dont il se sert, la rationalité qui le guide étaient, dans l’esprit du père Lévesque, des instruments au service d’une fin plus haute, spirituelle et pour ainsi dire sacrée : concourir, selon des règles éprouvées et méthodiques, à la réalisation de la justice chrétienne sur terre.
En assimilant devoir chrétien et responsabilité citoyenne, le social gospel protestant et le catholicisme social allaient nourrir une reconnaissance de la sociologie comme pratique et comme doctrine à laquelle se refusait un courant strictement libéral prompt à endosser l’idéologie du laisser faire, laisser aller en économie et la réification des hiérarchies en politique. Bien que libéral par tradition familiale et par tempérament personnel, Léon Gérin représente un cas ambigu, puisque sa typologie du particularisme demeure en définitive communautaire et que son libéralisme s’inspire en droite ligne du catholicisme social dont son grand-père, le publiciste Étienne Parent, s’était fait le convaincant propagandiste[10]. Si le royaume de Dieu devait être réalisé sur terre par l’abolition des privilèges et le redressement des injustices, c’est dire qu’une autorité devait agir sur les mécanismes de l’exclusion et sur les ressorts de la misère pour transformer de l’intérieur le système capitaliste dans le sens d’un socialisme chrétien. Cette autorité, plusieurs n’hésitaient pas à l’affirmer, c’était la sociologie. « The perfect sociology, perfectly applied, écrivait avec conviction S. D. Chown, superintendant général de l’Église méthodiste du Canada, will realize the Kingdom of God on earth[11]. » La sociologie répondait ainsi à une exigence morale, assignée par les Églises et sectes canadiennes, c’est-à-dire à une exigence de restauration sociale, et non pas seulement à une pure visée utilitariste, comme technique de collecte des données ou de compilation statistique des faits. Cette science sociale dont plusieurs chrétiens s’étaient faits, au tournant du xxe siècle, les ardents promoteurs se situait dans la conjonction du courant réformiste chrétien et d’une confiance nouvelle dans le rôle progressiste, voire millénariste, de la science. L’ambition de faire advenir le royaume de Dieu sur terre s’opposait ainsi à la résignation exprimée par le christianisme traditionnel, basé sur les notions de péché adamique et d’expiation, et qui débouchait sur une conception individualiste et moralisante de la charité. Il s’agissait désormais d’appuyer les efforts de réforme sociale, et de les appuyer méthodiquement et scientifiquement. En bref, la sociologie promettait de fournir un cadre d’analyse qui s’agençait dans une théologie du salut collectif. Ainsi, par exemple, dans le chapitre « Christianity and the Social Science » de son livre Applied Christianity, publié en 1886, Washington Gladden écrivait qu’aucune frontière ne devait séparer les sociologues des chrétiens, parce que leur objectif était fondamentalement le même, à savoir l’amélioration de la société. C’est vers cette époque que l’on vit paraître des titres de livres ou de chapitres tels que « L’Église face à la réforme sociale et politique », « Le Christ et la réforme sociale », « L’Église et l’ouvrier », etc.
Le réformisme des social gospelers s’est d’abord appliqué à jeter quelque lumière sur les problèmes industriels et urbains, et c’est donc vers la ville et vers les manufactures et les industries que leurs regards se sont tournés, avant que leurs préoccupations s’élèvent à l’étude générale du phénomène de l’urbanisation et de l’industrialisation. C’est en ce sens que l’on peut dire que les réformistes sociaux ont exercé une influence importante sur le développement des sciences sociales. Les problèmes sociaux (les problèmes familiaux, de logement, de pauvreté, de chômage, de mortalité infantile, etc.), regroupés en bloc sous la notion de « question sociale[12] », constituèrent le premier horizon de la recherche en sciences sociales[13]. Il fallait, affirmait-on, inspecter les bidonvilles, visiter les logements surpeuplés et insalubres des quartiers pauvres, comparer les revenus des travailleurs canadiens, s’enquérir des méthodes des entreprises agricoles, etc. My Neighbor (1911), de J. S. Woodsworth, ou The City Below the Hill (1897), de Herbert Brown Ames, sont de bons exemples de ce mélange de science politique, d’économie, de sociologie, d’histoire et de religion dont le but était d’appuyer une campagne de réformes de la société.
Pour de plus en plus de chrétiens engagés et de membres du clergé qui s’éveillaient aux problèmes créés par l’industrialisation rapide du Canada, la sociologie représentait en quelque sorte une science de la rechristianisation de la société. Les collèges méthodistes furent les premières institutions d’éducation supérieure à offrir au Canada des cours en sociologie, en 1906 ; les baptistes les imitèrent peu de temps après, ainsi que les catholiques, un peu plus hésitants à s’ouvrir directement à cette science nouvelle[14]. Dans la plupart de ces cours, les étudiants se familiarisaient avec les « problèmes complexes de la vie sociale » et « les lois gouvernant toutes réformes sociales » par l’étude, notamment, de l’économie, du civisme, de l’hygiène et de l’éthique. On insistait fortement sur la méthode de l’étude de cas et sur les diverses pratiques mises en oeuvre dans les organisations caritatives pour collecter des données. C’était là un « technocratisme du pauvre », mais un technocratisme néanmoins, avec une visée pragmatique enchâssée dans une vision du bien et du mal, appuyé par quelques chiffres et par un moralisme qui étouffait toute tentative de s’élever à un ordre de considérations sociologiques plus globales, en même temps que plus critiques. Au Canada français, les cours de l’École des sciences sociales, politiques et économiques, dirigée par Édouard Montpetit, suivent très souvent ce modèle, les considérations morales et « individualisantes » venant annuler la force des arguments fonctionnels et structurels.
Le temps ne fut pas très long avant que ce technocratisme du pauvre cède devant un technocratisme plus élaboré, plus structuré en fonction des grands bouleversements affectant la société canadienne dans son ensemble. L’interprétation particulière de l’écologie humaine privilégiée par Carl A. Dawson, ancien diplômé de l’Université de Chicago et premier professeur de sociologie à l’Université McGill, s’inscrit dans ce mouvement. Ce qu’on a appelé l’École de Chicago s’appuyait sur un courant de pensée qui distinguait la sociologie des formes d’intervention sociale associées au social gospel. Le directeur du département de sociologie, Albion Small, n’hésitait pas à condamner comme « utopistes » et « dangereux » ceux qui s’imaginaient pouvoir déduire des enseignements de l’Évangile des solutions toutes faites aux problèmes contemporains. Cependant, d’un même souffle, Small, fils d’un pasteur baptiste et lui-même instruit pour devenir pasteur au Newton Theological Seminary, conservait une vision prophétique des sciences sociales et faisait d’elles des instruments de l’établissement du royaume de Dieu sur terre et d’une vie humaine, non plus individualiste, mais pleinement sociale. Le royaume de Dieu, la société humaine, la loi naturelle, l’ordre moral, la justice sociale, tous ces termes étaient confondus dans une même volonté de traduire dans le langage de la science sociale les aspirations des chrétiens engagés. La théologie et la sociologie étaient deux sciences complémentaires, dont l’objet d’étude différait, certes, mais point l’objectif ultime[15], ainsi que l’illustre la longue coopération entre Small et Charles Henderson, le premier se déclarant d’abord intéressé par les enquêtes empiriques et le second, par les réformes sociales, alors que tous deux reconnaissaient dans les recherches de l’autre le complément des siennes propres. N’est-ce pas Henderson qui écrivait que la sociologie est « d’inspiration divine » ? « God has providentially wrought out for us the social sciences and placed them at our disposal[16]. » La connaissance empirique et méthodique des faits sociaux visait à la constitution d’une « sociologie chrétienne » dans le but de faire advenir une société plus juste, plus égalitaire, en un mot plus chrétienne. Albion Small ne s’y opposait guère, le département de sociologie et la Divinity School de l’Université de Chicago demeurant à ses yeux complémentaires.
C’est cette conception d’une sociologie empirique soucieuse de distinguer les sphères du savoir et de l’agir que Carl A. Dawson a importé à McGill en 1922[17], ce qui explique en partie la méfiance dont les universitaires ontariens ont entouré la sociologie telle qu’elle était pratiquée à McGill, qui leur apparaissait trop américaine, c’est-à-dire trop positive, trop instrumentale, trop spécialisée. On ne peut pas dire que sous la gouverne de Dawson le département de sociologie ait connu pour autant une forte autonomie durant les premiers vingt ans de son existence. Dawson fut nommé professeur de sociologie au département de sociologie en 1925 mais, durant les premières années, le programme incluait des cours en théologie et en service social. Si on se fie aux 16 maîtrises déposées entre 1926 et 1932, force est de conclure que la vaste majorité des étudiants de ce département poursuivaient des études en dehors de ce qui est considéré aujourd’hui du domaine de la discipline sociologique, sept maîtrises relevant du service social et six de la théologie[18]. Dawson avait d’abord été embauché pour organiser un département de service social et il avait oeuvré ensuite à la mise sur pied de la Canadian Association of Social Workers, dont l’objectif était de dissocier le service social des jeux politiciens et de rendre ainsi cette discipline plus rationnelle et plus efficace. Par la suite, la carrière de Dawson a été tout entière dédiée à l’établissement d’une pratique sociologique scientifique et méthodique, dans le sillage tracé par l’École de Chicago, mais il ne faut pas pour autant oublier que ses travaux visaient une autre entreprise que la simple compilation statistique et la collection à vide de données empiriques : il s’agissait pour lui, alors même qu’il entreprenait ses vastes enquêtes sur l’Ouest canadien, de subordonner la « social research to the progressive political goal of national efficiency and social redemption[19] ». C’est ce que Carl A. Dawson voulait dire lorsqu’il déclarait dans une conférence, en 1928 : « The church long ago realized that the field of service and goodwill is more extensive than church organization, and that in social work as a separate institution it could discover a new ally in achieving the goals of a more abundant life[20]. » En se guidant sur l’étoile du service social, prédisait Dawson dans une autre conférence, « the church will know men and in knowing them will be able to redeem them from evil forces that surround them. That redemption will show men their part in the Kingdom of Christ[21] ».
À l’École (puis Faculté) des sciences sociales de l’Université Laval, Gonzalve Poulin, premier titulaire du cours de sociologie générale, proposait un programme semblable, tentant à la fois de rationaliser les oeuvres de bienfaisance, de conduire, avec la collaboration de Jean-Charles Falardeau, une série d’études monographiques sur la ville de Québec conçue comme un laboratoire social et de développer une analyse positive de la réalité industrielle et urbaine dans laquelle devait désormais évoluer la population canadienne-française. Il faudrait aussi mentionner le nom maintenant bien oublié de Samuel Henry Prince, ordonné prêtre anglican en 1910. Après avoir complété une thèse en sociologie à l’Université Columbia, Prince est demeuré dans son alma mater pendant quatre années comme professeur avant d’accepter, en 1924, un poste en économie et sociologie au collège King affilié à l’Université Dalhousie ; en 1941, c’est lui qui se chargera d’organiser une école de service social à Halifax[22].
En parallèle de cette rencontre avec un service social orienté vers la résolution cas par cas des problèmes sociaux, mais à partir d’une tout autre perspective, la sociologie rencontrait aussi la philosophie sociale. Si Carl A. Dawson — ou à sa manière Stanislas Lortie — est un bon exemple d’une sociologie ayant subsumé les méthodes et les visées du service social dans le projet plus large de guider la marche d’une société poussée par un mouvement presque providentiel, Edward Urwick, directeur de l’École de service social (appelée alors science sociale) à l’Université de Toronto à partir de 1927, était, pour sa part, convaincu que la société était un « organisme spirituel » et il s’interrogeait sur l’organisation générale de l’ordre social, sur les postulats moraux qui le sous-tendaient et sur les institutions qui le structuraient. Là, plus encore sans doute que dans la sociologie pratiquée par Carl A. Dawson, se révèlent les liens entre sciences sociales et morale avant les années 1960, d’autant plus que l’architectonique sociale reproduite dans les livres d’introduction à la sociologie reprenait les principes de la théologie chrétienne, protestante ou catholique.
Il est trompeur de souscrire à l’idée selon laquelle le souci de préserver une culture générale distinguait l’enseignement des sciences sociales dans les universités francophones et anglophones dans l’entre-deux-guerres. En fait, s’il fallait donner un exemple d’une pensée soucieuse de préserver le lien entre philosophie et sciences sociales, le nom de Robert M. MacIver, embauché en 1915 à l’Université de Toronto comme professeur de science politique, s’imposerait facilement. MacIver est demeuré jusqu’à sa mort plus que circonspect face au discours positiviste d’une branche majoritaire de la sociologie américaine, au point de représenter, pendant son mandat comme directeur du département de sociologie de l’Université Columbia dix ans plus tard, une alternative possible et même souhaitable au plat empirisme vers lequel avait glissé l’École de Chicago. Un de ses disciples parlait de lui comme d’un professeur ayant voulu endiguer la vague pragmatiste, behavioriste, « bigger-and-betterist », « we-don’t-know-where-we’re-going-but-we’re-getting-there-fastist » et « by-all-means-measure-even-if-you-don’t-know-what-you’re-measuringist » (!) qui menaçait, selon ses dires, d’emporter les sciences sociales américaines[23]. Il s’agissait de s’élever contre le danger d’une sociologie « trop scientifique », c’est-à-dire incapable de nommer et de définir le cadre théorique dans lequel s’inséraient ses recherches empiriques. La position fondamentale de Robert M. MacIver découlait d’une conviction, partagée par l’ensemble des philosophes chrétiens, selon laquelle l’être humain n’est pas conditionné d’une manière mécanique par son environnement immédiat. L’individu étant un être pensant, désirant, rêvant, la sociologie ne pouvait ignorer la charge symbolique et signifiante contenue dans tout fait social, aussi anodin soit-il. « There is an essential difference, from the standpoint of causation, between a paper flying before the wind and a man flying from a pursuing crowd. The paper knows no fear and the wind no hate, but without fear and hate the man would not fly nor the crowd pursue[24]. » Cette constatation banale venait appuyer une formulation de l’idéal humaniste et philosophique de la pratique des sciences sociales, celles-ci devant être à la fois des sciences du fait et du possible. Le champ propre des sciences sociales, affirmait le professeur de Toronto, c’est celui du symbole et du sens, et donc, elles doivent pouvoir tenir compte dans leurs analyses du « calculable » et de « l’absolu » :
Social facts are all in the last resort intelligible facts. When we know why a government falls or how a price is determined or why a strike takes place or how a primitive tribe worships or why the birth-rate declines, our knowledge is different in one vital respect from the knowledge of why a meteor falls or how the moon keeps its distance from the earth or why liquids freeze or how plants utilize nitrogen. Facts of the second kind we know only from the outside ; facts of the first kind we know, in some degree at least, from the inside. [...] We must learn the values [...]. It is because there is always an inside story, or in other words a meaning, in human affairs that we never attain more than partial or relative truth. Here is the paradox of knowledge. The only things we know as immutable truths are the things we do not understand. The only things we understand are mutable and never fully known[25].
Si, dans la sociologie issue directement ou indirectement du social gospel ou de la doctrine sociale, les liens entre sciences sociales et morale apparaissent avec force et évidence, c’est aussi parce que les sociologues de cette tendance étaient animés par une tradition de préoccupations morales qui gardait ouvert le débat entre jugements de faits et jugements de valeurs. C’est ce que voulait dire Malcolm Maclellan, professeur à l’Université Saint Francis Xavier d’Antigonish, lorsque, dans un article paru en 1944, mais qui aurait aussi bien pu l’être vingt ans plus tôt, il rappelait la nécessité de refuser une science sociale purement scientifique, sans visée morale :
It is the writer’s experience that when the social science teacher comes out for a social philosophy of reconstruction, he puts his teeth into the work and the whole group adopts a spirit that is akin to apostleship. On this assumption, the social sciences are full of dynamite, and replete with the emotional. [...] Too frequently, the social sciences have been watered down as to be unharmful to the status quo. If the social sciences are not sufficiently scientific and philosophical to challenge youth to the reconstruction of society, they are just like sounding brass or tinkling cymbal[26].
Les sociologues chrétiens défendaient une conception de la science qui tentait de réconcilier les faits et les normes dans une certaine philosophie sociale, s’attachant aux faits pour mieux incarner une doctrine ou étudiant la doctrine pour mieux orienter l’étude des faits. Ils s’imaginaient amoindrir la science sociologique en la confinant à une collecte de faits quand elle devait embrasser un domaine social constitué par la liberté du sujet et le déterminisme des structures, le jugement moral et le jugement de fait, le devoir être et l’étant. Que ce soit dans la tradition idéaliste et humaniste anglaise ou que ce soit dans la tradition catholique, la sociologie ne pouvait s’émanciper d’une visée réformiste entée sur une certaine idée du bien commun, souvent défini en termes relativement conservateurs et à partir d’une conception figée de l’autorité et de la hiérarchie. Le père Georges-Henri Lévesque est certainement un bel exemple de cette solidarité de la morale et des faits empiriques, mais également, quoique de façon plus subtile et implicite, Jean-Charles Falardeau[27]. Ce dernier avouait avoir fait sienne la distinction du père Delos quant à la séparation des sphères de la sociologie et de la morale, à la condition que cette distinction ne soit pas considérée comme étanche et irréductible. Au Canada anglais, la même poursuite d’une synthèse entre les préoccupations des humanités et les découvertes des sciences sociales apparaît dans les travaux de la plupart des praticiens de l’entre-deux-guerres : pour eux, comme pour le grand sociologue britannique Hobhouse, l’idée d’oblitérer la nature morale de l’homme — et donc l’irréductible intentionnalité humaine — faisait figure de véritable hérésie. Comme l’écrivait MacIver : « Whenever life exists, attainment and failure, growth and decay, good and evil exist. Those who would make sociology a “natural” science, unconcerned with values, would leave out of account the special characteristics of the world of which it treats, in a vain attempt to ape those sciences where such characteristics are unknown[28]. »
Ce trop bref survol des liens entre la religion chrétienne et l’histoire canadienne des sciences sociales, et en particulier de la sociologie, avant les années 1960, démontre la justesse des remarques de Brian McKillop qui invitait à s’émanciper de l’analyse institutionnelle des intellectuels, pour s’intéresser davantage aux jeux des influences et aux mouvements de la pensée formant la trame propre du monde des idées. Nous devons, proposait-il dans la réédition récente d’un livre important, en venir à la conclusion que « the study of faith-based belief from the perspective of intellectual history could be fruitful rather than contradictory or, worse, perverse[29] ». Que ce soit par une attention plus grande aux problèmes sociaux créés par l’urbanisation et l’industrialisation, par une étude plus globale de la crise de la modernité ou du capitalisme sauvage, ou par une reconnaissance de la dualité intrinsèque entre jugement de faits et jugement de valeurs, toujours la religion accompagne le développement des sciences sociales au pays. Il importe aujourd’hui de reconnaître ce fait et de commencer une étude méticuleuse et attentive des particularités de « la » tradition intellectuelle canadienne, francophone ou anglophone, que ce fait a spontanément imposées. La tradition, au singulier, comme on dit, par exemple, « le » Moyen Âge puisqu’il s’agit de nommer ici, de notre point de vue, un moment particulier de cette histoire, moment pendant lequel la sociologie dialoguait encore, directement et pratiquement, avec la religion chrétienne.
La perméabilité du vocabulaire du social gospel et du catholicisme social dans le langage de la modernisation (plan divin pour désigner le progrès, communauté pour collectivisation, charité pour sécurité sociale, oeuvres de bienfaisance pour organisations du service social, etc.) a favorisé, dans les années d’après-guerre, un glissement pour ainsi dire naturel de l’un à l’autre, glissement ayant permis de voiler l’horizon religieux sur lequel s’était découpée l’histoire de la discipline sociologique. Robert M. MacIver est intéressant à ce titre, lui dont les travaux ont cherché à établir une distinction entre communauté et société, de manière à maintenir, dans le cadre théorique de la sociologie, l’exigence de la coopération et de la solidarité. De même, la confiance que MacIver plaçait dans le progrès de la civilisation lui permettait de lier l’épanouissement de l’individu et le processus de socialisation. Mais il semble qu’il demeure encore implicitement un malaise à vouloir lier le développement historique des sciences sociales et une éthique religieuse, comme si ces deux réalités étaient incompatibles, irréconciliables. Cela nous empêche de comprendre comment la sociologie du père Georges-Henri Lévesque, par exemple, était soudée à un impératif du bien commun, impératif qu’elle ne pouvait refuser, à ses yeux, au risque de s’abolir comme science véritable. « Ils ont perdu le sens de l’homme, écrivait-il, tous les savants [...] qui ne voient pas plus loin que l’horizon borné de leur spécialité, dont la science ne s’épanouit pas en amour[30]... » Il est évident que cet appel à l’engagement chrétien s’inspirait des vertus théologales de la charité, de l’espérance et de la foi — mais il est aussi évident que cet engagement n’a pas été vécu pareillement pour Stanislas Lortie à l’aurore du dernier siècle, ou dans les années 1950, pour Guy Rocher (ou encore, du côté du Canada anglais, pour Edward John Urwick ou Samuel D. Clark). Cela laisse entier l’impératif de reconnaître les idéologies, les valeurs et les idéaux collectifs ayant traversé « le » monde catholique et protestant canadien[31] avant les années 1960. Cela pourrait amener à entreprendre une nécessaire étude épistémologique, afin de montrer comment les sociologies franco-québécoise et anglo-canadienne ont surgi sur le fond d’une entente quant à la nature de l’ordre social et des critères d’objectivité. Sans chercher à appliquer au Québec et au Canada les intuitions historiques de Michel Foucault, il semblerait intéressant de reprendre le geste ayant été le sien, en liant, pour choisir un exemple à la fois évident et polémique, la transcendance divine telle qu’exprimée dans les ouvrages d’Henri Bergson et de Maurice Blondel, et la transcendance sans nom dans l’oeuvre de Fernand Dumont. Ou encore, pour évoquer le nom de Robert M. MacIver, l’idée d’un ordre social chrétien et cette idée que « la croissance de la sociologie depuis Comte » correspond au rêve de restaurer « la synthèse perdue de la communauté ». Cette conviction que la restauration sociale, plus que le contrôle social (sur le modèle par exemple de ce qui se faisait à Chicago), devait être l’objet constant de la sociologie naissante demande à être comprise comme une expression intellectuelle particulière. Cette démonstration n’a pas encore été faite.
De telles analyses devront être tentées dans une perspective comparative. Il est curieux de constater que, ici comme ailleurs, continuent de soliloquer les deux solitudes. Ce fait est d’autant plus désolant que les parallèles sont nombreux entre l’une et l’autre tradition linguistique, aux prises de toute façon avec des problèmes sociaux comparables, allant de l’aménagement urbain aux politiques de nation-building, et ce, même si l’horizon catholique ayant dominé la sociologie du Québec francophone avant les années 1960 entraînait forcément des divergences de fond et de détail avec la sociologie issue du milieu protestant. Il nous faut toutefois reconnaître que le développement de la sociologie au pays est double, une tradition plus empirique et technocratique ayant lutté, avant 1960, pour s’imposer face à une tradition plus philosophique et humaniste. Les conflits entre l’École des sciences sociales de l’Université Laval et l’École des sciences sociales, politiques et économiques de l’Université de Montréal constituent une page connue de l’histoire québécoise. On s’est moins attardé sur son équivalent canadien-anglais, celui ayant opposé le département de sociologie de McGill au département de science politique de l’Université de Toronto. E. J. Urwick, pour un, était un farouche opposant de la sociologie issue de l’École de Chicago. Ce mutuel dédain que se portaient les praticiens des sciences sociales à Toronto et McGill venait de l’adoption d’un modèle différent de sciences sociales, l’un plus américain et plus technocratique, l’autre d’influence britannique et porté davantage vers une critique globale de l’ordre social à partir d’une conception philosophique de la bonne société. McKillop a suggéré une hypothèse pour comprendre pourquoi la sociologie pratiquée à McGill n’a pu exercer une influence réelle sur le milieu universitaire canadien-anglais en rappelant que la tradition de préoccupations morales, de quête de la sagesse et de définition du bien commun, héritée de l’époque victorienne, s’était maintenue profondément dans le xxe siècle. « The continuity of this tradition into the twentieth century, écrivait-il, can be seen not only in the thought of religious and philosophical figures, but also in the writings of numerous other intellectual figures who reflect the modern temper of Canada[32]. » Cela est très certainement vrai des praticiens des sciences de l’Homme.
C’est aussi en ce sens que la religion ouvre de belles perspectives pour reprendre le procès de constitution et d’institutionnalisation de la sociologie dans le siècle : elle permet de rompre avec un paradigme un peu simpliste de scientificité positiviste, en rappelant un domaine à la fois de l’indicible et du contingent propre à l’existence humaine. De l’indicible, car il est une part des sciences sociales qui demeure suspendue aux parti pris, parti pris que, bien humblement, nous appelons postulats. Contingent, car les sciences sociales, en particulier la sociologie, ont cette manie de se constituer en traditions singulières, de telle sorte que l’on finit toujours par parler de tradition française, britannique, allemande ou américaine, même si ces traditions sont évidemment et forcément plurielles et qu’elles ne refusent pas de féconds emprunts réciproques.
Reste maintenant à mieux comprendre comment, dans le Canada d’une bonne partie du dernier siècle, les sciences sociales ont pu à la fois refléter de multiples manières une conscience et une éthique profondément et largement religieuses, et s’émanciper progressivement, de l’intérieur pour ainsi dire, de cette conscience et de cette éthique.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Cet article s’insère dans le cadre d’une recherche subventionnée par les organismes CRSH et FQRSC portant sur une comparaison des traditions sociologiques canadiennes francophones et canadiennes anglophones.
-
[2]
Gérald Fortin, La fin d’un règne (Montréal, Éditions Hurtubise-HMH, 1971), 193.
-
[3]
Robert Nisbet, La tradition sociologique (Paris, Presses universitaires de France, 1993), 409 p.
-
[4]
Stewart Crysdale, « Social Awakening Among Protestants, 1872 to 1918 », dans Stewart Crysdale et Les Wheatcroft, dir., Religion in Canadian Society (Toronto, Macmillan, 1976), 191-206.
-
[5]
Emmanuel Church, « Christian Socialism Advocated by the Pastor of Emmanuel Church », The Montreal Daily Star, 23 octobre 1893, 4.
-
[6]
Stewart Crysdale, « The Sociology of the Social Gospel : Quest for a Modern Ideology », dans Richard Allen, dir., The Social Gospel in Canada (Ottawa, Musée national de l’Homme, Dossier no 9, 1975), 263-285. Lire aussi Richard Allen, The Social Passion. Religion and Social Reform in Canada, 1914-1928 (Toronto, University of Toronto Press, 1971).
-
[7]
Nancy Christie et Michael Gauvreau, A Full-Orbed Christianity. The Protestant Churches and Social Welfare in Canada, 1900-1940 (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1996), xiii.
-
[8]
Jacques Palard, « Le “travail social” au Québec : de la logique religieuse à la rationalité étatique », Service social, 31,1 (janvier-juin 1982) : 137-167.
-
[9]
Georges-Henri Lévesque, « Service social et charité », Cahiers de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, III,2 (1944) : 20. Lire aussi R. P. Guillemet, « Le service social. Cours d’introduction », Nos cours, VI,2 (1944-1945) : 12-13.
-
[10]
Lire à ce sujet, Jean-Philippe Warren, L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec francophone (1886-1955) (Montréal, Boréal, 2003).
-
[11]
Cité par Ramsay Cook, The Regenerators. Social Criticism in Late Victorian English Canada (Toronto, University of Toronto Press, 1985), 195.
-
[12]
Jean-Philippe Warren, « La découverte de la “question sociale”. Sociologie et mouvements d’action jeunesse canadiens-français », Revue d’histoire de l’Amérique française, 55,4 (printemps 2002) : 539-592.
-
[13]
Lire, parmi plusieurs ouvrages, Mariana Valverde, The Age of Light, Soap, and Water. Moral Reform in English Canada (1885-1925) (Toronto, McLelland & Stewart, 1993).
-
[14]
Il est à noter qu’en 1900, aux États-Unis, 227 collèges et universités sur 683 proposaient des cours en sociologie. Alors que la sociologie avait été introduite dans 136 des 469 collèges affiliés à des Églises protestantes ou catholiques, et dans 91 des 214 collèges non confessionnels, seulement 6 collèges catholiques sur 81 offraient une formation dans cette discipline. J. Graham Morgan, « The Development of Sociology and the Social Gospel in America », Sociological Analysis, 30,2 (1969) : 50 ; pour une critique des conclusions que Morgan tire de ces chiffres, lire Jeffrey K. Hadden, Charles F. Longino et Myer S. Reed, « Further Reflections on the Development of Sociology and the Social Gospel in America », Sociological Analysis, 35,4 (1974) : 282-286.
-
[15]
Cecil E. Greek, The Religious Roots of American Sociology (New York, Garland Publishing, 1992), 105-159. Cet ouvrage, rempli d’intuitions fécondes et de citations révélatrices, n’en demeure pas moins biaisé.
-
[16]
Cité par Cecil E. Greek, The Religious Roots of American Sociology (New York, Garland Publishing, 1992), 129.
-
[17]
Marlene Shore, The Science of Social Redemption (Toronto, Toronto of University Press, 1987).
-
[18]
Thomas Poulantzas, « A Search for “Autonomy” at Canada’s First Sociology Department », Society/Société (mai 1991) : 10.
-
[19]
Nancy Christie et Michael Gauvreau, A Full-Orbed Christianity. The Protestant Churches and Social Welfare in Canada (1900-1940) (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1996), 137.
-
[20]
Cité par Nancy Christie et Michael Gauvreau, op. cit., 140.
-
[21]
Ibid., 141.
-
[22]
Jeffrey J. Cormier, « Missed Opportunities : The Institutionalization of Early Canadian Sociology », Society/Société, XXI,1 (1997) : 1-7.
-
[23]
Harry Alpert, « Robert M. MacIver’s Contributions to Sociological Theory », dans Morroe Berger, Theodore Abel et Charles H. Page, dir., Freedom and Control in Modern Society (New York, Octagon Books, 1964), 288.
-
[24]
Robert M. MacIver and C. H. Page, Society : An Introductory Analysis (New York, Rhinehart & Company, 1949), 628.
-
[25]
Robert M. MacIver, « The Social Sciences », On Going to College : A Symposium (New York, Oxford University Press, 1938), 124.
-
[26]
Malcolm Maclellan, « Education and the Social Sciences », Culture, V (1944) : 18.
-
[27]
Gilles Gagné et Jean-Philippe Warren, dir., Sociologie et valeurs. Quatorze penseurs québécois du xxe siècle (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2003).
-
[28]
R. M. MacIver, Community. A Sociological Study. Being an Attempt to Set Out the Nature and Fundamental Laws of Social Life (New York, Frank Cass & Co, 1970 [1917]), 59.
-
[29]
A. Brian McKillop, A Disciplined Intelligence. Critical Inquiry and Canadian Thought in the Victorian Era (Montréal, McGill et Queen’s University Press, 2001), xix.
-
[30]
Georges-Henri Lévesque, « Humanisme et sciences sociales », The Canadian Journal of Economics and Political Science, XVIII,3 (août 1952) : 268. Cette idée était reprise par Marcel Clément, professeur de sociologie à l’Université Laval, puis à l’Université de Montréal, avec, s’il est possible, encore plus de candeur : « L’heure des sciences sociales, affirmait-il, c’est l’heure de Dieu. »
-
[31]
C’est-à-dire, ici, « le » monde religieux, considéré d’un point de vue athée.
-
[32]
A. Brian McKillop, op. cit., 231.