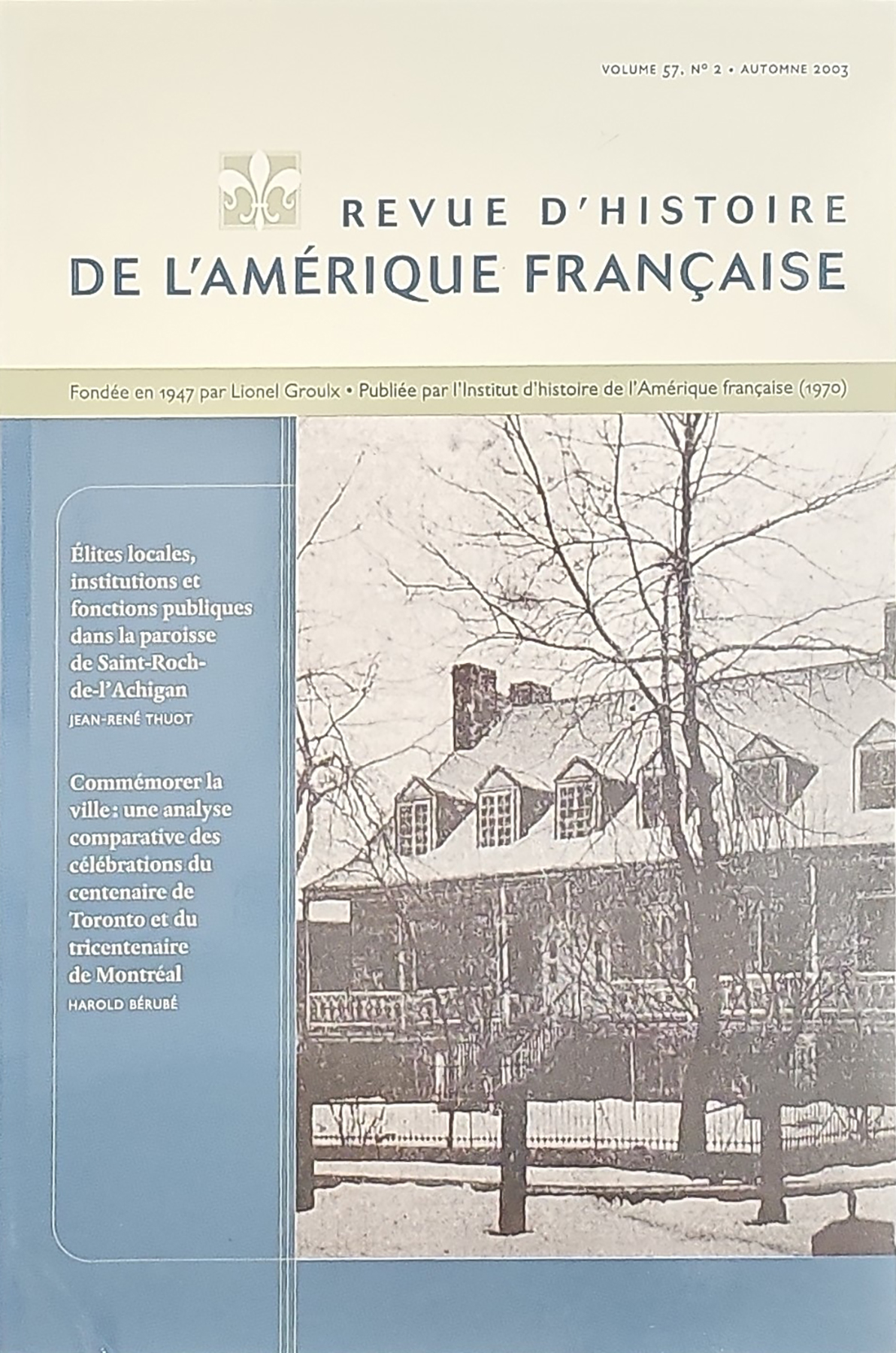Tiré de sa thèse de doctorat, cet ouvrage de Louise Bienvenue marque un pas dans notre connaissance de la jeunesse au Québec. Le sujet traité est ambitieux : Bienvenue y aborde de front les quatre mouvements nationaux d’Action catholique spécialisée de jeunesse, tant dans leur section masculine que féminine (Jeunesse ouvrière catholique, Jeunesse étudiante catholique, Jeunesse indépendante catholique et Jeunesse agricole catholique), de même que les organismes les chapeautant, dont le Comité national d’Action catholique. L’objectif l’est tout autant : elle veut redonner à la jeunesse sa place dans l’histoire du Québec d’avant la Révolution tranquille en dépassant les clichés essentialistes. Notons en passant que l’ouvrage traite des années 1930 et 1940, et non pas de l’avant Révolution tranquille. De manière plus spécifique, Bienvenue souhaite réintroduire la variable de l’âge dans l’analyse historique et démontrer qu’il s’agit d’un concept valable et porteur de sens pour saisir une société. Reprenant les approches de Pierre Bourdieu et d’Olivier Galland, l’auteure considère la jeunesse comme une catégorie sociale construite et définie en fonction des autres âges sociaux et des usages d’une société. Un peu courte, l’introduction est néanmoins d’une clarté exemplaire. Une critique de source un peu plus substantielle, plutôt qu’une simple présentation, aurait été souhaitable, mais les lecteurs peuvent toujours se référer à la thèse de doctorat de l’auteure pour plus de détails. Avec cette monographie, Bienvenue souhaite démontrer que les mouvements d’Action catholique spécialisée sont à l’origine de l’autonomisation de la jeunesse comme catégorie sociale au Québec. En fait, elle estime que, paradoxalement, « le nouveau zèle des élites à l’égard de la supervision des jeunes ne semble pas étranger à la promotion sociale du groupe et à sa prochaine autonomisation » (p. 28). Autrement dit, l’Église aurait mis en place des structures susceptibles d’être prises en main par les jeunes eux-mêmes et utilisées par ces derniers afin de s’imposer comme catégorie sociale autonome. La thèse est attrayante car, contrairement à beaucoup de publications précédentes sur la jeunesse, elle remet les jeunes au centre de l’analyse. La démonstration se fait en deux principales parties. La première couvre les années 1930-1945, c’est-à-dire la période de formation des mouvements d’Action catholique spécialisée jusqu’à la fin de la guerre ; la seconde s’attarde aux années 1945-1950, années de remise en question et de réorientation des mouvements. Chacune de ces parties est divisée en deux chapitres, eux-mêmes construits de manière thématique. Cette structure à la fois chronologique et thématique sert admirablement le propos. D’autant plus que les deux parties sont pertinemment articulées autour de deux conceptions différentes de la jeunesse : les années 1930-1945 sont dominées par une rhétorique de la « génération sacrifiée », alors que les années suivantes sont plutôt marquées par une nouvelle relation de la jeunesse à l’État et à la société civile, de même que par un désir d’ouverture internationale. Je tiens à souligner les quelques pages fort utiles du chapitre premier qui présentent plusieurs des nombreuses associations, mouvements et organisations de jeunes et de jeunesse qui fourmillent au cours des années 1930. L’audace dont fait preuve l’auteure en embrassant simultanément l’ensemble des mouvements de jeunesse d’action catholique, tant dans leurs dimensions féminines que masculines, fait de ce livre un incontournable de l’histoire de la jeunesse québécoise. Un sujet aussi vaste donne toutefois prise à la critique, car il est évident que certains mouvements (la JAC et l’ensemble des branches féminines des mouvements) font parfois figure de parents pauvres dans l’analyse. Des archives plus parcellaires expliquent peut-être cette situation. À quelques reprises, l’impression nous est laissée que les positions défendues par certaines branches (la JEC notamment, particulièrement après la guerre) …
BIENVENUE, Louise, Quand la jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la Révolution tranquille (Montréal, Boréal, 2003), 291 p.[Notice]
…plus d’informations
Karine Hébert
Département des sciences humaines
Université du Québec à Rimouski