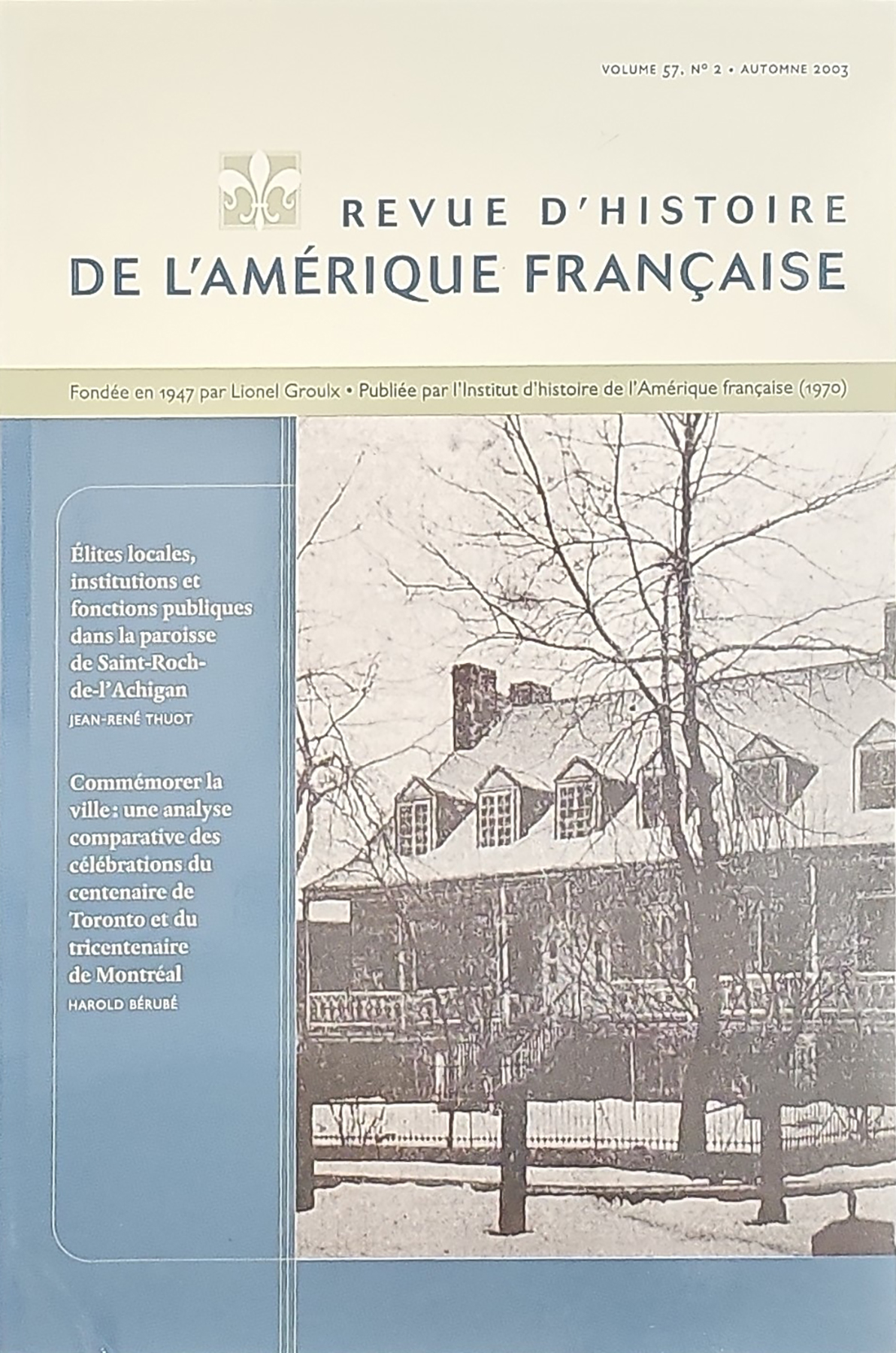Les publications récentes portant sur l’histoire des peuples autochtones sont d’une richesse extraordinaire. Elles remettent en question bien des idées reçues, en exhumant des archives des informations nouvelles et en faisant appel à des approches novatrices. Dans certains cas, elles contiennent toutefois des affirmations inexactes voire caricaturales portant sur des questions juridiques. Cette mauvaise perception risque de fausser les conclusions portant sur l’existence de droits ancestraux ou issus de traité. En effet, à défaut de faire des vérifications minimales, on risque de méconnaître les notions juridiques en se fondant exclusivement sur des conceptions historiques. Bien entendu, de nombreux écrits juridiques témoignent eux aussi d’une méconnaissance de la littérature historique, mais cet aspect du problème ne retiendra pas notre attention. Nous insisterons plutôt sur le traitement insatisfaisant ou discutable de certaines questions juridiques, en prenant pour exemple des études portant sur les fondements historiques des droits des Autochtones du Québec et des Provinces maritimes à l’époque de la Conquête ou du Régime français. Toutefois, notre objectif n’est pas de faire une revue de la littérature pertinente ou d’analyser l’ensemble de la jurisprudence. Nous présenterons plutôt les principes dont il aurait été important de tenir compte, en citant le cas échéant la décision rendue par la cour la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire, car c’est elle qui fait autorité, ou encore l’approche retenue par des juristes. Nous ne chercherons pas non plus à déterminer si le statut d’un auteur (universitaire ou consultant indépendant, spécialiste ou non des questions autochtones, anthropologue ou historien) ou le fait qu’une étude ait été commanditée par le gouvernement ou par une communauté autochtone accentue le problème discuté ci-dessous. Les risques d’abus sont évidents, d’un côté comme de l’autre d’ailleurs ; mais, à l’instar d’Arthur Ray, il faut résister à la tentation de considérer tous les experts qui déposent en cour comme des « hommes de main, des chacals ou des putains ». Les exemples ne manquent d’ailleurs pas d’études rigoureuses qui reconnaissent les limites de leur démarche. En ne prêtant pas attention à la terminologie juridique, les chercheurs risquent de négliger une dimension importante du passé. C’est ce que montre l’étude de la controverse ayant entouré la reconnaissance par les tribunaux du traité dit de Murray. De même, il est difficile de comprendre pourquoi certaines publications font abstraction des critères souples posés par la jurisprudence contemporaine en ce qui concerne la continuité entre la situation actuelle d’un peuple autochtone et celle dans laquelle se trouvaient placés ses ancêtres. Les risques d’erreurs que comporte l’utilisation de concepts juridiques anciens peuvent être illustrés par une étude récente de Denys Delâge et d’Étienne Gilbert portant sur les procès de 1760 à 1820 où au moins l’une des parties est autochtone. Les auteurs semblent ignorer qu’en 1774, la France et le Québec n’ont pas encore adopté de code civil. Ils supposent en outre qu’à cette époque, le « bénéfice du clergé » fait suite à la demande d’un prêtre de gracier un condamné à mort. En réalité, dans certains cas, cette règle de droit anglais permet au juge d’accorder la vie sauve à l’accusé non récidiviste ; il y a bien longtemps que le clergé ne joue plus aucun rôle à cette étape de la procédure. Ces auteurs croient également qu’il est « illégal » de vivre en union de fait, alors qu’aucune sanction pénale n’est imposée dans ce cas, même si cette relation ne confère aucun droit aux partenaires. Mais au-delà de ces points de détail, il existe des termes polysémiques dont la portée est éminemment discutable. Pour clarifier celle-ci, on ne peut faire l’économie de l’analyse des documents …
Les insuffisances d’une analyse purement historique des droits des peuples autochtones[Notice]
…plus d’informations
Michel Morin
Faculté de droit
Université de Montréal