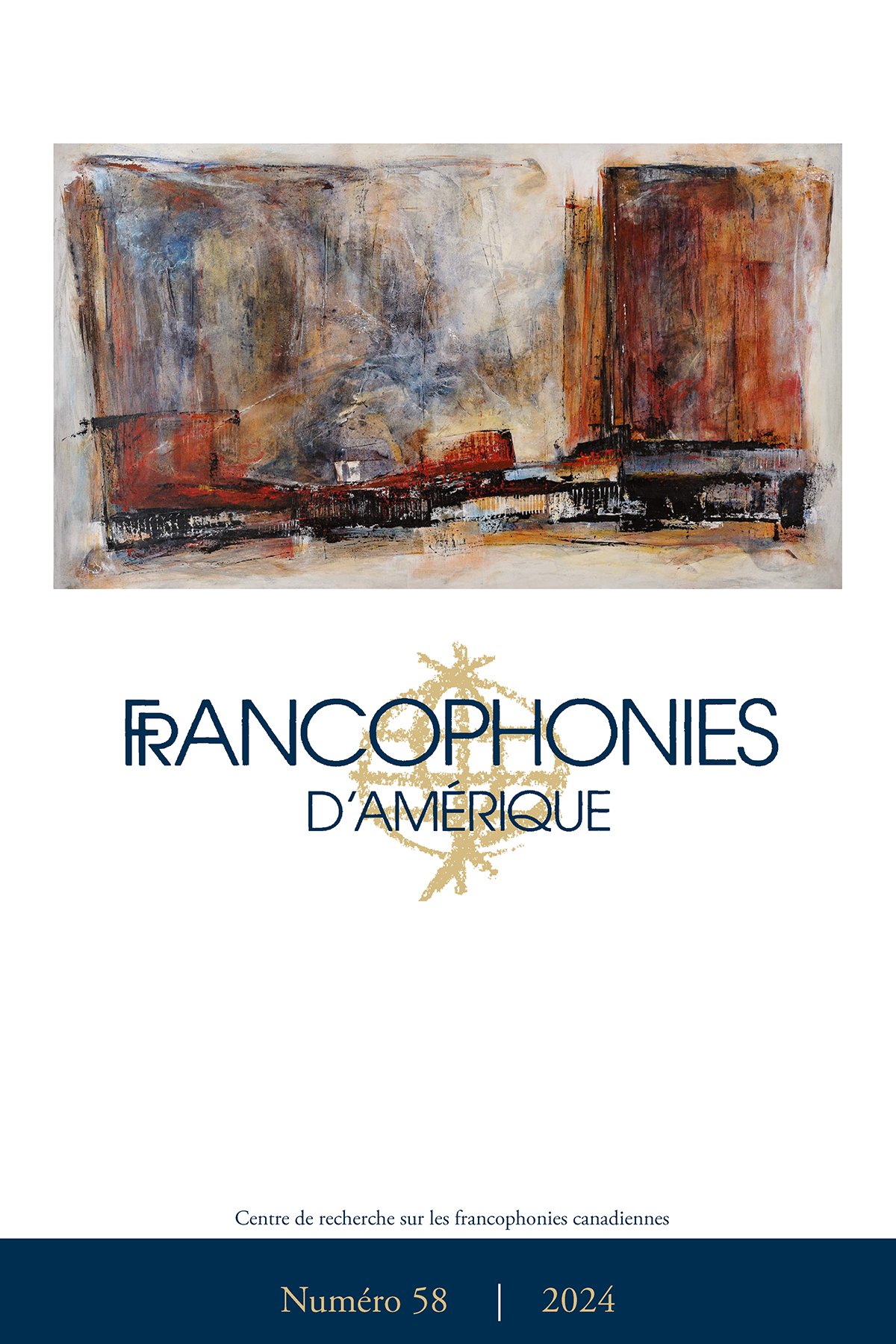L’importance de la contribution de Lise Gauvin à la théorie et à l’analyse des littératures francophones n’est plus à démontrer. Depuis plus de cinquante ans au cours desquels elle a rédigé quelques dizaines de volumes, Gauvin se penche sur les traits communs d’écrivains de toute la francophonie en s’arrêtant notamment à des questions cruciales, comme le rapport à la langue, la réception des oeuvres et les perspectives narratives, et en proposant quelques concepts fondamentaux, comme ceux de surconscience linguistique, de langagement et d’imaginaire des langues. C’est pourquoi ce dernier ouvrage, qui propose une synthèse de ses travaux est particulièrement digne d’intérêt, car il reprend en des versions nouvelles des articles et des chapitres de livres judicieusement choisis pour donner une image générale des diverses questions qui hantent les littératures francophones. L’auteure commence par l’explication de cette dénomination de « littératures de l’intranquillité » empruntée à une traduction de Fernando Pessoa et choisie pour éviter le piège de la minorisation et de l’inadéquation des diverses appellations adoptées pour désigner les littératures francophones. Ce faisant, elle met en place un argumentaire convaincant qui tient compte des difficultés et des défis de ces littératures, prises entre les particularités locales et la domination parisienne, pour proposer cette désignation qui découle de l’inconfort et du soupçon qui caractérisent la pratique de l’écrivain francophone et l’oblige à la mise en scène de sa propre écriture. Le premier chapitre s’arrête avec justesse sur un des textes les plus cités de l’étude des littératures francophones, soit le chapitre 3 de Kafka, pour une littérature mineure de Gilles Deleuze et de Félix Guattari (1975). Lise Gauvin en propose une analyse approfondie et passe en revue les diverses conceptions du corpus littéraire francophone pour aboutir à la notion d’intranquillité dans un texte qui devrait constituer le point de départ de tout étudiant qui s’intéresse aux littératures francophones. La surconscience linguistique, concept fondé par Lise Gauvin pour cristalliser le rapport très particulier de l’écrivain francophone à la langue et désormais inséparable de celui de littérature francophone, fait aussi à juste titre l’objet d’un chapitre. Cette notion riche et complexe englobe aussi bien le sentiment d’insécurité et d’inconfort face à la langue que la nécessité de la remise en question et le devoir de création par rapport à celle-ci. Le rapport problématique à la langue, comme déficit et surplus, implique l’engagement implicite ou explicite de l’écrivain que Lise Gauvin traduit par le concept de langagement, qui débouche sur diverses représentations et transformations de la langue que l’auteure a réunies dans l’idée d’imaginaire des langues. Comme l’auteure le mentionne dans l’introduction, un des champs d’action de l’écrivain francophone pour expliciter sa posture étrange par rapport au littéraire est souvent constitué de ce que Genette appelle les seuils du récit, c’est-à-dire tout ce qui accompagne le texte de fiction : préface, glossaire, notes, etc. Le quatrième chapitre met en évidence la richesse insoupçonnée de la note, sa variété, sa polyvalence, et donne ainsi un bel exemple de l’originalité et de la créativité de l’écrivain francophone contraint à réinventer à la fois la langue, le texte et tout ce qui l’entoure. Ici encore, le choc des langues, entre le français, l’anglais, le créole ou d’autres langues, montre toutes ses possibilités créatrices que Gauvin prend soin de codifier. Le travail de la note transforme la poétique romanesque, brouille la frontière entre le texte et le paratexte, décuple la puissance de création, la projette partout et produit un objet littéraire qui génère une salutaire et fascinante ambiguïté. La dernière partie de l’ouvrage a pour titre « Le roman comme atelier » …
Lise Gauvin, Des littératures de l’intranquillité : essai sur les littératures francophones, Paris, Karthala, 2023, 236 p.
…plus d’informations
Raoul Boudreau
Université de Moncton
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès