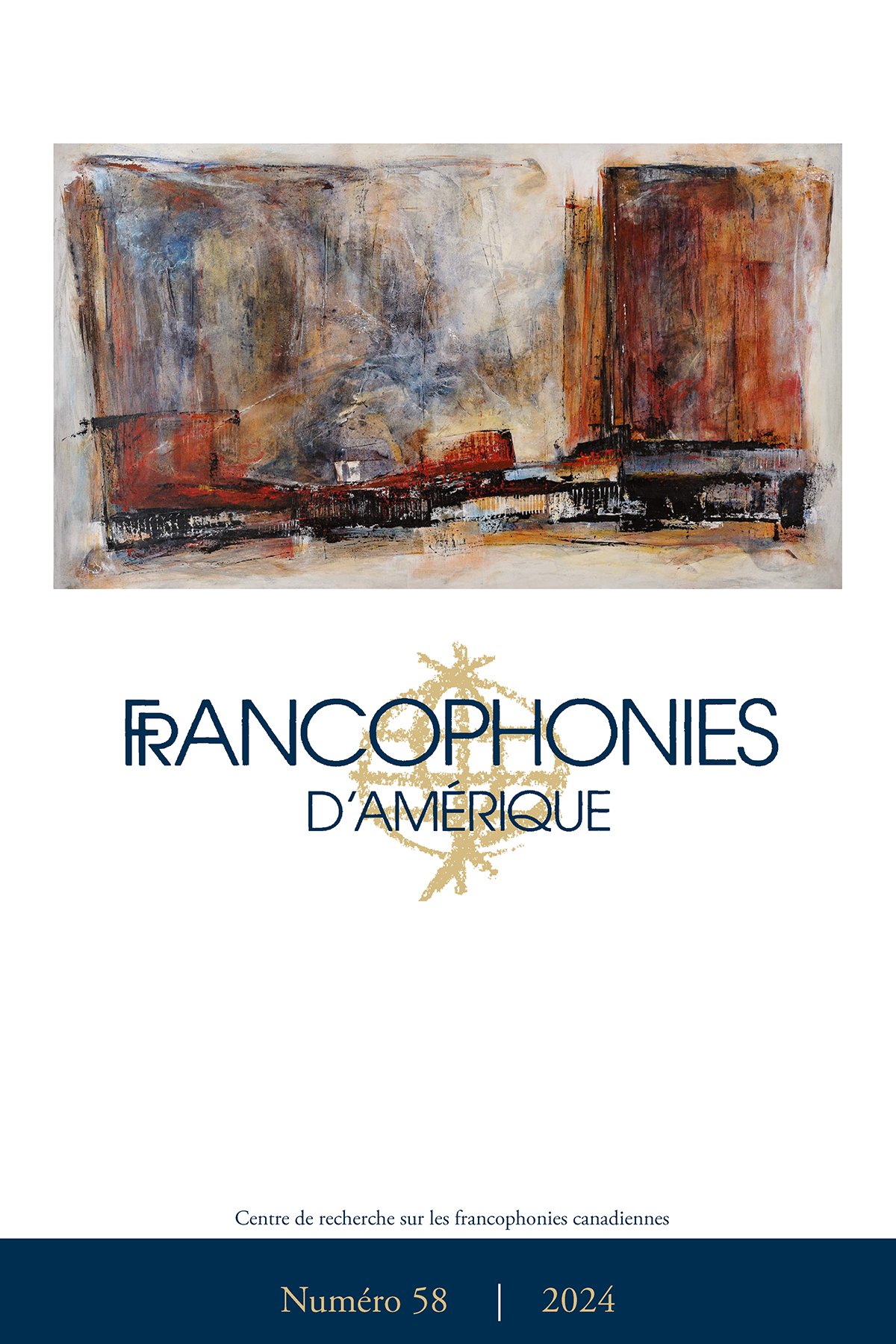C’est avec beaucoup de plaisir que je présente ce cinquante-huitième numéro de la revue, un numéro varia qui, malgré la diversité de ses approches et de ses objets d’étude, traite des tensions entre identité, territoire et langue, thématiques essentielles pour comprendre les dynamiques contemporaines. Les contributions de ce dossier adoptent des perspectives acadiennes, canadiennes et caribéennes et proposent une analyse multidimensionnelle sur la manière dont les communautés et les individus négocient leur rapport à l’espace, à la mémoire et à la langue dans des contextes historiques et actuels. Les trois premiers articles se consacrent à l’Acadie, lieu emblématique des défis identitaires et linguistiques en contexte francophone. Ces analyses montrent comment l’Acadie, par ses dynamiques sociales, ses productions littéraires et ses débats linguistiques, continue de s’affirmer comme un espace complexe, ancré dans l’histoire tout en étant en constante transformation. Qu’il s’agisse des défis pratiques de la gouvernance communautaire, des représentations littéraires de l’identité ou des débats contemporains sur la langue, ces textes explorent les multiples façons dont cette région entretient des relations avec son passé, ses territoires et son avenir. Le dernier article, quant à lui, nous transporte dans les Caraïbes, offrant un regard unique sur les questions identitaires et linguistiques dans un autre contexte francophone. Je suis particulièrement heureuse d’avoir pu inclure cette contribution, qui nous ouvre de nouveaux horizons et favorise un dialogue entre différentes francophonies. Ce numéro invite ainsi à reconsidérer les notions d’identité et de territoire comme des processus évolutifs, nécessaires pour comprendre et construire le monde contemporain. Tout d’abord, Majella Simard et Mario Paris présentent un article qui ancre notre réflexion dans les réalités concrètes des territoires et de leurs habitants. L’étude menée à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, met en lumière les défis auxquels font face les municipalités qui souhaitent s’adapter aux besoins d’une population vieillissante. À travers le prisme de l’initiative Municipalité amie des aînés (MADA), les auteurs explorent les questions de gouvernance, de collaboration et de leadership dans la mise en oeuvre de ce projet. Cette analyse repose sur une étude de cas longitudinale, incluant des entretiens et des groupes de discussion réalisés sur plusieurs années. Elle révèle que, malgré des efforts pour mettre en place les outils nécessaires, des obstacles persistants, notamment en matière de leadership et de communication, compromettent la pérennité du projet. L’article souligne également l’importance de renforcer la capacité d’agir des acteurs locaux, tout en plaidant pour une stratégie de gestion territoriale plus large, qui permettrait de mieux coordonner les actions. En montrant comment des projets communautaires peuvent à la fois comporter des défis et stimuler la résilience, cet article ouvre la voie à une considération plus vaste sur les relations entre territoire, gouvernance et identité collective. Le deuxième article, rédigé par Corina Crainic, nous invite à plonger dans l’univers littéraire d’Annie-Claude Thériault pour mieux comprendre les transformations identitaires en contexte migratoire. Dans l’analyse du roman Les Foley, Crainic explore les luttes intérieures et collectives des personnages, particulièrement des femmes, confrontés à une double appartenance, à leur passé irlandais et à leur avenir en sol acadien. L’analyse révèle comment la migration agit comme un moteur de transformation, mais aussi de tension, en obligeant les personnages à naviguer entre fidélité au passé et adaptation au présent. L’Acadie, telle qu’elle est représentée dans le roman, devient un espace complexe, à la fois enraciné dans l’héritage et ouvert à de nouvelles solidarités. Ce texte entre directement en dialogue avec le premier article en approfondissant la notion de territoire, mais cette fois sous un angle littéraire et symbolique. En choisissant de ne pas réduire l’identité à une essence fixe ou simplifiée, cet article illustre …
Présentation
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès