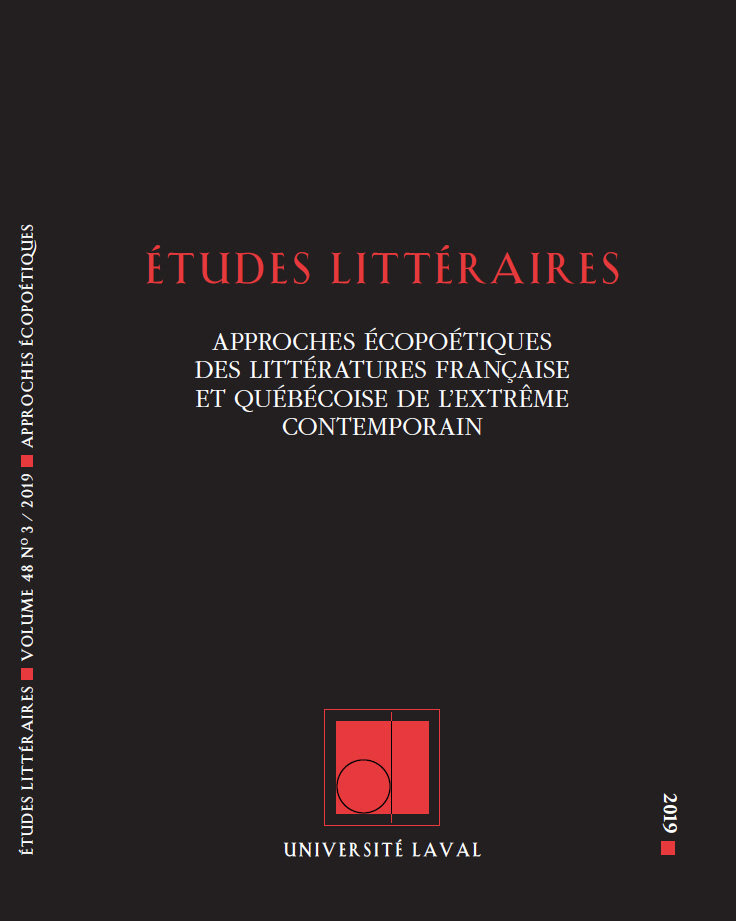L’écopoétique est une perspective théorique qui se donne pour objectif d’étudier la représentation littéraire des liens entre nature et culture, humain et non-humain. Elle peut relever à la fois d’une approche interne et externe du texte littéraire, dans la mesure où elle interroge le langage et les représentations d’une part, mais d’autre part, elle ne se départ jamais du monde, du réel et de ses contraintes et impératifs. Ce faisant, elle propose « une manière de répondre à la place toujours grandissante que les problématiques liées à la nature et à sa préservation occupent dans la littérature des dernières années ». Pierre Schoentjes souligne, dans son essai Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, l’éveil d’une conscience environnementale dans la littérature hexagonale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les récits de Pierre Gascar et de Romain Gary. Dans le corpus québécois, il faut attendre les années 1970 et L’Isle au dragon de Jacques Godbout pour lire un phénomène comparable. Ainsi l’écopoétique, comme le soulignent les recherches de Jonathan Bate, s’intéresse avant tout au texte en lui-même, à l’art littéraire comme création verbale, en délimitant clairement son objet d’analyse (le texte littéraire) et son approche théorique (l’analyse discursive, énonciative et narrative) au sein de la vaste mouvance des études écocritiques. On peut dès lors proposer une première distinction, voire une articulation entre écocritique et écopoétique, les deux termes étant parfois présentés comme équivalents (écopoétique a pu parfois passer pour la traduction de l’anglais ecocriticism). L’écocritique est un vaste champ de recherche transdisciplinaire qui interroge les relations entre l’homme et l’environnement. Cette approche théorique a émergé aux États-Unis au cours des années 1970, notamment à travers les travaux de Joseph Meeker, qui évoque une « écologie littéraire », et de William Rueckert, premier chercheur à employer le néologisme ecocriticism, proposant de rapprocher les domaines de la littérature et de l’écologie. Plusieurs paramètres relatifs à l’émergence de ce champ de recherche se sont révélés, au cours des années, faire à la fois ses grandeurs et ses misères. Forte sur le plan théorique de sa transdisciplinarité, cette caractéristique a nui à son institutionnalisation et à son développement, les chercheurs et les groupes de recherche ayant dans un premier temps éprouvé des difficultés à s’identifier mutuellement et à partager leurs réflexions. L’écocritique a ainsi longtemps « flotté » jusque vers le milieu des années 1990, sans acquérir de réelle visibilité. Si elle permet également de fructueux échanges, la transdisciplinarité s’étiole dans l’irréductible singularité de chaque sujet et des approches méthodologiques propres à certaines disciplines. Plus encore, à défaut peut-être de texte fondateur clairement identifié, l’écocritique est devenue une nébuleuse théorique aux contours indécis qui a donné naissance – du moins a nourri – plusieurs approches connexes telles que l’écoféminisme, les études animales, parfois nommées la zoopoétique, ou encore les critical plant studies. Il existe aussi de nombreuses formes de rapprochement avec les études postcoloniales et autochtones. L’écocritique a également essaimé sur plusieurs continents, traversant bien des frontières, des langues, mais donc aussi des expériences du monde bien différentes, ce qui a eu pour effet de dilater encore le champ déjà très large qu’elle couvrait. Si bien que ce terme demeure extrêmement lâche encore aujourd’hui et peut prêter à confusion. De définitions en élargissements successifs, la vaste mouvance écocritique paraît tendue entre deux pôles opposés : d’une part, un mouvement centrifuge la pousse à incorporer des approches et des sujets toujours plus divers, tandis que d’autre part, des forces centripètes s’efforcent de la définir, de la théoriser et d’en marquer les contours. La conjugaison de ces deux tensions opposées …
Parties annexes
Références
- Bate, Jonathan, Romantic Ecology. Wordsworth and the Environmental Tradition, London, Routledge, 1991.
- Bate, Jonathan, The Song of the Earth, Cambridge, Harvard University Press, 2000.
- Blanc, Nathalie, Thomas Pughe et Denis Chartier, « Littérature & écologie : vers une écopoétique », Écologie & Politique, vol. 36, no 2 (2008), p. 15-28.
- Brouwer, Malou, Viv(r)e la terre. La poésie autochtone féminine contemporaine comme art de l’environnement, Thèse de master, Nimègue (Pays-Bas), Université Radboud, 2015.
- Buell, Lawrence, The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture, Cambridge, Harvard University Press, 1995.
- Carrié, Fabien, Parler et agir au nom des bêtes : production, diffusion et réception de la nébuleuse idéologique « animaliste » (France et Grande-Bretagne, 1760-2010), Thèse de doctorat, Nanterre, Université Paris X Nanterre, 2015.
- Chelebourg, Christian, Les Écofictions. Mythologies de la fin du monde, Bruxelles, Les Impressions nouvelles (Réflexions faites), 2012.
- d’Eaubonne, Françoise, Le Féminisme ou la mort, Paris, Pierre Horay, 1974.
- Gary, Romain, Les Racines du ciel, Paris, Gallimard, 1956.
- Gascar, Pierre, Les Bêtes, Paris, Gallimard, 1953.
- Godbout, Jacques, L’Isle au dragon, Paris, Éditions du Seuil, 1976.
- Huggan, Graham, « “Greening” Postcolonialism », Modern Fiction Studies, vol. 50, n° 3 (2004), p. 701-733.
- Johnson, David Kenneth et Kathleen R. Johnson, « The Limits of Partiality – Ecofeminism, Animal Rights, and Environmental Concern », dans Karen Warren et Barbara Wells-Howe (dir.), Ecological Feminism, London, Routledge, 1994, p. 106-119.
- Laist, Randy (dir.), Plants and Literature : Essays in Critical Plant Studies, Amsterdam / New York, Rodopi, 2013.
- Larrère, Catherine, « Care et environnement : la montagne et le jardin », dans Sandra Laugier (dir.), Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, Payot & Rivages (Petite Bibliothèque Payot), 2012, p. 233-262.
- Meeker, Joseph, The Comedy of Survival. Studies in Literary Ecology, New York, Charles Scribner’s Sons, 1974.
- Merchant, Carolyn, The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, San Francisco, Harper & Row, 1980.
- Nixon, Rob, « Environmentalism and Postcolonialism », dans Ania Loombaet al. (dir.), Postcolonial Studies and Beyond, Durham / London, Duke University Press, 2005, p. 233-251.
- Romestaing, Alain, Pierre Schoentjes et Anne Simon (dir.), « Écopoétiques. Présentation », Revue critique de fixxion française contemporaine, n° 11 (décembre 2015), p. 1-5.
- Rueckert, William, « Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism », Iowa Review, vol. 9, n° 1 (1978), p. 71-86.
- Schoentjes, Pierre, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Marseille, Wildproject (Tête nue), 2015.
- Shiva, Vandana, Staying Alive. Women, Ecology and Development, London, Zed Books, 1988.
- Singer, Peter, Animal Liberation : A New Ethics for Our Treatment of Animals, New York, Avon Books, 1975.
- Suberchicot, Alain, Littérature et environnement. Pour une écocritique comparée, Paris, Honoré Champion (Unichamp-Essentiel), 2012.
- Waldau, Paul, Animal Studies : An Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2013.
- Warren, Karen J., Ecofeminist Philosophy : A Western Perspective on What It Is and Why It Matters, New York, Rowman & Littlefield, 2000.