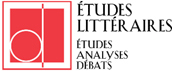Résumés
Résumé
Plusieurs critiques, comme François Ricard et Éva Le Grand, ont mis l’accent sur le désenchantement du roman kundérien. Si nous considérons leurs propos comme justes, nous croyons aussi qu’il faut rappeler la présence et l’importance des éléments mythiques et sacrés dans le roman de Milan Kundera. Nous posons l’hypothèse que le sacré et la prose sont unis par une oscillation qui organise le parcours des personnages du roman. Dans La valse aux adieux, cette oscillation est bornée par deux objets bleus : la lumière irradiant de Bertlef et le comprimé mortel de Jakub.
Abstract
Several critics, such as François Ricard and Éva Le Grand, insist on the disenchantment in Milan Kundera’s works. If we agree with this point of view, we also believe that many important mythical and sacred elements are included in these novels. Our contention is that the characters’ journey is guided by an oscillation between the sacred and the prose. In the Farewell Waltz, these poles are symbolized by two blue elements : the fabulous light irradiating from Bertlef and Jakub’s fatal pill.
Corps de l’article
Depuis quelques années, plusieurs monographies consacrées à Milan Kundera ont mis l’accent sur le climat de dévastation et de désenchantement dans lequel baignent les personnages du romancier : François Ricard, dans Le dernier après-midi d’Agnès, croit « qu’on peut lire l’oeuvre de Kundera comme l’exploration d’un monde dévasté, ou plutôt abandonné, c’est-à-dire du monde tel qu’il ne cesse d’apparaître à la conscience exilée[2] » ; Éva Le Grand, dans Kundera ou la mémoire du désir, montre comment le kitsch est déconstruit dans le roman kundérien pour mettre au jour « l’insidieuse intrusion d’une réalité mensongère entre soi et le monde[3] ». Si leurs propos semblent justes et sont corroborés par les intentions du romancier lui-même — il suffit de lire son Art du roman et ses Testaments trahis pour s’en convaincre —, nous croyons qu’il ne faut pas pour autant occulter l’autre face du Janus romanesque : la présence d’éléments mythiques et sacrés dans la prose kundérienne. Ainsi, il ne s’agit plus de parler du seul désenchantement, mais plutôt d’une sorte de tension ou d’oscillation romanesque : tantôt le roman s’élève vers une mémoire du mythe, tantôt il descend vers le sol de la prose, du « caractère concret, quotidien, corporel de la vie[4] », comme l’écrit Kundera dans Le rideau. Cette bipolarité est souvent constitutive de l’identité du personnage kundérien. C’est le cas pour le riche américain Bertlef, l’un des personnages les plus énigmatiques de l’oeuvre de Kundera, qui apparaît dans le roman La valse aux adieux[5] (1973).
Riche en rebondissements et en situations tragico-comiques, La valse aux adieux a toutes les apparences d’un vaudeville. Dans le décor d’une petite ville d’eaux, la rencontre de plusieurs personnages (Skreta, un médecin excentrique ; Jakub, un dissident à quelques heures de l’exil ; Ruzena, une infirmière enceinte ; Klima, un trompettiste pris au piège) conduit ou bien à leur mort, ou bien à la célébration de la vie sous toutes ses formes. Au coeur de cette alternative, Bertlef semble incarner — sans l’épuiser — l’étrange cohabitation du sacré et de la prose dans l’oeuvre de Kundera. Vieux libertin qui n’est pas sans rappeler le docteur Havel des Risibles Amours, il est paradoxalement animé par une sorte d’ascétisme, par une foi débordante.
Mais Bertlef est condamné. Malade du coeur, il sait que « sa vie est suspendue à un fil[6] ». Pourtant le fil ne se rompt pas, et La valse aux adieux ne se termine pas par la mort du personnage : bien au contraire, le roman se conclut par la perspective d’« un magnifique week-end[7] » que Bertlef passera avec sa jeune épouse, leur enfant et le docteur Skreta, qui cherche à se faire adopter par l’Américain. Si sa vie est bien « suspendue à un fil », il ne fait pas de doute que ce fil est solidement attaché. Bertlef n’est pas qu’un vieil homme valétudinaire : sa vie est ancrée dans un autre monde[8], fait de gestes miraculeux et de références bibliques qui rappellent à plusieurs égards la vie d’un saint, voire celle du Christ. À cet aspect divin viennent se mêler les plaisirs de la bonne chère et du libertinage, qui ne sont pas sans rappeler l’opulence bourgeoise de la Belle Époque. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si La valse aux adieux se déroule dans une de ces villes d’eaux que les mondains fréquentaient au début du siècle.
Si l’on en croit François Ricard, Bertlef est une figure satanique, « dans la mesure où ses gestes, ses paroles, son passé (les bribes que le roman nous en apprend suffisent à le placer sous le signe de la désillusion) le font apparaître […] comme un être qui a retiré au monde toute créance[9] ». Ce « désenchantement », qui le conduit à s’aménager « un espace à lui, protégé, harmonieux, comme une enclave de douceur et de bonté[10] », se conjugue toutefois avec une croyance en la grandeur de l’homme. En effet, Bertlef croit fermement au message d’amour christique : « Vaut-il la peine d’être homme, oui ou non ? Je n’en ai aucune preuve mais, avec Jésus, je crois que oui[11]. » À cet acte de foi, il faut ajouter les nombreux phénomènes inexpliqués dont il semble l’agent. Parmi ces manifestations qui paraissent relever d’un autre monde, l’on notera cette lumière bleue qui éclaire par deux fois la chambre du vieil homme. Que signifie-t-elle ? Serait-elle, comme l’auréole bleue du saint Lazare que peint Bertlef, l’image d’une « joie divine », « paisible et douce[12] » ?
À cette lumière bleue, il faut opposer le petit objet, bleu lui aussi, qui sème la mort à l’autre bout de La valse aux adieux : le comprimé de Jakub. Lorsque, plusieurs années auparavant, celui-ci est sorti de prison, il a cherché une façon « de rester maître de sa mort et de pouvoir en choisir l’heure et le moyen[13] ». Son ami Skreta, jeune biochimiste, lui a alors fabriqué un comprimé mortel. Quinze ans plus tard, sur le point d’émigrer, Jakub veut tirer un trait sur sa vie passée. Il revient donc dans la ville d’eaux pour remettre à Skreta le comprimé. Mais dans un vaudeville où les quiproquos et les hasards se multiplient, l’objet bleu se retrouve plutôt dans le sac de la jeune infirmière enceinte, Ruzena, parmi des médicaments de la même couleur. Les conséquences seront funestes.
Même si sa présence peut paraître épisodique, Bertlef est au coeur d’un jeu oscillatoire, à l’échelle du roman, dont les bornes liminaire et terminale sont cette lumière bleue et le comprimé mortel bleu pâle. Sans la réduire à la tension entre le sacré et la prose, on peut croire que cette oscillation y participe, qu’elle en constitue une sorte d’avatar, de variation, pour reprendre le vocabulaire de Kundera.
L’auréole bleue de Bertlef
Deux mois après son concert dans la petite ville d’eaux, le célèbre trompettiste Klima revient parmi les curistes pour revoir et convaincre la jeune infirmière Ruzena de se faire avorter — même s’il n’est pas certain d’être le père de l’enfant. Tandis qu’il cherche du réconfort auprès de Bertlef, il remarque que le vocabulaire de ce dernier a « quelque chose de délicieusement suranné[14] ». C’est en fait toute la personne de Bertlef qui semble sortie d’une autre époque. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’homme habite une chambre « où logeaient autrefois les ministres et les industriels[15] », dans le seul foyer de la station qui n’a pas été rebaptisé depuis sa construction : l’hôtel Richmond, « le plus bel édifice de la station, immeuble de style Art nouveau du début du siècle[16] ». Dans ces lieux riches de souvenirs bourgeois, les désirs de Bertlef sont comblés, comme s’il vivait encore à la Belle Époque. Dans « ce trou où il n’y a pas un restaurant qui serve un dîner correct[17] », comme le dit le docteur Skreta, Bertlef réussit à faire bonne chère. Ses plaisirs semblent même redonner vie à la petite ville d’eaux, comme si une lumière éclairait un décor depuis longtemps plongé dans l’obscurité.
Cette force vive que Bertlef insuffle aux lieux se condense dans cette lueur bleue qui émane de sa chambre, jaillissant par exemple après sa nuit d’amour avec la jeune Ruzena[18]. Si cette luminescence procède de plaisirs corporels, elle n’en rappelle pas moins l’auréole des saints, qui irradie « à certains moments de joie intérieure intense[19] ». Tout se passe comme si la lumière bleue venant de la chambre de Bertlef conjuguait les joies corporelles du libertin et les joies intérieures du saint, affirmant du coup l’identité « bicéphale » du personnage.
Deux épisodes de La valse aux adieux permettent de saisir cette coexistence du sacré et de la prose au sein d’un même être. Il y a le repas au restaurant Slavia, qualifié d’« entracte[20] » par le romancier, pendant lequel Bertlef fait irruption parmi plusieurs convives en multipliant les bouteilles de vin et les excellents fromages. Mais il y a d’abord la soirée dans l’appartement de Bertlef, en plein coeur du roman.
Ce soir-là, Jakub accompagne son ami Skreta chez Bertlef, question d’étudier de près le comportement du riche Américain. Une fois dans l’appartement de l’hôtel Richmond, il note avec surprise la couleur bleue de l’auréole du saint Lazare peint par Bertlef. Pourquoi a-t-il utilisé cette couleur ? Réponse du principal intéressé : « J’ai fait l’auréole bleue, simplement parce qu’en réalité une auréole est bleue[21]. » Jakub, étonné, questionne Bertlef sur la valeur symbolique de l’auréole. Ce dernier réitère la réalité des saints et des auréoles bleues. Cette réponse pour le moins déconcertante n’incline cependant pas les deux convives à considérer Bertlef comme un dévot un peu dérangé : oubliant très rapidement cette histoire d’auréoles, ils passent sans transition au choix de l’alcool qu’ils boiront. Tout se passe comme si le caractère mystique — qu’il soit réel ou illusoire — de Bertlef était ignoré ou feint d’être ignoré. On considère l’Américain tout au plus comme « un type extrêmement curieux[22] ».
La réaction de Klima, devant un des phénomènes inexpliqués dont Bertlef semble être l’agent, est analogue à celle des deux convives. Le soir de sa première visite à Bertlef, il est ébloui par une lumière bleue :
Il ne voyait rien. Il ne voyait qu’une clarté qui provenait d’un angle de la pièce. C’était une étrange clarté ; elle ne ressemblait ni à la blanche luminescence du néon, ni à la lumière jaune d’une ampoule électrique. C’était une lumière bleutée, et elle emplissait toute la pièce[23].
Si Klima cherche à comprendre l’origine de cette « lumière tout à fait extraordinaire[24] », il n’envisage jamais de causes surnaturelles : Bertlef prend peut-être « un bain de soleil avec une lampe à ultraviolets[25] ». Il suffit que le riche Américain éclate de rire pour que Klima se convainque que cet éblouissement n’était sans doute qu’une illusion causée par le passage de l’obscurité du couloir à la luminosité de la chambre. La conversation bifurque aussitôt vers les problèmes personnels de Klima. Mais comment celui-ci peut-il oublier si rapidement la « lumière tout à fait extraordinaire » qu’il vient de voir ? Ne se souvient-il pas de l’auréole bleue de saint Lazare ? Comme les autres personnages du roman, Klima ne semble pas disposé à envisager l’existence d’une autre réalité, celle où les auréoles sont bleues et où Bertlef est beaucoup plus qu’« un type extrêmement curieux ».
Un autre phénomène inexpliqué met à l’épreuve cette attitude des personnages :
La porte s’ouvrait, un enfant entra. C’était une fillette qui pouvait avoir cinq ans ; elle portait une robe blanche à volants, ceinte d’un large ruban blanc attaché dans le dos par un grand noeud dont les pointes ressemblaient à deux ailes. Elle tenait à la main la tige d’une fleur : un grand dahlia. En voyant dans la pièce tant de gens qui semblaient tous stupéfaits et tournaient vers elle leur regard, elle s’arrêta, n’osant pas aller plus loin.
Mais Bertlef se leva, son visage s’illumina, et il dit : « N’aie pas peur, petit ange, viens. »
Et l’enfant, voyant le sourire de Bertlef et comme si elle y prenait appui, rit aux éclats et se mit à courir vers Bertlef qui lui prit la fleur et lui donna un baiser sur le front.
Tous les convives et le garçon observaient cette scène avec surprise. L’enfant, avec le grand noeud blanc dans le dos, ressemblait vraiment à un petit ange. Et Bertlef debout, penché en avant avec le dahlia dans la main, faisait songer aux statues baroques des saints que l’on voit sur les places des petites villes[26].
En plus de cette assimilation du personnage aux saints baroques des places publiques, on notera que l’arrivée de l’ange rappelle un certain héritage chrétien. Son apparition est la répétition d’un épisode biblique, implicitement annoncé par la peinture de Bertlef représentant saint Lazare, ce moine du XIe siècle condamné par l’« ascétisme rigoureux [de son temps], intolérant à l’égard de toutes les joies profanes[27] ». On reconnaît ici la ligne de conduite de Bertlef : rendre grâce à Dieu par des « joies profanes ». Mais l’évocation du saint nom renvoie aussi au Lazare de la parabole de Jésus, « Le mauvais riche et le pauvre Lazare[28] ». On se souviendra qu’après leurs décès respectifs, le riche se retrouve « dans le séjour des morts, en proie aux tourments[29] », tandis que le pauvre est « emporté par les anges dans le sein d’Abraham[30] ». Entre les deux, dit Abraham, il y a « un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d’ici [où se trouve Lazare] chez vous [où se trouve le mauvais riche] ne le puissent, et qu’on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous[31] ». Cette parabole semble ironiquement récupérée dans le roman, sauf qu’ici, Bertlef réussit à combler l’abîme entre le mauvais riche et le pauvre Lazare. Il est à la fois l’« homme riche qui [s’habille] de pourpre et de lin fin et qui chaque jour [fait] brillante chère[32] » et le pauvre Lazare. Une parabole dévoyée, dans laquelle le mauvais riche s’élève avec les anges, est bel et bien inscrite dans La valse aux adieux.
Chers amis, dit-il, en se tournant vers ses invités, j’ai passé avec vous un très agréable moment et j’espère qu’il en va de même pour vous. Je resterais volontiers avec vous jusqu’à une heure avancée de la nuit, mais comme vous le voyez, je ne le peux pas. Ce bel ange est venu pour m’appeler auprès d’une personne qui m’attend. Je vous l’ai dit, la vie m’a frappé de toutes sortes de façons, mais les femmes m’ont aimé[33].
Le dévoiement de la parabole est renforcé par ces derniers mots, qui laissent croire que c’est une femme qui attend Bertlef, et non Abraham. Le libertinage est ici mêlé à la répétition d’un geste biblique. Puisqu’« une nuit d’amour [ferait] courir [à Bertlef] un grand danger[34] », on peut croire que c’est la force de l’autre monde, mêlée aux plaisirs corporels, qui empêche le personnage d’être emporté par la mort. Son ancrage dans l’illo tempore biblique lui permet peut-être de pallier la brièveté de sa vie humaine.
Les témoins de l’arrivée de l’ange n’envisagent pas ces dernières hypothèses. Si Olga — la protégée de Jakub qui s’est jointe aux convives — est très méfiante envers les croyants, qui « ont un sens aigu de la mise en scène des miracles[35] », Skreta et Jakub semblent accepter sans trop y croire l’identité angélique de la petite fille. Jakub ajoute néanmoins cette nuance importante : « Un ange proxénète et entremetteur. C’est bien comme ça que je me représente son ange gardien[36]. » Même si l’image correspond à la double identité de Bertlef, qui oscille entre l’azur céleste et la sexualité, elle ne semble pas confirmer, dans l’esprit des personnages, le caractère surnaturel de la petite fille. Comme Klima, les convives passent outre cette apparition céleste pour se consacrer à leurs problèmes bien « terrestres » : Skreta désire se faire adopter par Bertlef pour profiter du passeport américain, Olga veut séduire Jakub, et ce dernier vit ses dernières heures dans son pays. Le caractère céleste de l’expérience vécue dans l’appartement de Bertlef ne modifie pas leur comportement. Du moins, pas pour le moment.
Le second épisode de La valse aux adieux qui révèle la double identité de Bertlef est celui de la « multiplication des vins et fromages[37] ». L’endroit où se déroule ce « petit miracle[38] » est le restaurant Slavia, « le pire des établissements de la station, café crasseux où les gens du pays [viennent] boire de la bière et cracher par terre[39] ». Le romancier décrit ainsi les lieux :
Autrefois, c’était sans doute le meilleur restaurant de la ville d’eaux et de ce temps il restait encore, dans le petit jardin, trois tables en bois peintes en rouge (la peinture était déjà écaillée) avec des chaises, souvenir du plaisir bourgeois des fanfares en plein air, des réunions dansantes et des ombrelles posées contre les chaises[40].
L’infirmière Ruzena, qui erre dans le décor, ne sait rien de ce passé bourgeois : elle ne va dans la vie « que sur l’étroite passerelle du présent, dépourvue de toute mémoire historique[41] ». Seul l’enfant qu’elle porte, croit-elle, pourra la tirer de cette « durée sans événements[42] ». Mais c’est plutôt Bertlef qui bouleversera son destin.
Bertlef n’arrive pas au restaurant Slavia : il a « depuis longtemps la curieuse habitude de ne pas arriver mais d’apparaître[43] ». Malgré l’incrédulité des quelques gens attablés — auxquels s’est jointe la jeune infirmière —, l’Américain fait revivre, comme par enchantement, la splendeur qu’avait jadis le restaurant : la table sale et le mauvais vin sont remplacés par une table couverte d’une nappe immaculée où l’on sert un délicieux vin de 1922. D’excellents fromages sont apportés par un jeune garçon d’une douzaine d’années, qui ressemble à s’y méprendre au gamin qui a servi le repas dans l’appartement de Bertlef, un peu avant l’arrivée de l’ange. Deux passés se rencontrent de nouveau ici : l’abondance de la Belle Époque et le premier miracle du Christ, le jour du mariage à Cana. Bertlef donne ainsi une sorte de relief historique au restaurant vétuste. Du même souffle, il réussit à modifier le parcours jusqu’ici erratique de Ruzena, qui devient tout à coup scintillante comme un diamant. Bertlef rend hommage à cette beauté ignorée :
Je voudrais en trinquant marier le passé et le présent et le soleil de 1922 au soleil de cet instant. Ce soleil c’est Ruzena, cette jeune femme toute simple qui est une reine sans le savoir. Elle est, sur la toile de fond de cette ville d’eaux, comme un diamant sur l’habit d’un mendiant[44].
Ces quelques métaphores pompières et l’attitude de Bertlef suffiront pour que Ruzena ressente une force incroyable, venue d’en haut. C’est dans cette atmosphère de bien-être que la lumière bleue jaillira de nouveau, dans la chambre où les amants passeront la nuit.
Bertlef apparaît au restaurant Slavia au moment précis où la jeune infirmière s’apprête à prendre un médicament dans son sac. Le comprimé mortel s’y trouve déjà. Lorsque Bertlef dira plus tard à Ruzena qu’il est « venu à temps[45] », elle ne saisira pas la portée de cette affirmation. Elle ne saura pas qu’il lui a donné quelques heures de plus à vivre. Pendant ce temps, le comprimé mortel aura fait son oeuvre. Bertlef se retire de l’avant-scène. Il cède sa place à la mort et au personnage de Jakub.
Le comprimé bleu pâle de Jakub
Skreta a fabriqué un poison mortel pour son ami Jakub afin que celui-ci puisse toujours demeurer maître de sa vie. Pour l’intellectuel qui s’apprête à traverser la frontière, ce comprimé appartient à la vie qu’il laisse dans ce pays où il a tant souffert. Quelques heures avant son départ, tous les gestes et toutes les situations deviennent riches « d’un sens exceptionnel[46] », et Jakub désire une restitution hautement symbolique. Le fait qu’il trouve le tube de médicaments que Ruzena a oublié sur une table a nécessairement une signification qu’il doit déchiffrer. Depuis la veille, cette jeune femme est devenue le symbole de « son éternelle défaite[47] ». En effet, lorsqu’elle a voulu l’empêcher de sauver un chien pourchassé par des vieillards faisant partie de l’Association des volontaires de l’ordre public, il a compris : « elle était apparue sur la scène non pas comme persécuteur mais comme spectateur qui, fasciné par le spectacle, s’identifie aux persécuteurs[48]. » La haine de Jakub venait de trouver son dernier objet.
L’exilé en puissance cherche donc la signification de ce tube, sur la table. Pourquoi la jeune femme détestée a-t-elle oublié des comprimés semblables au sien ? Pendant sa réflexion, il introduit son comprimé dans le tube de Ruzena. Quelques instants plus tard, la jeune femme revient. S’il résiste pendant un moment, Jakub finit par lui remettre le tube. Il passera ses dernières heures au pays à essayer de comprendre son geste.
Une première explication s’impose à lui lorsqu’il croise Ruzena et peut encore la sauver, avant que celle-ci ne prenne le poison mortel :
celui qui le met à l’épreuve (Dieu en qui il ne croit pas) ne réclame pas le sang des innocents. Au terme de l’épreuve, il ne doit pas y avoir la mort, mais seulement l’autorévélation de Jakub à lui-même, pour que lui soit confisqué à jamais son orgueil inapproprié[49]
Mais Jakub ne fait rien. Il en vient à cette autre conclusion :
Jakub venait […] de comprendre qu’il lui était absolument égal que la créature aux cheveux jaunes survive, et que ce serait en fait de l’hypocrisie et une comédie indigne s’il tentait de la sauver. Qu’il ne ferait ainsi que tromper celui qui le mettait à l’épreuve. Car celui qui le mettait à l’épreuve (Dieu qui n’existe pas) voulait connaître Jakub tel qu’il était vraiment, et non tel qu’il feignait d’être. Et Jakub avait résolu d’être loyal envers lui ; d’être tel qu’il était vraiment[50].
Dans ces deux passages, c’est l’intervention directe du romancier, entre parenthèses, qui révèle l’identité du juge que refuse de reconnaître l’intellectuel athée. En évoquant ce « Dieu qui n’existe pas », le romancier pointe ironiquement l’inadéquation ou le dilemme entre, d’une part, la survivance d’une instance transcendantale dans l’esprit de Jakub et, d’autre part, le scepticisme qui a conduit le personnage à douter du genre humain. Sa volonté de déchiffrer les messages d’un Dieu inexistant, amplifiée par son geste mortifère, ne cessera de croître jusqu’au dénouement de la triste comédie.
Le lendemain de son acte, Jakub est pourtant soulagé : Ruzena est vivante. Il comprend que le poison n’était qu’un leurre de son ami Skreta. Ce qui « lui permettait de faire de sa vie un mythe grandiose[51] » n’était en fait qu’un placebo. L’intellectuel vient de jeter au sol le dernier de ses mythes : sa propre vie. Cette prise de conscience, fondée sur des prémisses qui s’avéreront fausses — car le comprimé est bel et bien mortel —, ne confirme pas la désillusion de Jakub à l’égard du genre humain. Au contraire, le personnage devient sensible à la découverte d’une autre réalité qui semble lui avoir échappé. Cette découverte prend la forme d’une révélation.
Jakub est d’abord frappé par la beauté de la femme de Klima, Kamila, venue rejoindre son mari dans la petite ville d’eaux. Cette rencontre a quelque chose de baudelairien : comme dans « À une passante », le personnage a l’impression cruelle que la Beauté — la majuscule s’impose — apparaît finalement devant lui, avant de s’éloigner à tout jamais. Les deux personnages s’avancent dans le décor :
Ils marchaient ensemble à travers le jardin public, le ciel était bleu, les buissons du parc étaient jaunes et rouges et Jakub se répéta que le feuillage était l’image du feu où brûlaient toutes les aventures, tous les souvenirs, toutes les occasions de son passé[52].
Le décor est à la fois apaisant et crépusculaire, mais ce ciel bleu, qui succède à la « lune ronde dans le ciel[53] », semble artificiel. Il n’amplifie pas moins la découverte de la beauté insoupçonnée. Jakub cherche un sens à l’image scintillante de la passante :
Jakub sentait qu’il était toujours plein de l’image de la belle femme. Le souvenir de cette beauté lui ramenait sans cesse à l’esprit une question : Et s’il avait vécu dans un monde entièrement différent de ce qu’il imaginait ? Et s’il voyait toute chose à l’envers ? Et si la beauté signifiait plus que la vérité, et si c’était vraiment un ange, l’autre jour, qui avait apporté à Bertlef le dahlia[54] ?
Privé de son dernier mythe — sa vie qui devait se conclure par une mort à la Sénèque —, Jakub en envisage un nouveau : le mythe d’un monde de beauté où les auréoles sont bel et bien bleues et où la petite fille est bel et bien un ange. À la chute de Jakub succède la prise de conscience que sa vie s’est déroulée au revers de la vraie vie. Le comprimé bleu pâle qu’il a déposé dans le tube de Ruzena l’a ramené du côté des persécuteurs. Il découvre que les combats politiques ne sont finalement que des miroirs aux alouettes ; la vraie vie se déroule beaucoup plus haut, à la hauteur du message d’amour de Bertlef :
[Jakub] songea encore que ce pour quoi il en voulait aux autres était quelque chose de donné, avec quoi ils venaient au monde et qu’ils portaient avec eux comme un lourd grillage. Et il songea qu’il n’avait lui-même aucun droit privilégié à la grandeur d’âme et que la suprême grandeur d’âme c’est d’aimer les hommes bien qu’ils soient des assassins[55].
Jakub quitte le pays avec le sentiment d’y avoir vécu en marge de la « réalité ». Sa voiture fonce vers la frontière. Il ne sait pas que Ruzena est déjà morte.
La rédemption finale de Jakub est-elle réelle ? Nous pourrions le croire : Jakub est tombé du socle de l’Histoire où il s’est longtemps maintenu comme un persécuté, pour découvrir la « vraie » réalité où les anges volent en emportant le saint libertin Bertlef. Pourtant, sous un ciel bleu en carton-pâte[56], cette rédemption pourrait être une astuce théâtrale, un trucage. Depuis la coulisse, un metteur en scène semble souffler les répliques finales d’une pièce déjà vue. La conclusion de Crime et châtiment revient à l’esprit du lecteur.
Dans La valse aux adieux, en effet, le romancier cite explicitement le roman de Dostoïevski. Au cours de ses réflexions, Jakub se rappelle le meurtre commis par Raskolnikov. Contrairement au personnage de Dostoïevski, il ne croit pas que les hommes soient des créatures divines[57] : son mépris du genre humain l’empêche de craindre la loi de Dieu — en qui il ne croit pas. On ne peut cependant manquer de relever la ressemblance entre sa prise de conscience finale et la rédemption du personnage de Crime et châtiment. Même si une certaine tristesse s’empare de Jakub, il peut désormais espérer, de l’autre côté de la frontière, « la lente rénovation d’un homme, […] sa régénération progressive, […] son passage graduel d’un monde à un autre, […] sa connaissance progressive d’une réalité totalement ignorée jusque-là[58] ». Cette réalité ignorée est celle où Bertlef a été emmené par un ange, comme le Lazare de la parabole. Pour Raskolnikov, cette réalité ignorée est la vie que révèle l’Évangile laissé par Sonia, qui lui avait déjà lu « la résurrection de Lazare[59] » de Béthanie. La symétrie est parfaite. Trop parfaite, sans doute, pour ne pas ébranler la crédulité du lecteur.
C’est sans compter la rapidité un peu douteuse de la conversion : du jour au lendemain, le sceptique a été foudroyé sur son cheval, sous un ciel bleu. Certes, on peut croire que le départ vers l’étranger a rendu Jakub sensible à la beauté et à la grandeur de son pays. Mais cela peut-il expliquer son revirement ? Il ne faudrait pas non plus oublier que la prise de conscience repose sur un imbroglio digne du plus vaudevillesque des vaudevilles. La rédemption finale de Jakub, sous un ciel bleu en carton-pâte, serait-elle ironique ?
Certes, d’un côté, il y a une rédemption qui sonne faux, qui incline à croire que l’élévation finit toujours par ramener au sol. Mais d’un autre côté, il y a Bertlef. Il n’est pas un saint qui représenterait la dimension sacrée inscrite en creux dans l’oeuvre de Kundera, pavant la voie à un réenchantement du monde. Saint et libertin, il est plutôt celui qui vient brouiller les pistes, qui vient « bloquer » le désenchantement complet que pourrait engendrer La valse aux adieux. Au milieu d’un décor en carton-pâte, dont l’aspect factice révèle la grande illusion d’un autre monde, un fil relie Bertlef à cet autre monde. On peut croire que cette présence ténue du sacré au milieu de la prose fonctionne un peu comme un cran d’arrêt. Le roman qui saperait tous les mythes, qui effacerait tous les repères, faisant du sol romanesque une plaine dévastée sans horizon, ne condamnerait-il pas ses personnages à errer, à ne pas savoir comment entamer leurs parcours ? Parce qu’il est par définition un monde « stable » qui confère un sens à chaque chose, le sacré, même s’il ne tient plus qu’à un fil, donne du relief à ce parcours, informe la prose romanesque, souvent instable et bornée par la brièveté de la vie humaine.
Parties annexes
Note biographique
Jonathan Livernois
Jonathan Livernois est étudiant de troisième cycle au département de langue et littérature françaises de l’Université McGill. Il a publié des textes dans plusieurs revues (Études françaises, L’Inconvénient, L’Atelier du roman, Contre-jour et MENS). Il a aussi fait paraître, en collaboration avec Yvan Lamonde, une sélection de textes de Pierre Vadeboncoeur : Une tradition d’emportement. Écrits (1945-1965) (Québec, Presses de l’Université Laval, 2007).
Notes
-
[1]
Cette étude a été réalisée dans le cadre du Groupe de travail sur les arts du roman (TSAR) de l’Université McGill, dirigé par Isabelle Daunais, qui bénéficie de l’aide financière du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
-
[2]
François Ricard, Le dernier après-midi d’Agnès, 2003, p. 30.
-
[3]
Éva Le Grand, Kundera ou la mémoire du désir, 1995, p. 42.
-
[4]
Milan Kundera, Le rideau, 2005, p. 21.
-
[5]
Milan Kundera, La valse aux adieux, 2003.
-
[6]
Ibid., p. 165.
-
[7]
Ibid., p. 328.
-
[8]
Voir Kvestolav Chvatik, Le monde romanesque de Milan Kundera, 1995, p. 120.
-
[9]
François Ricard, La littérature contre elle-même, 2002, p. 180.
-
[10]
Ibid., p. 181.
-
[11]
Milan Kundera, La valse aux adieux, op. cit. p. 151.
-
[12]
Ibid., p. 141.
-
[13]
Ibid., p. 123.
-
[14]
Ibid., p. 41.
-
[15]
Ibid., p. 99.
-
[16]
Ibid., p. 39.
-
[17]
Ibid., p. 154.
-
[18]
Ibid., p. 258.
-
[19]
Ibid., p. 141.
-
[20]
Ibid., p. 216.
-
[21]
Ibid., p. 141. Nous soulignons.
-
[22]
Ibid., p. 102.
-
[23]
Ibid., p. 88.
-
[24]
Ibid., p. 89.
-
[25]
Ibid., p. 88.
-
[26]
Ibid., p. 161.
-
[27]
Ibid., p. 43.
-
[28]
Lc, 16, 19-31.
-
[29]
Lc, 16, 23.
-
[30]
Lc, 16, 22.
-
[31]
Lc, 16, 26.
-
[32]
Lc, 16, 19.
-
[33]
Milan Kundera, La valse aux adieux, op. cit., p. 161-162.
-
[34]
Ibid., p. 163.
-
[35]
Id.
-
[36]
Ibid., p. 162.
-
[37]
François Ricard, « Comédie de la fin », dans Milan Kundera, La valse aux adieux, op. cit., p. 352.
-
[38]
Milan Kundera, La valse aux adieux, op. cit., p. 40.
-
[39]
Ibid., p. 211.
-
[40]
Ibid., p. 211-212.
-
[41]
Ibid., p. 212.
-
[42]
Ibid., p. 53.
-
[43]
Ibid., p. 222-223.
-
[44]
Ibid., p. 226.
-
[45]
Ibid., p. 239.
-
[46]
Ibid., p. 199.
-
[47]
Ibid., p. 136.
-
[48]
Ibid., p. 136-137.
-
[49]
Ibid., p. 234.
-
[50]
Ibid., p. 242.
-
[51]
Ibid., p. 268.
-
[52]
Ibid., p. 273.
-
[53]
Ibid., p. 169.
-
[54]
Ibid., p. 288.
-
[55]
Ibid., p. 321.
-
[56]
Voir François Ricard, La littérature contre elle-même, op. cit., p. 27.
-
[57]
Milan Kundera, La valse aux adieux, op. cit., p. 304.
-
[58]
Fédor Dostoïevski, Crime et châtiment. Journal de Raskolnikov. Les carnets de Crime et châtiment. Souvenirs de la maison des morts, 1950, p. 588.
-
[59]
Id.
Références
- Chvatik, Kvestolav, Le monde romanesque de Milan Kundera, Paris, Gallimard (Arcades), 1995 (trad. B. Lortholary).
- Dostoïevski, Fédor, Crime et châtiment. Journal de Raskolnikov. Les carnets de Crime et châtiment. Souvenirs de la maison des morts, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1950.
- Kundera, Milan, La valse aux adieux, Paris, Gallimard (Folio), 2003 [1976] (trad. F. Kérel).
- Kundera, Milan, Le rideau, Paris, Gallimard, 2005.
- Le Grand, Éva, Kundera ou la mémoire du désir, Montréal / Paris, XYZ éditeur / L’Harmattan, 1995.
- Ricard, François, La littérature contre elle-même, Montréal, Boréal (Compact), 2002 [1985].
- Ricard, François, Le dernier après-midi d’Agnès, Paris, Gallimard (Arcades) 2003.