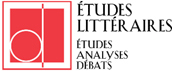Corps de l’article
6 juin 2008J’y arrive enfin, j’aborde les limites
fixées par d’autres que moi ;
une autre géographie s’offre,
plus personnelle et plus souple —
aux horizons plus ouverts —,
des territoires dans lesquels
j’imposerai mes frontières. Tout un été,
j’essaierai de reconstruire,
depuis le milieu, la maison
de mon âme : le lieu où le regard
est une fenêtre sur la liberté.
9 juin 2008Le matin est frais mais je m’installe
seul sur la galerie, parmi les arbres ;
je commence une lente méditation.
Les lilas ont fleuri ; les fleurs des cormiers
aussi colorent la cour, mais plus modestement.
Je m’attarde à ne pas m’empresser,
à ne pas chercher autre chose
que cette occasion toute simple
d’être là où je suis. J’étudie
comment découvrir le peu de mystère
que révèle ma présence en ce lieu.
10 juin 2008La lenteur se révèle un puits très profond
sur lequel je me penche : aucun reflet
ne me semble visible. Je me contente
de ce que j’observe : une corde à linge
sur laquelle sèchent les draps lavés ce matin.
Qu’attendre de plus significatif que cet indice
tout simple de l’été ? Je parcours enfin le vide,
je traverse l’espace sans me hâter, je trace
dans le ciel des sentiers où je m’éloigne
de tout pour m’approcher de moi.
12 juin 2008Au loin passe un train, qui laisse
un bruit de métal, un écho de roues
se frottant aux rails. Le vent frais
chante dans les branches ; attentif,
j’écoute pour recueillir un peu
de cette quiétude. Au-dessus de ma tête,
le bleu du ciel est sans tache ; à mes pieds,
je vois la bonne tête de la chienne
couchée paisiblement. Les claquements
d’une cloueuse m’indiquent qu’on s’affaire
à la besogne. Rien n’est gagné sur l’heure.
Dans une rue voisine roulent les voitures
comme s’il fallait encore se presser.
14 juin 2008Pas moins que les fleurs placées dans les pots
ou disposées dans les plates-bandes,
on compose un tableau auquel on participe.
Derrière la table sur le patio, avec son chapeau
et quelques livres, une tasse de café,
un ordinateur portable, on campe le rôle
du vacancier ou de l’écrivain de service,
pas plus important peut-être, en ce décor,
que la corde à linge mais aussi vivant
et effacé que les oiseaux et que la chienne
couchée en rond. Si l’on pouvait se retirer
en s’élevant au-dessus des choses, on signerait
d’un paraphe bien droit en coiffant l’ensemble
d’un titre clair, du genre « tableau d’été sur la terrasse »
ou « portrait d’un homme heureux sous les arbres ».
18 juin 2008Un matin de juin, je m’égare en ville
au milieu des conversations de personnes
retraitées : j’entends qu’on parle d’argent,
de richesse et de problèmes de prostate
ou de cancer ; je ne sais ce qui compte,
sinon le fait que tombe la pluie. Autour,
les gens échangent leurs cartes d’affaires
en discutant d’entreprises, de contrats,
d’ouvertures de marchés, et toujours d’argent,
encore d’argent. Je range le livre de poèmes
d’Ossip Mandelstam dans mon sac et retire
mes lunettes. Je pense au poète qui agonisait
dans les rues de Volojèje et je ne sais plus
très bien ce qu’est le véritable principe
d’humanité. Je regarde ma montre : je dois
payer mon déjeuner et déplacer ma voiture…
25 juin 2008Parmi les pierres dans le jardin, les fleurs
indiquent le mouvement des jours. Les heures
n’ont plus prise sur mon coeur ; bien retiré
derrière la maison, j’entends clairement
les mouvements de la ville. Je me lève
pour aller et venir autour de la maison,
sans chercher autre chose que ce qu’il y a
et que j’ignore. Je remarque des traces
du dernier hiver, comme de vieilles
blessures laissées par la neige sur les murs.
Même si je prends note de quelques
retouches qu’il faudra faire à la maison,
je m’inquiète peu de l’usure du monde.
27 juin 2008Je dispose l’espace à ma guise,
j’ouvre la fenêtre qui donne
sur la vieille étable ; j’écoute
la musique très douce
de François Couturier et j’entends,
au loin, le cri d’un geai bleu.
Seul au milieu de la pièce,
je cherche appui : en équilibre
sur la crête d’ombre de mon être,
j’apprivoise la beauté
comme elle se présente.
Un autre jour de ciel couvert,
il fait « lent » sur la ville
où je traîne mes pas.
1er juillet 2008Au-dessus des toits, je cherche un point de fuite,
une arête de lumière sur laquelle orienter
la pente descendante des jours. Ce que je fuis
ressemble à ce que j’emporte avec moi
au milieu du labyrinthe des âges. Je perçois
les battements d’un coeur sur une chaise vide ;
la beauté d’un visage éclaire ma solitude.
Je tente de sauver de l’abîme un peu d’ombre,
la jeunesse des bras qui m’enlacent
et la grâce qui émane des livres de poèmes.
3 juillet 2008J’ai tracé le cadastre du territoire
auquel j’appartiens. Je consens
rarement à quitter la page
sur laquelle je range les jours
en alignant mes pas. Si je vais
au hasard des rues, je m’égare aussitôt :
mais je recueille tout ce qui capte
mon attention : je vole des images,
je grave sur une pellicule d’ombre
de fines silhouettes, des poussières
qui rappellent les doigts que j’abandonne
sur la peau. Je reviens sur les bords
de la page, comme une vague qui vient
mourir sur le sable.
5 juillet 2008La ville où je demeure n’était autrefois
qu’un village autour duquel gravitaient
quelques fermes. Aujourd’hui, la banlieue
a transformé le paysage, tout en bouleversant
le rythme de la vie. Il arrive qu’on remarque
encore des gestes de villageois, des écarts
de conduite : ici, un homme s’affairant
à réparer la clôture d’un potager
sur un terrain où il n’y a pas encore
de piscine ; là, une femme qui se berce
sur une galerie de bois. Dans l’ensemble,
le portrait a bien changé : on voit partout
les piscines bien alignées au milieu
des terrains encadrés de haies ou de clôtures,
les entrées pavées où l’on stationne deux
ou trois voitures. Tout est bien conforme,
n’est-ce pas ? Comme on l’imagine, l’ennui
et l’ordre règnent sur la vie : chaque propriété
rappelle la photo d’une banlieue américaine.
à Stéphanie Lord
18 juillet 2008Tout à coup au bord d’une rivière,
j’ai éprouvé la lenteur du temps
dans les rebonds des cailloux sur l’eau ;
j’ai craint un moment de voir tomber
mon enfant qui s’amusait sur les pierres.
Au-dessus le ciel coulait bleu clair,
transparent dans la beauté des yeux :
nous tenions le vent entre nos doigts.
Sur les pierres, là où l’eau se casse
en cascades, le mouvement suspendu
m’est apparu encore plus beau
que le courant qui se jette dans les pierres.
31 juillet 2008Nous attendons toute une année
que se déploie le chemin, mais le moment
venu nous ne pouvons plus inscrire
nos traces sur le sol, et le chemin
disparaît sous les arbres. Que faut-il
pour être là où nous espérons
loger nos ombres ? Attendre encore,
sans doute… Un poème ne se fait pas
autrement : on scrute l’horizon
en tentant de saisir le vent qui passe,
la lumière quand elle semble naître
ou simplement se répandre et filer
entre les branches ; on ne prend rien,
on se glisse plutôt au milieu des choses,
on se laisse bercer par le mouvement
mélodieux de la vie. Avec un peu de chance,
on transcrit sur une feuille ou sur l’écran
la mesure intangible du silence.
Parties annexes
Note biographique
Claude Paradis
Poète né à Lauzon en 1960, Claude Paradis a publié six recueils de poésie depuis 1985. Un pont au-dessus du vide, son plus récent recueil, a paru en 2005 aux Éditions du Noroît. On trouve de ses poèmes dans diverses anthologies de poésie québécoise. Il enseigne la littérature au Cégep de Sainte-Foy depuis 1990 et a longtemps pratiqué la critique littéraire de poésie. En 1998, il a rédigé la préface explicative et le matériel pédagogique pour la réédition du recueil de poésie Mémoire de Jacques Brault aux Éditions C.E.C. (Anjoux). Membre fondateur du Centre d’études poétiques (C.E.P.) du Cégep de Sainte-Foy, il a collaboré à l’élaboration et à la composition d’un ouvrage consacré à l’oeuvre du poète Robert Melançon, paru à l’automne 2007 aux Éditions du Noroît sous le titre Le désaveuglé. Parcours de l’oeuvre de Robert Melançon.