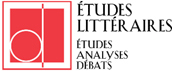Résumés
Résumé
Cet article vise à comprendre ce qu’entend Cioran lorsqu’il prétend avoir conçu « un genre nouveau : le pamphlet sans objet ». Dans cette perspective, l’analyse confronte les grandes caractéristiques esthétiques et rhétoriques des premières oeuvres françaises de l’essayiste – du Précis de décomposition (1949) à Histoire et utopie (1960), ouvrage dont est tiré l’extrait cité – aux typologies du genre polémique proposées par Marc Angenot, dans La parole pamphlétaire (1982). La finalité d’un tel exercice est de mieux comprendre certains paradoxes de la poétique cioranienne, fondée – en dépit de sa rare élégance – sur un usage singulier de la violence verbale.
Abstract
This article aims at understanding what Cioran means when he claims to have conceived “a new genre: the satirical tract without an object”. In this perspective, the analysis confronts the major aesthetical and rhetorical characteristics of the essayist’s first French works – from the Précis de décomposition (1949) to Histoire et utopie (1960), from which the aforementioned quote is taken – with the typologies of the polemical genre offered by Marc Angenot, in La parole pamphlétaire (1982). The finality of such an exercise is to better understand certain paradoxes of Cioran’s writing, founded – in spite of its rare elegance – on a singular usage of verbal violence.
Corps de l’article
Alors que l’invective et la violence langagière se comprennent généralement en fonction de leur cible, de la victime à laquelle de pareils écarts rhétoriques s’adressent, que penser d’un texte à visée polémique qui, paradoxalement, prétendrait se passer de référent ? C’est pourtant à une telle forme d’écriture que semble aspirer l’essayiste Emil Cioran, comme en témoigne une curieuse remarque formulée en introduction du recueil Histoire et utopie :
L’homme inoccupé qui aime la violence sauvegarde son savoir-vivre en se confinant dans un enfer abstrait. Délaissant l’individu, il s’affranchit des noms et des visages, s’en prend à l’imprécis, au général, et, orientant vers l’impalpable sa soif d’exterminations, conçoit un genre nouveau : le pamphlet sans objet[1].
Comment dès lors comprendre ce « genre » inédit ? De quelle manière peut-on prétendre exterminer « l’imprécis », le « général » ? Et, enfin, est-il seulement possible de concilier violence et « savoir-vivre » ? C’est à de telles questions que tentera de répondre cet article, en prenant appui sur des éléments tirés des premiers livres français de l’écrivain, soit Précis de décomposition (1949), Syllogismes de l’amertume (1952), La tentation d’exister (1956), Essai sur la pensée réactionnaire (1957) et Histoire et utopie (1960), ouvrage dont est tiré l’extrait cité.
Lorsque la critique aborde la question de la dimension pamphlétaire de l’oeuvre de Cioran, c’est généralement en fonction du passé publiciste de l’auteur, lequel a — comme on le sait depuis les années 1990[2] — commis, dans sa Roumanie natale, au cours des années 1930, quelques articles et un livre faisant l’éloge de l’extrême droite. Émergent ainsi deux thèses contradictoires. La première, étayée par Patrice Bollon dans son ouvrage Cioran l’hérétique, défend le point de vue comme quoi, pour le jeune écrivain transylvain, émigré à Paris à compter des années 1940, le passage aux rigueurs de l’écriture en français aurait contribué à atténuer la fureur et l’extrémisme d’antan, à asseoir le scepticisme intransigeant pour lequel ses livres se voient désormais reconnus :
Non seulement, en effet, son oeuvre française n’est que la réécriture inlassable, le réajustement du point de vue de cet écart, de son oeuvre roumaine ; mais elle n’apparaît, de plus, d’un certain regard, que comme la tentative raisonnée de ne jamais retomber dans un quelconque aveuglement, né d’une croyance en une religion ou une idéologie. L’intérêt philosophique et politique de son oeuvre tient même entièrement dans ce travail de désaveu souterrain de son passé[3].
La seconde, soutenue avec éclat par Alexandra Laignel-Lavastine dans le livre Cioran, Éliade, Ionesco. L’oubli du fascisme, avance au contraire que les idées de l’essayiste seraient demeurées les mêmes, au fil des années, et que l’entièreté de son oeuvre française ne constituerait qu’une réécriture hypocrite, car masquée, de ses postulats d’antan :
La cohérence de son univers politique comme de ses thèmes n’en demeure pas moins frappante […]. Au point qu’on peut légitimement se demander dans quelle mesure l’opération majeure, celle qui marque de son sceau le passage entre les deux époques, ne réside surtout pas dans la retraduction, dans une langue acceptable, de motifs et d’attitudes idéologiquement disqualifiés à l’Ouest[4].
Bref, comme on peut le constater, le débat demeure centré autour de l’opposition entre un Cioran publiciste repenti ou pamphlétaire sournois.
Sans jamais perdre de vue les enjeux de cette discussion biographique ou intentionnaliste, la présente réflexion tentera plutôt de voir comment la référence au pamphlet, faite par l’auteur lui-même, permet de mieux comprendre son oeuvre du point de vue de la poétique, de la dynamique même de l’écriture. Pour ce faire, les grandes orientations rhétoriques et esthétiques de la prose cioranienne seront confrontées à l’une des analyses canoniques de ce genre littéraire, soit celle proposée par Marc Angenot dans La parole pamphlétaire. Il importe toutefois de préciser dès l’abord qu’Angenot distingue nettement entre pamphlet et essai littéraire (ou « essai-méditation[5] »), catégorie pour laquelle il cite en exemple quelques lignes de… Cioran[6] ! Du point de vue de l’analyste du discours, donc, la question de la qualité pamphlétaire de la prose cioranienne ne se pose même pas. On abordera néanmoins celle-ci, comme prétexte à un regard autre sur l’oeuvre de l’essayiste, dans la visée de mieux comprendre la fascination pour la violence verbale qui y demeure, malgré tout, une constante.
Une absence de visées ?
La qualité fondamentale d’un pamphlet, selon Angenot, est de « s’articule[r] sur la dichotomie vérité/imposture[7] ». En d’autres mots : « Le pamphlétaire prétend affronter l’imposture, c’est-à-dire le faux qui a pris la place du vrai, en l’excluant, lui et sa vérité, du monde empirique[8]. » Or, force est de constater qu’un écrivain comme Cioran ne manifeste pas la moindre prétention à lutter pour la vérité. Au contraire, dès l’ouverture du Précis — en réaction évidente, pour qui sait lire entre les lignes, à son propre passé —, il dénonce les ravages causés par les idées fixes (et donc par ceux qui estiment avoir raison) pour valoriser, à l’inverse, des attitudes « négatives » comme le scepticisme, l’inaction ou le désistement :
En elle-même toute idée est neutre, ou devrait l’être ; mais l’homme l’anime, y projette ses flammes et ses démences ; impure, transformée en croyance, elle s’insère dans le temps, prend figure d’événement : le passage de la logique à l’épilepsie est consommé… Ainsi naissent les idéologies, les doctrines et les farces sanglantes[9].
Angenot cite d’ailleurs ce texte en conclusion de son propre ouvrage pour distinguer nettement entre raisonnement posé et parole pamphlétaire : « Pour paraphraser Cioran, nous dirions que le pamphlet s’instaure lorsque se consomme “le passage de la logique à l’épilepsie”, dans la volonté de puissance, le manichéisme, et le besoin aliéné de légitimité[10]. » On serait donc tenté de conclure que le Cioran français n’a plus rien du publiciste d’antan : son oeuvre serait désormais « sans objet » dans la mesure où, prenant pour modèle les sceptiques qui « ne proposent rien[11] », elle se donne d’emblée comme étant dépourvue de finalité.
Mais, en dépit de ses aspirations au détachement, Cioran n’emploie pas moins le terme chargé de « pamphlet ». De fait, son écriture conserve une charge corrosive, une capacité à saper le moindre sujet traité. La nécessaire « défascination » vers laquelle tend l’oeuvre cioranienne passe ainsi moins par la plénitude intérieure — visée traditionnelle de la sagesse — que par un besoin de discréditer systématiquement toute croyance existante. L’essayiste conserve dès lors des réflexes de pamphlétaire, dans la mesure où le moindre de ses propos repose sur un usage contrôlé de la violence verbale :
Cioran a érigé le mécanisme de dévalorisation en méthode de philosophie de la culture. La méthode inventée par Cioran est la diatribe objective, c’est-à-dire celle qui est dirigée tour à tour, avec les arguments de tous, contre n’importe qui. […] Aussi longtemps qu’il existe des modes, des arguments, des styles et des modèles culturels à relief accentué, le carrousel peut continuer indéfiniment[12].
En se posant ainsi comme « partisan du Vague[13] » — car, pour reprendre les catégories d’Angenot, il milite non pas pour le vrai mais pour le rien —, Cioran fait dès lors effectivement figure de pamphlétaire paradoxal, en ce que, de son point de vue, la (ou plutôt les) vérité(s) s’apparente(nt) à une imposture, et que c’est justement un tel amalgame qu’il s’agit de dénoncer.
Pareille mise à plat de la démarche de l’auteur tend dès lors à accréditer la thèse de Patrice Bollon : le Cioran français chercherait, par tous les moyens qui s’offrent à lui, à se prémunir de toute croyance, à se maintenir perpétuellement en position d’extériorité par rapport à son objet, quel qu’il soit. Or, la virulence même de cet exercice de « penser contre soi[14] » — s’il se voit évidemment motivé par des raisons d’ordre biographique — n’en laisse pas moins transparaître ce que Michel Jarrety a pu nommer une « essentielle autodétestation[15] ». Or, si un tel dégoût de sa propre personne peut éventuellement se rapporter à une conscience aiguë de la faute — Cioran avoue d’ailleurs avoir « tourn[é] sa dernière haine contre soi[16] » —, il n’en mène pas moins, toujours selon Jarrety, à une détestation d’autrui : « tout se passe, dans les Oeuvres, comme si Cioran avait voulu projeter, de lui-même sur l’homme, cette détestation qui fait de l’un et l’autre avant tout des vaincus[17]. » Pareil lien entre autoflagellation et misanthropie paraît d’autant plus justifié qu’Angenot le pose également dans le contexte plus général des éventuels dérapages de l’essai littéraire : « penser contre soi-même c’est penser contre les autres[18] ». Il importe donc de reprendre la réflexion sur le « pamphlet sans objet », cette fois non plus au sujet de sa prétendue absence de finalité, mais, à l’inverse, des cibles qu’il pourrait éventuellement viser.
Une absence de cible ?
La « forme primitive et minimale du pamphlet », une fois de plus selon Angenot, « c’est l’invective[19] ». Or, celle-ci consiste essentiellement en une tentative d’oblitération de l’interlocuteur :
Réaction primaire, viscérale, ou se présentant en tout cas comme telle, l’invective a pour règle de fuir tout scrupule et toute modération, de subordonner tout au but unique qui est de détruire symboliquement l’adversaire, de le tuer avec des mots[20].
De fait, si l’essayiste s’acharne, de son propre aveu, sur les idées, qu’en est-il de ceux qui les profèrent ? Une telle interrogation est particulièrement pertinente, dans le cas de l’oeuvre cioranienne, si l’on tient compte de certaines remarques (à mots couverts) de l’auteur au sujet de son passé publiciste. En effet, celui-ci affirme, d’une part, avoir été « fanatique […] jusqu’au ridicule[21] », allant jusqu’à faire de sa propension à l’extrémisme le soubassement d’un programme esthétique :
Ne pouvant me rendre digne d’eux [les « Tyrans »] par le geste, j’espérais y arriver par le mot, par la pratique du sophisme et de l’énormité : être aussi odieux avec les moyens de l’esprit qu’ils étaient, eux, avec ceux du pouvoir, dévaster par la parole, faire sauter le verbe et le monde avec lui, éclater l’un et l’autre, et m’effondrer enfin sous leurs débris[22]!
Si de tels propos peuvent paraître une tentative de se dédouaner à peu de frais de ses écrits passés, l’auteur n’en ajoute pas moins, d’autre part, parlant cette fois de lui-même au présent, que
[l]a stérilité guette ceux-là seuls qui ne daignent entretenir ni divulguer leurs tares. Quel que soit le secteur qui nous requiert, pour y exceller il nous appartient de cultiver le côté insatiable de notre caractère, de choyer nos inclinations au fanatisme, à l’intolérance et à la vindicte[23].
La question se pose donc : la prose cioranienne nécessite-t-elle, pour s’élaborer, la présence d’un adversaire, d’« ennemis réels ou imaginaires[24] » ?
À la lumière de ces dernières remarques — qui, à l’aspiration au détachement, opposent une propension à la violence verbale, voire au doute du penseur, confrontent la virulence de l’écrivain —, un passage en apparence anodin du Précis prend soudain une tout autre signification :
Si vous ne décriez ni un homme ni une institution, vous n’encourrez aucun risque ; aucune loi ne défend le Réel, mais toutes vous punissent du moindre préjudice porté à ses apparences. Vous avez droit de saper l’être même, mais aucun être ; vous pouvez licitement démolir les bases de tout ce qui est, mais la prison ou la mort vous attend au moindre attentat aux forces individuelles[25].
À l’instar de ce que Jean-Paul Sartre nomme la « mauvaise foi[26] », l’essayiste serait-il ici en train de confondre — en toute connaissance de cause — les dimensions essentielle et existentielle ? La distance marquée par la réflexion face aux « noms » et aux « visages » laisse-t-elle à l’écriture la licence de vitupérer en toute impunité ? Car force est de constater que l’oeuvre cioranienne abonde d’attaques contre des concepts idéal-typiques derrière lesquels peuvent pourtant se cacher des individus bien réels : le « civilisé », le « barbare », le « peuple », « l’intellectuel fatigué », etc. L’interrogation est d’autant plus valable que l’Occident — notion à laquelle l’écrivain a consacré nombre de pages — peut, de son propre aveu, se voir compris parmi ces cibles suffisamment désincarnées pour éviter toute conséquence néfaste à l’épanchement de sa rancoeur : « Ombres aussi ces nations dont le sort m’intrigue, moins pour elles-mêmes que pour le prétexte qu’elles m’offrent de me venger sur ce qui n’a ni contour ni forme, sur des entités et des symboles[27]. » Une telle perspective permet ainsi une deuxième compréhension de l’idée de « pamphlet sans objet » : celui-ci ne serait pas tant dépourvu de cible en soi, qu’une polémique d’ordre métaphysique, une charge contre l’existence en général.
Cette tendance, dont fait preuve Cioran, à s’en prendre à des ennemis abstraits ou composites rejoint toutefois — par la bande, il faut l’avouer — une autre qualité du genre pamphlétaire : celle de procéder par généralisations.
Le propre du pamphlet est de se refuser à la nuance : le groupe adverse est maximalisé. On n’affronte pas une poignée d’imposteurs, mais une vaste conspiration, une cabale aux limites floues qui s’appuie sur la lâcheté et la duperie générales. Le pamphlétaire, solitaire, affronte une hydre, un monstre protéiforme ; son refus devient englobant, sa malédiction entraîne la société entière dans le déluge[28].
Il est vrai que la pensée politique de l’auteur, qui se détourne de toute référence trop précise, évoque par moments l’idée d’un vaste complot des éléments, d’un mécanisme aussi immuable qu’inévitable auquel se verrait astreint tout individu. On comprend dès lors que les détracteurs de Cioran — Alexandra Laignel-Lavastine, notamment — puissent accuser ce dernier de dissimuler, sous d’élégantes généralités, ses obsessions d’antan : l’ennemi désigné, déclaré, se muerait insidieusement en malédiction, en fatalité. Mais, le plus intéressant dans de telles imputations n’est pas tant cette idée d’une obstinée continuité de la pensée cioranienne — laquelle, quoi qu’on en dise, prend la peine de dénoncer ce qu’elle a pu être — que celle comme quoi l’auteur masquerait le fond de sa pensée par le raffinement de l’écriture, de manière à ce que « les faits y soient exclusivement évoqués sur un mode allusif et très esthétisé[29]. » En effet, force est de constater que les textes de Cioran se distinguent, malgré leur virulence et leur exaltation de la « démence verbale[30] », par un style d’une rare élégance. Or, en quoi cette revendication d’une parfaite maîtrise de ses moyens — qui sous-entend une recherche constante du mot juste — coïncide-t-elle avec la production d’un pamphlet sans objet, genre volontairement flou ? C’est sur un tel paradoxe qu’il convient maintenant de se pencher.
Une finalité en soi ?
Évoquant la question de la vision du monde (Weltanschauung) du pamphlétaire, Marc Angenot relève, comme fondement du genre, l’omniprésence d’une pensée de la décadence : « Le noyau invariant de toute parole pamphlétaire est la nostalgie d’un Âge d’Or et le sentiment d’une dégradation irréversible des valeurs culturelles ou sociales, dégradation dont on ne peut voir encore que les signes avant-coureurs.[31] » Une telle observation ne va pas sans rappeler l’oeuvre cioranienne — rapprochant de fait celle-ci davantage du genre pamphlétaire — dans la mesure où l’impression de flou dégagée par l’emploi de notions généralisantes (« une civilisation essoufflée[32] ») s’articule autour d’une conception non moins abstraite de la « chute » ou du déclin. Mais le plus révélateur — dans le cadre de la présente réflexion — à émerger des remarques d’Angenot, est la présence, dans le pamphlet, d’une concomitante obsession pour la dégradation du Verbe :
C’est un des paradoxes du discours pamphlétaire que d’exprimer une double attitude face au langage : par une opposition très romantique, la dégradation de celui-ci est dénoncée avec horreur, mais ses pouvoirs de révélation sont au contraire majorés et exaltés[33].
Dès lors, si le pamphlétaire combat par les mots, il doit également lutter pour ceux-ci dans l’espoir de pouvoir, de par sa démarche, redonner au langage sa pleine charge sémantique.
Là encore, la démarche cioranienne rejoint pleinement une telle dynamique. Si, comme le rappelle Patrice Bollon, le changement de langue de l’écrivain correspond à une évolution de sa pensée, nombre de critiques ont par ailleurs souligné le fait que l’essayiste se forge tout de même un idiome bien à lui, « une langue d’apatride plutôt qu’une langue d’adoption[34] ». De fait, tout au long de sa carrière française, Cioran entretient une curieuse relation face au Verbe. Après avoir, par la rhétorique, discrédité la moindre « idée » pouvant entretenir une quelconque prétention à la vérité — et, par un choix lexical volontairement imprécis, contribué à susciter un flou sur le référent évoqué —, l’essayiste se voit confronté à un vide qu’il aura pourtant savamment créé. Paradoxalement, la seule issue qu’il conçoit à une telle impasse réside en une radicalisation du problème :
Puisque le poète est un monstre qui tente son salut par le mot, et qu’il supplée au vide de l’univers par le symbole même du vide (car le mot est-il autre chose ?), pourquoi ne le suivrions-nous pas dans son exceptionnelle illusion ? Il devient notre recours toutes les fois que nous désertons les fictions du langage courant pour nous en chercher d’autres, insolites, sinon rigoureuses[35].
Après avoir systématiquement réfuté tant le monde extérieur que le langage qui sert à l’exprimer, l’écrivain doit désormais verser dans la « démiurgie verbale[36] » — fût-elle négative — sous peine de sombrer à son tour. Se dégage ainsi une troisième — et dernière — définition du « pamphlet » cioranien : celui-ci serait « sans objet » dans la mesure où sa charge corrosive, vouée, à l’instar du poème, à supplanter le vide ambiant, devient une fin en soi.
Une telle perspective permet de mieux comprendre l’étrange cohabitation entre « décomposition » et élégance à l’oeuvre dans l’écriture cioranienne. À l’occasion d’une étude consacrée au penseur réactionnaire Joseph de Maistre, l’un de ses objets de fascination littéraire, l’essayiste associe d’ailleurs lui-même « passion du tour correct[37] » et « vision crépusculaire du monde[38] » :
Pourquoi les conservateurs manient-ils si bien l’invective, et écrivent-ils en général plus soigneusement que les fervents de l’avenir ? C’est que, furieux d’être contredits par les événements, ils se précipitent, dans leur désarroi, sur le verbe dont, à défaut d’une plus substantielle ressource, ils tirent vengeance et consolation. Les autres y recourent avec insouciance et même avec mépris : complices du futur, assurés du côté de « l’histoire », ils écrivent sans art, voire sans passion, conscients qu’ils sont que le style est la prérogative et comme le luxe de l’échec[39].
De telles remarques constituent un double aveu d’impuissance — et fondent d’autant plus la prose cioranienne comme étant « sans objet » — dans la mesure où tant le monde que les discours qui peuvent être tenus sur celui-ci semblent échapper à l’emprise du locuteur. L’essayiste ajoute d’ailleurs, au sujet de l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg : « Transes et boutades, convulsions et vétilles, bave et grâce, tout se mêlait chez lui pour composer cet univers du pamphlet du sein duquel il pourchassait “l’erreur” à coups d’invectives, ces ultimatums de l’impuissance.[40] » Mais, si Cioran paraît conséquent à l’intérieur de son propre système de pensée, qu’en est-il au regard d’autres pratiquants du pamphlet ? Et, surtout, sa démarche se voit-elle modifiée en présence d’une (rare) cible avouée ?
Un contre-exemple : L.-F. Céline
Évoquer ainsi la dimension pamphlétaire de l’oeuvre de Cioran fait immédiatement penser aux écrits de l’un de ses contemporains : Louis-Ferdinand Céline. Dans l’un comme dans l’autre cas, on est en présence d’auteurs reconnus dont les opinions politiques posent problème à la critique littéraire, mais aussi de stylistes d’envergure accusés de masquer le fond de leur pensée par la virtuosité de leur écriture. Patrice Bollon aura d’ailleurs, alors qu’il cherche à faire entrer Cioran dans des catégories existantes, cet aveu révélateur : « Faudrait-il se résigner alors à en faire ce qu’on appelle, faute de mieux, un “anarchiste de droite” et l’agréger à cette cohorte d’inclassables qui sentent le soufre, à la Céline, Hamsun ou Blondin […][41]? » Dans cette optique, il paraît intéressant de comparer, à la lumière de ce qui a été dit précédemment au sujet de la parole pamphlétaire, la prose des auteurs de Voyage au bout de la nuit et des Syllogismes de l’amertume dans l’idée d’en dégager certaines constantes et oppositions. Afin d’éviter toute polémique et de demeurer dans le sujet d’une poétique de la violence verbale, auquel est consacrée la présente réflexion, on évitera le thème chargé de l’antisémitisme pour se consacrer à une autre cible commune à ces deux polémistes : le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre.
Selon les caractéristiques mises de l’avant par Marc Angenot, le court texte À l’agité du bocal, de Céline, a tout du véritable pamphlet. Le romancier, pris à partie par Sartre dans Réflexions sur la question juive, lutte pour rétablir ce qu’il estime être la vérité, moins en argumentant sur les faits qu’en cherchant à discréditer son adversaire à tout prix. Dès lors, fidèle en cela au genre pamphlétaire, non seulement le texte « confond-il persuasion et violence[42] », mais encore se présente-t-il comme un torrent d’injures :
Satanée petite saloperie gavée de merde, tu me sors de l’entre-fesses pour me salir au-dehors ! Anus Caïn pfoui. Que cherches-tu ? Qu’on m’assassine ! C’est l’évidence ! Ici ! Que je t’écrabouille ! Oui !… Je le vois en photo… ces gros yeux… ce crochet… cette ventouse baveuse… c’est un cestode ! Que n’inventerait-il, le monstre, pour qu’on m’assassine ! À peine sorti de mon cacao, le voici qui me dénonce[43] !
Le court essai « Sur un entrepreneur d’idées » de Cioran, publié à la même époque, procède quant à lui d’une tout autre manière. Évoquant également la figure de Sartre, le texte se construit par affirmations indirectes :
Ses constructions sont magnifiques, mais sans sel : des catégories y resserrent des expériences intimes, rangées comme dans un fichier de désastres ou un catalogue d’inquiétudes. Y sont classées les tribulations de l’homme, de même que la poésie de sa déchirure. L’Irrémédiable est passé en système, voire en revue, étalé comme un article de circulation courante, vraie manufacture d’angoisses. Le public s’en réclame ; le nihilisme de boulevard et l’amertume des badauds s’en repaissent[44].
Comme on peut le constater, à l’inverse de Céline qui prend un malin plaisir à qualifier Jean-Paul de « Jean-Baptiste[45] », Sartre ne se voit jamais nommé. Ceci s’explique probablement par le fait que, contrairement à Céline, l’auteur du Précis ne connaissait pas personnellement le philosophe — ou, du moins, n’était pas connu de lui — et ne cherche dès lors pas à régler des comptes : s’il s’en prend au « Penseur sans destin[46] », c’est essentiellement au nom d’une certaine conception de l’écriture et de la pensée. Évitant toute pointe par trop directe contre l’homme, c’est avant tout le symbole — le « Fils d’une époque[47] » — qu’il vise.
Par delà ces différences d’approche, toutefois, Céline et Cioran se rejoignent dans le fond de leur propos : l’un comme l’autre accuse Sartre d’inauthenticité.
Toujours au lycée, ce J.-B. S. ! toujours aux pastiches, aux « Lamanièredeux »… […] Regardez Shakespeare, lycéen ! 3/4 de flûte, 1/4 de sang… 1/4 suffit, je vous l’assure… mais du vôtre d’abord[48] !
C’est un conquérant qui n’a qu’un secret : son manque d’émotion ; rien ne lui coûte d’affronter quoi que ce soit, puisqu’il n’y met aucun accent. […] Son adresse à prendre de front les grands problèmes déroute : tout y est remarquable sauf l’authenticité. Foncièrement a-poète, s’il parle du néant, il n’en a pas le frisson ; ses dégoûts sont réfléchis ; ses exaspérations, dominées et comme inventées après-coup[49].
S’il s’agit là de la pire insulte à adresser au théoricien de la mauvaise foi, de telles paroles sont surtout révélatrices de la posture littéraire de ceux qui les formulent : l’auteur du Voyage comme celui du Précis se reconnaissent, malgré tout, dans une esthétique du pamphlet dans la mesure où, de leur point de vue, l’authenticité (littéraire ?) équivaut à une forme de démesure. À leurs yeux, le seul critère de vérité demeure l’excès.
Conclusion
Une telle lecture de la prose cioranienne à la lumière des avancées proposées par Marc Angenot dans La parole pamphlétaire permet de mieux saisir les remarques paradoxales qui ont servi de point de départ à la présente réflexion. Ainsi, « [l]’homme inoccupé qui aime la violence » serait le Cioran français, qui regrette son extrémisme politique d’antan et se consacre désormais à un scepticisme exacerbé, tout en conservant une ambiguë nostalgie de la vitalité langagière qui découlait de ses excès passés. De même, « l’enfer abstrait » représenterait l’univers littéraire dans lequel il choisit désormais d’évoluer, espace volontairement détaché de tout référent par trop précis de manière à lui permettre de déverser néanmoins son fiel en toute impunité. Enfin, ce « savoir-vivre » — curieusement associé à une « soif d’exterminations » — constituerait un aveu d’impuissance de l’écrivain, tant par rapport au monde extérieur qu’au langage employé pour le signifier, mais aussi, pourquoi pas, un clin d’oeil ironique de celui qui, désormais, n’en est pas moins conscient du fait qu’« [a]ller trop loin, c’est donner infailliblement une preuve de mauvais goût[50]. » Mais, si l’on comprend ainsi l’essayiste par rapport à son propre système de valeurs, la question se pose néanmoins : le « pamphlet sans objet » est-il véritablement un pamphlet ?
En fait, force est de constater que, même si, d’une part, comme le suggère le qualificatif « sans objet », la prose cioranienne se veut dépourvue à la fois de cible et de visée — et, d’autre part, comme l’a montré la comparaison avec Céline, le ton de l’essayiste demeure nettement plus posé que celui d’un « véritable » pamphlétaire —, la démarche de l’auteur du Précis n’est pas pour autant dépourvue de ce que Marc Angenot nomme une « roublardise rhétorique[51] ». En effet, la dynamique même du genre fait en sorte que « le pamphlétaire tend à fréquemment devenir un imprécateur démagogique, pour qui tous les coups sont bons — la noblesse de la cause étant caution suffisante[52] ». Or, Cioran n’hésite pas — comme l’a souligné H. R. Patapievici — à sauter d’une position à l’autre, dans le but d’avoir toujours raison, fût-ce de lui-même. Ce qui importe, chez lui, est moins l’originalité des arguments évoqués — qu’il emprunte au fil de l’histoire de la littérature et des idées — que l’ardeur mise à triompher de tout obstacle. Une telle instabilité de la position de l’essayiste peut d’ailleurs contribuer à expliquer pourquoi des critiques comme Bollon ou Lavastine peuvent respectivement louer sa sincérité ou dénoncer son hypocrisie, sans jamais pouvoir réellement clore le débat. Ainsi, c’est dans le renversement de paradoxes — forme rhétorique dans laquelle il excelle — que Cioran se rapproche le plus du pamphlétaire, puisque, de son point de vue, tous les arguments sont valables pour triompher de la conception (de l’« idée ») à laquelle il s’oppose.
Sous cette « roublardise » d’écrivain se dissimule toutefois une ultime caractéristique du pamphlet : ce dernier ne repose pas tant sur une construction logique, des arguments raisonnés, que sur une expérience vécue (généralement négative), sur le « moi » du locuteur. Ainsi, « le pamphlétaire ne cherche pas à présenter un ensemble de thèses et de jugements distanciés ; il devra dire comment dans son vécu, ces thèses et ces opinions ont surgi, dire où il a lui-même rencontré son chemin de Damas[53] ». De fait, si un écrivain comme Cioran présente cette ambiguïté d’écrire des anti-pamphlets, de polémiquer en quelque sorte contre le dogmatisme (propre au genre pamphlétaire), pareille attitude s’explique avant tout en fonction d’une expérience vécue, d’une faute personnelle dont il cherche à s’émanciper. Et c’est cette dernière caractéristique — la capacité du moi à évoluer, à se défaire de ses obsessions profondes — qui, malgré les similitudes relevées jusqu’à présent, distingue l’auteur de La tentation d’exister du genre du pamphlet pour le camper pleinement dans celui de l’essai littéraire. En effet, comme le rappelle Marc Angenot,
[le] discours aporétique [de l’ « essai-méditation »] où l’appareil de démonstration est « chargé d’un puissant potentiel affectif » se rapproche par ces traits du pamphlet comme nous l’avons défini. Toutefois — outre son caractère polémique —, le pamphlet ne présente pas une pensée en devenir : les certitudes lui sont acquises, c’est le rapport de la vérité subjective au cours du monde qui crée le problème. Le discours est dès lors assertif et les principes qui l’appuient sont stables. Le pamphlétaire ne fait pas retour sur lui-même, il ne se livre pas au travail de Pénélope de l’essai-méditatif. Son discours est essentiellement tendu vers un but extérieur[54].
Ainsi, paradoxalement, alors que l’invective et la violence verbale ont généralement un but strictement négatif, chez Cioran, à l’inverse, un tel nihilisme langagier se fait constructif dans la mesure où le fait de saper continuellement ses propres positions pousse l’essayiste à aller de l’avant, à renaître incessamment de ses cendres.
Parties annexes
Note biographique
Sylvain David
Sylvain David est professeur adjoint au Département d’études françaises de l’Université Concordia. Spécialiste de la littérature française du xxe siècle, ses travaux de recherche portent notamment sur la fiction romanesque contemporaine et sur l’articulation entre pessimisme et représentation de soi dans l’écriture du fragment. Il a récemment publié Cioran. Un héroïsme à rebours aux Presses de l’Université de Montréal.
Notes
-
[1]
Émil Michel Cioran, Histoire et utopie, dans Oeuvres, 1995, p. 991.
-
[2]
Voir à ce sujet Pierre-Yves Boisseau, « La transfiguration du passé », Le monde, 28 juillet 1995.
-
[3]
Patrice Bollon, Cioran l’hérétique, Paris, Gallimard, 1997, p. 28.
-
[4]
Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme, 2002, p. 461.
-
[5]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, 1982, p. 56.
-
[6]
Ibid., p. 58.
-
[7]
Ibid., p. 85.
-
[8]
Ibid., p. 38.
-
[9]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, dans Oeuvres, op. cit., p. 581.
-
[10]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, op. cit., p. 353.
-
[11]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, op. cit., p. 582.
-
[12]
H. R. Patapievici, « E. M. Cioran : entre le “démon fanfaron” et le “barbare sous cloche” », dans Lectures de Cioran, 1997, p. 64.
-
[13]
Émil Michel Cioran, Syllogismes de l’amertume, dans Oeuvres, op. cit., p. 778.
-
[14]
Émil Michel Cioran, La tentation d’exister, dans Oeuvres, op. cit., p. 821.
-
[15]
Michel Jarrety, La morale dans l’écriture. Camus, Char, Cioran, 1999, p. 115.
-
[16]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, op. cit., p. 636.
-
[17]
Michel Jarrety, La morale dans l’écriture, op. cit., p. 119.
-
[18]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 58.
-
[19]
Ibid., p. 249.
-
[20]
Ibid., p. 61.
-
[21]
Émil Michel Cioran, Histoire et utopie, op. cit., p. 981.
-
[22]
Ibid., p. 1014.
-
[23]
Ibid., p. 1023.
-
[24]
Émil Michel Cioran, La tentation d’exister, op. cit., p. 919.
-
[25]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, op. cit., p. 631.
-
[26]
Voir à ce sujet Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, 1943, p. 91.
-
[27]
Émil Michel Cioran, Histoire et utopie, dans Oeuvres, op. cit., p. 991.
-
[28]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 92.
-
[29]
Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco, op. cit., p. 21.
-
[30]
Émil Michel Cioran, Histoire et utopie, op. cit., p. 981.
-
[31]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 94.
-
[32]
Émil Michel Cioran, La tentation d’exister, op. cit., p. 832.
-
[33]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 94.
-
[34]
Michel Jarrety, La morale dans l’écriture, op. cit., p. 156.
-
[35]
Émil Michel Cioran, La tentation d’exister, op. cit., p. 944.
-
[36]
Id.
-
[37]
Émil Michel Cioran, Essai sur la pensée réactionnaire, dans Oeuvres, op. cit., p. 1553.
-
[38]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 99.
-
[39]
Émil Michel Cioran, Essai sur la pensée réactionnaire, op. cit., p. 1557.
-
[40]
Ibid., p. 1553.
-
[41]
Patrice Bollon, Cioran l’hérétique, op. cit., p. 173.
-
[42]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 341.
-
[43]
Louis-Ferdinand Céline, À l’agité du bocal et autres textes, 1995, p. 10.
-
[44]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, op. cit., p. 731.
-
[45]
Louis-Ferdinand Céline, À l’agité du bocal, op. cit., p. 8.
-
[46]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, op. cit., p. 731.
-
[47]
Ibid., p. 732.
-
[48]
Louis-Ferdinand Céline, À l’agité du bocal, op. cit., p. 8 et 14.
-
[49]
Émil Michel Cioran, Précis de décomposition, op. cit., p. 731.
-
[50]
Ibid., p. 662.
-
[51]
Marc Angenot, La parole pamphlétaire, op. cit., p. 249.
-
[52]
Id.
-
[53]
Ibid., p. 296.
-
[54]
Ibid., p. 58.
Références
- Angenot, Marc, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Paris, Payot (Langages et sociétés), 1982.
- Boisseau, Pierre-Yves, « La transfiguration du passé », Le monde, 28 juillet 1995, p. 12.
- Bollon, Patrice, Cioran l’hérétique, Paris, Gallimard, 1997.
- Céline, Louis-Ferdinand, À l’agité du bocal et autres textes, Paris, L’Herne, 1995.
- Cioran, Emil Michel, Essai sur la pensée réactionnaire, 1957, dans Oeuvres, Paris, Gallimard (Quarto), 1995.
- — — —, Histoire et utopie, 1960, dans Oeuvres.
- — — —, La tentation d’exister, 1956, dans Oeuvres.
- — — —, Précis de décomposition, 1949, dans Oeuvres.
- — — —, Syllogismes de l’amertume, 1952, dans Oeuvres.
- Jarrety, Michel, La morale dans l’écriture. Camus, Char, Cioran, Paris, Presses universitaires de France (Perspectives littéraires), 1999.
- Laignel-Lavastine, Alexandra, Cioran, Eliade, Ionesco. L’oubli du fascisme, Paris, Presses universitaires de France (Perspectives critiques), 2002.
- Patapievici, H. R., « E. M. Cioran : entre le “démon fanfaron” et le “barbare sous cloche” », dans Norbert Dodille et Gabriel Liiceanu (dir.), Lectures de Cioran, Paris, L’Harmattan, 1997.
- Sartre, Jean-Paul, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943.