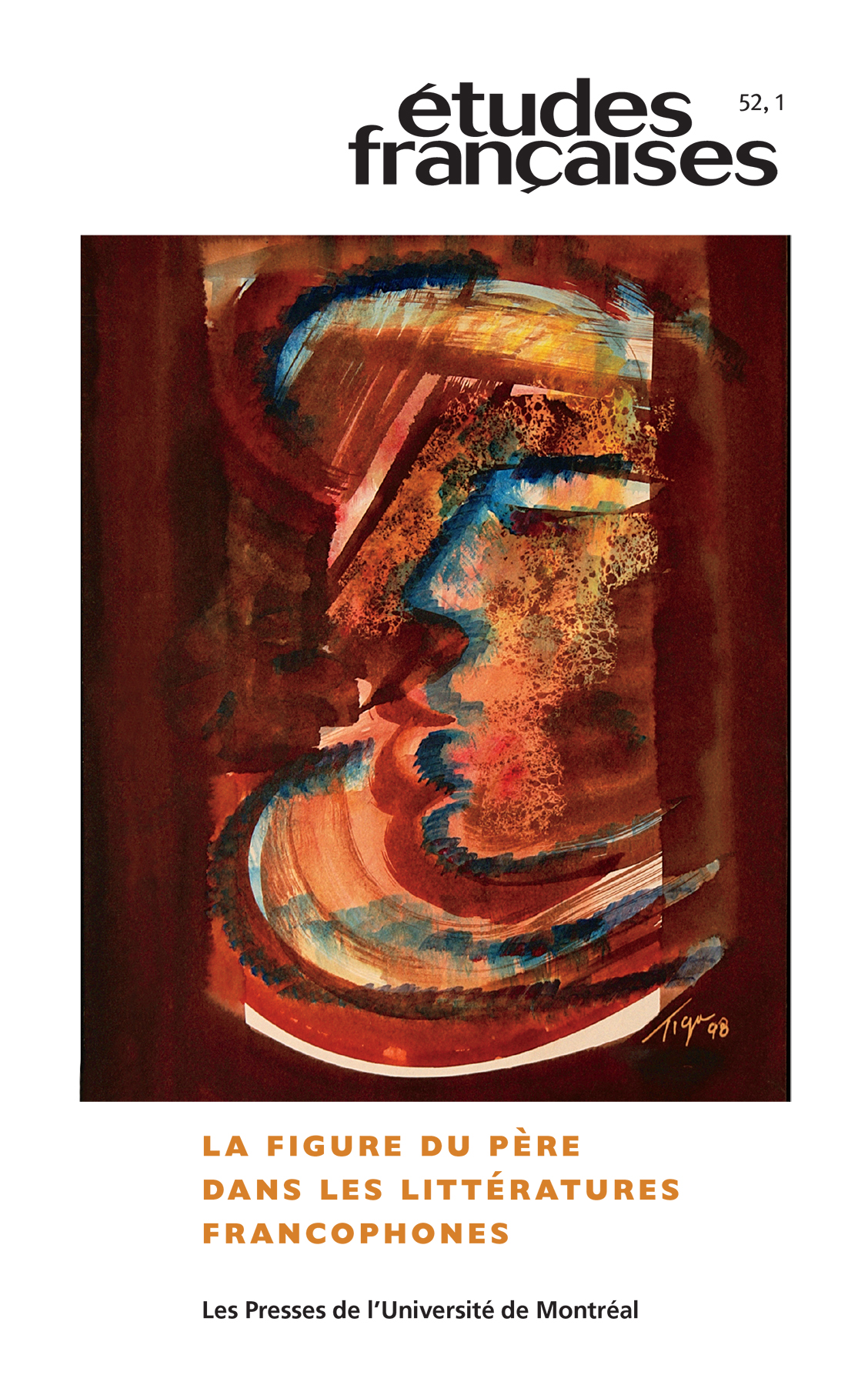Absent, faible, irresponsable, vaincu, violent, incestueux, tyrannique, autant d’adjectifs qui sont régulièrement convoqués pour décrire le père dans la fiction littéraire, et même dans la culture générale. Lori Saint-Martin rappelle à ce propos, à la suite de Germain Dulac, que « l’une des images fortes de la culture occidentale dans son ensemble est celle du père défaillant ». Au Québec en particulier, nous dit François Ouellet, « [o]n retrouve [dans les romans et dans les films] toutes les formes de représentations possibles [du père], mais toujours, ou presque, marquées par l’échec ». Car plus qu’ailleurs, le père y serait impuissant, incapable d’assumer le meurtre du père symbolique pour enfin « passer au rang de père », confiné depuis la défaite des Patriotes « dans une position de fils qui n’en finit plus », installé à demeure dans une paternité inachevée depuis la Révolution tranquille, période pourtant de « volonté parricide ». Dans L’écologie du réel, Pierre Nepveu note que la sociologie littéraire des années 1960 avait déjà fait le constat que « “le meurtre du père n’a jamais lieu dans notre littérature” » et qu’« [i]l y a dans la littérature de la Révolution tranquille, un discours pathétique sur la paternité exploitée, dépossédée ». En éternelle quête de paternité/d’indépendance sans jamais l’atteindre, le Québec produirait des enfants « se complai[san]t dans la posture du fils », une posture de fils victimaire qui, « faute de se distinguer de manière exceptionnellement positive, […] a la satisfaction morbide d’échouer de manière exceptionnelle ». S’il est vrai que « [l]’on écrit pour se faire père », il n’est dès lors pas étonnant que dans un tel contexte d’« incapacité », la littérature québécoise, qui s’écrit forcément du point de vue du fils selon cette logique, soit l’expression « d’une volonté sans cesse brisée d’accéder à la paternité symbolique ». Ailleurs, Ouellet avance que « la notion d’enfant-roi est liée à une représentation défaillante de la paternité. Le règne de l’enfant-roi a été fondé sur la faillite de la figure paternelle et du patriarcat. » En ce sens, si le père fait défaut, « l’enfant-roi est né “par défaut”, sur les cendres d’une paternité vidée de son sens ». Dans son ouvrage sur « La question du père », qui traite des romans écrits par les hommes autant que par les femmes, Lori Saint-Martin offre une étude à la fois plus riche et surtout moins politique que celle de François Ouellet : du père incestueux au père empêché en passant par le père « in extremis », toutes les figures paternelles font l’objet d’analyses éclairantes. Sans aller jusqu’à dire que la paternité a perdu tout son sens, bien que « pèse sur les pères littéraires, comme sur les pères réels, ce “soupçon” […] qui les rend vulnérables et hésitants, voire coupables d’un crime indéfini », la critique en arrive tout de même à cette conclusion pas du tout réjouissante : Qu’il soit mort, manquant, inattentif ou trop présent, trop autoritaire, le père semble ainsi toujours faire défaut, et pas seulement en Occident, puisque certaines littératures de l’Extrême-Orient, notamment chinoise, regorgent de représentations négatives du père – du simple mauvais père au plus cruel et sadique, sans oublier le père débauché et pervers – qui précèdent d’ailleurs les contestations radicales du xxe siècle. Mais si la littérature préfigure les changements sociaux et politiques, ce n’est qu’au xxe siècle, à partir du mouvement de mai 1919, que l’on assiste au déclin de l’ordre patriarcal et du pouvoir paternel en Chine. En France, bien que « l’effritement progressif » débute dès 1760 et que …
Présentation[Notice]
- Ching Selao
Diffusion numérique : 9 mars 2016
Un document de la revue Études françaises
Volume 52, numéro 1, 2016, p. 5–16
La figure du père dans les littératures francophones
Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2016