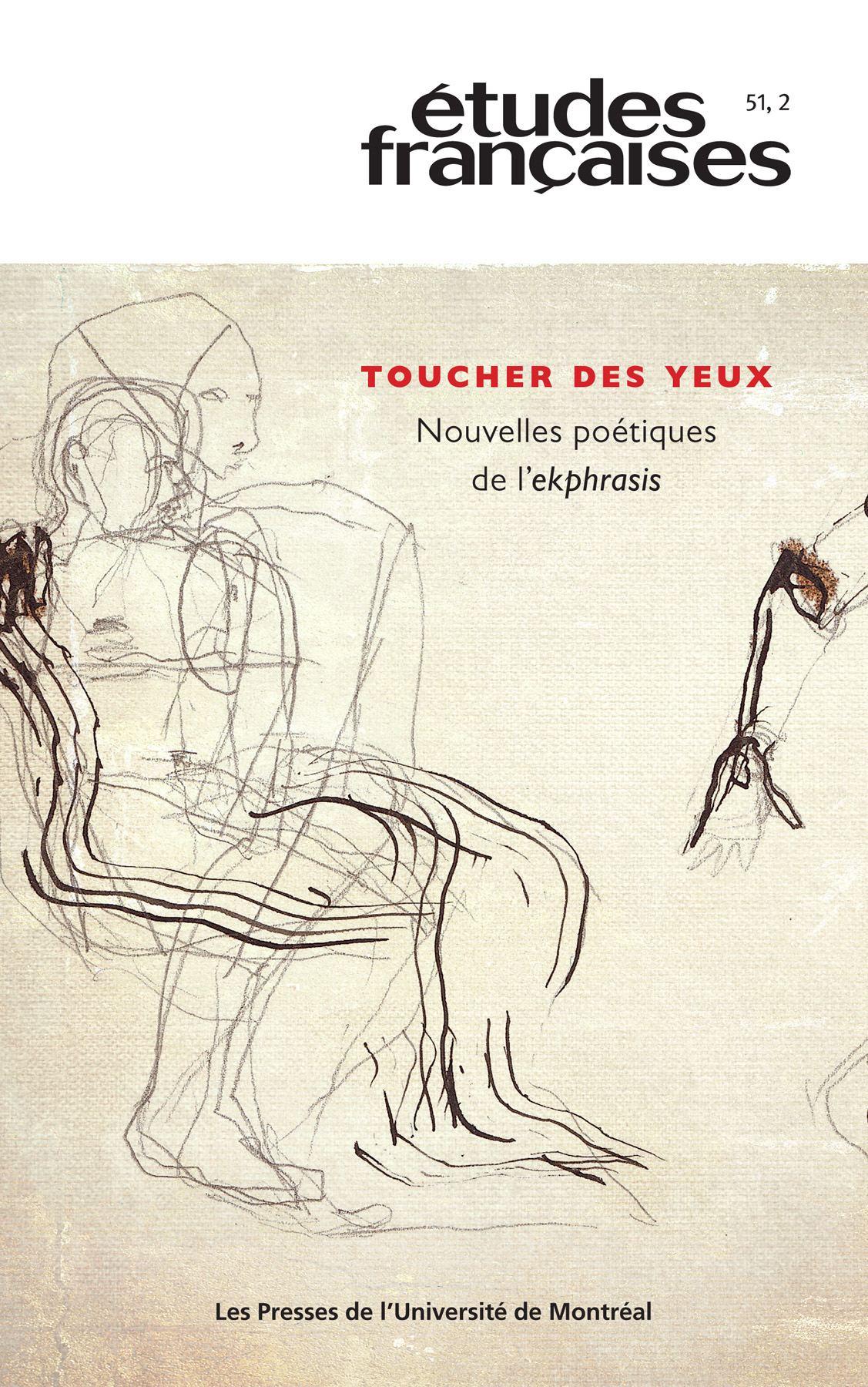Résumés
Résumé
Cet article présente une lecture d’ensemble des différents textes que le philosophe a consacrés à l’art et à la technique de la photographie, de l’oraison funèbre dédiée à Roland Barthes (1981) à ses derniers textes brefs accompagnant Diaspora. Terres natales de l’exil de Frédéric Brenner (2003). Le texte aborde quelques-uns des motifs liés aux questions de la métonymie, du dé/montage comme dé/limitation de la représentation, de la vérité, des temporalités et espaces du développement, de la célébration et du rituel de l’art photographique. Derrida fait rarement usage de l’ekphrasis aux dépens des photographies qu’il lit ; il écrit plutôt la « graphie de la lumière », avec sa référentialité complexe, ses retours spectraux, à travers des effets et des affects déconstruits, à l’intérieur des demeures fragiles et vulnérables qu’elle illumine : telle est la différence de l’interprétation derridienne des images et de la vision.
Abstract
The present article offers a broad reading of Derrida’s various writings on photographic art and technique, from the funeral oration he dedicated to Roland Barthes (1981) to the late, short essays that accompany Frédéric Brenner’s Diaspora. Terres natales de l’exil (2003). This essay tackles motifs related to matters of metonymy, of “dé/montage” as a de/limitation of representation, of truth, of the temporalities and spaces of development, and of the celebration and the ritual of photographic art. Derrida rarely makes use of ekphrasis at the expense of the photographs he is reading; rather, he writes in a “script of light,” with its complex referentiality and spectral returns, through deconstructive effects and affects, from within the fragile and vulnerable dwellings it illuminates: it is what sets apart Derrida’s interpretation of images and vision.
Corps de l’article
Lui – écrire, faire à l’ami mort en soi présent de son innocence.
Jacques Derrida, « Les morts de Roland Barthes[1] »
Elle fait bouger une langue qui se dérobe devant la caméra, elle la met à nu dans ses mouvements indécis, inachevés, innocents et pervers à la fois […].
Jacques Derrida, « Aletheia[2] »
[…] peut-être, un « nous » peut protester […], nous pourrions protester innocemment de notre innocence […] un vivant innocent qui à jamais ignore la mort : en ce nous nous sommes infinis […].
Jacques Derrida, Demeure, Athènes[3]
Au commencement – déclic ou cliché – de notre traversée des textes que Jacques Derrida a consacrés à l’art et à la technique de la photographie, du passage du désir d’un don d’écriture innocente à l’ami disparu, à travers les perturbations et les altérations de l’innocence d’un modèle, jusqu’à la « dénonciation » ou à la « protestation » d’une innocence défendue par nous tous, il nous avait semblé qu’il était possible de montrer le « tout » d’une telle « aventure », le comme si d’une fiction ou d’une tentative impossible, la pulsion de totaliser (et de ressembler) n’étant jamais à écarter parce qu’inscrite, encore et toujours, dans le pouvoir, le vouloir et le savoir-regarder[4]. La photographie : la lecture de Derrida est rythmée par des passages ou des déclics instantanés. La première rencontre a pour cadre « Les morts de Roland Barthes », un hommage triste pour la disparition de l’ami, mais béni par le sourire de la mère dans la « Photographie du Jardin d’Hiver » ; suit la « Lecture » du « chef-d’oeuvre » Droit de regards, de la photographe belge Marie-Françoise Plissart, si original qu’il requiert l’invention d’une langue pour en approcher les expérimentations ; arrive, des années plus tard, l’oeuvre japonaise de Kishin Shinoyama, Light of the Dark, dont Derrida s’éprend dans le splendide « Aletheia » ; puis les « stills » derridiens se font les intimes des photographies de Jean-François Bonhomme dans Demeure, Athènes et se laissent intimer par leur art la venue d’interprétations toujours nouvelles et à-venir. Enfin, et comme depuis le début la musique en a rythmé, avec le silence et le mutisme, la passion, Derrida conclut son voyage photographique par une « coda » qui célèbre, tout en la rompant – au coeur des « petits essais », « sans titre », il y a le révélateur de la « puissante machine photographique » (L, iii) –, la sacralité de l’oeuvre de Frédéric Brenner consacrée à Diaspora. Terres natales de l’exil[5].
Dans l’exposition à l’impossible continuité, à l’ampleur et à l’intensité de ces passages et déclics dans l’oeuvre et les opérations de Derrida, en vérité, se produisait quelque chose de radicalement différent (il appellerait cela le « différentiel ») par rapport à l’intention initiale : dans la recherche du « tout », nous nous retrouvions exposée à une opération (de nombreuses opérations) où le « tout » se retirait sans cesse, attiré par son propre « retrait », à l’intérieur d’une écriture fragmentée, à plusieurs voix, parfois muettes, parfois en con-di-vision ou partage avec des « chants silencieux » et des « pupilles d’yeux » rêveuses – le caractère visionnaire de la pellicule, le développement du négatif, la mutation, toujours déjà inscrite par nature, les temps du développement, les révélations, les épreuves et les témoignages des secrets, des énigmes et des « miracles » de l’art et de la technique de la photographie[6]. Si ce n’était le « tout », qu’est-ce qui nous était alors offert, à l’intérieur du rythme instantané qui donnait sa cadence à l’« écriture de lumière » des oeuvres exposées à la « lecture » derridienne, à travers le don, la perturbation et la protestation de son et de notre innocence ? Un sens (mot que Derrida n’aurait pas aimé, parce que trop lié à la perception, à la sensibilité, à l’« esthétique », sinon encore en raison de « la disparité foncière, archi-originelle des/du sens[7] » qui ne se soumet à aucune catégorie du savoir, de la méthode et du régime théorique), le sens de la « dissémination » est, peut-être, venu conclure notre aventure, destinée à retracer le voyage de l’« écriture de lumière » de Derrida[8]. Non plus au commencement ni seulement dans l’exposition aux inventions déconstructives[9] mais à la fin, un après-coup photographique, le temps retardé du développement d’une photo : la croyance que le « tout » représenté dans le travail photographique de Derrida ne passionne son regard, sa pensée et son écriture que pour relever la valeur éthique et politique de l’art et de la technique de la photographie. Barthes, cité et commenté par Derrida, se demandait :
« Que dois-je faire ? » Dans La chambre claire, il semble approuver celle qui place la « valeur civile » au-dessus de la « valeur morale ». Dans Roland Barthes par Roland Barthes il dit de la moralité qu’on doit l’entendre comme « le contraire même de la morale (c’est la pensée du corps en état de langage) ».
M, 96
La « valeur civile » est une question soulevée par l’oraison funèbre écrite par Derrida ; comme une trace qui n’a cessé de s’inscrire et d’en travailler la réflexion, elle fait en sorte que le philosophe conclut le parcours des lectures de la photographie en se référant aux principes d’« attestation », de « contestation » et de « protestation » (R, 294). L’attestation matérialise le don de l’« il y a » de la photo, et, en même temps, la responsabilité d’en lire (dans « Lecture », une voix se félicite avec une autre voix de ne pas avoir fait « la sourde oreille » – il s’agit là de la « première condition d’accès » (L, xxx) – à l’événement de Droit de regards, d’en avoir accueilli l’« il y a », l’offre faite) le concept phantasmatique, la structure de différence, l’événement de pellicule, les retards réflexifs de l’« écriture » de la lumière et de l’ombre (la pensée se tourne souvent vers la skiagraphie)[10]. Encore, la contestation se dédouble dans l’orthophotographie de la con-testation – le respect et la transformation, le « rapport sans rapport » – de la Loi, de ses ordres, de sa vérité et de la dette que nous devrions ressentir à son égard, en faisant avancer en même temps la contestation – la résistance à l’autorité – de l’Un, du Général, de la Vérité, du Temps, de la Révélation. Et au-dessus de tout cela doit nécessairement s’élever la « protest-action » de l’écriture, innocente et perverse à la fois (l’« hostipitalité » est toujours déjà en acte), exposée à la singularité la plus absolue et à la dispersion la plus métonymique, au dé/montage et au désordre de la séquence, à la déstructuration de la scène, au temps de l’intervalle, à l’écart, à l’espacement, à la durée, à la dissémination finale de la diaspora en « liturgies », publiques, privées et/ou secrètes.
Du reste, n’est-ce pas la cérémonie elle-même qui, toujours, désire laisser la trace, le sillage, l’émanation, la photo de sa propre sacralité, secret et séparation, derrière soi ? Derrida laisse-t-il donc la photo de soi derrière soi, au moment où la mémoire s’arrête – un ultime « passage d’innocence », le maternel toujours évoqué qui se transforme – dans le souvenir conclusif, fragile et aléatoire des photos du père qui célèbre, comme prévu par l’ordre et par la communauté auxquels il appartient, un « mariage » algérien ? Peut-être est-ce cet ultime instantané que Derrida signe, pour célébrer l’hymen de la photographie, son art et sa technique, et de la déconstruction ? On dirait un legs urgent, ordonné, se renouvelant, et qui exigerait contresignature, maintenant plus que jamais.
*
Attestation, contestation et protestation – le désir d’ekphrasis des photo-graphies que Derrida regarde et lit existe-t-il ? Est-il possible de d-écrire la photo – absente – dans les « émanations » ou dans les effets de communicabilité, à l’exemple (l’exemplarité est ici en jeu) de l’émotion que nous éprouvons lorsque nous sommes exposés à l’évocation de la clarté des yeux, uniques et singuliers, d’une mère, que pourtant nous n’avons jamais vue, seulement lue dans l’écriture la plus touchante ? Est-il possible de d-écrire l’oeuvre et le mode opératoire d’un dé-montage énigmatique, qui garde pour lui le droit de regarder, tandis que – trop tard, toujours trop tard, d’où l’imminence – il invente l’autre ? Si l’autre apparaît et a le droit de regarder, en se disséminant dans l’« avoir lieu », et peu importe si nous sommes plus ou moins capables d’en décrire l’événement, ne devrions-nous pas nous sentir en tout cas impliqués, regardés pendant que nous regardons, d-écrivant et d-écrits en même temps ? « Nous » sourions au sourire de l’autre en nous, nous rêvons ses visions ; l’autre nous garde, nous regarde, garde et regarde « nous », innocents, « nous tous » diasporiques à l’intérieur de nous-mêmes et dans chaque communauté d’appartenance sans appartenance.
Derrida décrit rarement une photo ou une oeuvre photographique[11]. « Nous », dans ce qui suit, voudrions montrer l’expérience d’une lecture-écriture qui pourrait décrire les « passages d’innocence » (certains diraient la signature) de Derrida à travers les photos par lui regardées et lues « différemment ». Dans cette expérience, parfois, une fois pour toutes, nous aurions désiré pratiquer le ventriloquisme (combien de voix entend-on dans le silence de la photographie ? Toujours plus d’une, contre les empires et les droits de l’Un) ; d’autres fois, nous aurions pu céder à la tentation d’une – maladroite, nous nous en excusons par avance – sélection de la complexité de la pensée derridienne inscrite dans les choix stylistiques des photos auxquelles il s’expose, et nous avec lui ; souvent, sinon toujours, nous aurions aimé dépister et retracer la passion déconstructive pour l’écriture, les mots, les phrases, les signes que l’art et la technique de la photographie montrent, en les inscrivant dans la singularité la plus absolue et dans la métonymie la plus intime…
« Plus de lumière pour laisser à penser, laisser à désirer » (M, 60) ; la puissance et la jouissance de la pensée derridienne à travers la photographie constituent un don et une promesse ; le « tout » se retire et, en disparaissant, dans son sillage, il laisse rester la restance de l’obsession, le désir, l’amour fou, le culte de l’image, la sacralité que l’« écriture de lumière » habite, héberge et célèbre, habitée, hébergée et célébrée par l’écriture de Derrida, sans cesse, sans fin, infiniment.
L’irréductible référentiel
Le passage de Jacques Derrida par l’art et par la technique de la photographie commence sur une île, dans un isolement voulu pour lire, ou relire, deux livres – le premier et le dernier – de Roland Barthes : Le degré zéro de l’écriture et La chambre claire – comme si, suivant le développement de la pensée de l’ami disparu, la totalité du commencement et de la fin, il pouvait enfin « tout voir et tout savoir » (M, 62). Dans le recueillement grave de l’oraison funèbre pour la mort – les « morts » – de Barthes, Derrida peut seulement laisser tomber de « petits cailloux […], au bord d’un nom comme la promesse de revenir » (M, 60). Un à la fois, une fois pour toutes, les fragments garderont ainsi trace de la « rhétorique » de l’oraison – « Il faut interrompre le commerce des survivants, déchirer le voile vers l’autre, l’autre mort en nous mais l’autre » (M, 80) – et de la chance des « signes de vie ou de mort » (M, 71), auxquels puiser dans la « réserve définie » (M, 71) de la mémoire et des textes.
Un souvenir ouvre l’oraison funèbre de Derrida : Barthes y est placé au seuil d’une tristesse infinie et du plaisir le plus saisissant. L’idée est donnée par l’image du je de Barthes en lui, sans être ni en lui ni dans l’autre (« ni lui ni l’autre n’y sommes vraiment pour l’essentiel », M, 62) ; c’est, en même temps, la bénédiction de la mère de Barthes, dont le sourire s’adresse au fils et, donc, également à Derrida : « Elle lui sourit et donc en moi » (M, 62). La mémoire est importante si dorénavant la justice-justesse de l’émanation féminine doit faire en sorte qu’il n’y ait pas de « trait » photographique que le philosophe ne rapporte, immédiatement, à la bénédiction de la différence, du rêve, des larmes, du rire, du sourire – « tout ce qu’elle souffle de vie et ranime de plaisir » (M, 62)[12]. L’autre ressource à laquelle Derrida puise pour honorer la mémoire de son ami est la textualité. Le degré zéro de l’écriture, qu’il relit sur l’île, marque une compréhension nouvelle : chaque ressource ancienne passe à travers la « sortie » de Barthes hors des limites de son époque, là où il mettait en acte « la plus grande force de jeu », la « manière légère de mobiliser en déjouant » (M, 63). Barthes savait faire travailler les termes les plus opposables et opposés des dialectiques de la modernité (dont celle, importante pour l’avenir des lectures photographiques de Derrida, qui la développera à sa manière, entre Histoire et Nature) l’un pour l’autre. Quel sens auraient les Majuscules, employées dans ce texte et d’autres, sinon celui d’exprimer « la déprise et l’incrédulité » (M, 63) envers les binômes et les cercles dialectiques ? Derrida souligne le pour des espacements barthésiens ; peut-être parce que c’est la vocation qui se dé-tourne, dans la pratique déconstructive, dans l’invagination, dans la répétition, dans la réflexion (sur la tekhnê de la production et de la reproduction de l’image). Du reste, comment distinguer les deux modalités, quand, par exemple, est en jeu l’« Art » photographique, ses expérimentations, les renvois et les relances des photos dans d’autres photos, réflexions à l’intérieur de réflexions, un univers de multiplications et de proliférations infinies ? Il s’agit d’un trait nodal de la « réserve » de Derrida à l’égard de l’interprétation photographique de Barthes, qui s’allie souvent à une position bien plus radicale à l’endroit de la catégorisation platonicienne du « mimétique » et du « phantasmatique ».
Dans ce jeu de citation et de feinte infinie, l’autre texte que Derrida lit est donc le dernier ouvrage de Barthes, La chambre claire, le livre qui a « veillé » sur la mort de l’auteur comme aucun autre[13] et qui s’impose pour avoir mis, à l’instar de la pensée de Walter Benjamin, le focus de l’attention de la modernité technique sur la question, la grande énigme, de la Référence. Barthes dirait le « Référent » ; Derrida le conjugue pour en faire le « référentiel » de la photographie et, plus généralement, de toute instance de référence de l’image : « […] ce ne sera pas réduire ce qu’il dit de spécifique quant à la photographie que de le supposer pertinent ailleurs : je dirais même partout » (M, 76). La chambre claire offre, ici et ailleurs (dans la réflexion photographique derridienne, l’ami est sans cesse évoqué et discuté ; son nom en marque le point de référence et, en même temps, la blessure, le punctum aigu et blessant), de nombreuses occasions de réflexion : la composition (placée entre médiation et musique) du punctum et du studium ; le caractère phantasmatique du concept de photographie (et, simultanément, la photographie du concept de phantasme)[14] ; le « retour du mort », la « spectralité » comme essence photographique ; surtout, l’apparition, sans se montrer et sans se cacher, d’une photo, la photo qui, pour Barthes, unit et dévoile toutes les autres : la Photographie du Jardin d’Hiver, où sa mère, à l’âge de cinq ans, accomplit ce que lui, des années plus tard, appellera « la science impossible de l’être unique[15] », la vérité de la singularité absolue, sans métonymie possible (la photo montre sa mère, non pas la Mère), l’adhérence la plus réelle du Référent.
Observant le témoignage inespéré, la photo trouvée par hasard, le don inattendu, Barthes sait qu’elle « a été[16] » : la vérité de l’Un est rejointe. D’une manière différente, pour Derrida, c’est la lecture d’un « détail » de l’écriture de son ami qui est en jeu quand, dans une parenthèse qui opère comme un trait graphique de son deuil inconsolable, Barthes nomme l’utopie : « Ma particularité ne pourrait jamais plus s’universaliser (sinon, utopiquement, par l’écriture, dont le projet, dès lors, devait devenir l’unique but de ma vie)[17]. » L’« utopie de l’écriture » : Derrida pense que le besoin urgent et nécessaire de « suspendre un concept naïf du Référent » (M, 76) se rapproche ici de la « praxis » de la photographie (la pragmatique ou la valeur pragmatique rythmeront constamment, par emphase graphique, la future démarche des lectures derridiennes). C’est l’inscription, tout à la fois, du punctum et du studium dans la métonymie la plus hallucinatoire, intime et touchante, qui, seule, « permet de parler, de parler de l’unique, de lui et à lui » (M, 87). La métonymie « délivre le trait qui rapporte à l’unique » (M, 87). Pourquoi donc l’émanation de clarté et de justice-justesse des yeux de la mère de Barthes, qui illumine La chambre claire, sans être ni se faire jamais visible, réussit-elle à nous toucher, à nous émouvoir, à nous troubler – c’est cela que Barthes aime au sujet du punctum, contre le studium qui fait quant à lui appel au savoir, à la connaissance et à la culture –, nous qui la voyons à travers la description de Barthes, dans l’amour et dans le pathos de l’évocation de l’image de la mère, et non pas de la Mère[18] ? Un mouvement naïf d’identification est-il à l’oeuvre ? En vérité, la force métonymique de l’écriture – la plus « touchante », qui permet, par exemple, de lire l’Amitié spéciale entre Blanchot et Bataille – ouvre la déconstruction de l’Un aux abîmes les plus profonds et à d’inexorables vertiges :
L’altérité reste à peu près intacte, et c’est la condition. Je ne me mets pas à sa place, je ne tends pas à remplacer sa mère par la mienne. Si je le fais, cela ne peut m’émouvoir que depuis l’altérité du sans-rapport, l’unicité absolue que la puissance métonymique vient de me rappeler sans l’effacer. Il a raison de protester contre la confusion entre celle qui fut sa mère et la Figure de la Mère, mais la puissance métonymique (une partie pour le tout ou un nom pour un autre, etc.) viendra toujours inscrire l’une et l’autre dans ce rapport sans rapport.
M, 88
Derrida accueille, lit, relance et « développe » (dans le « liquide amniotique[19] » de la photographie) le deuil et la pensée, quand, en conclusion de sa retraite tout en recueillement, il laisse tomber d’abord un grain, puis un autre, dans le sable-cendre-flux de son écriture, livrant à l’oeuvre et aux opérations de Barthes le concept sans concept d’une « théorie contrapuntique » :
La force métonymique, voilà qu’elle divise le trait référentiel, suspend et laisse à désirer le référent tout en maintenant la référence.
M, 91
[…]
Théorie contrapuntique ou défilé des stigmates : une blessure vient sans doute au lieu du point signé de singularité, au lieu de son instant même (stigmê), en sa pointe. Mais au lieu de cet événement, la place est laissée, pour la même blessure, à la substitution qui s’y répète, ne gardant de l’irremplaçable qu’un désir passé[20].
M, 97
Division, suspension, désir ; ouverture, substitution, répétition : la photo-graphie ou « graphie de la lumière » ne s’anime pas dans l’Unique, ou dans l’adhérence du Référent. D’une manière plus complexe, et différemment, la vocation photographique se suspend dans l’irréductible implication et la fréquentation « référentielle » de son art et de sa technique[21].
L’invention de l’autre
[…] seuls les mots m’intéressent, la venue et le retrait des vocables dans la taciturne obstination de cette puissante machine photographique.
Jacques Derrida, « Lecture », dans Droit de regards[22]
Au retour de l’isolement de la lecture, Derrida ne fait que regarder, avec obsession, les photos et l’écriture manuscrite de Barthes – les détails, les choix pour les couvertures des livres, les lignes blanches inscrites sur un fond sombre – et peut-être cherche-t-il à voir dans l’écriture « essentielle » de son ami ce que celui-ci ne réussissait peut-être pas à voir. En vérité, l’anamnèse est exposée, comme les photos qu’elle habite et qui l’habitent, à l’interruption et à la disparition « toujours trop tôt » ; la promesse est cependant de recommencer à nouveau – « reste à venir » (M, 97). Peu de temps après la rédaction de l’oraison pour « Les morts de Roland Barthes » – un titre arrivé comme un ordre, « Aucune objection n’y résista, ni la pudeur après l’instant d’une décision intraitable et ponctuelle, le temps presque nul d’un déclic : il en aura été ainsi, uniquement, une fois pour toutes » (M, 59), et l’« ordre » sera, pour Derrida, la trace, la note, le passage, la négation et l’avancement, l’instantané et l’imminence –, Derrida reprend son voyage en s’exposant au photo-roman de Marie-Françoise Plissart, Droit de regards, et en le faisant suivre d’une « Lecture » – l’exégèse requise par l’oeuvre – qui vient de côté, du dessus, par derrière, par dessous[23] le (dé)montage à l’oeuvre, prêt qu’il est à se laisser surprendre par la « puissante machine photographique » (L, iii) et espérant surprendre lui-même l’objectif qui le cadre encadré.
L’oeuvre est complexe ; seul l’un des plus intenses polylogues derridiens peut la suivre, en demeurant fidèle à l’« ordre » et aux « règles » : on peut raconter toutes les histoires possibles, mais en se pliant au droit de regard que le dispositif du montage garde pour lui. L’Histoire, écho de l’intérêt barthésien, devient la possibilité de raconter, l’invention d’histoires, l’infinie virtualité du discours au sujet de l’ordre, de la succession, de la consecutio et de l’enchaînement des photogrammes. Il s’agit de l’ordre secret des figures qui habitent les demeures vides et abandonnées, dans la succession incessante de stases, courses, chutes, répétitions s’éloignant, reprises et relais qui, selon l’ordre prédisposé, développent l’énigme à la limite de la persécution, de l’inquisition, de la rhétorique, de l’érotique, de la photo-grammaire. Au départ, Derrida s’intéresse aux figures « génériques » – « Je, tu, vous, il, elle, on, nous, vous, elles, ils » (L, iii) – qui habitent les photos qui défilent ; par la suite, il se concentre sur le genre du roman-photo, exposé à toutes les opérations possibles de citation, division et altération. Un roman-photo sans « légende », se demande la « Lecture », c’est-à-dire sans la voix qui s’arroge le droit d’ordonner une interprétation unique, est-il encore un photo-roman ? Ne s’agit-il pas, plutôt, d’exposer le « droit » de regarder, annoncé dans et dès le titre de l’oeuvre, au centre de l’interrogation ?
Qui dispose du « révélateur » ? Qui « fixe » ? Qui « monte » ? Qui joue avec le noir et blanc du damier ou avec l’inversion des deux couleurs, comme du bien et du mal ? Qui « dispose » mais aussi qui pose, expose, sur- ou sous-expose ? Qui « développe » en inversant le noir et blanc du négatif ? L’auteur ? les auteurs ? les destinataires ? Un photographe est a priori le récepteur aussi, le destinataire donc, de la photo qu’il « prend », il ne vaincra jamais une certaine passivité devant elle […]. Que dit la loi ? Qui a le droit de voir la scène, de capter des images, de les interpréter, cadrer, découper ? Qui a le droit d’induire des récits ? Et de faire croire ?
L, viii
Émanant du vertige de ces interrogations s’ensuit la question du genre de Droit de regards. L’oeuvre photographie, le « type espagnol » mis à part, une suite de femmes : deux couples d’amantes, deux petites filles qui jouent aux dames (la présence d’un damier, avec coups et règles, vient signifier iconographiquement le jeu en acte) et, encore, une femme, au crâne nu, qui écrit et, comme les autres, apparaît, sort, court… Le texte commence avec deux femmes étendues sur un lit, peut-être après avoir fait l’amour ; tout à coup, l’une d’elles sort, court, tombe, est « prise » par l’appareil photo d’une troisième femme ; dans les photogrammes qui suivent, cette photo apparaît au-dessus du lit qui accueille la nouvelle rencontre. Tout avance ainsi : les femmes entrent, sortent et entrent à nouveau dans la suite inexorable des cadres, encadrements, miroirs, vitres, verres cassés, photogrammes réfléchis dans les photogrammes suivants et dans les précédents, une photo à l’intérieur des autres photos, un reflètement continu à l’intérieur du reflètement. La succession des figures et le retour de leur « bénédiction » assument la fonction d’agir la puissance de l’« autre structure » de la photographie et, en même temps, un autre rapport à la « parole possible » (L, iv). Exposant la série infinie et la réflexivité constante des départs et des courses des femmes, Droit de regards remarque l’altérité photographique à la progression de l’Histoire, à la prétention d’un développement ordonné, dans l’instant et dans l’instantané de l’« an-histoire » et de la « différence » : « Voilà peut-être l’an-histoire qu’elle raconte, ce que seule une technique photographique, par l’invention d’un nouveau dispositif, peut donner à penser en lui donnant lieu, une autre temporalité, ladite “intemporalité de l’inconscient”, l’anneau de l’éternel retour, l’hymen et l’affirmation des femmes. » (L, xi-xii)
L’affirmation des femmes qui partent, sortent, tombent, entrent de nouveau, et recommencent, invente la « topophotographie » (positions, suppositions, mises, poses, parts, parties) du dé-montage qui, par la suite, dans l’à-venir qui ordonne, s’apprête à photographier ce qu’une voix du polylogue appelle « la pensée du rêve » (L, xiv) : l’irréductible rupture de la simplicité linéaire en faveur de l’inversion et de la disjonction absolues. La question concerne la « scène primitive » : une femme dort, l’autre, à côté d’elle, pensivement, fume ; au-dessus du lit, la photographie de la chute de l’une, prise par l’autre. La photo no 18 ne pourrait-elle être l’une des femmes qui rêverait la photo, qui rêverait sur elle ? Et la photo qui arrive ensuite, après, dans l’ordre des photos, ne pourrait-elle anticiper – ou bien différer – l’origine et la matrice de la conséquence ? Rien ni personne ne pourrait nier la richesse onirique du montage. Qui pourrait dès lors croire qu’une possibilité est plus réelle ou moins fictionnelle que l’autre : la matrice au commencement, ou au centre ? Vertigineusement, en développement, si l’oeuvre a mis en suspens le générique, le genre et le gender et, encore, la genèse, la génération et la régénération du dés-ordre photographié ; si, encore, tout a été artifice, artefact, technique et symbolique, la chute photogénérique encadrée dans la photo au-dessus du lit déclare l’appartenance, sans appartenance, à l’écriture de lumière, exigeant, nécessairement, imminemment, sa « Lecture » : « Oui, on ne peut que lire. […] la brillance du phainestai et de la lumière, photographie » (L, xvi).
Quelle sorte d’exégèse peut s’ensuivre, être amenée à devoir suivre ? Le déchiffrement, la somme, la totalisation, la description, la nomination, peut-être l’inventaire – « un vrai descriptif » (L, xxvi) –, un métadiscours avec droit de regard confié à la parole, ou encore une théorie générale qui voudrait, pourrait et saurait s’arroger le droit de dominer le dé/montage ? D’une manière différente, ce que la « Lecture » opère, c’est la performativité du « rapport sans rapport » déjà évoquée dans la conclusion du texte « Les morts de Roland Barthes » : l’impensable au coeur de la loi, ce qui donne le plus à penser, inscrit dans le photogramme, sur la limite et dans l’ombre – l’agrandissement ou la glorification d’un détail, non pour instituer quelque panoptikon ou droit du regard total mais pour jouir de la « dé-limitation » même de la représentation.
Au centre des 100 photos (99, plus la photo de quatrième de couverture), un fragment de photo, trouvé dans la rue, commence à s’agrandir jusqu’à se faire image, sur toute la page, d’une femme, une figure mi-masculine mi-féminine, au crâne nu – « puissante, douce et terrifiante, solide. Une autorité fascinante » (L, xxv). L’instance topique-topologique que cette apparition laisse être est le trait, l’espacement, the spacing, la textualisation, la différence, l’écriture de Droit de regards : « l’écriture apparaît » (L, xxv)[24]. Pensive, la femme écrit ; sur la table, un paquet de cigarettes (métonymie de la fumée qui a sans cesse circulé dans l’oeuvre) expose le mot « filter » au miroitement et au reflet de la photo. Le mot intéresse Derrida parce que, autour de lui, se déploie la variété des langues, l’anglais, le français, le flamand et le grec : « tu le lirais philtre (je t’aime) […] “oui, je t’aime” à la vie à la mort » (L, xxvii). Les femmes s’aiment, mais leur amour vit de l’absence de croisement des regards. L’appellation de l’amour – par la langue, across les langues – croise la phrase « [Elles] […] ne se regardent jamais[25] » (L, xxvii). Elles ne se regardent pas ; suspendues dans l’indépendance et dans la solitude, les femmes s’aiment sans se regarder l’une l’autre, droit dans les yeux, en croisant les regards ; l’objectif de la caméra ne pourrait jamais témoigner du croisement ou du toucher de leurs regards. Il s’agit là de la limite de la photographie et, en même temps, de la limite générale de la représentation : « Délimitation générale : jamais un troisième regard ne surprendra le face-à-face de deux autres » (L, xxviii). Au seuil d’une telle dé-limitation, le témoin sans témoin tiers exclu réussit à bouleverser toute pré-vision, perspective, thématisation, pouvoir et violence de l’objectivation, du droit et de l’empire de la vision, en mettant en acte photographique la grammaire même de la « non-violence » : « Regard sans droit de regard. […] tu m’aimes, donc, au-delà des mots, dans plus d’une langue. […] Je – philtre, j’aime, le mot filtre[26] » (L, xxix).
Dorénavant, mais il en a été ainsi à travers l’entier dé-montage, l’avenir de Droit de regards consistera dans une partie à venir. Pilar, nommée par l’une des voix du polylogue, se lève, sort, réapparaît pour remettre de l’ordre dans le jeu de dames, puis – peut-être pour se montrer elle-même comme une pièce, une partie, une figure parmi les autres, sans droit ni emprise aucune sur le jeu, un détail fragmenté, partiel et dans la série – se retire, retournant progressivement dans l’obscurité et laissant derrière elle d’ultérieures réflexions de réflexions, d’autres photos de photos, invagination après invagination, jusqu’à la fin. Et, à la fin, tout semble revenir au même : les femmes apparues dans les premières photos se rencontrent, comme si rien ne s’était passé. Les fantômes reviennent ; le secret met en scène leurs effets de retour, la revenance, et, en même temps, la différence de la référance. Si l’énigme s’est nouée dans l’élément du photogramme, si celui-ci a été artifice, technique, photogrammaire et photohistoire, est-il possible que le référent externe – essentiel à la photographie, comme le répète Derrida, citant Barthes en conclusion de la « Lecture », peut-être pour mettre encore une fois sa pensée à l’épreuve – soit domestiqué, pris, suspendu ? L’unicité du référent et l’adhérence au « réel » seraient incontestables si seulement on ne considérait pas la photographie comme l’art qui peut – c’est son « droit » – transformer le référent en indice, l’indicer, et ainsi allonger, spatialiser, renvoyer la référence à l’infini : « La chimère est possible. S’il y a un art de la photographie […], il est là. Il ne suspend pas la référence, il éloigne indéfiniment un certain type de réalité, celle du référent perceptible. Il donne droit à l’autre, il ouvre l’incertitude infinie du rapport au tout autre, ce rapport sans rapport. » (L, xxxv).
Le premier pas de la déconstruction photographique se conclut en marquant tout ce que Derrida avait désiré au début de sa traversée ; là-bas, l’ouverture du « commerce des survivants » (M, 80) ; là, l’image d’un « cercle ouvert », « une spirale » – « un anneau central reste ouvert » (L, xxxv). Droit de regards reste suspendu à la limite de son « écriture de lumière », encore et toujours, soucieuse du droit à l’invention de l’autre.
Lumière, voile et film
Depuis qu’il y a la physis […] la photographie y aura toujours été imminente, incessamment, l’imminence même dans le désir […].
Jacques Derrida, « Aletheia[27] »
Derrida avance – « sans voir », « sans savoir » et « sans pouvoir » – au coeur de l’univers photographique. Ce ne sera ni le rapport entre Nature et Histoire ni celui entre l’Histoire et les « histoires », mais la confrontation entre Nature et tekhnê qui maintenant intéressera le philosophe. Après s’être exposé au concept phantasmatique de la photographie et en avoir suivi la structure de différence, dans « Aletheia », le bref et complexe essai consacré à la « grande oeuvre » de Kishin Shinoyama, l’ouverture, le regard, la lecture et le questionnement de Derrida se concentrent sur la « vérité » – de la restance – d’une autre figure de femme, une vierge, fiancée, épouse ou mère, exposée, en singularité absolue et dans son unicité, à la limite, à l’angle, au côté, au bord d’une série d’instantanés faits de lumière et d’obscurité : Light of the Dark.
La femme est au « centre » d’une concentration insistante ; exposée, seule, en silence, souvent au bord des larmes[28] (la limite entre la tristesse et la joie est, du reste, insituable et indécidable). Le trait du récit est l’immanence – la figure semble se préparer à tout, mais il ne se passe rien ; elle ne parle pas, la scène est absolument silencieuse. En vertu du mutisme, en vérité, c’est la langue qui s’expose à l’objectif, à la pensée et à la promesse : « […] l’oeuvre donne, dès son titre anglais, à penser la langue, elle promet même de toucher au corps du mot dans le jeu des langues. Elle fait bouger une langue qui se dérobe devant la caméra, elle la met dans ses mouvements indécis, inachevés, innocents et pervers à la fois. » (A, 260-261)
« Les mots viennent » (A, 261) : à commencer par le titre Light of the Dark de l’oeuvre japonaise. Light dit l’image de la « légèreté », la légèreté de l’image, le simulacre le plus léger, et, en même temps, le jour, la lumière, la visibilité ; the Dark : nom et adjectif, la nuit est évoquée, l’obscurité est appelée, comme l’oeil caché de la caméra, et, par métonymie, tout ce qui se soustrait à la visibilité, qui menace la visibilité, qui défie la lumière. Singularité et métonymie : l’oeuvre et la femme sont uniques et singulières, et, en même temps, elles allégorisent la genèse de la lumière, phôs. L’apparition, par « nature », en outre, se soustrait, se retire et, ce faisant, signifie : dans le passage à la lumière photographique, la lumière naît, toujours déjà comme mémoire graphique et archive de la visibilité incise, skiagraphie, l’« écriture » de la lumière et de l’ombre. Light of the Dark : que dit, alors, le rapport que les mots instaurent dans le of de l’appartenance de la lumière à l’ombre, lumière dans/de l’obscurité, autrement dit, dépendante de l’obscurité ? Une réponse consisterait à ramener à la « vérité de la vérité » qui, depuis Platon, lève le voile et dévoile l’invisibilité de ce qui donne à voir : ce qui (se) laisse regarder se soustrait à la vue. Cette « vérité » est allégorisée par/dans Light of the Dark : par pudeur, la femme se soustrait à la lumière, se laissant regarder dans l’imminence du nocturne qui, seul, permet de la regarder. C’est la loi même du phénomène lumineux : « Cette loi du phénomène lumineux (phôs) est inscrite, dès l’origine, dans la nature (physis). Comme une histoire de l’oeil. Les lois de la photographie sont dans la nature, ce sont des lois physiques […] » (A, 263).
Il y a, magnifiquement représentée dans ce chef-d’oeuvre, une réponse autre au sujet de la vérité philosophique « sans âge », à l’interrogation sur le rapport entre lumière et obscurité ; Derrida pense au dispositif optique de l’oeil-prothèse, au témoin sans témoin, à l’origine et à l’archive de l’implication de l’ombre au coeur de la lumière. C’est le surgissement du désir pour l’image et, grâce à lui, l’ouverture la plus intense de la dialectique entre Nature et Technique : « Alors la tekhnê devient la vérité de la physis […]. […] l’interposition d’un dispositif optique venue rappeler que dans la physis déjà, l’interstice aura été ouvert, comme un diaphragme, pour que la photographie en témoigne : pour que le témoin invisible comme tiers (terstis) voie et donne à voir […] » (A, 264).
Interstice, diaphragme, shutter : dans Light of the Dark, emblèmes et indices montrent la nature d’un jour et d’une nuit qui existent en vertu de leur inversion, le noir de la visibilité de la lumière, la nuit qui éclaire : la lune matricielle, le négatif qui attend le développement, le corps dévoilé par le voile de la nudité de la femme. « […] la mutation […] appartient […] à la physis » (A, 264), répète Derrida, en pensant à la différence du rapport à soi de la nature qui, seule, et avec elle-même, se garde, se regarde, se divise, s’espace, et ainsi s’aveugle…
Reste le sentiment d’amour pour les images. Seuls, et avec eux-mêmes, singuliers et allégoriques, l’oeuvre et le modèle de Light of the Dark provoquent une émotion chez Derrida qu’il appelle « confusion érotique » (A, 266) : il ne sait pas, et peut-être ne saura-t-il jamais, s’il aime l’oeuvre, chaque photogramme unique et singulier, ou bien s’il est amoureux de celle qui donne la naissance, la vie et la mort, au bord des larmes – « à brouiller la vue pour montrer les eaux » (A, 265). L’image et le modèle – encore une fois Barthes est appelé sur la scène de l’exégèse photographique quand Derrida s’interroge sur ce qui matérialise le trouble du désir : s’agit-il de l’existence adhérente du référent ou bien de la seule et unique fois de la photo, et, tout à la fois, de la caresse qui appelle d’autres caresses, faisant ainsi avancer, en imminence et par métonymie, le (trouble du) désir vers l’autre, promis à travers le double, la pellicule, le film[29] ? Le film de Light of the Dark montre l’imminence de son faire-oeuvre, le se-faire de son « Aletheia » comme un acte photographique qui est métonymie de tous les actes possibles : fiancée, épouse, mère, la femme peut attendre l’amour, la naissance, le mariage, ou la mort. « Plus précisément, cette métonymie en acte décrit l’imminence de ces actes […] à la fois dans un instantané qui fixe le mouvement et selon le cliché qui schématise un type et rend ainsi possible le jeu des figures » (A, 267). La rhétorique photographique n’est rien d’autre que cela : la transfiguration d’une figure dans l’autre – « ce qui à la fois enchaîne, entraîne et annule toute narrativité possible » (A, 267).
Nuit de rêves, condensation et dispersion, ce qui vient avant et ce qui suit, les instantanés de Light of the Dark riment avec le silence, dans le mutisme, avec le mouvement et avec l’arrêt : leur film « tourne autour » de toutes les révolutions entre lumière et obscurité, entre jour et nuit, entre naissance et mort, et, au tournant, l’amour pour la photographie ne peut fusionner avec le corps d’« Aletheia » mais, d’une manière différente, peut seulement se partager dans son souffle, ses seins, un baiser… « Tourner autour »/Poindre – la tentation serait, en conclusion, de répondre à la « vérité » photographique de l’oeuvre par un récit qui suivrait l’enchaînement discret de chacune de ses photos. En vérité, la tentative pourrait prendre la forme de cinquante actes théâtraux. Sur le fond, sur la surface immaculée, khôra ou « droit de regard », « Aletheia » écrit l’absolu « avoir-lieu » de son « il y a » : elle crie « me voici » (A, 270). Le secret clôt Light of the Dark pour en ouvrir le passage à l’à-venir : « Tout cela arrivera sans arriver. Cela arrivera au futur, sans lui arriver, au futur » (A, 271). Le passage à travers la pellicule ne laisse rien d’autre que l’empreinte de la mémoire d’une passante exposée à d’autres passants, qui relance l’événement de l’impossible réponse « plus loin » : « L’exposée s’expose davantage, mais point trop, elle répond, elle fait mine de répondre, elle ouvre la bouche sans rien dire : la pointe du sein sera toujours promise à l’impossible. Aller plus loin… » (A, 271).
Entre photo et graphies
[…] toutes les modalités affectives que vous voudrez (l’ironie, la tendresse, la compassion, la révolte, la curiosité, etc.) […].
Jacques Derrida, « Prégnances[30] »
Derrida est en voyage en Grèce, exposé à la limite d’un récit qui n’est plus, maintenant, « théâtral », mais « musical ». Dans « Les morts de Roland Barthes », il avait déjà éprouvé la fascination de la « composition » d’une sonate classique. Ici, allant « plus loin », son regard s’arrête, pour se donner un rythme d’écriture, sur le « chant silencieux » (D, 45) de Korê ou Perséphone, la déesse descendue aux enfers et dans la mort, l’autre Pupille de l’Oeil, de l’Occh-io[31] :
Ne règne-t-elle pas sur ce livre, Perséphone, l’épouse d’Hadès, la déesse de la mort, et des fantômes, et des âmes errant à la recherche de leur mémoire ? mais aussi […] une déesse de l’image, de l’eau et des larmes, à la fois transparente et réfléchissante, miroir et pupille ? Korê, son autre nom, c’est la jeune fille et la pupille de l’oeil, « ce qu’on appelle la pupille (κόρην καλοῦμεν) » dont l’Alcibiade de Platon nous rappelle que notre visage s’y réfléchit, en son image, dans son « idole », quand il se regarde dans les yeux de l’autre. Il faut donc regarder le dieu, « c’est le meilleur miroir des choses humaines » (133c). Et tout cela serait dû à la mort, et les spectres, et la pupille photographique, et la symphonie de tous ces instruments de musique.
D, 46
D’abord, les yeux clairs et justes de la mère dans « Les morts de Roland Barthes » ; ensuite, les courses et les chutes des figures de femmes dans Droit de regards ; puis, faisant suite au modèle « Aletheia », l’émanation d’un autre regard féminin illumine Demeure, Athènes, consacré aux photographies de Jean-François Bonhomme (le nom interpelle le regard de Derrida, qui l’appelle « ce bonhomme de photographe », D, 58), qui reprennent les destinées de la ville d’Athènes, lesquelles, à leur tour, illuminent l’interprétation des destinées – destinerrance – d’une phrase qui saisit le philosophe comme un snapshot, en plein jour, sous un soleil brûlant, près du cap Sounion. Le crossing de l’arrivée de la phrase avec les photos qui accompagnent Derrida en voyage, sur lesquelles il a promis d’écrire un texte, marque une nouvelle relance – qui serait finale, si ne recommençait une fois encore, une seule fois, « chaque fois unique, la fin du monde » – de la traversée de l’art et de la technique de la photographie.
Le « passage de l’amour » pour la photographie – annoncé dans le film d’« Aletheia » et peut-être écho de ce qui était apparu aux yeux de Derrida comme l’« accélération autobiographique » de la pensée de Barthes (M, 80), le sentiment de l’imminence de la mort – s’expose à une intimité et à un partage (con-di-vision) sans précédent avec l’écriture déconstructive. Derrida, en photographe amateur suivant les traces d’un photographe, consacre la forme de quelques « Stills » – aphoristiques et sériels – aux « stills » du photographe français[32]. La sérialité et l’aphorisme sont déjà inscrits dans les photographies et exposés aux sens de la demeure (mot tellement aimé et fréquenté par Derrida dans ses lectures photographiques[33]). Selon des temporalités différentes – before, since, after –, les photos prennent des vues des « morts » d’Athènes (un pluriel qui semble encore inscrit dans le sillage du deuil impossible pour l’ami Barthes) ; l’Antiquité, les maisons, les temples, les tombes, les dernières demeures ; le présent en transformation (Athènes envahie, par exemple, par la photographie touristique) ; le futur de ce qui aura cessé d’exister quand le photographe aura fini et publié le livre – « Livre d’épitaphes, […] en effigie photographique » (D, 11)[34].
Demeure, alors, comme durée de cette action retardée, de cet événement ou acte en développement, la mise en demeure, la rencontre de l’« amour fou » de Derrida pour le moratoire ou l’action du retard (parce qu’il donne davantage à penser) et le dispositif photographique dénommé déclenchement-retard, le retard automatique qui calcule l’intervalle de la « prise », inscrivant la technologie à l’origine du temps et de la durée, l’intervalle plein de durée. Il y a une photo qui montre, dans son titre et par sa composition visuelle, tout cela de façon paradigmatique, réfléchissant en elle les autres photographies du texte : « Photographe à l’Acropole ». Ébloui, Derrida pense que cette photo photographie « la photographie et son photographe » (D, 21) : le photographe, peut-être l’auteur du livre lui-même, s’est endormi au milieu des pierres de l’Acropole, protégé par une ombrelle ; il a devant lui un appareil photographique fixé sur un trépied et, derrière lui, un appareil d’une génération différente, à côté de photos ; un pigeon assiste à la scène silencieuse et onirique. Derrida se livre à une lecture envoûtée par le caractère d’« inspection » et d’« inventaire » de la photo, de l’opération de « 8 + n “autres choses” » (D, 36) qui archive les différents règnes – minéral, végétal, divin, animal, humain, le règne technique et le règne de la réflexion :
les ombrelles-réflecteurs […]. Réflexions sur la réflexion et la mise en abyme (au sens large : la représentation métonymique d’une représentation), sur les phantasmes de simulacre ou les simulacres de phantasmes […], ce sont les jeux innombrables qui photographient la photographie […].
D, 43
La mise en demeure se fait mise en abyme du trait, singulier et métonymique, dans d’infinies réflexions et réflexivités. Que se passe-t-il dans le passage des signes sans cesse réfléchis en eux-mêmes ? Ce qui, pour Derrida, ici et dans les photos que cette photographie réfléchit et sur lesquelles elle réfléchit, a assumé le sens des morts d’Athènes, la désuétude et l’obsolescence de la ville, « l’affect de la désaffection » (D, 40), et s’expose extraordinairement à une « traduction », la trace étendue, allongée et retardée du deuil photographique des opérations du photographe :
[…] ces procédures réflexives […] manifestent l’affection pour le désaffecté, le deuil qui garde au-dedans de lui ce qu’il perd en le gardant. Une reconnaissance de dette auprès de la mort est signée par tout ce qui réfléchit, dans l’acte photographique aussi bien que dans la structure du photogramme. […] La dette n’attend pas la stèle funéraire ou l’inscription sur une sépulture[35].
D, 45
Affect/affection – la rechute de l’impossible traduction dans la durée du passage de la réflexion de Derrida en voyage en compagnie de ses amis grecs marque l’arrivée de la phrase « Nous nous devons à la mort ». Aphoristique, imprévue, inattendue – une « chose oraculaire » (D, 14), « Un oracle de silence » (D, 22) –, une fois pour toutes les fois, la phrase prend le philosophe par surprise : un instantané en procès, le temps de la mise en demeure. Dette et devoir : Derrida voudrait, comme le photographe à l’Acropole, fixer le dispositif retard de l’appareil photo pour qu’ils soient pris ensemble, la phrase et lui, en même temps, pour toujours – « à demeure » (D, 18). Pour la durée du voyage (et des fragments derridiens), la phrase revient, reprend, se développe et, à un certain point, (se) réfléchit dans l’histoire du destin de Socrate qui, exposé au verdict de sa mort, en vit, rêveur, le retard : « J’aurais donc photographié Socrate attendant la mort » (D, 32-33). Trait ironique, peut-être simplement sens étymologique, la « théorie contrapuntique » de Barthes et la « théorie générale » du panoptikon de Plissart s’écrivent maintenant dans la theoria de la procession : Socrate ne sera pas exécuté tant que durera le voyage aller et retour du navire envoyé comme chaque année à Délos pour célébrer le « salut » de sept jeunes gens et sept jeunes filles par Thésée, parce que la loi athénienne interdit – « Athènes avait fait un voeu. À Apollon » (D, 34) – tout sacrifice et toute exécution pendant la durée de ce voyage, incalculable s’il s’agit de prévoir les conditions « naturelles » de son accomplissement. Et pourtant, Socrate « connaît » le moment de sa mort – la vision d’une femme, venue en rêve, le lui apprend –, tout comme il « sait » devoir rembourser, dans le calcul du temps de son attente, la dette contractée – la vision d’un autre rêve lui commande de composer une musique célébrant la philosophie, un hymne aux dieux.
Socrate connaît, fait et destine : le calcul de l’intervalle, et la destruction du retard, qui, pour Derrida, n’est peut-être rien d’autre que le désir de la philosophie[36]. L’histoire pourrait, alors, peut-être, éclairer le sens de la phrase qui vient à Derrida, inattendue et énigmatique : le destin de l’être-voué-à-la-mort, l’écho que la dette a destiné à la pensée occidentale ? Ici et maintenant, le chant silencieux de Korê éclaire l’« affect » de la différence : la protestation silencieuse de Derrida s’adresse à cette lecture, affirmant croire, quant à lui, et fermement, en une chance autre pour la philosophie et pour ses destinées. Et pourtant, à son tour, la « protestation » se réfléchit dans la suggestion interprétative que Derrida offre aux amis qui voyagent avec lui. Que peut signifier la phrase à la lumière de la réflexion et du retard photographique, après avoir été exposée à la protestation à l’égard d’une vision destinale du « se-devoir » à la mort ? La phrase qui arrive ainsi « photorthographié[e] » (D, 51) est inscrite et incise dans la ressource idiomatique de la langue française : nous nous devons à la mort. « La phrase prend en photographie la langue qui la photographie » (D, 22) – la réflexivité photographique marque la réflexivité du langage. Derrida explique ainsi à ses amis qu’une explication possible serait que le premier « nous », le sujet de la phrase, ne peut que se réfléchir dans le second « nous », l’objet réfléchi, parce que le premier se constitue seulement après sa réflexion dans le second :
[…] nous nous apparaissons à nous-mêmes, nous nous rapportons à nous-mêmes, nous nous prenons en vue comme un dû, pris dans une dette ou un devoir qui nous précède et nous institue, une dette qui nous contracte avant même que nous ne l’ayons contractée. […] Et toutes les figures du devoir autonomique qui commandent à notre morale seraient prises en vue par cette hétéronomie primitive.
D, 54
La réflexion hétéronome permet de mieux saisir la « modalité pragmatique » du « nous » réfléchi :
[…] « nous nous devons à la mort » ! Eh bien non, nous refusons cette dette […] nous refusons l’autorité de cette antériorité, cet a priori ou cette originarité prétendue du devoir […]. Contre la dette, contre ce devoir, contre cette culpabilité, et cette peur des morts, peut-être, un « nous » peut protester […], nous pourrions protester innocemment de notre innocence, un nous protesterait contre l’autre. […] nous, en premier lieu, non, le premier nous qui regarde, observe et photographie l’autre, et qui parle ici, c’est un vivant innocent qui à jamais ignore la mort : en ce nous nous sommes infinis […].
D, 55-56
Retard, réflexion, dénonciation : il ne reste au photographe amateur qu’à rêver la vision du photographe rêveur.
Je rêve alors sa vision, le feu d’une déclaration d’amour, un flash en plein soleil, et l’un dirait à l’autre : « je me surprends à t’attendre, aujourd’hui, mon amour, depuis toujours ». Dionysisme, philosophie, photographie. Reste à savoir ce que c’est (τί ἐστι) que l’essence de la forme photographique du point de vue d’un retard qui s’emporte à gagner le temps de vitesse. Un aveu muet, peut-être, et réticent, car il sait se taire, un discours infiniment elliptique, fou d’un seul désir : impressionner le temps par tous les temps, et furtivement, dans la nuit, comme un voleur de feu, à la vitesse de la lumière archiver la vitesse de la lumière.
D, 58
Le révélateur diasporique
[…] la photographie témoigne toujours en nous interrogeant : qu’est-ce qu’un témoignage ? Qui témoigne de quoi, pour qui, devant qui ? Le témoin est toujours singulier, irremplaçable, unique, il se présente dans son corps sensible. Mais comme le tiers (testis, terstis), il atteste et testifie exemplairement l’universalité d’un lieu, d’une condition, d’une vérité.
Jacques Derrida, « [Révélations et autres textes][37] »
L’altérité apparaît en se soustrayant ; elle a droit au regard ; elle est promise dans les doubles, tout autant qu’aux doubles[38]. À travers la pellicule ou le film, l’autre nous regarde ; dans un partage hétérogène, l’altérité regarde nous, son innocence et notre innocence. La traversée de l’altérité photographique pourrait finir sur la « dénonciation la plus conséquente » (D, 57), la plus passionnée de Derrida ; le « culte amoureux de l’image » (L, xiii) a cependant encore une chance quand le philosophe laisse accompagner ses « petits essais », « sans titre », des photographies de Frédéric Brenner, consacrées, sur une longue période de recherche, à la diaspora juive dans la mondialisation contemporaine[39].
Encore une fois la différence éclaire le désir : des femmes rient derrière les barrières de leur exclusion des rites patriarcaux ; de manière surprenante, dans un théâtre de l’impossible, peut-être comme une venue du messie, quelques femmes rabbins endossent le tallith ; au-dessus de toutes, il y a Esther – « “la première marrane, l’archétype” » (R, 276) et, en même temps, « le prénom caché de ma mère, Esther » (R, 276)[40]. Ce que la différence féminine éclaire, à l’intérieur des photographies consacrées aux hommes, pères et fils, ce n’est plus seulement le concept phantasmatique, la structure an-historique, la vérité d’événement et le temps du retard mais la « solution » de la photographie : le révélateur, la substance ou solution chimique, et, tout à la fois, le photographe. Exposé aux « ré-solutions » de Brenner, l’« habiter », que jusqu’ici Derrida a associé à la demeure, devient un « séjourner » dans la fragilité de la mémoire : « Je séjourne donc pour un temps dans mes abris de mémoire, mes demeures provisoires, aléatoires et fragiles […] » (R, 275). L’habitation emporte l’hospitalité : la dynamis ou la force métonymique (ici magistralement exposée, si chaque histoire d’exil, unique et singulière, est absolument métonymique de la diaspora commune et globale) se montre dans la « force » des « contradictions » (R, 276) qui concernent l’exil du peuple hébreu. Dans les photos exposées à Derrida, et à nous avec lui, la clé de l’enclave diasporique est mise à résolution : « l’étranger au coeur du chez-soi. La diaspora est chez elle hors de chez elle, elle reste hors de chez elle chez elle, chez-soi-chez-l’autre […] ». Plus loin, il ajoute : « la dispersion affecte de l’intérieur, elle divise le corps et l’âme et la mémoire de chaque communauté » (R, 277).
La clarté – la « force d’évidence », souvenir de Barthes – de la clé interprétative pourrait mener à la résolution, sauf que le liquide amniotique de la photographie de Brenner expose, encore, une « intense agitation identificatoire » (R, 281). Au cours de ce séjour dans sa propre mémoire, Derrida conjugue le mouvement dans l’identification de soi, exposée, avec toujours plus d’insistance dans le parcours déconstructif, au sérieux d’un jeu. Lui, le marrane qui, appartenant sans appartenir, dans le rapport sans rapport à la Loi, sait comment voir arriver l’énigme, le secret, ce qui se maintient en retrait vis-à-vis de la visibilité, du rapport à la lumière, irréductible à la visibilité, séparé (se cernere, secretum), sans le voir, le savoir ou pouvoir le voir, mais tout en le sauvegardant et en le révélant. Il ne s’agit pas de la « révélation » telle que la comprendrait Hegel – « il n’a rien compris » (R, 286) – en la plaçant dans l’élément de la lumière, dans l’histoire et dans la vérité du concept et du savoir absolu comme développement de la religion révélée ; il ne s’agit pas non plus de l’impossibilité du témoignage, comme en auraient discuté, si la rencontre tant désirée avait jamais eu lieu, le philosophe Adorno et le poète Celan ; peut-être, alors, au contraire, s’agit-il ici du témoignage impossible – parce que seulement celui-ci peut témoigner de l’impossible – du révélateur photographique, la solution et, en même temps, le photographe, qui agissent la valeur pragmatique, politique et éthique de la « réflexion et [du] « reflet » (R, 292). Évoqué dans la conclusion de Demeure, Athènes, le « nous » innocent se réfléchit, dans la mémoire sans titre des fragments de Derrida qui réfléchissent sur l’image révélée des photographies diasporiques de Brenner, dans la réflexion de « nous tous » : « Nous, nous tous, tous les vivants présents, les vivants du passé et les spectres de l’avenir, nous tous, hommes ou animaux, n’avons de lieu propre et de terre bien-aimée que promise, et promise depuis une expropriation sans âge, plus vieille que toutes nos mémoires. » (R, 293)
Dans les photos de la diaspora, laquelle concerne « nous tous », le gathering déconstructif – « l’être ensemble, de l’assemblée, du maintenant, du maintenir […]. La déconstruction […] l’affirmation d’un certain “être ensemble”, d’un certain maintenant[41] » – n’oublie pas, comme il ne le doit pas, s’agissant de la question juive de l’archive, de regarder à travers le milieu, à travers l’élément apparemment diaphane de la visibilité, la photographie de la vitre cassée d’une fenêtre, pour s’exposer enfin et là à l’expérience du témoignage photographique, au culte, à la cérémonie, à la liturgie et à la sacralité de l’art et de la technique de la photographie. Chaque cérémonie et toutes les cérémonies publiques et/ou secrètes désirent laisser derrière elles, « gravée » et « révélée », la trace de leur réalisation. Les « petits essais » que Derrida développe à travers le révélateur de Diaspora de Brenner s’interrompent sur le souvenir des cérémonies célébrées par son père, « membre d’une corporation chargée […] de rites conjugaux » :
Djerba, peut-être la plus « vieille » communauté juive du bassin méditerranéen.
[…]
Je regarde des photos montrant mon père (membre d’une corporation chargée, entre autres, de rites conjugaux) à l’instant où il donne une cuillère de soupe rituelle à une jeune mariée d’Alger qui ressemble à celle-ci.
R, 296-298
Chance donnée à la chance, la promesse anamnestique du mariage de la photographie et de la philosophie, du regard déconstructif et de l’image, arrête la « révélation » de l’écriture de Derrida sur ce dernier instantané sacré. L’interruption semble marquer la fin de l’oeuvre et des opérations de Derrida à travers la photographie ; en vérité, avec la bénédiction de la différence, elle reste toujours à-venir : la lumière de son regard et de son écriture ne cesse d’arriver en provenance du futur antérieur de la survie, encore, et toujours, pour « nous » exposer, « nous tous », à la responsabilité de la contresignature du don, se renouvelant, dans l’à-venir d’infinis autres passages, clichés ou déclics, de la déconstruction[42].
Parties annexes
Note biographique
Silvana Carotenuto est professeure associée à l’Université de Naples L’Orientale, où elle enseigne la littérature contemporaine de langue anglaise. Ses champs d’intérêt sont la déconstruction, l’écriture féminine, les études culturelles, postcoloniales et visuelles. Elle a traduit en italien Tre passi sulla scala della scrittura d’Hélène Cixous (Rome, Bulzoni, 2000) et son dernier livre est consacré à La lingua di Cleopatra. Traduzioni e sopravvivenze decostruttive (Gênes, Marietti, 2009). Elle a dirigé le numéro « Impossible Derrida. Works of Invention » de la revue darkmatter (vol. 8, 2012) et un numéro de la revue Anglistica, « Writing Exile: Women, the Arts, and Technologies » (vol. 17, no 1, 2013). Elle mène actuellement un projet de recherche subventionné par la Communauté européenne, « Matriarchivio del Mediterraneo. Grafie e materie » et a codirigé A Feminist Critique of Knowledge Production (Naples, Iuo, 2014). À paraître en 2015 : « “Go Wonder” : Plasticity, Dissemination and (the Mirage of) Revolution », dans Plastic Materialities: Politics, Legality, and Metamorphosis in the Work of Catherine Malabou (Durham, Duke University Press).
Notes
-
[1]
Jacques Derrida, « Les morts de Roland Barthes », dans Chaque fois unique, la fin du monde, textes présentés par Pascale-Anne Brault et Michael Naas, Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2003, p. 70. Dorénavant désigné par la lettre M, suivie du numéro de la page.
-
[2]
Jacques Derrida, « Aletheia », dans Penser à ne pas voir. Écrits sur les arts du visible (1979-2004), Ginette Michaud, Joana Masó et Javier Bassas (éds), Paris, Éditions de la Différence, coll. « Essais », no 82, 2013, p. 261. Dorénavant désigné par la lettre A, suivie du numéro de la page.
-
[3]
Jacques Derrida, Demeure, Athènes, photographies de Jean-François Bonhomme, Paris, Galilée, coll. « Écritures/Figures », 2009, p. 56. Dorénavant désigné par la lettre D, suivie du numéro de la page. C’est Jacques Derrida qui souligne. Sauf indication contraire, ce sont toujours les auteurs qui soulignent.
-
[4]
Jacques Derrida insiste : « Un trait n’est jamais simplement tiré sous le désir de rassembler, il le traverse et s’y divise, c’est tout. Ne niez donc pas ce désir, il commande encore le regard, et l’économie rhétorique […] ». Cf. Marie-Françoise Plissart, Droit de regards, suivi d’une « Lecture » de Jacques Derrida, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. xxiv ; rééd., Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, coll. « Traverses », 2010, p. xxxii. Dorénavant désigné par la lettre L, suivie du numéro de la page. Nous citons ici la première édition.
-
[5]
Jacques Derrida, « Les morts de Roland Barthes » (1981), dans Chaque fois unique, la fin du monde ; « Lecture », dans Marie-Françoise Plissart, Droit de regards ; « Aletheia » (1993), dans Penser à ne pas voir (d’abord paru dans « Nous avons voué notre vie à des signes », Bordeaux, William Blake & Co, Edit. 1996 ; cité ici dans l’édition parue dans Penser à ne pas voir) ; Demeure, Athènes (d’abord paru sous le titre « Demeure, Athènes. Nous nous devons à la mort », dans Athènes à l’ombre de l’Acropole, photographies de Jean-François Bonhomme, éd. bilingue, trad. grecque Vanghélis Bitsoris, Athènes, Éditions Olkos, 1996) ; 14 fragments, sans titre, dans Frédéric Brenner, Diaspora. Terres natales de l’exil (volume Voix), Paris, Éditions de La Martinière, 2003 (cité ici dans l’édition de Penser à ne pas voir, p. 272-298 ; dorénavant désigné par la lettre R, suivie du numéro de la page).
-
[6]
Dans Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography (2000) (introduction et édition de Gerhard Richter, trad. angl. Jeff Fort, Stanford, Stanford University Press, 2010), Derrida commence la conversation en parlant de la division du présent dans l’archive qu’il lie au « miraculeux » photographique : « […] photography performs this miracle as a technology of the miracle, that is, by giving something to see ». (Op. cit., p. 3.)
-
[7]
Cf. Jean-Luc Nancy, « “Éloquentes rayures” », dans Derrida et la question de l’art. Déconstructions de l’esthétique, Adnen Jdey (dir.), Nantes, Éditions Cécile Défaut, 2011, p. 18.
-
[8]
Le terme « aventure » que Derrida utilise explicitement dans les fragments consacrés aux photos de Brenner est emprunté à Barthes (cf. Penser à ne pas voir, p. 296). Comme le rappellent Eduardo Cadava et Paola Cortés-Rocca dans « Notes on Love and Photography » (October, no 116, printemps 2006, p. 9), dans La chambre claire, la contingence, la singularité et l’« aventure » forment une série qui montre l’agitation, le risque, l’animation et la transformation du sujet, le passage dans l’expérience, les modes transformateurs et inattendus de l’amour de et pour la photographie.
-
[9]
Derrida réfléchit à la relation d’« excès » qui existe entre la pensée et la philosophie à l’intérieur de sa discussion sur les arts de l’espace : « une remise en question potentielle de la philosophie, qui va au-delà de la philosophie. […] un peintre ou un réalisateur […] devient porteur de quelque chose qui ne peut être maîtrisé par la philosophie. […] la pensée se produit dans l’expérience de l’oeuvre, c’est-à-dire que la pensée y est incorporée – l’oeuvre provoque notre pensée et cette provocation à penser est irréductible ». (Jacques Derrida, « Les arts de l’espace. Entretien avec Peter Brunette et David Wills », trad. fr. Cosmin Popovici-Toma, dans Penser à ne pas voir, p. 41-42.)
-
[10]
Sur cette question, cf. Ginette Michaud, « Ombres portées. Quelques remarques autour des skiagraphies de Jacques Derrida », dans Derrida et la question de l’art, p. 317-341. Dans « Penser à ne pas voir », le philosophe décrit la portée différentielle de l’événement relativement au voir : l’événement est irruptif, inaugural, singulier, il ne se laisse pas voir arriver, il est sans anticipation ou pré-vision, sans horizon d’attente, imprévisible et imprédictible. (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 61.)
-
[11]
Jean-Luc Nancy y lit la résistance de Derrida à parler de l’oeuvre d’art en soi, sinon pour avancer « l’amorce ou le tour d’une pensée qu’il file et déroule le long d’elle ». (Jean-Luc Nancy, « “Éloquentes rayures” », dans Derrida et la question de l’esthétique, p. 15.) Dans l’oeuvre derridienne consacrée à la photographie, nous retrouverons spécifiquement cette ouverture au « détournement » et au « tourner autour » (ibid., p. 17) dont parle Nancy.
-
[12]
Derrida écrit : « Traduisez : l’image du moi de Barthes que Barthes a inscrite en moi, mais ni l’un ni l’autre n’y sommes vraiment pour l’essentiel, cette image, je me dis présentement qu’elle aime en moi cette pensée, elle en jouit ici maintenant, elle me sourit. […] la mère de Roland Barthes, que je n’ai jamais connue, me sourit à cette pensée comme à tout ce qu’elle souffle de vie et ranime de plaisir. Elle lui sourit et donc en moi depuis, pourquoi pas, la Photographie du Jardin d’Hiver, depuis l’invisibilité radieuse d’un regard dont il nous a dit seulement qu’il fut clair, si clair. » (Jacques Derrida, « Les morts de Roland Barthes », dans Chaque fois unique, la fin du monde, p. 61-62.) La mort de Derrida est elle-même bénie par un passage de « sourires » : « Souriez-moi, dit-il, comme je vous aurai souri jusqu’à la fin. Préférez toujours la vie et affirmez sans cesse la survie… Je vous aime et vous souris d’où que je sois. » (Jacques Derrida, [sans titre], Rue Descartes, no 48, avril 2005, p. 6-7.)
-
[13]
Cf. Ginette Michaud, Veglianti. Verso tre immagini di Jacques Derrida, préface de Jean-Luc Nancy, trad. italienne Roberto Borghesi, avec la collaboration de Nicoletta Dolce et Gabriella Lodi, Milan et Udine, Mimesis, coll. « Filosofie », 2012 (Veilleuses. Autour de trois images de Jacques Derrida, Québec, Éditions Nota bene, coll. « Empreintes », 2009).
-
[14]
Pour la question du « spectre », qui existe entre le visible et l’invisible, par rapport au « concept », cf. Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 59-60.
-
[15]
Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma/Seuil/Gallimard, 1980, p. 110.
-
[16]
Ibid., p. 126 sq.
-
[17]
Ibid., p. 113.
-
[18]
C’est la question abordée par l’essai d’Eduardo Cadava et Paola Cortés-Rocca (« Notes on Love and Photography », October).
-
[19]
Jacques Derrida dans Prégnances. Lavis de Colette Deblé. Peintures, Mont-de-Marsan, L’Atelier des Brisants, 2004, p. 19 ; repris dans Penser à ne pas voir, p. 174. Cf. l’étude de Marta Segarra, « De l’esthétique “féminine” au regard de travers », dans Derrida et la question de l’art, p. 383-396.
-
[20]
Derrida lie la référence à la « théorie », ici et ailleurs dans les passages sur la photographie de « Penser à ne pas voir », à la « métaphoricité » et au theorein, c’est-à-dire au « regarder ». « La théorie de la contemplation, le privilège du théorique, c’est le privilège de la vue ; donc, ce privilège de l’optique a dominé […] en effet toute l’histoire de la métaphysique ». (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 73.)
-
[21]
Sur la question du suspens et les arts du visible, cf. Joana Masó, « Illustrer, photographier. Le point de suspension ou l’image chez Jacques Derrida », dans Derrida et la question de l’art, p. 361-381.
-
[22]
Jacques Derrida, « Lecture », dans Marie-Françoise Plissart, Droit de regards, p. iii.
-
[23]
Pour Derrida, l’événement, qui n’a pas d’horizon, n’arrive pas horizontalement mais verticalement : « il peut venir du dessus, de côté, par derrière, par dessous, là où les yeux n’ont pas de prise, justement, n’ont pas de prise anticipative ou préhensive ou appréhensive ». (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 61-62.)
-
[24]
Derrida insiste : « Quand je dis trait ou espacement, je ne désigne pas seulement du visible ou de l’espace, mais une autre expérience de la différence. » (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 77.)
-
[25]
L’analyse de Derrida indique trois possibilités d’interprétation de la phrase « Elles se regardent » ; 1) elles se regardent l’une l’autre sans que l’une voie l’autre la regarder ; 2) chacune se regarde elle-même dans un miroir ; 3) elles se regardent l’une l’autre en croisant leurs regards. S’il y a de nombreux exemples des deux premières possibilités, il n’y a pas d’exemple de la troisième possibilité dans le livre de Plissart, sinon pour la photo d’un seul face-à-face, où, cependant, le croisement des regards impliqués n’est pas assuré. (Jacques Derrida, « Lecture », dans Marie-Françoise Plissart, Droit de regards, p. xxviii.)
-
[26]
Derrida relie la question des yeux – voyants et visibles – au « trouble du miroir » et de l’« autoportrait » : « Dans l’expérience du miroir, cette indécision affleure. Quand nous nous regardons dans un miroir, nous devons choisir entre regarder la couleur de nos yeux et regarder le flux, l’influx du regard qui se regarde avec tous les paradoxes de l’autoportrait […] ». (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 63.)
-
[27]
Jacques Derrida, « Aletheia », dans Penser à ne pas voir, p. 261.
-
[28]
Derrida parle des larmes comme de l’« expérience » des yeux, faits non seulement pour voir mais aussi pour pleurer. (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 57.)
-
[29]
La « réserve » de Derrida vis-à-vis de la pensée barthésienne est ici donnée entre parenthèses : « Barthes y a beaucoup insisté, […] l’existence unique du référent […] est indéniablement posée comme la condition de l’oeuvre (mais je préfère dire supposée, et cela change presque tout) ». (Jacques Derrida, « Aletheia », dans Penser à ne pas voir, p. 266.)
-
[30]
Jacques Derrida, « Prégnances », dans Penser à ne pas voir, p. 171.
-
[31]
Nous jouons ici avec une ressource de la langue italienne qui insère l’« io » (je) dans l’« occhio » (oeil) ; ce qui rappelle aussi l’inclusion sonore, l’homophonie, des sons anglais « I » (je) et « eye » (oeil).
-
[32]
Ginette Michaud l’appelle « photographiant » (cf. « Ombres portées », dans Derrida et la question de l’art, p. 325).
-
[33]
Ici semblerait en jeu l’implication du corps – « une expérience de cadres, de déhiscence, de dislocation » – de Derrida dans l’acte photographique. (Jacques Derrida, « Les arts de l’espace », dans Penser à ne pas voir, p. 27.)
-
[34]
Sur la question complexe des temps retardés des morts d’Athènes, cf. Michael Naas, « “Now Smile”: Recent Developments in Jacques Derrida’s Work on Photography », The South Atlantic Quarterly, vol. 110, no 1, hiver 2011, p. 205-222.
-
[35]
Cf. la lecture de Demeure, Athènes proposée par Mireille Calle-Gruber dans « Du deuil photographique dans quelques textes de Jacques Derrida » (dans Derrida et la question de l’art, p. 343-359), qui lie le texte à la question de l’ekphrasis : « On notera que l’approche analogique tend ici à convoquer efficacement un dispositif d’homonymie assurant le passage d’un registre à l’autre : le temps de pose photographique faisant écho au temps de pause narrative : le développement désignant le processus en chambre noire aussi bien que la longueur textuelle : de même que clichés, stéréotypes, détail, agrandissement, gros plan, même, relèvent de l’ekphrasis autant que du laboratoire photographique. Et autant du laboratoire philosophique travaillant à penser la traversée, l’impression sensible, le retard du sujet ». (Ibid., p. 346.)
-
[36]
Derrida associe ce « calcul » au logos : « […] le logos en général : au sens de raison, au sens de discours, au sens de proportion, au sens du calcul. Le logos, c’est tout ça, c’est le compte qu’on rend, logon didonai, c’est la raison, le discours, la parole, le calcul, la proportion, le compte, comme ratio en latin, le compte, le calcul […] ». (Jacques Derrida, « Penser à ne pas voir », dans Penser à ne pas voir, p. 67.)
-
[37]
Jacques Derrida, « [Révélations et autres textes] », dans Penser à ne pas voir, p. 294.
-
[38]
On pourrait, encore une fois, indiquer ce que Derrida associe à la « mère » de Barthes : « […] l’autre ne peut paraître qu’en disparaissant. Et elle “savait” le faire, innocemment, car c’est la “qualité” d’“âme” d’un enfant qu’il déchiffre dans la pose sans pose de sa mère. Psyché sans miroir. Il ne dit pas plus et ne souligne rien. » (« Les morts de Roland Barthes », dans Chaque fois unique, la fin du monde, p. 75.) La question d’une « Psyché sans miroir » éclairera le parcours du philosophe dans Le toucher, Jean-Luc Nancy (Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2000).
-
[39]
Ginette Michaud consacre une partie de sa lecture de la question photographique chez Derrida à ces « fragments » sur l’oeuvre de Brenner (cf. Ginette Michaud, « Ombres portées », dans Derrida et la question de l’art, p. 330-339).
-
[40]
Analysant, en s’appuyant sur la pensée déconstructive, l’oeuvre de Barthes consacrée à la photographie comme étant de l’« amour », Eduardo Cavada et Paola Cortés-Rocca affirment que « giving birth to an image, the mother is another name for photography » (« Notes on Love and Photography », October, p. 25).
-
[41]
Jacques Derrida, « Les arts de l’espace », dans Penser à ne pas voir, p. 45.
-
[42]
Dans le contexte anglo-américain, Michael Naas souligne le don, grâce à la traduction et à la réimpression en langue originale de certains textes, de l’apparition, à la fois contemporaine et pourtant toujours « out of joint », du corpus derridien consacré à la photographie : « It is purely by accident, a matter of sheer happenstance, that the full scope of Jacques Derrida’s work on photography is only now beginning to come to light […] an important series of works on photography is only today, years after Derrida’s death, coming to be developed. » (Michael Naas, « “Now Smile”: Recent Developments in Jacques Derrida’s Work on Photography », The South Atlantic Quarterly, p. 205 ; c’est l’auteur qui souligne.) La conclusion de l’essai reprend, en l’interprétant, le début : « But if all this is indeed “by accident”, then we must also consider along with Derrida how the accidental is part of the very structure of not only every photograph but every trace and how the uncommon delay that now allows us to reflect on this structure was one of those happy accidents to which Derrida often—and, as we have seen, particularly with regard to photography—bore witness. » (Ibid., p. 220 ; c’est l’auteur qui souligne.)