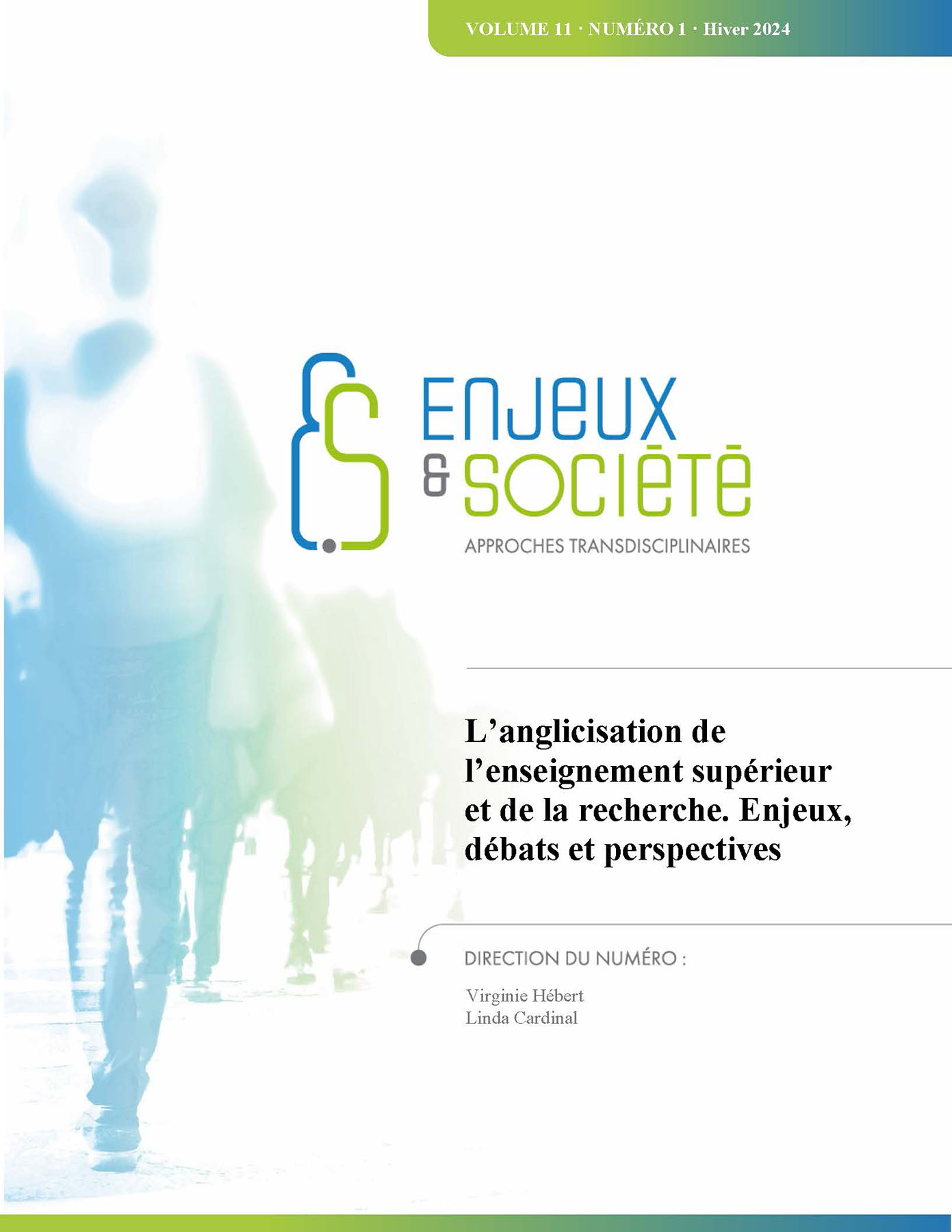Résumés
Résumé
Ce texte aborde la tendance fréquemment observée dans les pratiques des universités des pays non anglophones, notamment au niveau des instances décisionnelles, à accorder, sans guère de recul critique, une place considérable à la langue anglaise. Cette tendance est nette dans la plupart des universités européennes, universités ayant historiquement, socialement et politiquement vocation à travailler en français. On tente ici, au-delà du constat, de proposer un démontage analytique, posé comme condition nécessaire à (i) typologiser les utilisations de l’anglais, (ii) mieux discerner les motifs (parfois compréhensibles, parfois fallacieux) qui motivent ces pratiques, et (iii) proposer des mesures concrètes qui permettent l’ouverture internationale sans abandonner à la langue anglaise un quasi-monopole dans l’enseignement et la recherche au niveau tertiaire.
Mots-clés :
- gouvernance des universités,
- plurilinguisme,
- politique linguistique
Corps de l’article
Introduction
L’anglicisation des universités à travers le monde est indubitable, y compris dans les pays non anglophones dotés d’une tradition académique multiséculaire. Comme le dit de manière très directe un site internet prodiguant des conseils aux futurs étudiants :
L’Europe est rapidement en train de devenir une région de choix pour les programmes d’études en anglais, même dans des pays où l’anglais n’est pas la langue locale […]. Les cours donnés en anglais, qui étaient encore rares et dispersés jusqu’en 2009, notamment au niveau du baccalauréat académique (BA), mais depuis cette époque, le nombre de BA disponible en anglais a été multiplié par un facteur de cinquante (Collier, 2022)[1].
Comment en est-on arrivé là? Pour quelles raisons cette anglicisation, dont nombre d’indices donnent à penser qu’elle est plus dommageable que salutaire, semble-t-elle accueillie avec si peu de réticences? Et quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour arrêter la dérive vers l’uniformité et garantir sur le long terme la diversité linguistique dans l’enseignement supérieur et dans la recherche? Telles sont les questions qu’aborde ce texte.
Cette liste de questions signale du même coup ses limites, en précisant d’emblée qu’il ne s’agit pas ici de développer une approche empirique adossée à un jeu de données : on déroule plutôt une réflexion, encore en partie exploratoire, qui se propose d’identifier les questionnements nécessaires afin de structurer la réflexion, notamment celle que peuvent susciter les défis auxquels sont confrontées les universités francophones en conséquence même des phénomènes d’anglicisation.
La première section plante le décor avec un état des lieux succinct. La deuxième section replace l’anglicisation des universités dans la perspective plus large de la (macro) dynamique des langues. Dans la section suivante, je tente de caractériser le problème en termes de contradiction entre, d’un côté, le constat bien établi des avantages de la diversité par rapport à l’uniformité et de l’autre, l’adhésion à l’anglicisation (sous prétexte d’internationalisation) qu’on observe si souvent dans les universités des pays non anglophones. La quatrième section propose d’expliquer cette contradiction à partir de la structure de contraintes et d’incitations très spécifiques à laquelle sont confrontées des entités de niveau « méso » comme les universités. La dernière section avance quelques mesures de nature à corriger cette situation. L’article se termine par une brève conclusion.
1. Une source de préoccupation croissante
Il existe sur l’anglicisation de l’enseignement et de la recherche une littérature de plus en plus étoffée. Avant de discuter de ses orientations principales, il convient de préciser la perspective dans laquelle se situe la réflexion développée dans les pages qui suivent. Son cadre de référence n’est pas (ou que subsidiairement) celui de la recherche sur la gouvernance des universités. Bien entendu, le pilotage de l’enseignement supérieur constitue un vaste champ d’investigation, dans lequel on peut s’interroger sur l’internationalisation du monde académique en mettant un accent plus ou moins marqué sur les conséquences spécifiquement linguistiques de cette internationalisation. Dans ce texte, toutefois, j’entends m’inscrire dans une perspective un peu différente. Mon objet premier est la diversité linguistique elle-même, notamment en tant que champ possible d’intervention des sociétés sur elles-mêmes au moyen des politiques linguistiques. Autrement dit, le thème principal de ce texte n’est pas la gouvernance universitaire, mais le multilinguisme sociétal (à distinguer du plurilinguisme individuel) tel qu’il se manifeste dans le contexte d’un type particulier d’environnement, qui se trouve être celui de l’enseignement supérieur.
Cette priorité thématique se reflète non seulement dans les préconisations qui vont suivre, mais aussi dans les références mentionnées : la littérature sur la gouvernance des universités n’y joue qu’un rôle de second plan. Pour l’essentiel, mon propos est positionné principalement par rapport aux discours de la linguistique appliquée et il propose de répondre à certaines des questions que cette linguistique identifie en tirant parti d’une autre approche, celle de la politique linguistique, considérée ici comme champ de spécialité en tant que tel.
Dans la littérature en linguistique appliquée, on rencontre principalement deux types de préoccupations à l’égard de l’anglicisation des universités.
D’un côté, de nombreux auteurs cherchent à décrire et à documenter le phénomène plus ou moins en détail, en s’intéressant par exemple aux modalités pédagogiques de l’enseignement universitaire en anglais à des étudiants dont ce n’est pas la première langue, ou aux pratiques langagières des étudiants dans un environnement académique ainsi anglicisé. Dans ces travaux, l’accent peut être mis sur telle ou telle sphère linguistique (la France, l’Italie, l’Allemagne, les pays scandinaves, etc.), ou tel type de contexte universitaire (les pays anciennement industrialisés, les économies émergentes, etc.). Ces contributions prennent généralement l’anglicisation comme une donnée de départ qu’il n’y a pas forcément lieu de remettre en cause, du moins pas frontalement, et cherchent plutôt à identifier les conditions nécessaires pour que l’utilisation de l’anglais, notamment sur le plan de l’enseignement, n’entrave pas la progression des étudiants dans leur parcours (voir p. ex. Coleman, 2006; Doiz et al., 2013 ; Haberland et al., 2008 ; Hultgren et al., 2014 ; Montgomery, 2013 ; Preisler et al., 2011 ; Wilkinson & Walsh, 2015).
De l’autre côté, on trouve des contributions dont les auteurs voient cette anglicisation avec inquiétude. Dans ces travaux, la notion d’anglicisation renvoie soit à la présence accrue de l’anglais, soit à la marginalisation, par l’anglais, d’autres langues, notamment nationales. Mais elle est en tout cas posée comme un problème, voire comme une menace à laquelle il convient de réagir (Beacco et al., 2022 ; Bonnissent & de Sinety, 2021 ; Fiedler & Brosch, 2019 ; Phillipson, 2006, 2015 ; Widin, 2010). Divers arguments sont apportés à l’appui de cette vision et nombre d’entre eux concernent non seulement l’enseignement (et le travail des étudiants ; voir Conceição & Caruso, 2022), mais aussi la recherche, perçue en tant que processus de production des savoirs. Même si l’anglicisation n’entraîne pas forcément l’éviction complète des langues autres que l’anglais, le simple accroissement de son poids relatif érode leur légitimité et leur prestige dans l’ensemble des arènes scientifiques, ce qui peut finir par entraver non seulement la capacité à exprimer des contenus scientifiques, mais aussi la possibilité même de penser scientifiquement dans ces langues (Berthoud & Gajo, 2020 ; Berthoud et al., 2011 ; Conceição, 2020 ; Dembinski et al., 2022 ; Gajo & Pamula-Behrens, 2013 ; Zanola, 2024).
D’autres lignes d’argumentation mettent l’accent sur une fréquente illusion d’optique : certains clichés peuvent porter à croire que « la science se fait en anglais » (Grin, 2014), alors que dans la pratique de la réflexion sur des objets scientifiques, l’usage linguistique est nettement moins monolithique, que ce soit dans leur appropriation par les apprenants (voir par exemple Christopher (2015), ou les contributions réunies dans la Partie III de Berthoud et al., 2013) ou dans leur émergence. Une partie importante de la communication entre chercheurs, par exemple au sein d’une équipe ou d’un laboratoire, se déroule surtout en langue locale, donc en français dans le cas d’universités francophones (Jaime, 2022 ; Lévy-Leblond, 1996). Dans un mouvement moins descriptif qu’évaluatif, on fait valoir qu’il serait fondamentalement dommageable au travail scientifique (notamment pour la création des savoirs, qui suppose la pleine maîtrise de l’outil linguistique à l’aide duquel on développe sa propre réflexion) qu’il se déploie sur un mode monolingue, dans une langue hégémonique telle que l’anglais[2].
Ces orientations ne sont pas totalement disjointes, vu qu’il y a une certaine porosité entre elles. Elles n’épuisent pas, tant s’en faut, toute la littérature sur l’anglicisation des universités, mais elles dessinent les deux pôles principaux de la littérature sur la question en linguistique appliquée (pour un panorama général, voir Stickel & Robustelli, 2015).
Fondamentalement, cet article s’inscrit davantage dans la seconde que dans la première orientation, en ceci que la diffusion non maîtrisée de l’anglais dans les universités non francophones y est posée d’emblée comme problématique, pour des raisons que nous examinerons plus loin. Toutefois, les arguments que je chercherai à faire valoir dans ce texte diffèrent sensiblement de ceux que l’on rencontre le plus souvent dans cette seconde orientation qui, pour légitime qu’elle soit, tend à faire passer au deuxième plan des enjeux importants qui touchent au fonctionnement quotidien des universités francophones, en particulier la question de leur langue de communication administrative. En même temps, ce texte n’est pas sans rapport avec la première orientation, en ceci qu’il débouche sur un questionnement des pratiques institutionnelles en matière d’enseignement et de gestion des ressources humaines, avec ce que cela comporte de conséquences pour l’enseignement et la recherche.
Je vise donc, dans les pages qui suivent, à formuler et à structurer une réflexion critique sur l’anglicisation de l’université non anglophone (notamment, mais pas exclusivement, l’université francophone), afin de baliser une démarche nécessaire, qui est celle de la formulation de réponses cohérentes et appropriées aux défis que cette anglicisation soulève. Cette réflexion critique s’appuie sur un ensemble d’observations qui dessinent un tableau, à mon sens préoccupant, de la réalité linguistique des universités francophones en cette première moitié de 21e siècle. En revanche, les données nécessaires à un examen quantitatif de ces défis (avec mise en oeuvre d’un appareil statistique) ne sont, à ma connaissance, disponibles nulle part, en dépit de la richesse de la littérature sur la gouvernance des universités dans un contexte d’internationalisation (voir p. ex. Çalıkoğlu et al., 2023). Un des objectifs de ce texte, par conséquent, est de tirer de la réflexion critique un inventaire des données qu’il serait essentiel de récolter en vue de fonder plus solidement les politiques de gouvernance universitaire permettant de contrer l’hégémonie linguistique.
2. L’anglais dans les universités francophones : un effet de la dynamique des langues?
Il n’existe pas de théorie générale de niveau macro sur la dynamique des langues au niveau international, même si la question est fréquemment posée (Maurais et al., 2008 ; Pilhion & Poletti, 2017). En particulier, on ne dispose toujours pas d’un modèle complet ou intégré de l’expansion de langues dites « de grande diffusion », mais à partir d’un inventaire des explications fréquemment avancées, il semble fréquemment admis que cette dynamique est tributaire d’un ensemble de forces fondamentales, dont les suivantes :
-
Les décisions des appareils d’État, surtout à partir de l’émergence de l’État westphalien sujet de droit international, aboutissant à l’officialisation d’une langue X, ou dans certains cas (moins fréquents) de plusieurs langues ; les langues ainsi reconnues deviennent alors parties prenantes aussi bien du renforcement de l’État à l’interne (avec la répression concomitante des langues régionales ou minoritaires) que de son expansion internationale, notamment dans le sillage des aventures coloniales (Hüning et al., 2012 ; Ostler, 2005).
-
Le poids économique et la domination géopolitique de pays utilisant la langue X ; ces caractéristiques peuvent être associées parfois à des politiques délibérées d’aide à la diffusion de la langue X, justifiant une analyse en termes d’impérialisme linguistique (Phillipson, 2009, 2019 ; Durand, 2010 ; Juvin, 2013).
-
Le poids démographique des pays où domine la langue X, que l’on peut aborder dans des perspectives un peu différentes qui mettent en jeu la pertinence communicationnelle : d’un côté une vision systémique où les langues sont disposées en cercles concentriques autour d’une langue dite « hypercentrale », entourée de langues « supercentrales », autour desquelles gravitent des langues « centrales », elles-mêmes environnées de langues de moindre importance, jusqu’aux plus périphériques (en termes de ce système) des langues minoritaires (Calvet, 1999 ; de Swaan, 2001) ; de l’autre, une vision tablant davantage sur le comportement linguistique des acteurs, qui seraient particulièrement guidés par un apprentissage probabiliste : on apprend une langue (par exemple, la langue X) dont il est plus probable qu’elle facilite la communication ; si ce choix est largement partagé, la langue X devient ipso facto celle qui, effectivement, permet la communication la plus large, renforçant du même coup ce phénomène d’apprentissage probabiliste (van Parijs, 2001).
-
À l’intersection des théories précédentes, certains modèles combinent la démographie et les choix des acteurs pour proposer une lecture de la diffusion des langues comme la résultante de calculs stratégiques d’optimisation où peut en outre intervenir le coût relatif d’apprentissage de telle ou telle langue (Pool, 1991 ; Selten & Pool, 1997).
-
Certaines dynamiques de communication qui, sans contrevenir complètement aux processus évoqués dans les paragraphes précédents, autonomisent les langues par rapport aux facteurs géopolitiques ou démographiques (Templin et al., 2022) et qui peuvent se traduire par l’émergence de langues jouant un rôle de lingua franca, souvent régionale, dont un exemple classique est le swahili. C’est souvent dans cette perspective que l’on va chercher dans la notion de mondialisation une explication de la dynamique des langues (Egger & Toubal, 2016 ; Mélitz, 2008).
Développement de l’État, expansion (voire expansionnisme) économique ou géopolitique (que suit parfois une politique d’influence linguistique), démographie, comportements stratégiques des acteurs, mondialisation : telles sont les cinq forces principales qui sont invoquées pour expliquer l’influence, la domination, voire l’hégémonie d’une langue X à un moment donné. Deux remarques s’imposent ici. Premièrement, ces explications ne sont pas mutuellement exclusives et elles sont plutôt à voir comme mutuellement complémentaires même si, on l’a dit, on ne dispose pas encore d’une théorie qui les combine de manière rigoureuse. Deuxièmement, certaines facettes de la dynamique des langues sont mieux connues, notamment les processus de déperdition souvent dits, par calque de l’anglais, d’attrition des langues minoritaires dans un contexte étatique donné ; et à l’heure de la mondialisation (donc d’une intégration accrue au sein d’un contexte mondial qui présente certaines similitudes avec les contextes nationaux traditionnels), certaines caractéristiques des processus qui obèrent les perspectives des langues minoritaires sont éventuellement transposables aux relativement grandes langues nationales (qui sont toutefois, justement, un peu moins grandes qu’une langue « hypercentrale »).
Cependant, ce qui nous intéresse ici, c’est bien la diffusion de l’anglais jusqu’à l’atteinte de sa position hégémonique, et comment cette diffusion se manifeste dans le monde académique francophone. Nous pouvons, à cet égard, poser cinq constats (Grin, 2022) :
-
La présence croissante, au fil du temps, de la langue anglaise dans l’enseignement, la recherche et le fonctionnement administratif.
-
La propagation parallèle de la langue anglaise sur plusieurs axes :
-
des sciences dures et des sciences du vivant vers les sciences sociales et les sciences humaines ;
-
de la recherche à l’enseignement, puis de l’enseignement à la communication interne ;
-
des enseignements spécifiques de pointe aux cours généraux ;
-
des formations de niveau doctoral aux maîtrises (« mastères ») puis des maîtrises aux licences ou baccalauréats.
-
-
Bien que ces phénomènes soient gratifiés d’une justification au nom de « l’internationalisation », ce qui suppose l’existence d’un multilatéralisme défini par la présence de différentes « nations », cette justification se dissout complètement dans la réalité, unilatérale, d’uniformisation au profit d’une langue hégémonique.
-
Corrélativement, les autres langues sont plus ou moins marginalisées ou ringardisées, voire évincées de certains programmes d’enseignement, de certaines activités de recherche et parfois de certains processus de communication interne.
-
Les quatre constats précédents donnent naissance à des effets en cascade dont la portée dépasse de loin le contexte académique :
-
des effets manifestes, dont (i) la réduction de la diversité des langues dans l’activité scientifique (conférences, revues spécialisées, etc.) et (ii) des inégalités entre les acteurs (chercheurs, enseignants, étudiants), non en fonction de la qualité scientifique ou pédagogique de leur travail ou de leur assiduité à l’étude, mais en fonction de leur aisance en anglais ;
-
des effets plausibles, dont (i) l’érosion de la multipolarité du monde, (ii) des atteintes à la qualité des enseignements et des apprentissages (tant il est vrai que contrairement à un cliché fort répandu, tout le monde ne maîtrise pas l’anglais à un niveau permettant de fonctionner à peu près aussi bien que dans sa L1), et (iii) des conséquences encore incertaines sur la création, le partage et la diffusion des connaissances.
-
Aux yeux de certains, tout cela ne pose guère de problème : l’uniformisation linguistique (en l’occurrence, en anglais) ne serait dommageable ni en termes d’efficience, ni en termes d’équité – c’est-à-dire en référence aux dimensions structurantes de toute évaluation comparative. Pour d’autres, au contraire, la situation est problématique, tant sur le plan de l’efficience que sur celui de l’équité ; une telle vision, toutefois, va à l’encontre du consensus, certes adossé à des arguments superficiels mais qui reste néanmoins dominant, qui prévaut dans le monde académique, y compris en francophonie.
Tentons à présent de cerner de plus près les raisons de l’accroissement de la présence de l’anglais, notamment quand cette présence marginalise d’autres langues. Mais avant d’aborder cette question, rappelons la précaution d’usage : ce qui est en cause ici n’est pas la langue anglaise elle-même, mais l’hégémonie linguistique, quelle que soit la langue au profit de laquelle elle s’exerce.
3. Aux racines du problème : une première approximation
Le but premier de ce texte n’est pas de dresser un bilan des aspects positifs et négatifs des processus d’uniformisation linguistique (en l’occurrence : d’anglicisation) qui marquent la plupart des universités de la sphère francophone, mais de porter plutôt l’attention sur une autre question, qui nous emmènera du côté des attitudes et des motivations. Plus précisément, nous chercherons à éclairer les raisons pour lesquelles une dérive dont maints indices révèlent les effets délétères se poursuit, voire bénéficie de l’adhésion enthousiaste de nombreux intervenants dans le monde académique.
Le recours à l’anglais semble souvent être vécu, notamment par les autorités universitaires, comme allant de soi, d’être une évidence et, à ce titre, de se dispenser de toute justification ; du même coup, tout contre-discours est ipso facto invalidé. C’est un exemple de ce que Barthes appelait le langage encratique, un langage associé au pouvoir qui se présente « comme allant de soi alors que justement il ne va pas de soi mais qu’il procède de l’autre et que par ce tour de passe-passe il vous réduit au silence et vous culpabilise en vous ridiculisant » (Gobard, 1976, p. 121). Dans certaines des manifestations les moins subtiles de cette posture, les avocats de l’anglicisation des universités francophones invoqueront, non sans une désarmante naïveté, le « pragmatisme », pour l’opposer à la position nécessairement « idéologique » de ceux qui s’y opposent. Or ces étiquettes peuvent aisément être inversées. Un exemple éloquent de cette attitude nous est donné par un document de travail interne de la League of European Research Universities, un club de 23 universités réparties dans plusieurs pays européens, mais dont seules cinq (Cambridge, Édimbourg, Imperial College [Londres], Oxford et Trinity College [Dublin]) sont situées dans des pays de langue anglaise. Un document à vocation interne intitulé Language Policies at the LERU member institutions (LERU, 2019) commence avec raison par souligner que les étudiants, les enseignants et les chercheurs ont certes tout intérêt à être plurilingues eux-mêmes. Mais il ajoute qu’il est nécessaire de préparer les collaborateurs non académiques, jusqu’au personnel d’entretien, à communiquer en anglais avec les chercheurs internationaux, notamment dans le cadre d’échanges entre les universités de la LERU! Faire porter le poids de l’adaptation linguistique sur les nettoyeurs (qui, fréquemment issus de l’immigration, ont parfois déjà dû apprendre la langue du pays d’accueil, français ou autre) est révélateur d’une certaine confusion dans la vision du monde au sein de ces augustes institutions.
La légèreté avec laquelle nombre d’universités cèdent à l’anglicisation, en général sous couvert d’une « internationalisation » mal comprise (Grin, 2021 ; Laforest, 2014), mérite explication, car elle fait fi de plusieurs constats qui donnent à penser que si le recours soigneusement cadré et délimité à une langue de grande diffusion comme l’anglais, ou autre que telle ou telle langue nationale (notamment le français) présente d’indéniables avantages, une anglicisation sauvage et incontrôlée qui se traduit par une éviction du français est en revanche dommageable.
Les pertes qu’entraîne l’uniformité linguistique peuvent être lues en négatif des avantages du plurilinguisme individuel et du multilinguisme sociétal. Les résultats de la littérature de plus en plus vaste sur ce sujet sont convergents (Coleman, 2011 ; McEntee-Atalianis & Tonkin, 2023 ; voir aussi diverses contributions dans Gazzola & Wickström, 2016). S’il est impossible de se lancer ici dans un panorama de la littérature qui met en évidence les avantages de la diversité, quelques résultats ciblés peuvent être rappelés :
-
Depuis les premiers travaux issus des traditions canadienne et états-unienne (Vaillancourt, 1996 ; Bloom & Grenier, 1996), les bénéfices du plurilinguisme individuel sont largement documentés et se traduisent par des avantages non seulement symboliques, mais salariaux ; qui plus est, ces avantages salariaux augmentent avec le niveau de compétence (voir p. ex. Grin et al., 2010) et avec la fréquence des pratiques multilingues. Une telle relation indique que le plurilinguisme est, y compris dans une perspective multivariée, associé à la création de valeur au sens économique, en l’occurrence de valeur marchande, sans préjudice des valeurs non marchandes qu’il fait aussi apparaître (Grin & Masiero, 2024). Dès lors, une érosion, voire la perte de capacité à fonctionner dans une langue autre que l’anglais (y compris dans sa langue maternelle) dans les registres de langue liés aux savoirs acquis dans les études universitaires ne revient pas seulement à une baisse de capital linguistique, mais fait aussi courir le risque d’une perte en termes de création de valeur économique[3].
-
L’analyse quantitative des liens entre diversité linguistique et créativité révèle aussi l’existence d’une relation positive entre celles-ci (à nouveau, y compris en analyse multivariée), et même en « contrôlant » l’effet des compétences multiculturelles afin de bien mettre l’accent sur le plurilinguisme des acteurs (Fürst & Grin, 2018, 2021). En d’autres termes, la diversité des langues favorise la créativité, qui à son tour favorise l’innovation et, à terme, la prospérité. Le monolinguisme universitaire peut donc, a contrario, brider la créativité.
-
La très vaste littérature en politique linguistique, qui se situe à l’intersection de plusieurs spécialités des sciences sociales humaines, dont bien sûr la linguistique appliquée, mais aussi la théorie politique, l’analyse des politiques publiques, l’économie des langues et le droit (voir p. ex. Cardinal & Sonntag, 2015 ; Gazzola & Wickström, 2016 ; Kraus & Grin, 2018 ; Lane-Mercier et al., 2018 ; Ricento, 2015) établit deux points importants :
-
premièrement, que les acteurs assignent au respect de leur langue une valeur, symbolique certes, mais non moins pertinente sur le plan de l’efficience (Gazzola et al., 2018) ;
-
deuxièmement, que la reconnaissance des diverses langues est aussi une condition de justice linguistique et qu’elle constitue de ce fait un critère majeur d’équité (Bonotti & Mc Giolla Chríost, 2019 ; Oakes & Peled, 2018 ; Skutnabb-Kangas & Phillipson, 2023).
-
Notons ici une chose : les travaux qu’on vient de mentionner convergent en ceci qu’ils montrent que le plurilinguisme individuel, le multilinguisme sociétal et plus généralement la diversité des langues (bien entendu, dûment gérée à l’aide de politiques linguistiques structurées en tant que politiques publiques ; voir Gazzola et al., 2024) sont à l’avantage des acteurs individuels et des sociétés. Il ne s’agit pas de nier que le recours à une langue de grande communication comme l’anglais présente divers avantages, tant que c’est en plus de la ou des langues nationales du pays considéré. En revanche, on chercherait en vain des résultats démontrant que le recours exclusif à une langue hégémonique et l’éviction concomitante des autres langues, notamment des langues nationales qui se voient peu à peu écartées des activités de recherche scientifique et d’enseignement, constituent, à titre net, un gain pour les individus et les sociétés des pays non anglophones.
On ne peut donc pas éluder la question que voici : comme l’éviction des langues nationales par l’anglais se fait au détriment des individus et des sociétés concernés, pourquoi les pays non anglophones accordent-ils une telle place à l’anglais dans leurs systèmes universitaires?
Une interprétation possible est celle d’une forme d’aliénation, proposée par Gobard (1976), Durand (2010), Phillipson (2019), voire Debray (2017). Malgré eux ou de leur plein gré, les divers intervenants de la vie universitaire (autorités académiques, professeurs, chercheurs, étudiants, personnel administratif) céderaient à la pression exercée par les sociétés anglophones ou leurs autorités politiques, elles-mêmes décidées à tirer le meilleur parti du soft power que confère la diffusion de « leur » langue. Nombre des arguments invoqués à l’appui de cette interprétation sont indubitablement convaincants. Cependant, celle-ci attribue à l’impérialisme un pouvoir d’aliénation qui fait un peu trop bon marché de la marge de manoeuvre des différents acteurs.
Une seconde interprétation est celle de la naïveté et du snobisme. Elle apparaît aussi dans l’analyse de Gobard, qu’on vient de mentionner. Cette interprétation repose sur la mise en évidence des clichés et autres idées reçues qui entourent souvent l’enthousiasme avec lequel des organisations du secteur public ou privé, dans des pays non anglophones, recourent à l’anglais (Usunier, 2010 ; Grin, 2014). Parmi ces clichés, citons l’idée qu’une formation universitaire internationale se déroule nécessairement dans une langue (elle-même internationale), que de toute façon, partout, la science se fait en anglais, ou qu’il faut enseigner en anglais pour attirer les meilleurs étudiants. Je ne m’attarderai pas sur ces clichés, qui ont déjà été critiqués ailleurs (Grin, 2021, 2022), sinon pour souligner qu’ils reposent largement sur une confusion entre « internationalisation » et « anglicisation ».
Un troisième ensemble d’interprétations repose sur la mise en évidence de forces structurelles. Parmi celles-ci, on pourrait d’abord transposer telle quelle au monde académique l’analyse déjà évoquée de l’apprentissage probabiliste (van Parijs, 2001, 2011), en y ajoutant le principe d’exclusion minimale avancé par le même auteur : dans une situation d’interaction à laquelle doivent prendre part des personnes aux attributs linguistiques variés, les participants graviteront « naturellement » vers la langue dans laquelle le niveau de compétence du moins équipé des participants est le moins bas. Or, dans n’importe quelle situation, toute personne non anglophone possédera au moins quelques rudiments d’anglais ; et on ne peut pas s’attendre à constater la même chose pour d’autres langues comme l’arabe, le chinois, l’espagnol ou le français, sans même parler d’autres langues moins répandues que celles-ci. Même si ce mécanisme, exposé par van Parijs avec une remarquable économie de moyens[4], est convaincant à maints égards (Grin, 2004), il reste que cette interprétation a été abondamment critiquée, car elle fait l’impasse sur la culture (Ives, 2006) et sur des différences de pouvoir entre locuteurs (Phillipson, 2012) : l’anglais peut se retrouver en position privilégiée si c’est la langue de ceux des participants qui disposent de plus de pouvoir tandis que d’autres langues, dont l’usage exclurait moins de participants, sont écartées. Il reste que l’intérêt d’une explication à caractère structurel est double : elle évite de faire dépendre toute l’analyse (comme le fait l’explication « impérialiste ») de l’appétit de pouvoir de certaines entités dominantes en termes géopolitiques ou économiques ; et elle va plus en profondeur que l’analyse par les clichés, qui porte davantage sur les canaux par lesquels le problème se manifeste que sur les origines du problème. Il est donc utile de revenir sur les questions de structure, mais en les abordant à présent sous un angle légèrement différent ; c’est ce que nous tenterons de faire dans la section suivante.
4. Retour sur les motivations : le rôle du niveau « méso »
Repartons donc de la question posée plus haut : l’éviction des langues nationales par l’anglais comportant plus d’inconvénients que d’avantages, pourquoi l’usage de l’anglais est-il accepté de manière aussi acritique, voire encouragé par les systèmes universitaires des pays non anglophones?
Commençons par rappeler que ce bilan des avantages et des inconvénients se dégage au niveau micro des individus ou des citoyens. Dans la mesure où les citoyens vivant dans des sociétés démocratiques se dotent, avec l’État, d’un mode d’organisation politique agissant sur mandat des citoyens (raison pour laquelle, par exemple, on utilise constamment, dans la tradition politique, le terme de souverain pour désigner le peuple), les acteurs de niveau micro peuvent, dans le cadre du fonctionnement normal des institutions, signifier leur volonté à l’appareil d’État, donc aux acteurs de niveau macro. L’action des niveaux micro et macro doit alors refléter le même intérêt à l’entretien de la diversité linguistique et converger vers des politiques linguistiques dans l’enseignement supérieur qui, sans exclure le recours à l’anglais, préservent le rôle des langues nationales.
Or c’est un troisième niveau, le niveau « méso », qui soulève de véritables difficultés. Le niveau méso est celui des organisations, telles que les entreprises du secteur privé (donc non soumises, ou que très partiellement, aux dispositions réglementaires édictées par l’État) et des entreprises qui peuvent être publiques ou parapubliques, comme le sont fréquemment les universités (notamment en Europe continentale), mais qui en même temps disposent – et c’est, en soi, fort heureux – d’une large autonomie qui les soustrait à d’éventuelles dispositions réglementaires.
Les universités réagissent à des incitations et à des contraintes qui, sur le plan linguistique, peuvent s’avérer délétères. Elles sont de plus en plus soumises à diverses formes de concurrence interinstitutionnelle uniformisatrices. D’une part, pour attirer des étudiants, on va les recruter (aussi) sur le plan international ; dès lors, offrir des programmes en anglais semble être un quick fix un peu facile, qui joue sur le double mécanisme de « l’apprentissage probabiliste » et du « minimum d’exclusion », tout en renforçant cette dynamique linguistique centripète ; et tant qu’à faire, le glissement vers des programmes en anglais seulement constitue une tentation presque irrésistible. D’autre part, pour obtenir des fonds de recherche, on s’adresse à des organismes de financement qui, soucieux de présenter un visage d’ouverture, vont cultiver l’internationalité dans la liste d’experts invités à évaluer les propositions de recherche. Arguant de la difficulté à s’attacher la collaboration de ces experts, les instances de financement vont exiger des soumissions rédigées en anglais, dans l’idée qu’elles seront comprises par un éventail plus large d’experts internationaux.
Prima facie, ces arguments sont convaincants, mais ils relèvent d’une vision intellectuellement tronquée de l’internationalisation et induisent une dynamique qui évince progressivement les langues autres que l’anglais. En outre viennent se greffer là-dessus les phénomènes causalement secondaires, mais sans doute pas totalement absents, de naïveté et de snobisme, qui contribuent à la propagation de l’anglicisation vers une troisième dimension du fonctionnement des universités : la communication administrative interne, à laquelle la recherche sur les politiques linguistiques dans l’enseignement supérieur, tout occupée qu’elle est à rendre compte de ce qui se passe dans l’enseignement et la recherche, n’a jusqu’ici pas accordé suffisamment d’attention.
Comme le niveau méso des universités est complexe, il n’est pas inutile de passer par une typologie des pratiques linguistiques dans l’enseignement supérieur, car les combinaisons de contraintes et d’objectifs des différents acteurs ne sont pas forcément les mêmes dans ces différentes pratiques. Par conséquent, l’intervention politique, sous forme de politique linguistique, que l’on peut souhaiter mettre en place pour rectifier la situation ne sera pas nécessairement la même dans tous les cas.
Les pratiques linguistiques des universités peuvent être caractérisées en combinant trois dimensions (Grin, 2015). La première dimension est celle des types d’activités, qui sont fondamentalement au nombre de cinq[5] :
-
Les langues enseignées à titre de matière ;
-
La ou les langues utilisées comme langue d’enseignement pour des matières non linguistiques ;
-
Les langues utilisées par le personnel scientifique pour les différentes activités de recherche, où l’on peut notamment distinguer la recherche proprement dite et la diffusion de la recherche dans les publications et les colloques ;
-
La ou les langues de la communication administrative interne, y compris pour la fourniture de services divers (cafétérias, activités sportives et culturelles, etc.) destinés aux membres de la communauté universitaire) ;
-
La ou les langues de la communication externe (recrutement, relations publiques, opérations de visibilité).
La deuxième dimension renvoie aux aspects linguistiques de ces cinq types d’activités ; ces aspects linguistiques peuvent être abordés en tant que conséquences ou causes, c’est-à-dire en tant que réponses aux données de l’environnement politique, social, économique, culturel ou en tant que facteurs qui contribuent à leur tour à donner forme à cet environnement, notamment en termes linguistiques.
La troisième dimension concerne quant à elle les politiques linguistiques qui peuvent être définies dans le cadre d’une gouvernance linguistique de l’enseignement supérieur. Il est utile de mettre en évidence cette dimension qui est celle de la nature fonctionnelle de l’acte langagier de l’institution. On peut discerner trois axes principaux :
-
Les orientations de politique linguistique générale ;
-
Les questions organisationnelles ;
-
Les pratiques pédagogiques.
La combinaison de ces trois dimensions fournit les bases d’une typologie des actes langagiers institutionnels (Grin, 2015, pp. 108-109) qu’on ne présentera pas ici, mais qui permet de caractériser de manière un peu plus approfondie ces actes langagiers et, partant, d’évaluer plus précisément deux choses : premièrement, quels sont exactement les actes langagiers qu’une politique des langues au sein de l’université devrait viser ; deuxièmement, quelles sont les motivations qui animent les décideurs du monde académique – ce qui aide par-là même à voir comment combiner au mieux les deux instruments principaux de toute politique publique, politique linguistique comprise : l’incitation et la régulation.[6]
Pour approfondir notre compréhension des contraintes et incitations auxquelles sont confrontés les décideurs dans le monde académique, il ne serait pas inutile d’entreprendre une vaste enquête quantitative ciblée sur cette question (et surtout évitant les items convenus qui permettent aux répondants d’éviter les thèmes dérangeants) auprès d’un échantillon représentatif et d’un effectif suffisant. À ma connaissance, une telle enquête n’a jamais été réalisée à ce jour.
5. Quelques mesures envisageables
Revenons maintenant au cas des universités francophones et examinons quelques mesures qui pourraient être prises par les autorités politiques, là où elles ont juridiquement le droit d’édicter des dispositions concernant le fonctionnement des universités et/ou là où elles contribuent de façon assez importante au financement des universités pour que les conditions qu’elles imposent à l’octroi des fonds soient susceptibles d’infléchir leur comportement linguistique. Les dispositions à cet effet peuvent prendre différentes formes, et je mettrai ici l’accent sur celles qui passent par l’incitation.
Il y a à cela deux raisons : d’abord, la régulation (notamment par le recours à l’interdiction) a souvent un caractère quasi tautologique ; ensuite, il convient de préserver l’autonomie des universités ; si celles-ci veulent obstinément s’enferrer dans l’hégémonie linguistique, libre à elles de le faire, tout en en supportant les conséquences.
Cette question justifie une brève remarque en lien avec le thème (qui n’est que connexe, rappelons-le, du point de vue de ce texte) des mécanismes de gouvernance universitaire (Austin & Jones, 2015). Comme cette gouvernance présente fréquemment un caractère collégial, il serait assurément intéressant d’approfondir la question des nuances et adaptations que ce caractère collégial peut impliquer pour les préconisations qui suivent. Toutefois, ces éventuelles nuances ne sont pas d’importance primordiale pour la thématique centrale de ce texte, qui est la gouvernance de la diversité linguistique (plutôt que celle des universités) ; qui plus est, il est peu probable qu’elles changent grand-chose aux suggestions qui suivent, précisément parce que ces dernières reposent sur les incitations. Le caractère collégial de la gouvernance universitaire peut influer sur les modalités de mise en oeuvre, mais les mesures-cadres dans lesquelles se déploient les activités de différentes entités, dont les universités, restent définies par les pouvoirs publics.
Sur le plan de l’enseignement, se prémunir contre l’anglicisation n’implique pas nécessairement de bannir l’anglais en tant que langue d’enseignement. En revanche, il faut exclure tout cursus (et tout diplôme correspondant) qui exclurait le français. Il ne devrait exister aucun diplôme dont l’obtention est possible en ne suivant des cours qu’en anglais. Les mesures envisageables sont notamment :
-
La non-reconnaissance officielle des diplômes qu’il est possible d’obtenir en ne suivant des enseignements qu’en anglais ;
-
Le refus d’accréditation de l’université tout entière aussi longtemps qu’elle proposera une ou plusieurs filières exclusivement en anglais ;
-
L’exclusion des financements normaux par étudiant (au prorata des étudiants inscrits à ces cours) pour toute filière offerte entièrement ou principalement en anglais, au-delà d’un taux plafond ;
-
La fixation d’un taux plafond d’enseignements en anglais pour chaque filière bénéficiant de financement des autorités politiques. Ce taux peut être modulé en fonction (i) du champ considéré (par exemple, les sciences du vivant, les sciences de l’ingénieur, les sciences sociales, les sciences humaines, etc.) ; (ii) le niveau de la formation (BA, MA, études doctorales) ; (iii) l’année de programme au sein d’une formation.
Cette quatrième disposition peut prendre la forme de la « courbe en U » (Grin, 2021, p. 113 ; 2022, p. 129) qui prévoit un taux plafond relativement élevé en première année de BA, un taux très bas en fin de BA et en début de MA (qu’un peut visualiser comme le creux d’une lettre « U »), puis une remontée de ce taux en fin de MA puis pour les études doctorales. Le taux plafond n’est jamais égal à 0 (en d’autres termes, l’anglais n’est jamais totalement exclu), mais il ne dépasse jamais une cote à fixer clairement et sans exception ni passe-droits, par exemple 50 % en BA et en MA selon les années, et 80 % à 90 % dans les études doctorales (en d’autres termes, le français ne peut en aucun cas être exclu d’un cursus diplômant)[7].
Cette approche en U favorise le recrutement d’étudiants étrangers en facilitant leur arrivée tout en encourageant leurs efforts pour l’acquisition du français. Profitons pour démonter au passage un cliché très répandu, qui veut que pour attirer les meilleurs étudiants étrangers, une université soit obligée de proposer des filières entières en anglais. C’est oublier que parmi les « meilleurs » étudiants, ceux qui souhaitent une formation en anglais se seront déjà inscrits dans les universités anglophones les plus réputées, celles qui coiffent les classements internationaux comme ceux de Shanghai, du Times Higher Education, de Leiden ou le QS[8]. Dès lors, ceux qui condescendent à faire leurs études dans une université francophone ne sont peut-être justement pas « les meilleurs », à moins, justement, qu’ils ne démontrent leur ouverture en faisant l’effort d’apprendre le français en lien avec leurs études universitaires dans un pays francophone[9].
Sur le plan du recrutement, une des dérives les plus banales de certaines universités francophones (ou germanophones, néerlandophones, etc.) passe par l’embauche de professeurs qui, n’ayant pas la langue locale (français, allemand, néerlandais, etc.) dans leur répertoire lors de leur engagement dans une université francophone, n’estiment pas nécessaire de l’apprendre et trouvent normal de n’enseigner qu’en anglais (y compris si l’anglais n’est pas leur langue maternelle et qu’ils le parlent somme toute assez mal). Cette attitude contribue grandement, sur le plan symbolique, au déclassement de la langue locale, tout en fournissant une excuse (si piètre qu’elle soit) pour n’enseigner qu’en anglais. Là aussi, diverses mesures incitatives peuvent être envisagées, notamment :
-
Toute embauche de personnel académique non francophone devrait être assortie d’un engagement à être capable de fonctionner en français dans un délai de deux ans à dater du début du contrat de facto. Cette capacité est souvent exigée[10], mais il arrive que cette disposition reste lettre morte. Elle devrait donc être attestée par une autorité relevant de l’autorité politique, mais en tout cas indépendante de l’université et notamment de la faculté de rattachement. Si elle ne l’est pas, le financement du poste concerné devrait être déduit, sans compensation par ailleurs, de l’enveloppe budgétaire fournie par les autorités politiques à l’université concernée.
-
Le renouvellement d’un contrat d’enseignant ou de chercheur devrait, entre autres conditions, être subordonné à la clause ci-dessus.
-
Une offre personnalisée de cours de français devrait être proposée aux personnes concernées.
Sur le plan de la recherche, les interventions ne peuvent être que très retenues, car les pratiques linguistiques dans le cadre des activités de recherche au quotidien sont très contextuelles (voir notamment la typologie de Lévy-Leblond, 1996, qui distingue par exemple, dans la recherche, l’oral et l’écrit d’une part, l’informel, l’institutionnel et le public d’autre part). De fait, un colloque scientifique de niveau régional et la coordination d’équipes de recherche dans un projet international présentent des nécessités linguistiques complètement différentes. Toutefois, diverses mesures incitatives peuvent là aussi être envisagées, telles que les suivantes :
-
Lors du recrutement de collaborateurs scientifiques, notamment de rang professoral, le dossier de publications est un critère important ; seuls devraient alors entrer en ligne de compte les dossiers comportant des publications dans au moins deux langues, la moins représentée des langues constituant au moins un minimum raisonnable de x % des publications pondérées par leur importance. (Les indicateurs étant presque toujours éminemment manipulables, une attention particulière doit être accordée au respect de l’esprit de cette disposition.) Les embauches ne satisfaisant pas à cette condition, tout en restant possibles, seraient exclues du financement accordé à l’université par les autorités politiques.
-
Le renouvellement des contrats devrait être soumis à une exigence similaire, de façon à veiller à ce que la pratique multilingue ne soit pas négligée aussitôt une première titularisation (tenure) obtenue ; ceci revient à exiger qu’une certaine proportion de la production scientifique soit publiée en français – quelle que soit la langue (ou les langues) dans laquelle le travail intellectuel en amont aura été réalisé.
-
Les instances de financement de la recherche, souvent nationales, ne devraient pas être autorisées à exclure la ou les langues nationales ou officielles autres que l’anglais des appels à projets de toute nature qu’elles diffusent – ou, si elles persistent à le faire, l’enveloppe budgétaire totale serait réduite d’un montant équivalent au budget alloué aux programmes de recherche pour lesquels une soumission en anglais serait exigée.
-
Cette même disposition devrait s’appliquer aux rapports scientifiques et administratifs remis par les équipes de recherche ainsi financées.
-
Elle devrait également concerner toutes les communications (évaluations de propositions et de rapports de recherche, etc.) émanant de l’instance de financement et destinées aux équipes de recherche ou plus largement à la communauté scientifique.
-
Des exceptions aux trois dispositions précédentes peuvent être prévues, pour autant que l’instance de financement de la recherche prenne intégralement en charge, et sans conséquence négative pour les équipes de recherche concernées, la traduction de et vers l’anglais des documents concernés.
Sur le plan de la communication administrative interne, l’usage du français (ce qui n’exclut pas l’utilisation en parallèle de l’anglais) devrait aller de soi. Cependant, ce qui va sans dire va généralement mieux en le disant et, à cet égard, la solution naturelle est celle de la régulation plutôt que celle de l’incitation. Cependant, rien n’exclut de passer par l’incitation, d’autant plus que la régulation n’a de portée que si elle est véritablement appliquée, avec un mécanisme de sanction en cas d’infraction. L’incitation et la sanction en cas de violation d’une réglementation sont en fin de compte des mécanismes très voisins, et on peut notamment envisager :
-
Le conditionnement du soutien financier à telle ou telle action (par exemple les événements culturels ou festifs destinés à la communauté universitaire) à l’usage du français (sans préjudice d’autres langues) dans toute la communication qui s’y rapporte.
-
Un système d’amendes pour tout cas de communication administrative interne (affiches, pages internet, circulaires, diplômes, etc.) qui ne serait fournie qu’en anglais et/ou ne serait pas disponible en français de manière également visible et rapide. Pour autant que les faits soient dûment établis, de telles amendes pourraient être prononcées sur dénonciation par tout membre de la communauté universitaire ou par une personne externe afin de prévenir les éventuelles mesures d’intimidation. L’annulation de l’amende doit rester possible si la violation est pleinement rectifiée dans un délai de quelques jours. En revanche, au-delà d’une certaine période, la non-mise en conformité avec la disposition réglementaire serait assortie d’une astreinte quotidienne venant en déduction de l’enveloppe budgétaire octroyée à l’université par l’autorité politique.
Conclusion
Comme le montrent les quinze mesures que l’on vient d’évoquer, il est parfaitement possible aux autorités universitaires francophones de garantir la présence du français sans pour autant s’enfermer dans l’unilinguisme et sans exclure l’anglais. En effet, en dehors des systèmes universitaires opérant en tant qu’institutions purement privées, les incitations auxquelles répond le monde académique sont, en dernière analyse, mises en place par les États. Et même dans un monde académique relevant exclusivement de l’économie privée, celle-ci reste tributaire d’un cadre régulateur défini par les États. Ceux-ci peuvent donc intervenir au moyen de l’incitation ou de la régulation, avec bien entendu davantage de leviers lorsqu’ils fournissent une part importante du financement de l’enseignement et de la recherche.
Bien entendu, la politique linguistique applicable au monde académique s’inscrit dans un contexte international, et les États sont eux-mêmes confrontés aux pressions que cette internationalité engendre. C’est pour cela qu’il est indispensable que les États francophones s’engagent fortement pour la conclusion (notamment sous l’égide de l’UNESCO) d’une future Convention internationale pour la protection et la promotion de la diversité linguistique. À cet égard, il est heureux que des pays membres de la francophonie, y compris des États officiellement plurilingues comme le Canada et la Suisse, aient activement soutenu l’adoption en 2005, par l’UNESCO, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Il est à souligner que les décideurs académiques ne sont pas nécessairement de mauvaise volonté : mis à part que nombre d’entre eux sont convaincus de l’intérêt qu’il y a à éviter l’unilinguisme dans une langue hégémonique, certains souhaiteraient que les États établissent un cadre contraignant ou fortement incitatif s’appliquant à tous, de sorte que les universités puissent prendre sans dommage, même dans un contexte de concurrence internationale, des mesures de lutte contre l’uniformisation, donc conformes à l’intérêt général.
En dernière analyse, c’est donc aux citoyens qu’il revient de garder l’oeil sur les pratiques linguistiques des universités, surtout par l’intermédiaire de leurs autorités politiques ; la lutte pour une internationalisation sans uniformisation est bien une question d’exercice de la démocratie.
Parties annexes
Notes
-
[1]
L’auteur remercie Marco Civic et Linda Cardinal pour leurs commentaires et encouragements, ainsi que deux évaluateurs anonymes pour leurs suggestions qui m’ont permis de mieux préciser les objectifs et limites de ce texte.
-
[1]
Traduction libre. Dans l’original : “Europe is fast becoming a top region for finding study programs in English, even in countries where English is not the local language […] English-taught courses were few and far between as recently as 2009, particularly at bachelor’s level, but there as since been a fifty-fold increase in the number of English-taught bachelor’s degrees available” (Collier, 2022).
-
[2]
Voir le compte-rendu de la table ronde « Penser/écrire entre les langues » réunissant Étienne Klein, Claudine Tiercelin, Pierre Judet de La Combe et Jean-Marie Klinkenberg (2021).
-
[3]
On peut même associer l’unilinguisme anglais dans l’enseignement de la finance à l’émergence d’un monolinguisme professionnel qui contribue à orienter les choix des décideurs vers des stratégies qui aggravent les crises financières ; voir Dembinski et al. (2022).
-
[4]
Terme préférable à l’anglicisme parcimonie.
-
[5]
Je laisse délibérément hors du champ la question de la communication entre individus, qu’il s’agisse d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs, car la communication privée ne relève pas de la gouvernance universitaire.
-
[6]
Il est courant, en analyse des politiques publiques, d’ajouter un troisième instrument, à savoir l’exhortation morale. L’expérience donne à penser que même pour des universités, qui sont supposées mues par des considérations telles que des valeurs, l’effet de telles exhortations reste marginal.
-
[7]
Bien entendu, il est essentiel de veiller à ce que les cours offerts en français ne soient pas cantonnés à des cours à option, qui joueraient alors un rôle d’alibi ou de window-dressing.
-
[8]
Pour ces quatre classements, en 2023 les cinq premières universités sont anglophones (voir https://www.universityrankings.ch/fr).
-
[9]
La mise en oeuvre de la courbe en U peut être flexibilisée de diverses façons, notamment en introduisant une distinction entre la production et la réception : dans le cadre d’un enseignement en français, la remise par les étudiants (notamment allophones) de travaux en anglais peut par exemple être autorisée, et réciproquement.
-
[10]
Ainsi, il est fréquent que les annonces de postes académiques aux Pays-Bas stipulent que les candidats ne parlant pas le néerlandais doivent l’apprendre dans les deux ans suivant l’engagement.
Bibliographie
- Austin, I., & Jones, G. A. (2015). Governance of higher education. Global perspectives, theories, and practices. Routledge.
- Beacco, J.-Cl., Bertrand, O., Herreras, J. C., & Tremblay, C. (Éds). (2022). La gouvernance linguistique des universités et établissements d’enseignement supérieur. Éditions de l’Institut Polytechnique de Paris.
- Berthoud, A.-C., & Gajo, L. (2020). The multilingual challenge for the construction and transmission of scientific knowledge. John Benjamins.
- Berthoud, A.-C., Gradoux, X., & Steffen, G. (Éds). (2011). Plurilinguismes et construction des savoirs (Cahiers de l’ILSL, no 30). Centre de linguistique et des sciences du langage, Université de Lausanne.
- Berthoud, A.-C., Grin, F., & Lüdi, G. (Éds). (2013). Exploring the dynamics of multilingualism. John Benjamins.
- Bloom, D. E., & Grenier, G. (1996). Language, employment, and earnings in the United States: Spanish-English differentials from 1970 to 1990. International Journal of the Sociology of Language, 121(1), 45-68. 10.1515/ijsl.1996.121.45
- Bonnissent, J.-C., & de Sinety, P. (Éds). (2021). Pour des sciences en français et dans d’autres langues [Actes de colloque international]. Honoré Champion.
- Bonotti, M., & Mac Giolla Chríost, D. (Éds). (2019). Sociolinguistica, 33(1-2) (Linguistic justice in an interdisciplinary context). De Gruyter.
- Çalıkoğlu, A., Jones, G. A., & Kim, Y. (Éds). (2023). Internationalization and the academic profession. Comparative perspectives. Springer.
- Calvet, L.-J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Plon.
- Cardinal, L., & Sonntag, S. K. (Éds). (2015). State traditions and language regimes. McGill-Queen’s University Press.
- Christopher, S. (2015). I flussi comunicativi in un contesto istituzionale universitario plurilingue [Le flux de communication dans un contexte institutionnel universitaire multilingue]. Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana.
- Coleman, H. (Éd.). (2011). Dreams and realities: Developing countries and the English language. British Council.
- Coleman, J. (2006). English-medium teaching in European higher education. Language Teaching, 39(1), 1-14. https://doi.org/10.1017/S026144480600320X
- Collier, S. (2022). Where can you study abroad in English? QS Top Universities. https://www.topuniversities.com/student-info/studying-abroad/where-can-you-study-abroad-english
- Conceição, M. C. (2020). Language policies and internationalization of higher education. European Journal of Higher Education, 10(3), 231-240.
- Conceição, M. C., & Caruso, E. (2022). Higher education language policies for mobility and inclusion. Dans F. Grin, L. Marácz, & N. Pokorn (Éds), Advances in interdisciplinary language policy (pp. 215-234). John Benjamins.
- Debray, R. (2017). Civilisation. Comment nous sommes devenus américains. Gallimard.
- Dembinski, P., Rudaz, P., Soissons, H., & Chesney, M. (2022). Does global English influence the perception of professional ethical dilemmas? Dans F. Grin, L. Marácz, & N. Pokorn (Éds), Advances in interdisciplinary language policy (pp. 531-553). John Benjamins.
- de Swaan, A. (2001). Words of the world: The global language system. Polity Press.
- Doiz, A., Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (Éds). (2013). English-medium instruction at universities. Global challenges. Multilingual Matters.
- Durand, C. X. (2010). Une colonie ordinaire du XXIe siècle. Bruxelles : Éditions modulaires européennes.
- Egger, P. H., & Toubal, F. (2016). Common spoken languages and international trade. Dans V. Ginsburgh, & S. Weber (Éds), The Palgrave handbook of economics and language (pp. 263-289). Palgrave Macmillan.
- Fiedler, S., & Brosch, C. R. (2019). Der Erasmus-Studienaufenthalt—Europäische Sprachenvielfalt oder English als Lingua Franca? [Le séjour d’études Erasmus – Diversité linguistique européenne ou l’anglais comme lingua franca?] Leipziger Universitätsverlag.
- Fürst, G., & Grin, F. (2018). Multilingualism and creativity: a multivariate approach. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39(4), 341-355.
- Fürst, G., & Grin, F. (2021). Multicultural experience and multilingualism as predictors of creativity. International Journal of Bilingualism, 25(5), 1161–1182.
- Gajo, L., & Pamula-Behrens, M. (Éds). (2013). Synergies Europe (Français et plurilinguisme dans la science), no 8/2013.
- Gazzola, M., Grin, F., Cardinal, L., & Heugh, K. (Éds). (2024). The Routledge handbook of language policy and planning. Routledge.
- Gazzola, M., Templin, T., & Wickström, B.-A. (Éds). (2018). Language policy and linguistic justice. Economic, philosophical and sociolinguistic approaches. Springer.
- Gazzola, M., & Wickström, B.-A. (Éds). (2016). The economics of language policy. MIT Press.
- Gobard, H. (1976). L’aliénation linguistique. Analyse tétraglossique. Flammarion.
- Grin, F. (2004). L’anglais comme lingua franca : questions de coût et d’équité. Commentaire sur l’article de Philippe Van Parijs. Économie publique, 15(2), 33-41.
- Grin, F. (2014). Dépasser les idées reçues. Le Débat, (178), 127-135.
- Grin, F. (2015). Managing languages in academia: Pointers from education economics and language economics. Dans G. Stickel & C. Robustelli (Éds), Language use in university teaching and research (pp. 99-118). Peter Lang.
- Grin, F. (2021). Uniformisation ou pluralité dans l’enseignement supérieur mondialisé : des illusions aux solutions. Dans J.-C. Bonnissent, & P. de Sinety (Éds), Pour des sciences en français et en d’autres langues [Actes de colloque international] (pp. 105-115). Honoré Champion.
- Grin, F. (2022). Internationalisation et anglicisation des universités : diagnostic et éléments de stratégie. Dans J.-Cl. Beacco, O. Bertrand, J. C. Herreras, & C. Tremblay (Éds), La gouvernance linguistique des universités et établissements d’enseignement supérieur (pp. 123-131). Éditions de l’École polytechnique.
- Grin, F., & Masiero, I. (2024). Mesurer la valeur du plurilinguisme suisse. Concepts, méthodes, estimations. Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Grin, F., Sfreddo, Cl., & Vaillancourt, F. (2010). The economics of the multilingual workplace. Routledge.
- Haberland, H., Mortensen, J., Fabricius, A., Preisler, B., Risager, K., & Kjaerbeck, S. (Éds). (2008). Higher education in the global village. Département de Culture et Identité, Université de Roskilde.
- Hultgren, A. K., Gregersen, F., & Thøgersen, J. (Éds). (2014). English in Nordic universities. Ideologies and practices. John Benjamins.
- Hüning, M., Vogl, U., & Moliner, O. (Éds). (2012). Standard languages and multilingualism in European history. Multilingual Matters.
- Ives, P. (2006). ‘Global English’: Linguistic imperialism or practical lingua franca? Studies in Language & Capitalism, 1, 121-141. http://hdl.handle.net/10680/1254
- Jaime, H. (2022). Le plurilinguisme et la créativité scientifique. Dans J.-Cl. Beacco, O. Bertrand, J. C. Herreras, & C. Tremblay (Éds), La gouvernance linguistique des universités et établissements d’enseignement supérieur (pp. 59-67). Éditions de l’École polytechnique.
- Juvin, H. (2013). La grande séparation. Pour une écologie des civilisations. Gallimard.
- Klein, É., Tiercelin, Cl., Judet de La Combe, P., & Klinkenberg, J. M. (2021). Table ronde no 1. Penser/écrire entre les langues. Dans J.-C. Bonnissent, & P. de Sinety (Éds), Pour des sciences en français et dans d’autres langues [Actes de colloque international] (pp. 43-80). Honoré Champion.
- Kraus, P. A., & Grin, F. (Éds). (2018). The politics of multilingualism. Europeanisation, globalisation and linguistic governance. John Benjamins.
- Laforest, M. (2014). Contribution pour une redéfinition de l’internationalisation universitaire. Dans M. Laforest, G. Breton, & D. Bel (Éds), Réflexions sur l’internationalisation du monde universitaire. Point de vue d’acteurs (pp. 1-16). Éditions des archives contemporaines.
- Lane-Mercier, G., Merkle, D., & Koustas, J. (Éds). (2018). Minority languages, national languages, and official language policies. McGill-Queen’s University Press.
- LERU. (2019). Language Policies at the LERU member institutions. https://www.leru.org/publications/language-policies-at-leru-member-institutions
- Lévy-Leblond, J.-M. (1996). La pierre de touche : la science à l’épreuve. Seuil.
- Maurais, J., Dumont, P., Klinkenberg, J.-M., Maurer, B., & Chardenet, P. (Éds). (2008). L’avenir du français. Éditions des archives contemporaines.
- McEntee-Atalianis, L. J., & Tonkin, H. (Éds). (2023). Language and sustainable development. Springer.
- Mélitz, J. (2008). Language and foreign trade. European Economic Review, 52(4), 667-699.
- Montgomery, S. (2013). Does science need a global language? University of Chicago Press.
- Oakes, L., & Peled, Y. (2018). Normative language policy. Ethics, politics, principles. Cambridge University Press.
- Ostler, N. (2005). Empires of the world. A language history of the world. Harper.
- Phillipson, R. (2006). English, a cuckoo in the European higher education nest of languages? European Journal of English Studies, 10(1), 13-32.
- Phillipson, R. (2009). Linguistic imperialism continued. Routledge.
- Phillipson, R. (2012). Language, genocide, and justice in the European integration process: On “Indigenous children’s education as linguistic genocide and a crime against humanity? A global view” by Skutnabb-Kangas and Dunbar and on “Linguistic justice for Europe and for the world” by van Parijs. Journal of Contemporary European Studies, 20(3), 377-381.
- Phillipson, R. (2015). English as threat or opportunity in European higher education. Dans S. Dimova, A. K. Hultgren, & C. Jensen (Éds), English-medium instruction in higher education (pp. 19-42). Mouton de Gruyter.
- Phillipson, R. (2019). La domination de l’anglais. Un défi pour l’Europe. Libre & Solidaire.
- Pilhion, R., & Poletti, M.-L. (2017). … et le monde parlera français. Édition par les auteurs.
- Pool, J. (1991). The world language problem. Rationality and Society, 3(1), 78–105.
- Preisler, B., Klitgård, I., & Fabricius, A. H. (Éds). (2011). Language and learning in the international university. From English uniformity to diversity and hybridity. Multilingual Matters.
- Ricento, Th. (Éd.). (2015). Language policy and political economy. English in a global context. Oxford University Press.
- Selten, R., & Pool, J. (1997). Is it worth it to learn Esperanto? Introduction to game theory. Dans R. Selten (Éd.), The Costs of European Non Communication (pp. 114-149). ERA.
- Skutnabb-Kangas, T., & Phillipson, R. (Éds). (2023). The handbook of linguistic human rights. Wiley Blackwell.
- Stickel, G., & Robustelli, C. (Éds). (2015). Language use in university teaching and research. Peter Lang.
- Templin, T., Wickström, B.-A., & Gazzola, M., (2022). Effectiveness of policy measures and language dynamics. Dans F. Grin, L. Marácz, & N. Pokorn (Éds), Advances in interdisciplinary language policy (pp. 319-342). John Benjamins.
- UNESCO. (2005). Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_fre
- Usunier, J.-C. (2010). Un plurilinguisme pragmatique face au mythe de l’anglais lingua franca de l’enseignement supérieur. Dans Berthoud, A.-C. (Éd.), Les enjeux du plurilinguisme pour la construction et la circulation des savoirs (pp. 37-48) [Actes de colloque]. Académie Suisse des Sciences Humaines.
- Vaillancourt, F. (1996). Language and socioeconomic status in Quebec: measurements, findings, determinants, and policy costs. International Journal of the Sociology of Language, 121(1), 69-92.
- van Parijs, P. (2001). Le rez-de-chaussée du monde. Sur les implications socio-économiques de la mondialisation linguistique. Dans J. Delcourt, & P. de Woot (Éds), Les défis de la globalisation. Babel ou Pentecôte? (pp. 479-500). Presses universitaires de Louvain.
- Widin, J. (2010). Illegitimate practices. Global English language education. Multilingual Matters.
- Wilkinson, R., & Walsh, M. L. (Éds). (2015). Integrating Content and Language in Higher Education. Peter Lang.
- Zanola, M. T. (2024). Language Policy in Higher Education. Dans M. Gazzola, F. Grin, L. Cardinal, & K. Heugh (Éds), Routledge handbook of language policy and planning (pp. 483-496). Routledge.